Une liberté dont l’opposé conceptuel et pratique est l’entrave ne peut, par nécessité, exister sans lui ; les être libérés définis comme non entravés dépendent pour leur existence d’êtres entravés, que la liberté des premiers entrave en retour.
Wendy Brown, Politiques du stigmate, 2016
Liberté : c’est un mot et un champ idéologique d’histoires qui se vomissent à force d’usages et d’idéaux, un vieux couteau au fond du tiroir dont on ne sait trop quoi faire entre tenter de l’aiguiser encore une fois ou en refaire fondre le métal pour lui donner une autre forme, au risque de se retrouver avec une lame à peine bonne à couper du beurre dans les deux cas. “Personne ne sera libre tant que tout le monde ne sera pas libre” résument ces dernières années les multitudes de luttes décoloniales, trans-féministes et anti-capitalistes, où les systèmes d’exploitations économiques et de coercitions politiques sont pensées comme des articulations globales et des interdépendances collectives. Dont les situations singulières semblent vouées aux mêmes reproductions socio-culturelles pour conserver les divers pouvoirs institutionnels et étatiques, et les intérêts confortables d’une minorité d’élites bien installées dans leurs tours d’ivoires locales et internationales.
Dans cette optique on peut saisir en hypothèse avec Wendy Brown que les privilèges de ces minorités dépendent alors des oppressions du reste des populations, que cette “liberté” définie a priori comme puissance d’agir, de choisir impunément son existence, implique forcément, inévitablement la non-liberté d’autres personnes qui en permettent les conditions. Se pose alors la question de ces différentes interdépendances de puissances et d’impuissances, de leurs entrelacements et de nos possibilités à l’intérieur de ces étaux : ce tout le monde sera-t-il vraiment libre ou bien comment envisager des formes de résistances aux oppressions politico-économiques où l’opposé du libre n’est pas le non-libre ? Comment pouvons-nous ainsi définir cette liberté qui est inévitablement contraintes et en discerner les actuels opposés ? En quoi les domaines du symbolique, de l’esthétique, des images et des poèmes sont-ils ou pas un prisme de réflexion-action légitime ?
Ce noeud de paradoxes est une des portes d’entrées que la poétesse et théoricienne Maggie Nelson nous donne en lecture dans son dernier essai De la liberté, qui depuis le contexte des Etats-Unis s’attaque à un chemin d‘analyses de figures archétypales d’émancipations historiques et de ce qui peut se nommer libre actuellement à travers Quatre chants sur le soin et la contrainte. Des études de cas qui se déploient en mouvements d’intersections entre courants de pensées philosophiques établis et expériences empiriques diverses, entre actualités médiatiques et histoires des luttes collectives qui se font relais dans cette nécessité de détailler ce qui peut se reconnaître libre/non-libre a priori : l’art, les sexualités, les consommations addictives de drogues, la crise climatique et ses catastrophes. Des hypothèses de pensées et des états de faits des stratégies d’usages autant politiques que esthétiques - et leurs interrelations - de cette sainte notion de libération qui se retrouve à porter des masques de diables et à devenir un mythe, de comment s’entremêlent les différents champs symboliques et sociaux autour des enjeux de nos puissances d’agir et de leurs entraves.
Nous venons ici pour donner à la discussion nos notes de lectures et les pistes que Nelson propose à travers ces chants et particulièrement celui de l’art auquel elle s’attèle en premier, qui lui permet de poser des fondements de définitions sur les apparitions de ces puissances et impuissances. Où le monde de l’art dans ses mutations et ses régimes d’exceptions est significatif autant en différence qu’en similarité de nos situations socio-politiques. Ses analyses naviguent entre les distinctions de ces champs et leurs récentes remises en questions, les hybridations et les vases communicants qui s’y trament, de comment penser « la différence sans séparabilité » de nos relations et nos confrontations, des porosités de nos rapports d’images, de leurs liens et de leurs disjonctions. De ce qui se présente comme libre, de qui utilise les techniques de représentations et de communications pour s’approprier cette idée-valeur et de quelles manières est-il possible de s’y frayer un chemin sans tomber dans des vortex d’illusions, de morales et de confusions diverses.
« Résoudre la question de savoir comment forger une camaraderie qui ne demande pas à purger ces modes de vies, qui ne se contente pas d’opposer la liberté et l’obligation » nous dit-elle : dans ce déplacement des dichotomies et des oppositions la poétesse amène aussi une partie de son analyse sur nos tendances historiques à vouloir distinguer ce qui serait bon et mauvais, libre et non-libre, pur et sale. Des catégorisations qui font échos aux morales religieuses avec toutes les conséquences de punitions, de censures et d’exclusions dans nos relations aux autres que cela implique, dont il serait peut-être temps de sortir ou du moins de commencer à prendre un minimum de distance. Et le véritable défi ici semble s’annoncer dans l’étape d’après cette prise de distance - qui se retrouve déjà en processus dernièrement autour de l’idée critique de “pureté militante” - dont l’enjeu est de ne pas retomber dans le même genre de grille de lecture ou toute autre forme d’idéalisation qui viendrait en bouée de sauvetage. Ou autrement dit savoir localiser les kinks et ses triggers, discerner les perversions et les nuisibles sans pour autant s’en amputer, leur trouver une place qui ne soit pas dans le déni de nos inévitables humanités pécheresses : « savoir comment reconnaître des compromissions sans pour autant fétichiser la démystification (…) ».

Maggie Nelson pose aussi en fil rouge l’anthropologue David Graeber dès le début et y revient en fin de parcours tout en se gardant de donner des réponses ou des solutions, avec cette citation dont nous tenterons aussi de suivre le chemin ici : “agir comme si nous étions déjà libres”. Et nous la suivrons tout autant sur cette ligne de crête ardue de ce « besoin urgent de stratégies pour éviter de verser dans la paranoïa, le désespoir ou le flicage permanent (…) et pas seulement dans un futur révolutionnaire qui n’adviendra jamais ni dans un passé idéalisé (…) mais ici et maintenant. »
PRATIQUES DE LIBERTÉS ET TEMPORALITÉS POÉTIQUES
La frontalité ambitieuse de ce sujet et titre De la liberté se déploie dès l’introduction en nuances interrogatives, mesurées et contextualisées dans les appartenances socio-culturelles de Nelson et de son intérêt pour ce cette notion : l’idée-même de libre-arbitre est “un mot de Blancs” selon une de ses amies écrit-elle, un concept construit depuis l’Occident et l’histoire des colonialismes européens qui sous-entend celui d’un progrès émancipateur exponentiel sans limite. Où une certaine humanité serait en droit de jouir du monde et de ses possibilités, d’y accomplir ses désirs et ses choix en toute-puissance. Un positivisme manichéen du “monde libre de l’Ouest” décliné à toutes les sauces jusqu’à aujourd’hui et qui dans les faits semble surtout servir à légitimer les guerres et les impérialismes du dit Occident. Et dont les liens avec les désastres écologiques en cours apparaissent de plus en plus évidents. La liberté des uns s’est ainsi faite sur le dos de la non-liberté des autres, sur l’exploitation des ressources naturelles et la misère de populations qui travaillent à produire les richesses qui permettront aux personnes dominantes d’avoir tout simplement le temps libéré de toute contrainte matérielle pour penser et nommer ce concept, et le reste du monde avec. Un processus qui se retrouve dans ce qu’on appelle patriarcat ou aussi la cis-hétéronormativité ou le capitalisme neo-libéral, le tout s’entremêlant tristement ensemble pour certains groupes sociaux. L’un des enjeux de la poétesse est alors de questionner ces historiques et de quelles manières il se sont déplacés depuis le XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Envisager ce que peut signifier liberté à la lumière de ces biais de rapports de forces implique alors non seulement d’en repenser la valeur à l’intérieur de ces derniers mais aussi les conditions qui en permettent sa redéfinition et donc d’autres mises en action d’émancipations possibles.
Maggie Nelson saisit justement la dimension temporelle de nos relations politiques, de comment le rapport lui-même au temps et aux différentes formes de temporalités est lié à ces marges de manœuvres dans nos existences que nous reconnaissons comme libres. Les prises et les reprises de nos temps individuels et collectifs - de ce qui serait donné, conquis et aboli, ou destitué, nous y reviendrons - de nos rapports de représentations, de ce qui est établi comme passé, présent et futur, de ce qui est défini comme a priori une ligne droite exponentielle immuable, un moment révolu ou encore possible de changements. Ces situations dépendent alors peut-être aussi de conceptions historiques et politiques biaisées sur lesquelles nous pouvons agir et penser autrement. Des possibilités de fluidités temporelles qu’elle fait alors discuter entre Foucault et son “labeur patient qui donne forme à l’impatience de la liberté” et la pensée queer de ces dernières décennies dont les transtemporalités ainsi que les expériences d’existences hors du temps hétéronormé mettent à jour les structures de nos chronopolitiques, de leurs impératifs coercitifs en terme de productions et de reproductions. Tordre les lignes droites exponentielles pour en faire des cercles, des boucles entremêlées, des vagues aux multiples circulations comme des portes dérobées de possibilités dans le tunnel du métro-boulot-dodo qui redevient travail-famille-patrie ces derniers temps. Dérober, reprendre, grappiller chaque minute comme chaque baiser tendrement donné.
En ce moment ici en France les luttes politiques se cristallisent symboliquement autour des retraites et donc de l’investissement de nos temps d’existences, et de qui en profite, alors ces perspectives de lectures nous semblent une des briques pour cerner nos possibilités d’alliances immédiates et de résistances sur le long terme. De comment faire coexister plusieurs temporalités d’actions et de patiences, réorienter les timings pour se réapproprier nos représentations-mêmes des formes de chronologies et donc des narrations qui en découlent. Faire des relais aussi, des alternances de qui peut quoi à quel moment. Cela touche cette “mutualisation des expériences” et cette nécessité “de repenser radicalement la fonction et la structure du récit” dont Pierre-Aurélien Delabre parle dans Contre l’art politique, nous en rejoignons les hypothèses de réflexions et les ambitions esthétiques en conséquence : le cœur du pouvoir symbolique est poétique. Et il nous semble aussi que ces sillons de transformations empiriques Maggie Nelson les cherche et les creuse depuis deux-trois décennies autant dans ses recueils de poèmes que ses essais d’esthétique, par une écriture dite non-fictionnelle, un entrelacement incessant de flots autobiographiques et d’argumentations théoriques, de vies croisées et de lectures rencontrées.
Cela implique alors désormais de discuter des conditions d’apparitions de ces formes de réalités a-fictionnelles, de comment notre rapport aux temps va permettre ou pas de faire histoire en soi, d’avoir un pouvoir d’action et d’interprétation autonome sur nos mémoires, nos présences et le sens que cela aurait demain. Reprendre de la puissance sur la maîtrise du dire et de se dire, de la puissance de symbolisation collective, de se raconter et donc de se transmettre, de se relier. Le symbole : ce qui est séparé du tout mais représente tout entier, ce qui est lié par sa séparation. Ce que précisément les pensées queer et décoloniales enseignent depuis un moment déjà : naviguer dans les réinterprétations narratives et les fissures de l’Histoire, et ainsi être en pouvoir de sa propre histoire et des potentielles actions possibles actuellement. Faire tomber les statues et le piédestal du roman national ou aller jouer au paintball de temps en temps avec une équipe amicale, tout peut servir pour transformer nos corps, nos rues et nos idées.
ÊTRE LIBRE = ÊTRE BIEN ?
— La souffrance est un malentendu, dit Shevek, se penchant en avant, les yeux larges et clairs. (...)
— Cela existe, dit Shevek en écartant les mains. C’est réel. Je peux l’appeler un malentendu, mais je ne peux pas prétendre qu’elle n’existe pas, ou cessera jamais d’exister. La souffrance est la condition de notre vie. Et quand elle arrive, on le sait. On reconnaît que c’est la vérité. Évidemment, il est bon de soigner les maladies, d’empêcher la faim et l’injustice, comme le fait l’organisme social. Mais aucune société ne peut changer la nature de l’existence. Nous ne pouvons pas empêcher la souffrance. Telle ou telle douleur, oui, mais pas la Douleur. Une société peut seulement supprimer la souffrance sociale, la souffrance inutile. Le reste demeure. La racine, la réalité. Nous tous ici allons connaître le chagrin ; si nous vivons cinquante ans, nous aurons connu la douleur durant cinquante ans. J’ai peur de la vie ! Il y a des fois où je suis… où je suis très effrayé. Tout bonheur semble futile. Et pourtant, je me demande si tout cela n’est pas un malentendu – cette recherche du bonheur, cette crainte de la douleur… Si au lieu de la craindre et de la fuir, on pouvait… la traverser, la dépasser. Il y a quelque chose au-delà d’elle. C’est le moi qui souffre, et il y a un endroit où le moi… s’arrête. Je ne sais pas comment le dire. Mais je crois que la réalité – la vérité que je reconnais en souffrant et non pas dans le confort et le bonheur – que la réalité de la douleur n’est pas la douleur. Si on peut la dépasser. Si on peut l’endurer jusqu’au bout.
— La réalité de notre vie est dans l’amour, dans la solidarité, déclara une grande fille aux yeux doux. L’amour est la véritable condition de la vie humaine.
Bedap secoua la tête.
— Non. Shev a raison, dit-il. L’amour n’est qu’un des moyens, et il peut se tromper, ou manquer. La souffrance ne manque jamais. Et nous n’avons donc pas tellement le choix de l’endurer ou non ! Nous le devrons, que nous le voulions ou pas.
La fille aux cheveux courts secoua fortement la tête.
— Mais nous ne le ferons pas ! Un sur cent, un sur mille, va jusqu’au bout. Le reste d’entre nous continue à prétendre que nous sommes heureux, ou se contente d’être engourdi. Nous souffrons, mais pas assez. Et ainsi nous souffrons pour rien.
— Que devrions-nous faire ? demanda Tirin. Aller nous frapper la tête avec un marteau pendant une heure chaque jour pour être sûrs que nous souffrons assez ? (...)Les Dépossédés, Ursula Le Guin, 1973
La science-fiction d’Ursula Le Guin a cette intense complexité spatio-temporelle de faire l’expérience de pensée de mondes politiques dans leur ensemble et d’en pousser les limites ontologiques, pratiques, culturelles, de voir jusqu’où ça peut aller avec ces conditions narratives spécifiques. La structure même de la série de romans du Cycle de l’Ekumen n’est pas une temporalité linéaire : ce qui fait finalement chronologie ce sont les processus technologiques de communications et de transports qui se transforment, permettent les rencontres et les liens, l’histoire commune. Et les livres passent d’un moment à un autre comme d’une planète à une autre. Les possibilités/impossibilités de mouvements, rythmes et vitesses en définissent les rapports de représentations, les différences de temporalités mettent en exergue les formes de capacités et d’anticipations d’actions des personnages. Chaque récit est dans un rapport au temps et à l’historicité spécifique, et donc au langage, à ce qui se déplace en termes de corps ou d’informations et à quels moments ; des conditions finement explorées par l’autrice pour chaque monde-civilisation dont l’Ekumen est la confédération qui les regroupe à travers les distances de l’univers.
Le monde mis en oeuvre dans Les Dépossédés est double, les deux faces d’une même pièce en hypothèse : Urras la planète ultra-capitaliste comme nos gouvernements actuels en rêvent et Anarres sa lune ascétique anarchiste qui fait sa vie d’indépendante accomplie depuis presque deux cent années terrestres. Dont peut-être nous rêvons un peu moins de l’autre côté si on a l’habitude d’un relatif confort quotidien, de certaines satisfactions de possessions ou plaisirs accumulés comme rapports de bien-être et c’est bien là l’un des enjeux que questionnent Le Guin en 1973 et Nelson en 2022 : quel est ce lien préétabli entre se sentir bien et se sentir libre ?
De quelles manières s’articulent cet être-bien avec ce que nous définissons comme bon, sain ou nuisible, avec nos représentations elles-mêmes de ce que nous nommons accomplissements, finalités de nos besoins et souffrances ? Quels processus historiques idéologiques ont structuré ces images idéales de l’existence humaine comme non-manque et jouissance absolue du monde ? En quoi cela est-il assimilé à ce qui se définit comme liberté ? Comment cela s’est-il relié à cette notion de bonheur en tant que libération des douleurs et des insatisfactions mais aussi affirmation d’une puissance ? Un être-libre qui serait ainsi un être-distance, un séparé de nos expériences ontologiques négatives ?
Comment se construit ce rapport au bonheur-liberté et à sa valeur dans nos existences individuelles et collectives, en quoi cela conditionne et justifie des discours-actions politiques ? Et enfin comment peut-on penser, mettre en œuvre des formes de représentations communes d’émancipations et de rapports au soin - de l’autre et de soi - qui puissent différer de ces binarités manichéennes ?
Le lien que nous suggère Maggie Nelson sur ces questions est d’abord bien celui du plaisir de puissance, de la jouissance du monde qui serait dûe à l’humanité et de l’infinité de ses possibilités : cette sensation de l’expérience du pouvoir qui nous préserverait des maux de l’existence et de ses contraintes, qui nous permettrait de choisir de nous protéger de préjudices aliénants et des incontrôlables contextes qui nous traversent. Ce mythe occidental colonial post-bourgeois viriliste des Lumières suppose alors ce “sans limite” de nos légitimités à agir et à désirer, et que seule cette condition d’affirmation de force conquérante serait le moyen salvateur de nous défaire des moments douloureux/non-heureux de nos vies individuelles et collectives, de prévenir nos failles-faiblesses et de nous en séparer, et donc de nous en libérer. Cette libération par séparation, par scission et suppression, comme si l’abondance de la vie n’était pas liée à l’interdépendance du vide et de la mort ; ce qui remplit autrement nos existences de présences et d’absences.
Ce processus de symbolisation politique se situe et s’entrelace depuis déjà un moment avec nos temps téléologiques et économiques, c’est-à-dire nos institutions religieuses en charge des croyances existentielles - nos images - associées aux intérêts des savoirs matériels et des prédations de marchés, qui s’incarnent et se structurent en classes sociales compartimentées, le tout s’étant transformé, dissocié, retissé de mille manières pour conserver et reproduire le système de pouvoirs en place. C’est ce qui nous pose problème par exemple dans les processus abolitionnistes : ce que la classe dominante veut bien céder en accord de compromis, et donc abolir, est-il vraiment une conquête politique ou bien n’est-ce pas juste quelques miettes lâchées aux pigeons comme stratégie d’adaptation et d’assimilation des contre-pouvoirs ? Mais sinon pourquoi parle-t-on encore de classisme, de privilège blanc ou de mansplaining ? Nous ne referons pas ici l’histoire des idées multiples depuis au moins le XIXe siècle qui pensent ces mécanismes oppressifs sous toutes leurs coutures et conséquences dans nos sociétés… Nous ne sommes que des artistes dans un multivers post-marxiste-éco-transféministe-décolonial sur une terre matrixée en train de cramer qui envoient des poèmes d’amours pour draguer. Il nous faut cependant relever quelques strates de ces postulats qui sont encore à l’œuvre de différentes manières et sur lesquels nous marchons inévitablement comme dans des sables mouvants, dont il faut cerner l’enracinement sans vouloir pour autant tout purger comme des mauvaises herbes. Il est question de cultiver un jardin commun.

Des intrications du protestantisme et du capitalisme bien-sûr, du post-colonialisme au prisme mondialisé du judéo-christianisme européen dans ce rapport de libération de la souffrance aussi, du sacrifice et du plaisir dans les cosmogonies monothéistes dans leur ensemble tout autant, des constructions sociales et symboliques qui se jouent dans le don de la mise en gestion du monde et de ce que nous en faisons, des dettes de cette donation de puissance de transformations que cela engendre inéluctablement. De ces imperfections humaines qu’il faudrait corriger, amputer ou guérir, de ces fatalités prises pour acquises comme des étaux immuables et de ces promesses d’un mieux, d’un état permanent de félicité comme un ticket gagnant si on souffre assez au labeur avant. Le mérite et les déchets, la déchéance de l’impureté et ses punitions narcissiques, du problématique qu’il faudrait abstraire ou réparer, nettoyer ; ces notions et leurs puissances symboliques nous semblent encore irriguer les différentes strates sociales contemporaines plus ou moins directement.
De cette idée de la retraite comme temps mérité après avoir assez accepté pendant x décennies les rouleaux-compresseurs du travail capitaliste, quelques miettes d’années qui actuellement sont reprises par les politiques-financiers, mais dont les attaques fissurent cette croyance collective de ce qui seraient de justes répartitions temporelles, de qui est en dette de qui. On comprend alors mieux les tentatives d’éléments de langages médiatico-politiques sur “la seule issue possible” d’une telle réforme pour “sauver le système par répartitions” et que les dites entités politiques “ne font pas ça par plaisir”, que finalement tout le monde doit donner du sacrifice sur l’autel du CAC40 ; sauf les régimes spéciaux des députés, des sénateurices, des flics et des militaires, ça c’est ok c’est conservé dans le texte. Pas besoin de sadisme pour se garder les bonnes parts du gâteau, juste de la cupidité et de l’égocentrisme avec une bonne pincée de corruption.
Nelson rappelle l’histoire étymologique du mot obscène, littéralement ce qui se tient devant le sale. Jouir de la vie oui mais pas n’importe comment ni avec n’importe qui. Dans un précédent livre - Les Argonautes - elle cite à un moment le tract d’activistes queers non-assimilationnistes pendant un mois de Gay Pride aux alentours de l’université où elle enseigne : Pour la destruction totale du Capital, / de sales chiennes qui vont vous foutre le bordel. Et elle en parle juste après avec l’hypothèse du risque de fétichisation inversée, qu’elle partage la même joie de renversements de l’ordre social actuel mais qu’elle redoute le kinky mythe révolutionnaire qui dépend du même paradigme que les adversaires : « Notre diagnostic est similaire, mais notre perversion n’est pas compatible » conclue-t-elle sur le sujet en 2015.
Ce n’est pas la jouissance en soi ou les perversions qui nous font mouiller-bander qui lui posent problème - le premier paragraphe de la première page de ce livre est un beau moment de sodomie amoureuse et enchaîne sans transition sur Wittgenstein et l’inexprimable de l’exprimé - mais de comment on les associe et vers quels objets-finalités cela tend, quel temps ça prend et reprend. Sept ans plus tard, elle se demande comment discerner le plaisir des transformations saines de celui des jubilations oppressives, de comment engager des formes de puissances qui acceptent leurs contraintes, leurs interdépendances et leurs déchéances. Les tendresses et les violences qui font une même force sur différents moments. Si ces derniers mois la communauté queer se questionne sur son rapport au capital beauté, à ses impératifs de séduction et de performativité sociale ce n’est peut-être pas un hasard ; et sans pour autant se flageller ou cancel à tout va mais juste déplacer jour après jour les dons et les dettes de nos attentions et de leurs bienveillances. De ce qui est désirable non pas comme extase infinie atemporelle mais comme rapport au monde et à l’autre moment après moment, comme limites des valeurs de nos délectations, de leurs incessantes transformations et des coups de marteaux qui nous rappellent que la joie est autant passagère que la douleur. Ni l’une ni l’autre n’est affaire de possession ou de mérite nous semble-t-il lire chez Le Guin aussi, chacune a son rythme et ses intensités : il y a plutôt cette proposition d’une endurance, d’une traversée des différents temps et états de nos conditions d’existences. Ou autrement dit chez Maggie Nelson lorsqu’elle conclut son chapitre sur l’archétype art et ses reponsabilités autant symboliques que politiques : « le plus souvent, on reste dans la merde (...) c’est simplement le signe que nous sommes, ou avons un jour été, en vie. »
INJONCTIONS, COMPROMISSIONS ET COMPULSIONS
Nous rappelons ici en préambule que les champs du monde de l’art contemporain et l’histoire occidentale dont il est issu sont à considérer comme une impasse idéologique, une construction politique institutionnelle et un rouage spéculatif économique qui participent au maintien de l’ordre sociétal année après année, siècle après siècle. Nous en avions exploré quelques enjeux et figures, les impossibilités et les paradoxes dans nos précédentes critiques - à propos de Smirna Kulenovic et d’Anne Imhof, qui s’articulent en contribution dans les discussions collectives actuelles. Et c’est précisément ces états de faits, de ces impuissances de l’Art et de ses instrumentalisations au service des dominations politiques et des exploitations économiques - et de comment les artistes se retrouvent sans cesse entre le marteau et l’enclume - qui nous mènent ces dernières années à penser ce qui peut être nommé en réponse comme un pouvoir symbolique, et non pas artistique.
Une puissance esthétique : ces gestes-formes de poèmes en dehors des mythes de l’art et de ses génies messianiques ; agir avec ces pratiques du poétique comme lien d’endurance entre les tendresses et les violences. Pour ne pas se défigurer, pour ne pas perdre nos visages ni nos amours, pour survivre à la mort des divinités, de l’Histoire et à celle de tous nos idéaux positivistes progressistes exponentiels. Pour ne pas leur laisser le monopole des images et de définition de ce qui est bon, beau et sale ; pour ne pas devenir ce contre quoi nous résistons. Maggie Nelson parle des artistes comme des êtres de compulsions qui absorbent le monde toujours un peu trop pour que ce soit supportable ou acceptable, des nausées qui nous font vomir continuellement ce qui pourrait être autrement. Ce qui reste possible malgré toute la merde.
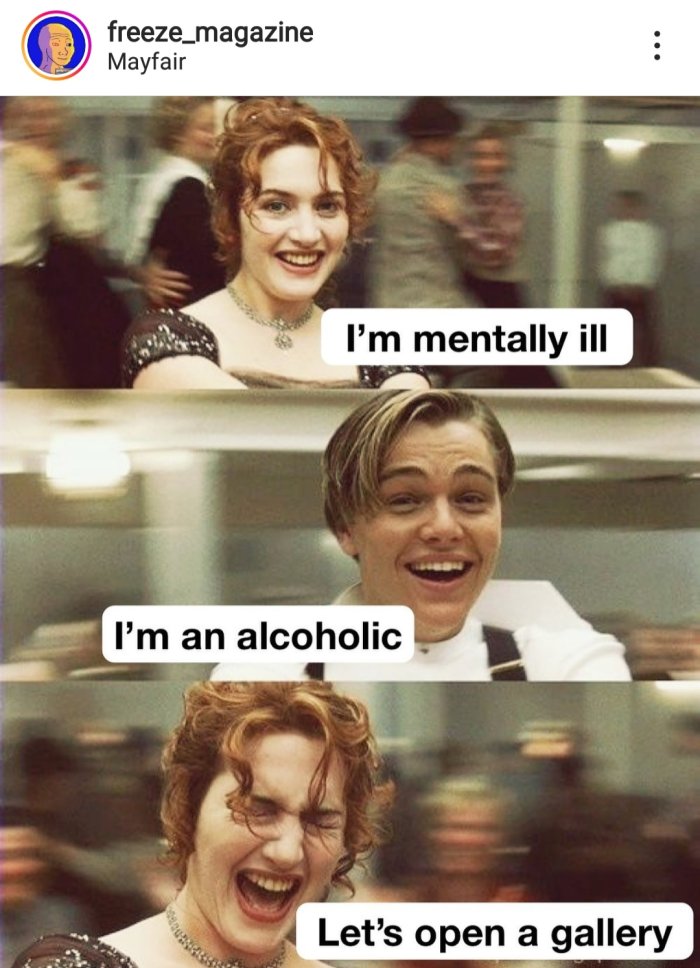
L’histoire comme l’actualité du monde de l’art en tant qu’instrument du pouvoir politico-économique a ainsi comme utilité d’incarner et de perpétuer ces valeurs attribuées à ce qui est libre, à l’accomplissement de formes d’émancipations et des impacts collectifs que cela aurait : de ce bien-être de la figure de l’artiste qui ne fait que ce qui lui plaît en toute-puissance désirante devant sa toile à peindre. L’accomplissement d’une vocation quasi-mystique qui dans les faits aujourd’hui jongle entre xanax et blanchiment d’argent ; en novlang on va parler de montage d’optimisation financière et de défiscalisation à 75% des impôts, on comprend pourquoi nos ultra-riches sont si généreux à aider à l’acquisition d’oeuvres pour les musées nationaux ou à la rénovation des vieux trucs brûlés. Parce que ça leur reviendra d’une manière ou d’une autre, d’une dette à une autre. Un peu le même genre de bails que les autoroutes vendues aux privés début 2000 mais avec la touche glamour du vernis culturel ; notre douce fRance semble ne plus être souveraine ni de ses infrastructures routières nationales ni de ses héritages symboliques collectifs, de moins en moins, année après année, dette après dette.
Nelson propose le domaine de l’art comme un des archétypes parmi d’autres où le tissage de ces liens liberté-contrainte est visible, mais elle en note la spécificité par le statut juridique qui diffère des autres actions humaines légales/illégales dans nos sociétés occidentales. Un régime d’exception de l’expression-action qui s’est construit jusqu’à aujourd’hui dans ce que l’on définit comme oeuvre en tant qu’espace de liberté de représentation, de la distinction de l’oeuvre avec l’ouvrage, et de sa valeur autant politique que financière, là est bien l’enjeu de la reconnaissance de ce qui est ou pas art comme légitimité d’existence sociale. Hypothèse : tant que les artistes se croient libres et le public avec, alors les laisses attachées à leurs jolis colliers resteront invisibles. Autre hypothèse : les stratégies néo-libérales du monde du travail ont intégré ces idéaux de l’art-liberté-bonheur comme management des individus, comme capital créatif utile à l’entreprise ou l’institution, où chaque personne doit être spéciale, s’identifier et se mettre en scène socialement, faire preuve d’innovation, de fun, de productivité. Ces forces de propositions et ces auto-promotions en flux continu qui nous épuisent plus qu’elles ne nous apaisent.
Ce qui nous amène à l’autre spécificité de l’étude de cas art que l’autrice va analyser en combinant plusieurs approches théoriques et empiriques : de comment les fantasmes de l’art et de ses idéologies se sont dé-compartimentées et ont été déplacées dans d’autres strates sociales comme stratégies entrepreneuriales et politiques. Comment autant les puissances en place que les résistances adverses ont remis en question le statut et les légitimités de l’art ; comment et où ces processus de mouvements de réappropriations et de transformations de nos rapports symboliques se jouent actuellement. Un état des lieux des polarisations et des divisions où elle propose de chercher des chemins de dosages de nos attentes et de nos idéaux sans pour autant lâcher les actions critiques, et poétiques, où parfois I care nécessite un I can’t.
CHOCS ET SOINS, PARANOÏAS ET RÉPARATIONS
Nelson envisage l’histoire de l’art occidentale du XXe où se sont construits les mouvements artistiques majeurs et de leurs figures comme symboles politiques d’émancipations collectives, avec ce début de siècle tissé aux contextes géo-politiques européens. Des guerres successives et des avant-gardes autant militaires que esthétiques à la croisée des poussées technologiques, qui ont déplacé les pratiques-fonctions des images depuis l’invention de la photo/cinéma jusqu’à nos smartphones. Et il y a l’Artiste qui vient libérer cognitivement le public par l’éveil perceptif, sensible, conceptuel via des œuvres d’art transcendantales et transformatrices des consciences individuelles. Sauver les masses en produisant des marchandises culturelles, lever le voile des vérités au grand public pour faire déclic du grand soir, réveiller ce public par un art du choc. Un soft power qui s’est bouffé à toutes les sauces décennie après décennie jusqu’à être usé jusqu’à la corde par les gouvernements successifs, qui sur sa fin de siècle post-coloniale a donné lieu à l’émergence de réponses à ces impasses et réappropriations symboliques. Où depuis les marges sont arrivées d’autres pratiques libres qui redéfinissent leurs portées en réponse aux instrumentalisations et propagandes politico-économiques, en tentative de forger d’autres possibilités autant d’être-bien que d’être-libre, d’y penser cette relation comme processus alternatif à l’accumulation-exploitation des biens, des corps et des datas.
Ce tournant éthique et esthétique s’est envisagé à travers le rapport au soin, et tous les courant d’études du care outre-atlantique, du souci de l’autre comme empathie collective et formes de communications-relations qui prennent en compte les limites, les préjudices, les besoins de guérisons face aux douleurs et oppressions diverses, de ce qui se définit comme moyens de résiliences et de résistances. La force et la puissance ne sont plus envisagées comme coercition, conquête et agression à tendance testostérone mais dans ces capacités à acter des rapports non-nuisibles à son environnement et entourage, à soigner ses relations aux autres et à soi. Nelson fait remarquer que ces rapports au soin peuvent être aussi des pratiques de relation avec le non-vivant, les formes et les matières, de soigner ses gestes et ses poèmes, de la délicatesse d’un tissu ou d’un papier qui demandent de l’attention. Et l’assimilation politique de ces dernières années a alors transféré la figure de l’artiste qui sauve à l’artiste qui soigne, qui est en responsabilité symbolique de panser-penser les maux collectifs ; qui doit prendre soin de son public et se soucier des conséquences de ses oeuvres en terme de bien-être et de préjudice. La mère idéale de certains néo-vieux schémas sociaux qui doit être sur tous les fronts avec option dévouement total. En fRance actuellement on ne compte plus les appels à candidature pour des résidences de créations en milieux scolaires/publics, dans les petites et grandes collectivités, dans les quartiers isolés ou dits sous tension, avec cette condition de proposer des ateliers et des sessions de médiations, de penser l’intégration au milieu local et de travailler avec, etc. En soi, prendre en compte son environnement et les contextes socio-économiques dans lesquels on débarque en tant qu’artiste cela est tout à fait cohérent et sain, mais être un pansement-rustine des fractures politiques de plusieurs décennies de coupures budgétaires et autres défragmentations des services publics c’est cyniquement malsain. L’art du choc et l’art du soin comme alternative libre, sauver le collectif ou bien le réparer ? Et comment envisager les responsabilités et légitimités autant politiques que esthétiques en conséquence ?
Que ce soient le capitalisme ou nos systèmes démocratiques post-seconde guerre mondiale, les libérations messianiques toutes-puissantes ont non seulement prouvé leurs impasses écologiques et ontologiques dans leurs disproportions destructrices des rapports libres/non-libres, mais aussi par ces biais injonctifs d’idéaux de bonheur et de monde libre, de l’imagination infinie créatrice ou des jets privés à tout-va, des méga-installations d’art contemporain qui font fonctionner autant de mains sous-payées que les grandes entreprises désormais, ou des autres domaines du monde du travail qui cherchent les profils out of the box. L’idée commune très vingtième siècle qui distingue ce monde du travail - entendu comme trepalium et donc inévitable douleur-pénibilité avant tout mais qui mène aux dialectiques sacrifice/mérite/bonheur - du monde de l’art, où le travail créatif serait d’abord source de plaisir, de la passion alliée à la souffrance des conditions d’existence, et donc plus libre puisque la douleur serait choisie. D’autres dialectiques qui impliquent le don et le génial, du génie individuel qui distingue quelques personnes et actuellement surtout un bon carnet d’adresses. Libre-choix de la création et vocation transcendante, du mystère du poétique mis en boîte de Pandore avec les mystiques spéculatives et les croyances divines comme des Twix ; du sucre, des opiums, encore des opiums, et des entre-soi.
L’occasion était trop belle pour les managers corporate, les DA de pubs et autres stratèges des réseaux de mixer tout ça ensemble, de nous proposer un trepalium mais design, tout doux tout confort et avec écran intégré. Kinky néo-libéralisme qui tricote nos pulsions les unes avec les autres. Le travail d’entreprise comme réalisation de soi et des autres, et qui comble tous les besoins potentiels c’était le dada de la Silicone Valley, de Google et consorts qui assurent à leurs employés nourriture à foison, services, soins directement sur place, comme à la maison. Chez Twitter il y a eu quelques changements depuis l’arrivée martienne de Musk, y’a plus de pizza tous les jours. Elon est un savant mélange de néo-conservatisme post-technologique, c’est lui le génie et les autres creusent, et comptent leurs lignes de codes comme preuve de travail effectif. Mais il semble qu’il y a toujours d’une manière ou d’une autre ces impératifs à se distinguer, à cultiver ses spécificités comme identités de performances sociales, de kiffer sa best life, d’être fun et libre. Tout ce bordel de développement personnel et de méditations importées d’autres cultures pour faire pansement des plaies occidentales, et continuer de faire tourner la machine.
Les communautés issues des mouvements queers, post-coloniaux et féministes, non-blancs, non cis-hét, non productifs normalement ont pensé le soin à travers les processus de préjudices éthiques-esthétiques qui nécessitent des formes de tactiques réparatrices, et qui s’entremêlent aussi avec le soin comme protection et anticipation des griefs, d’une stratégie paranoïaque, dixit la poétesse en citant les travaux de José Munoz et Eve Sedgwick. De ces expériences pratiques de justices réparatrices, des responsabilités politiques et visibilités symboliques qui sont mises en question, déplacées, remises en récit collectif et en paroles individuelles. Des réflexes de survies quotidiennes et d’entre-aides affectives et matérielles, effectives, résistantes et non toutes-puissantes, endurantes. Du dosage de l’autonomie et de l’interdépendance. Des danses voguing qui se répandent aux réseaux souterrains fournissant testo-oestro sur des centaines et milliers de kilomètres, des assignations de naissance, à résidence du genre et du sexe, et des choix pour ne plus subir ce qui n’est pas bon pour soi, du risque de se faire tuer juste pour ce que tu représentes. Du qui-vive et de l’hyper-vigilance, du temps non-linéaire du trauma et de ses boucles, de l’endurance encore ici. De ces bienveillances, résiliences, empathies, tendresses, des contacts sensibles et joyeux en réponse. Des forces douces et tranchantes, des économies d’énergies et d’attentions qui se diffèrent en plusieurs temporalités aussi et sont en capacité de distances critiques, de moments de latences entre observations, actions furtives et esthétiques virales.
Une partie de ces notions sont déjà en cours de réappropriation ces dernières années par les machines médiatico-politiques dominantes, en exponentiel depuis la pandémie, moment où Maggie Nelson finit d’écrire De la liberté. Elle va venir chercher des poux sur ces digestions sémantiques et symboliques qui désamorcent les alternatives émancipatrices-réparatrices en ingérant les éléments de langage pour les retourner ; mais aussi sur les limites en-soi de ces pratiques récentes, de ce rapport au don comme soin qui peut vite induire un tout-donner, une dépense-donation totale qui revient à des formes d’absolu, de toute-puissance par ce tout-bienveillance. Ce souci de l’autre, d’une situation, d’une relation dont on ne peut pas toujours être en soin, dont nous ne sommes pas forcément en capacité. Cela m’importe, I care, mais je ne suis pas en possibilité d’y remédier, I can’t ; il n’y a pas la ressource, ou pas complètement, ou pas à ce moment-là. Quand aider une personne revient à ne pas l’aider, à la laisser faire. “Ce qui est fait pour nous, sans nous, est en fait contre nous.” disait Mandela en citant Gandhi.
Un laisser-la-place aussi, que la bienveillance ne deviennent pas injonction passive-agressive, un trop-plein de don à l’autre qui peut glisser vers des formes de contrôles coercitifs mais aussi de redevabilité, de dette affective ou de totale anticipation des be-soins. Encore de l’absolu et du parfait, du pur don de soi et de l’autre qui passe par des pratiques de prévisions de ce qui va advenir, des futures nécessités, d’en envisager toutes les possibilités et conséquences. Ce qui laisse peu de place aux surprises, aux hasards, aux imprévisibles : vouloir éviter ce genre d’inévitable nous semble vain, et nous sépare un peu plus de nos potentialités poétiques comme politiques qui ne sont pas encore advenues. Et ce serait se priver d’un avantage tactique non négligeable, cet effet de surprise dans ce monde hyper-technologique où tout se calcule et s’anticipe, ou presque. De même pour les stratégies paranoïaques, utiles, vitales parfois, mais l’épuisement d’une vigilance constante se double d’un idéal d’omniscience, d’absolu de la prévention et des impacts de tel acte, ou telle oeuvre d’art, qui referme les limites de nos possibilités pour l’autrice : « (...) l’homogénéisation de la logique paranoïaque demande à ce que tout le monde réponde à ces questions uniformément, à jamais. »

C’est aussi ce rapport au temps et à nos avenirs qui va différer des temporalités esthétiques et poétiques, du politique aussi, et ces différentes conditions se confrontent, se confondent, se déplacent et s’entremêlent. Un désir d’anticipation totale des préjudices, une peur de ce qui ferait mal et qui pourrait être évité. Ca ne veut pas dire que ce n’est pas légitime ou authentique, et parfois nécessaire rappelle l’autrice, mais que dans l’objectif d’un processus collectif aux trajectoires individuelles diverses et parfois inévitablement en conflit - d’idée, de besoin ou d’intérêt, il est question de trouver pour Maggie Nelson des formes de protections, de dissociations ou de dissensus qui ne nous séparent pas pour autant. Qui font qu’on ne va pas s’effondrer absolument et que « Le fantasme selon lequel, avec suffisamment de prévenance (...), nous n’aurions pas eu à vivre cette sale expérience (...) n’est un modèle ni représentatif, ni fructueux, ni sain. » (p.110)
CHRONOLOGIES ESTHÉTIQUES, RÉSISTANCES ET REPLIS
« L’art a parmi ses attributs les plus fascinants de s’inscrire dans une disjonction temporelle entre sa composition, sa dissémination et sa considération - un écart où surgissent l’humilité et l’émerveillement. » (p.50)
Ce qui est appelé art par la poétesse a cette particularité de disjonction temporelle qui est à l’oeuvre dans les gestes poétiques dans leur ensemble nous semble-t-il, et ces conditions diffèrent de celles des actes politiques tout comme des logiques économiques : leurs finalités, leurs applications et leurs fonctionnalités peuvent alors facilement se retrouver en conflit mais aussi en confusion dans ces volontés et tentatives de les faire concorder ou s’accorder. Cependant l’enjeu ici qu’elle pose est de cheminer vers des formes d’associations et d’alliances entre les différents domaines, des configurations collectives de ces puissances spécifiques qui ne sont pas pour autant opposées et strictement séparées. De définir les liens d’influences et leurs distinctions comme faisant partie d’un même mouvement. Et surtout, qui n’ont pas forcément à « correspondre aimablement », dont les frictions et les contradictions peuvent justement amener à mettre en place des alternatives dialectiques aux vieux schémas historiques ou aux tentatives plus récentes. Trouver des formes d’inter-relations comme stratégies communes qui assument les paradoxes et les désaccords, des échanges et des fluidités qui ne deviennent pas à leur tour entraves ou oppressives.
La temporalité esthétique se distingue par cet enroulement et entremêlement de plusieurs rapports au temps, à plusieurs moments de passé-présent-futur dont certains ne sont contrôlables ou anticipables ni par sa source ni par le public en réception : de la composition, qui résulte d’un mélange d’influences passées et de désirs présents et de volontés futures, à la dissémination et la considération que cela peut amener autant dans l’époque présente qu’à celles encore en devenir et tout cela en regard de ce qu’il reste d’historique et en mémoire… L’objet poétique plie et replie nos temps et leurs mouvements, garde ensemble ce qui est révolu et ce qui advient d’une prochaine lecture, fait tenir en simultané les potentialités de puissances et impuissances, de ce qui fait signe en creux des hasards et des chaos. Entre les chocs et les soins il y a peut-être ces choses qui coulent, qui ruissellent en suspension de leurs fonctions. « Mais il y a une différence entre se tourner vers l’art dans l’espoir qu’il réifie une croyance ou une valeur qui nous était déjà propre et s’insurger s’il la contredit, et se tourner vers l’art pour voir ce qu’il fait, ce qui s’y passe, en le considérant comme un espace où découvrir ‘les communiqués insolites et tangibles de la pensée et du ressenti des autres autour de nous’, comme l’a dit un jour Eileen Myles. » (p.43)
Ces conditions chronologiques non-linéaires et non-homogènes nous mènent alors à quelques noeuds possiblement conflictuels avec les stratégies de réparation et de paranoïa mais aussi avec celles politiques de manière plus générale : de ces impératifs socio-économiques, ces instrumentalisations du symbolique et de ces responsabilités éthiques attribuées successivement et simultanément à ce qui apparaît dans le contexte de l’art. Maggie Nelson articule avec tendresse les différentes composantes et dynamiques de relations possibles entre acte poétique et geste politique, des implications et des remises en questions récentes du statut d’artiste et de ses objets, de comment le public peut y répondre quasi directement à la faveur de nos communications technologiques en expansion. De comment en effet nos esthétiques et nos symboles ont un impact cognitif collectif autant qu’individuel, il paraît qu’en Belgique les médecins peuvent prescrire des visites au musée pour accompagner les soins dépressifs : les effets de perceptions-réceptions d’objets poétiques sont visibles quand on scanne nos cerveaux avec toutes ces machines neuro-médicales, ça stimule et ça aide, mais ça ne sauve pas ; pas toujours.
De qui est médiatisé dans nos arènes sociales post-spectacle et de quelles influences cela sert aussi. La poétesse considère la légitimité des troubles psycho-somatiques, des systèmes productivistes-positivistes broyeurs des désirs et des regards, des formes d’exploitations et de dominations qui portent authentiquement préjudice, des faits historiques du colonialisme et de l’idéologie raciste encore à l’oeuvre aujourd’hui, de ce care qui répare et qui prend soin de ne pas encore plus entraver. De cette stratégie récente efficace d’assimilation des préjudices matériels et cognitifs, d’éviter de heurter la sensibilité comme si c’était un coup de poing, mais aussi de répondre et de nommer la réalité des violences autant visibles qu’invisibles. Mais peut-on vraiment éviter tout préjudice ? Elle pose donc la question si, pour autant toutes ces nécessités et légitimités politiques, les gestes poétiques et les artistes se doivent d’être tout le temps et en tout lieu dans un processus d’anticipations politiques et d’incarnations idéologiques visant telle ou telle finalité. De soigner ou de faire plaisir, d’être dans un don absolu de vocation. D’avoir des flics dans la tête aussi. Et a posteriori dans les étapes de disséminations et de considérations au moins dans son époque, quelles conditions de discussions, de réceptions et de contradictions sont possibles et envisageables ? « (...) mettre sur un pied d’égalité le destin d’une oeuvre d’art et le salut ou la destruction de vies humaines est une construction qu’il y a de bonnes raisons - y compris d’un point de vue éthique - d’interroger, voire, dans certaines circonstances, de récuser. » p.69
Et Nelson ajoute encore « La possibilité qui nous est donnée de nous adresser directement aux artistes pour leur faire part de nos émotions qu’ils nous ont inspirées ne les rend pas pour autant responsables de nos états d’âmes. » ; c’est un parti pris définitif mais qui sous-entend une discipline de nuance des degrés de préjudices, des responsabilités politiques et symboliques qui s’entremêlent en plusieurs temporalités distinctes et dont les conséquences ne sont peut-être pas si absolues, pas si fatales. Parfois c’est sale, c’est amoral, c’est violent, c’est significatif de tel ou tel contexte des individus comme du rapport au collectif, et c’est tout à fait nécessaire-légitime de le discuter et de le remettre en question. Cela peut être considéré comme représentatif de tels mécanismes de dominations systémiques ou tels autres : c’est compulsions humaines autant positives que négatives, c’est Douleur et Plaisir. Et l’autrice n’ignore pas pour autant les enjeux de places de pouvoirs et d’influences, des devants de scènes et des problématiques d’appropriations historiques : de qui est visible, de comment les mouvements dits progressistes de ces dernières décennies ont installé une légitimité de réponse à la réception des images et des objets culturels. De ce qui est en train de se déplacer en termes de pouvoir symbolique et d’emprise des narrations, des reprises de ces temps de transmissions des expériences, de qui est en légitimité directe d’en parler ou pas. C’est le fameux ouin-ouin du on ne peut plus rien dire, et encore moins rire : c’est pas que tu peux plus rien dire, c’est juste qu’en conséquence en face ça ouvre sa gueule et ça mord si besoin.
Elle rappelle que ce qui se nomme censure est le propre des personnes qui détiennent le pouvoir, qui ont la capacité politico-économique de mettre en œuvre des processus administratifs, judiciaires, médiatiques ou moraux qui bloquent l’apparition et la transmission politique. Les stratégies de contestations et d’oppositions des notions de légitimités ou de représentativités de telle exposition ou telle personne publique dite artiste, qui se sont construites et affirmées ces dernières années à travers les mouvements féministes et décoloniaux particulièrement, sont ainsi historiquement du ressort des personnes dénuées de pouvoir et qui amènent à une transformation des rapports de forces justement. L’efficacité de ces processus implique alors de penser cette redistribution des puissances, ces déplacements des reconnaissances collectives et des responsabilités individuelles autant symboliques que politiques. Et Maggie Nelson en propose une analyse dans le cadre de nos histoires de libérations positivistes et des enjeux actuels d’instrumentalisations esthétiques, des tactiques paranoïaques et réparatrices qui se sont mises en place en conséquence et en résistance, des ressources et des limites de nos devoirs de soin.

Cette analyse passe par l’étude de cas de deux épiphénomènes de 2017 liés au monde de l’art aux Etats-Unis qui donnent corps à ces déplacements de puissances éthiques et esthétiques : les contestations des artistes Dana Schultz et Sam Durant, respectivement pour une peinture à propos du meurtre raciste d’Emmett Till lors de la Whitney Biennal et pour une installation citant le génocide des native americans et de la communauté Dakota particulièrement au Walker Art Center. Dans les deux cas les artistes n’ont aucune attache directe avec les groupes sociaux persécutés cités, iels sont au contraire en lien avec la blanchité dominante et leur propos est plein de bonnes intentions de vouloir rendre visible ces histoires depuis leur situation de puissance. Il a donc été question de cette liberté blanche d’expression qui est majoritairement sur le devant de la scène qu’importe le sujet, des formes de réappropriations narratives et culturelles - de qui en profite et encaisse le cash au passage - mais aussi de cette notion de préjudice symbolique comme continuité des dominations oppressives et reproduction systémique d’un certain ordre social. De cette responsabilité éthique-esthétique de l’artiste qui s’est récemment déplacée vers le care et ce souci du soin politique, de comment on peut facilement passer d’un mythe de liberté à un autre parfois. Cela questionne les présupposés du devoir de soin, de fonction de réparation des gestes poétiques et des individus qui les proposent au regard collectif. Les débats pour Schultz se sont plutôt faits de manière indirecte amenant quelques argumentations de fond via les médias et la presse spécialisée ; dans le Minnesota, Durant a accepté une session de rencontre et de discussion IRL avec la communauté Dakota. La peinture du visage mort tuméfié est restée exposée et la sculpture aux multiples potences a été démontée.
La légitimité du contre-pouvoir mis en place par la protestation n’est pas remise en question par Nelson mais elle explore plutôt la redéfinition des organisations sociétales et culturelles que cela induit, et des risques de tous les côtés de glissements en polarisations binaires que l’on ne peut ignorer, avec lesquels il faut peut-être jongler, composer ou déjouer selon les moments. Et que dans le cadre du poétique et de ce qui apparaît comme art, exiger des “bonnes réponses” de l’artiste est quelque peu vain, ou même absurde - et nous pouvons aussi questionner en quoi ces artistes se sont sentis investis de ces responsabilités politiques comme propos poétique. Mais mettre en place des modalités de discussions critiques pour envisager les enjeux de représentations collectives à l’ère post-spectaculaire post-coloniale et post-meetoo… ouais, c’est peut-être utile pour tout le monde. L’autrice relève aussi l’immédiateté émotionnelle et cognitive de nos réseaux de communications technologiques, leurs algorithmes biaisés qui rajoutent de l’huile sur le feu, rendent plus difficile de discerner et d’analyser avec le calme de la distance temporelle. Dans ce contexte et en partant du principe que l’adversaire n’a pas à être supprimé ou réparé, comment mettre en place des conditions de conflits et de résolutions qui ne passent pas par ces réflexes de purifications, d’amputations et donc d’exclusions ? Et comment en même temps mettre en acte les situations nécessaires de changements, de confrontations offensives-défensives et de rapports de forces dans les espaces collectifs, symboliques et politiques ?
« Si la prise de conscience à laquelle on assiste dans le monde de l’art face au racisme structurel, à l’inégalité des chances, à la philanthropie toxique, au art washing, aux relations communautaires, à la restitution et au dessaisissement est aussi profonde que transformative, elle ne peut éviter de perturber et de désorienter un grand nombre de gens. Ça me semble évident. Mon souhait est que nous puissions nous engager dans cette prise de conscience tout en nous rappelant que nous nous tournons vers l’art - ou, au minimum, certains d’entre nous se sont tournés vers l’art à un moment donné - précisément pour échapper aux impasse binaires telles qu’aimer/ne pas aimer, dénoncer/couronner - ce que Sedgwick appelle ‘la rhétorique bon chien/mauvais chien de l’école de dressage pour chiots’ - qui nous assiègent partout ailleurs. » (p.95)
La mesure de nuance et de distance qu’elle propose est risquée car sensible, encore en processus de dé-construction et de définition nous semble-t-il actuellement, car à travers ce déplacement des dichotomies binaires et les études de cas de 2017 c’est le sujet des personnes problématiques et des oeuvres qui les accompagnent qui est amené, de ce statut d’exception d’artiste qui protège institutionnellement certains prédateurs, de ses mythes et de l’entrelacement des intimes et des politiques, qui légitiment et perpétuent les dominations systémiques. Déboulonner ce genre de statut-statue et toute la merde qui va avec semble en effet nécessaire dans une optique de recalibrage des rapports de force, mais cela devient plus compliqué en le conditionnant à cette sortie du “bon chien/mauvais chien”, surtout quand la personne dite problématique en face s’aggrippe à ses privilèges malsains comme à une branche en train d’être coupée. Et si Dana Schultz et Sam Durant nous paraissent déjà un peu lointains chronologiquement et géographiquement, le récent fait divers Bastien Vivès en France nous semble sous-tendre les mêmes questions. Il n’est bien sûr pas question ici de comparer des atrocités avec d’autres atrocités, de hiérarchiser les légitimités des préjudices ou de nier le caractère représentatif du système de violences et de dominations que ces figures publiques laissent dans leur sillage. Il est toujours question ici de différencier les transformations saines de la jubilation narcissique de la punition : « Penser que, si seulement nous pouvions réparer les gens - amputer un petit bout d’alcoolisme ici, un petit bout de pédophilie là (ou de machisme ou de transphobie ou de trouble de la personnalité ou qu’importe) -, nous pourrions alors continuer d’en faire nos héros me paraît absurde, voire cruel. »
Le processus de confrontations médiatiques amenant à la déprogrammation de l’exposition de l’auteur de bd a montré l’efficacité de cette reprise politique de parole et de nomination des narrations : cette vieille histoire d’art “transgressif”, libidineux, qui n’aurait aucune responsabilité éthique parce que génial se renverse dans une mise à jour de ces réseaux institutionnels et financiers qui le soutiennent, qui se réjouissent de ce genre d’iconographie à tendance pédocriminelle. Nous tentons ici une approche sensible mais dés-affectée, de garder en considération légitime la prégnance de la culture des violences sexuelles/patriarcales et des irréversibles traumatismes qui s’y perpétuent tous les jours, sans que cela nous empêche de nous demander si les auteurs d’images fictives immorales sont à mettre strictement dans la même case judiciaire que les réseaux criminels pédopornographiques et consorts - qui font des horreurs à des enfants bien réels, à les attaquer en justice sur le même plan et leur donner la même valeur collective. Et d’une certaine manière la même attention, la même dépense de temps-énergie pour un dessinateur qui aurait juste dû rester au fond de son caniveau à lécher les eaux croupies des egos masculinistes. De comment les préjudices symboliques et politiques sont plus ou moins assimilés, tissés ensemble pour garder une puissance d’action médiatique dans la sphère publique, et pour quelles finalités. Quand nous essayons de sortir de ce prisme qui navigue entre ce qui est dégueulasse et ce qui serait de l’innocence pure, il nous semble qu’il reste ce mec qui ne veut pas se remettre en question ou discuter en contradictoire des portées de ses images, et sur quelles histoires socio-culturelles cela joue et dont il profite, gonflé de narcissisme et de mauvaise foi par tout ce système de groupes de gens qui lui ont fait monter les échelles sociales, et en retour se repaissent de cette transgression-liberté qui confirme leur propre puissance politique.
« Le mythe de l’artiste hors la loi (ou du réalisateur mégalomane ou du romancier incorrigiblement libidineux, ou ses pendants) ne peut continuer à servir d’excuse, comme ça a été si longtemps le cas, aux comportements inacceptables. En même temps, il serait naïf et injuste d’attendre des artistes ou des écrivains qu’ils témoignent d’un accès privilégié aux aspects les plus intenses, extrêmes ou douloureux de la vie, puis de prendre l’air surpris ou effaré en apprenant qu’ils ont un rapport à ces choses qui excède la contemplation abstraite ou la simple critique. Fort heureusement, prétendre que le monde se divise soigneusement ( ou qu’il nous revient de le diviser) en des personnes problématiques, moralement turbulentes, essentiellement dangereuses qui doivent rester “là-bas”, et des personnes non problématiques, moralement responsables, essentiellement de confiance, qui elles peuvent rester “ici”, n’est pas notre seule option. Après tout, ce que je viens de décrire s’appelle une prison. » (p.96)
Et le problème c’est pas tant ce connard-là que le caractère systémique qu’il représente, de tous ces connards encore majoritairement sur le devant de la scène artistique qui profitent de ce genre de statut et s’articulent en un mouvement homogène à tendance boysclub qui fait nappage socio-symbolique sur ces banalisations du mal. Faire de cet arbre le représentant-responsable de toute cette forêt merdique, nous en doutons. Mais monter au créneau faire pression pour lui barrer le chemin de la visibilité à grande échelle, et que collectivement s’installe l’idée que profiter de ces dominations amène des conséquences en réponse, cela s’entend comme nécessaire et utile, un moyen efficace et non pas une fin en soi dans ce processus de contre-pouvoir. Que les peurs et les désirs changent de camps nous semblent en effet être des transformations saines. Nommer ces chiens pourris, ni bons ni mauvais, juste en décomposition de pourriture dénuée de tout poème. C’est pas sale mais morbide, c’est déjà-mort. Et à travers ces sphères symboliques et les valeurs sociales actuelles de ce qui est art/artiste c’est bien le tissage des idéologies politiques et économiques qui se trouve impliqué. Non pas parce que le domaine esthétique est une sur-puissance cognitive miraculeuse, mais car les dialectiques sémantiques d’assimilation de ce qui est création/oeuvre et production/marchandise par les puissances politico-financières ont dévoré ce domaine en mode walking dead. Et les fascistes d’hier et d’aujourd’hui aussi bien sûr, ça revendique cette liberté transgressive de jouissance du monde, ça retourne le soin et les désirs, les frustrations et les dépressions ; ça dévore et il est question de faire recracher tout ça avec quelques dents à un moment ou un autre.
« Les enjeux qu’il y a à opposer la désinhibition et la liberté à l’inhibition et au devoir dépassent de loin le monde de l’art. » (p.96)
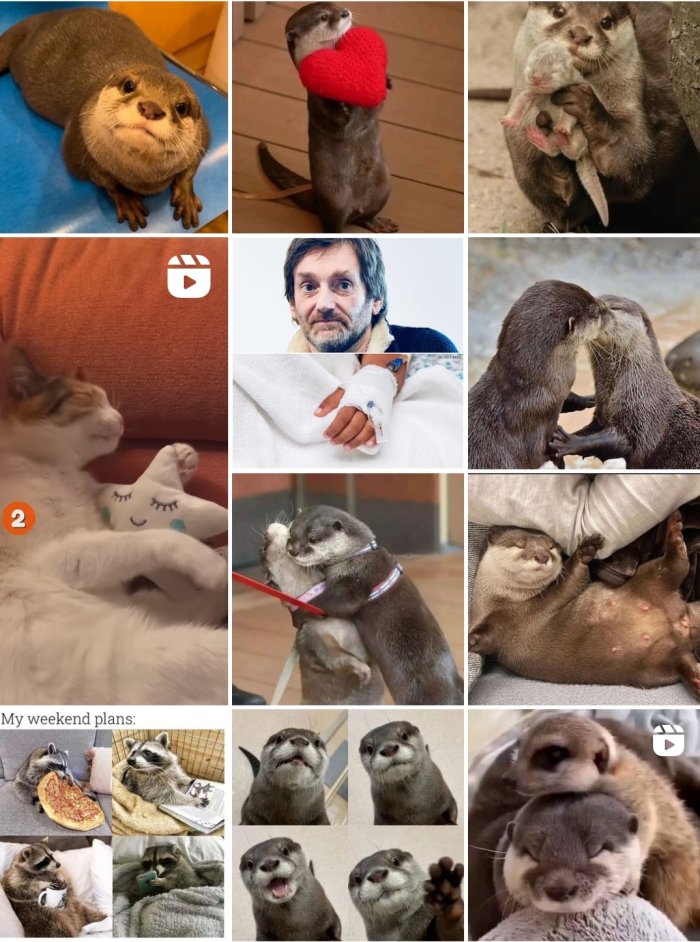
LIBERTÉ ET FUN
Maggie Nelson relève les enjeux liés à ces phénomènes de transgressions morales et d’usages des symboliques libidinales, de ces formes de désinhibitions des désirs-puissances d’agir associées historiquement aux artistes comme être-libre et qui se sont assimilées dans le tissu politique jusqu’à un être-bien qui serait dû, de l’affirmer comme un droit au bonheur-liberté. Elle argumente en lecture avec Wendy Brown qui est enseignante-chercheuse en sciences politiques - proche de Judith Butler au passage, et il nous faut ici citer ce paragraphe d’analyse tel quel des pages 96 et 97 :
« Alors même que j’écris ces lignes, l’extrême droite alternative est en train de faire valoir ce que Wendy Brown a décrit comme une “brillante(...)campagne” en vue d’associer “les sentiments anti-égalitaires, anti-immigration et anti-responsabilités à la liberté et au fun”, tout en rejetant “les engagements de la gauche et des libéraux dans le camp de la répression, de la régulation, de la sinistrose et de la police”. Cette campagne séduit ses adeptes en puissance avec la promesse d’une exonération de toutes sortes de responsabilités, qu’elles soient “envers soi-même, les autres, le monde, un compactage social avec l’avenir, au nom d’un certain type de désinhibition politique et sociale”. L’avertissement de Brown - dont l’urgence s’est amplifiée à mesure que j’écrivais ce livre - quant à la fusion du libidinal “liberté et fun” aux accents libidineux avec un “nouvel étatisme autoritaire” progresse à une rapidité et avec une puissance prodigieuse, et une capacité singulière à embrigader “les jeunes, les immatures, les désinvoltes, et les meurtris”. Cette fusion, dit Brown, nous confronte à “une difficulté pire que ce que nous avions conçu jusqu’alors”, et exige que “nous réfléchissions en profondeur à des stratégies pour la contrer le plus efficacement possible. »
C’est ce qui sous-tend les mouvements trumpistes et autres Bolsonaro outre-atlantique, mais aussi ici à la sauce européenne, de ce qui serait dû comme statut, comme territoire d’identité, comme puissance de nomination et d’action en total déni des responsabilités collectives et individuelles que cela implique. La poétesse envisage alors plusieurs contre-forces qui sont apparues en réponse, leurs puissances et leurs limites toujours comme les deux faces d’une même pièce. Il y a d’abord le classique effet miroir punitif, de reproduire ces retournements dialectiques en mode kinky justiciable, la loi du talion mixée à David contre Goliath, où cela est acceptable « à partir du moment où ils sont commis par les vulnérables contre les puissants. » Elle entend tout à fait la légitimité des griefs et des colères, des nécessités de justices et des violences inévitables face à certains préjudices endurés, mais elle estime nécessaire aussi de constater les risques de “cruauté désinhibée” dont chaque personne humaine sur cette planète est capable avec ce chemin de contre-attaque sur-affectée, sur-investie de jubilation du pouvoir, et surtout dont chacun et chacune est éthiquement responsable.
Elle cite ensuite Sara Ahmed qui est théoricienne-chercheuse plutôt du côté de la phénoménologie queer, et sa stratégie de “la rabat-joie” : des tactiques de significations et de communications qui partagent tout ce qui ne va pas, « des choses dans ce monde qui justifient notre mécontentement » et qui va venir transmettre ces formes de malheurs au milieu de toutes ces injonctions au bonheur et ses jouissances supposées. Nelson note l’efficacité de cette pratique déjouant ces idéologies positivistes qui oscillent entre “tout va bien dans le meilleur des mondes” et la logique du “moins pire” : nous la voyons dans ces manières de ne plus rien laisser passer, de dire et de nommer publiquement chaque fait encore nuisible, encore problématique, chaque blague, chaque geste, chaque mot. Mais cette mise en oeuvre l’autrice la reprend ici comme une étape d’un processus temporel politique dont la finalité n’est pas que la contre-attaque, et encore moins l’apparition de nouvelles binarités morales ou hygiénistes : il est question de saisir chaque puissance et impuissance en jeu, et dont la discussion collective et les prises de consciences individuelles peuvent nous amener à la recherche d’élaborations d’autres formes d’inter-relations aux autres comme à soi-même. C’est un moyen « pour comprendre comment encourager des formes de bien-être plus justes et mieux partagées ; en y mettant de l’humour et de la créativité, ça peut même être fun (...) ». Creuser pour trouver des sources de joies et de puissances inattendues, de ce qui peut faire réseau et influence entre esthétique et politique.
Ces derniers mois il y a de plus en plus de peintures sur les murs ministériels et les façades d’entreprises privées, les tee-shirts avec punchline ça passe bien à la caméra aussi, et n’oublions pas la sauce tomate sur les vitres blindées dans les temples de l’art. Nous comprenons la bonne volonté de ces tentatives bien que nous doutions de l’efficacité politique en-soi de ces gestes médiatiques ; les réactions de censures et de répressions des pouvoirs en place sont cependant intéressantes, elles ne se cachent plus d’une certaine manière, ça coupe juste l’image en direct. Peut-être alors faut-il les penser comme un échiquier, une composition de moments et de gestes, qui si elles sont jouées en même temps telles des symphonies cela aurait alors l’allure d’un hacking médiatique - comme une attaque de déni de service, cette stratégie informatique de saturation d’un serveur pour le faire crasher. Une histoire d’échelle et de proportions des demandes et des perceptions, dont l’ampleur des contestations actuelles qui larvent autour des retraites sera peut-être propice. Une coordination de concordances qui demande un coup de dé qui jamais n’abolira le hasard, ce précieux mélange de non-anticipation et d’accomplissement maîtrisé que les pratiques poétiques ont en commun, la surprise de nos confiances partagées.
Essayer de discerner plus en détails ces lieux de pouvoirs symboliques qui ne sont pas forcément sur les voies publiques, faire remonter aux regards collectifs ce qui est encore caché, là où se réfugient ces apparences de puissances. Ou autrement dit, le principe des “cheveux de riches” : le privilège du pouvoir se soigne et se montre, le cheveu est soyeux, il y a le temps et la ressource pour en prendre soin. Une anecdote récente d’un murmure de petites mains brodeuses dans une grande maison de couture de luxe parisienne nous semble montrer le chemin qu’il y a encore à faire entre la performativité d’une sauce colorée et son efficacité comme menace politique des pouvoirs en place. Les ateliers de haute-couture les plus en vue sont ponctuellement visités à titre médiatico-symbolique par nos plus sympathiques chiens pourris, et ces derniers mois autant pour la visite présidentielle que pour la troisième fortune française et sa famille le processus de préparation des espaces, et du temps auquel cela a été consacré, est vraiment croustillant et quasi similaire. Il a été question de tout nettoyer esthétiquement, avec l’association au sécuritaire bien sûr, c’est-à-dire d’épurer et d’anticiper tous les espaces de travail mais aussi ceux des pauses : il n’y avait plus de poubelles nulle part, on ne savait plus où jeter son gobelet de café pendant des jours ; nous sommes chez les brodeuses qui cousent et coupent des fils et des tissus et manipulent des centaines de perles, et qui se retrouvent avec d’autres petites mains employées littéralement à leurs pieds pour balayer, nettoyer chaque fil et chaque impureté visuelle en prévision de la sainte visite. Pur absurde quotidien. Les murs des halls d’accueil et autres espaces de transits ont été repeints entièrement, bien bien blancs. Plusieurs jours de gesticulations pour dix minutes de visite et pouvoir admirer ces si beaux cheveux brillants. Procession royale on dirait, et disproportions totales des temps investis pour servir ces précieux regards, qui daignent se montrer aux petites mains qui leur rapporte de l’argent. Il y a sûrement plein d’histoires de ce genre dans plein d’endroits, des moments de fun à trouver ailleurs que sur des vitres blindées.
Pour boucler la boucle avec Maggie Nelson et les stratégie possibles dans nos adversités actuelles elle se garde surtout d’amener des hypothèses trop définies, elle nomme cependant les pistes de « (...) plaisir ouvert, la convivialité insurrectionnelle et la compassion radicale » pour ne pas se résoudre fatalement à « passer mon temps à vénérer une rhétorique rabat-joie, ou privilégier la complainte, laquelle sombre trop souvent dans “une sorte d’aliénation communautaire tordue où les gens se retrouvent liés non par le sang ou la langue commune mais à travers un surenchérissement du malheur”, pour citer Moten. » Et elle précise en continuant avec Fred Moten, théoricien lié aux cultural studies et poète, sur les mécanismes de ces situations qui mènent à passer son temps - et à le dépenser - à penser et agir sur ce qu’il ne faut pas faire, sur ce que l’on ne veut pas être ; et à délaisser en conséquence ce que l’on veut de possible pour être et faire autrement. Graeber et son “agir comme si nous étions déjà libres” ne sont pas loin, et l’intérêt de l’art pour Nelson - et pour ce que nous reconnaissons comme gestes poétiques - est ces temps-espaces de marge de manoeuvre que l’on se laisse, de comment socio-historiquement les pratiques esthétiques ont pu faire l’expérience des extrêmes, des multiples possibles, des symboles et des poèmes. Elle sous-entend un effet catharsis aussi bien sûr, dont on peut aussi penser la réactualisation politique. Dans les énergies d’insurrections et de destitutions particulièrement nous semble-t-il.
« Ça a longtemps été un espace de liberté et de fun, sans pour autant avoir recours - ou rarement - à l’intimidation, à la menace, ou au bullying. (...) un cadre où contempler ou délimiter ce qui est proprement irregardable ailleurs. (...) ». Elle assume l’art comme une pratique qui rendrait la vie plus digne, ou moins dure d’être vécue, que ces moments poétiques amènent du sens et de la sensation jusqu’à cette idée de magie, d’effet mystique aux origines et destinations inconnues où peuvent survivre nos joies et nos amours, et se transmettre. Nous doutons de cette idée de dignité, sûrement encore trop occidentale/blanche, mais il y a peut-être à garder ces formes d’améliorations de nos existences qui ne seraient ni positivistes ni narcissiques, des gestes humbles de profit des temps de vie partagés. « Pour ceux que cet excès de sentimentalisme ferait lever les yeux au ciel, ou qui en sont venus à considérer l’art comme un énième concept en faillite, ou un attribut dommageable du capital, je n’ai rien à leur opposer, sinon à leur rappeler qu’il peut aussi exister d’autres choses - des choses qui pour certains d’entre nous comptent autant ou plus encore que les fruits de la démystification. » (p.99)
SOIN FORCÉ ET LIBREMENT DONNÉ
Nelson pose les implications de ce qui peut se reconnaître comme soin esthétique, de pratiques d’empathies et de réparations dont les poétiques ne se réduisent pas à cette fonction, qui peuvent être possiblement en capacité de transformation individuelle ou collective jusqu’aux sphères politiques, mais que cela n’est pas dû ni essentiel, que cela n’a pas à correspondre aimablement, ou à l’être tout le temps. De trouver des moyens pour déplacer ces nœuds de dettes et de redevances pour mieux engager nos responsabilités et nos efficacités, de chercher ces meilleures conditions de vie, et non pas ces bonheurs sans douleur. Elle fait état dans le monde de l’art récent de ce glissement sémantique « vers un langage de devoir et de soin » qui au croisement des biais capitalistes demandent des “résultats quantifiables” et des identifications binaires, identifiées et polarisées médiatiquement comme tous nos autres domaines d’activités. Au point que l’efficacité des stratégies queer de ces dernières années se retrouvent à leur tour dans des niches de minorités, visibles et invitées à apparaître uniquement sur des sujets précis, limités esthétiquement et socialement. Cette situation de réduire les potentialités en devenir implique alors une limitation de finalités du poétique, et des surprises politiques qui peuvent encore advenir en parallèle.
Outre tous les biais historiques, politiques, économiques, idéologiques qui ont été posés en amont - ces situations d’injonctions et leurs conséquences, l’autrice discerne après cela cette relation discrète mais inévitable qu’entretiennent soin et coercition, de ce que nous devons donner. De comment nous avons tendance pour de multiples raisons à faire ce nœud paradoxal d’auto-exploitation de ce qui se donne et se contre-donne unilatéralement. Du care qui historiquement s’est fait entrave patriarcale de la féminité dévouée aux autres, du colonialisme qui a doublement posé l’impératif de soin pour les femmes non-blanches, et de comment le système salarial capitaliste post-colonial pousse certains groupes sociaux à ce non-choix du tout-donner, de ce devoir de soin et toutes ces charges mentales-émotionnelles qui vont avec. Du travail dit professionnel, familial, amoureux, amical. Des biais de redevances et de responsabilités souvent internalisés, non visibles ; ce qu’elle nomme du soin forcé. Pour déplacer le curseur de ces auto-coercitions elle pose comme piste de distinguer les pratiques de soin de celles du don, d’arriver à discerner et redéfinir cette idée de dette comme de responsabilité induite. Tenir à distance les mérites et les sacrifices. Aussi d’apprendre à faire la différence « entre le soin qui nous est imposé et celui que nous dispensons de bon coeur » tout comme de s’éviter le piège de « circonscrire le soin au don (...) plutôt que de le considérer comme une négociation de besoins (...) de permettre à la douleur, l’individuation et le conflit d’exister sans qu’on s’effondre. » (p.111)
Nous revenons alors sur ce qui est à discerner comme nuisible, nocif, toxique, dégueulasse, douloureux, injuste, contradictoire, traumatique : de chercher ces tactiques pour les traverser et les endurer, d’en tirer des formes d’entre-aides, d’entre-soins, qui ne nous amputent pas de cet part du réel et du monde. De ne pas être en cécité aussi, d’avoir une authentique analyse des situations autant esthétiques que politiques, et comment de temps à autre l’une peut aider l’autre sur ces visibilités et invisibles.
« – C’est notre souffrance qui nous réunit. (...) Et la main que vous tendez est vide, comme la mienne. Vous n’avez rien. Vous ne possédez rien. Vous êtes libre. Vous n’avez que ce que vous êtes, et ce que vous donnez. Je suis ici parce que vous voyez en moi la promesse, la promesse que nous avons faite il y a deux cents ans dans cette ville - la promesse tenue. Car nous l’avons tenue, sur Anarres. Nous n’avons que notre liberté. Nous n’avons rien à vous donner que votre propre liberté. Nous n’avons comme loi que le principe de l’aide entre les individus. Nous n’avons comme gouvernement que le principe de l’association libre. Nous n’avons pas d’états, pas de nations, pas de présidents, pas de dirigeants, pas de chefs, pas de généraux, pas de patrons, pas de banquiers, pas de seigneurs, pas de salaires, pas d’aumônes, pas de police, pas de soldats, pas de guerres. Et nous avons peu d’autres choses. Nous partageons, nous ne possédons pas. Nous ne sommes pas prospères. Aucun d’entre nous n’est riche. Aucun d’entre nous n’est puissant. Si c’est Anarres que vous voulez, si c’est vers le futur que vous vous tournez, alors je vous dis qu’il faut aller vers lui les mains vides. Vous devez y aller seul, et nu, comme l’enfant qui vient au monde, qui entre dans son propre futur, sans aucun passé, sans rien posséder, dont la vie dépend entièrement des autres gens. Vous ne pouvez pas prendre ce que vous n’avez pas donné, et c’est vous-même que vous devez donner. Vous ne pouvez pas acheter la Révolution. Vous ne pouvez pas faire la Révolution. Vous pouvez seulement être la Révolution. Elle est dans votre esprit, ou bien elle n’est nulle part. »
Les dépossédés, Ursula le Guin, 1973
Les mains vides est le symbole-devise de la société anarchiste fictive de Le Guin, qui donne cette ligne éthique de dépossession qui titre le roman et va apparaître à plusieurs reprises jusqu’à la dernière page, avec cette sous-tension de n’avoir que ce que l’on donne, comme déjouement des dettes peut-être, mais aussi se laisser-place au vide de l’avenir, et à son partage. Ces mots ont un demi-siècle mais nous semblent d’une actualité frappante, ou peut-être que nous n’avons pas beaucoup bougé depuis cinquante ans. Mais les conditions de ce dénuement du don et de ce système d’interdépendances sont posées dans un contexte politique précis qui nous garde de trop d’idéalisations : la romancière évite autant l’utopie que la dystopie il nous semble, elle nous propose une expérience de pensée d’exploration sociale au regard de nos contraintes ontologiques et de comment nous négocions nos besoins dans ce cadre-là. Ainsi les humains anar’ d’Anarres sont issus de la planète-mère Urras la capitaliste, dont le gouvernement de cette dernière a évité une révolution politique accomplie sur son territoire en passant un accord avec le mouvement anarchiste, et lui a donné un espace-temps pour faire son modèle sociétal : céder la lune, loin.
Un endroit posé comme peu propice au vivant, sans abondance d’eau ni vertes prairies, une lune faite de poussière et de marécages, dont les ressources sont limitées et peu plaisantes ; où la survie individuelle s’est élaborée sur la solidarité du groupe, sur la répartition collective de cette dépossession et des manques quotidiens. La fiction pousse le curseur jusqu’à la transformation des sémantiques linguistiques et des grammaires, d’une structure de pensée sans formes possessives de propriété, autant matériellement que émotionnellement ; jusqu’à en saisir ses revers, ces personnages qui s’accrochent à telle couverture ou tel bout de bois et les cachent, malgré la politique totale de ne rien avoir à soi. De l’horizontalité du maillage des domaines de productions et de reproductions où les rapports de pouvoirs sont déjoués par l’interchangeabilité des postes, des rôles et des responsabilités qui se déplacent et s’échangent ; mais dont Le Guin fait ressortir petit à petit des risques de biais administratifs et institutionnels que nous connaissons bien, des divergences, des désirs, des ambitions et des egos qui s’y jouent inévitablement. Et il nous semble qu’elle aussi ne prétend pas des résolutions définies, il n’est pas question de bonnes solutions mais de faire l’expérience de ce qui est possible : le personnage principal est le premier émissaire d’Anarres à revenir sur Urras depuis le schisme lunaire - l’histoire suit le fil de ce parcours, et sans trop spoiler nous noterons que le roman s’achève à son retour, avec ces mains vides librement données.
« “Ce soir, je m’étendrai pour dormir sur Anarres“, pensa-t-il. “Je m’étendrai près de Takver. J’aurais aimé rapporter la photo de l’agneau pour la donner à Pilum.“ Mais il n’avait rien rapporté. Ses mains étaient vides, comme elles l’avaient toujours été. »
CHRONOPOLITIQUES, RENONCEMENTS ET INDÉTERMINATIONS
Le terme de chronopolitique, comme organisation et gestion des temporalités politiques de nos productions-reproductions, s’est pensé et diffusé depuis les recherches queer et postcoloniales du milieu des artistes de ce début de XXIe siècle, qui ont envisagé les divisions/coercitions capitalistes des temps-espaces de travail et de relations sociales - et de nos esthétiques, comme structures garantissant aussi l’ordre symbolique hétéronormatif, patriarcal, neo-colonial, raciste, validiste. Not Now ! Now ! – Chronopolitics, Art & Research est une publication collective parue en 2015 initiée par l’artiste Renate Lorenz qui regroupe les interventions d’une rencontre-discussion viennoise autour de ces temps politiques de l’art, de comment les expériences des vécus hors-normes vont venir poser d’autres rapports au temps possibles, des représentations non-linéaires et multilatérales, qui circulent. Des décalages et des aller-retours des personnes qui s’engagent dans les esthétiques et les transitions, des avants et des après des identités comme des traumas qui ne sont pas une ligne en aller-simple vers un futur bonheur. De ce qui fait mémoire et héritage autrement que les modèles de familles instituées, des formes de relations amoureuses/amicales non-exclusives ou dites libres de se redéfinir selon les situations et les moments. Plein de petits grains de sable qui enrayent les grosses machines. Ça s’entremêle, ça repart en arrière, ça coexiste avec le présent - ses présences et ses absences, les débuts et les fins ne sont pas forcément distinctes, ni définies ni définitives. Ces temps des invisibles, ces creux entre les jours et les nuits comme ce “Pas maintenant ! Maintenant !” qu’Elizabeth Freeman va saisir en préface comme un arrêt et un mouvement en même temps, une grammaire de l’urgence qui prend son temps. “(...) content-free, une force plus qu’une figure (...)” précise-t-elle. Cette gestion des temps d’énergies et de repos, de nos dépenses et de nos dettes, de nos fatigues et du bien-être vendu comme soulagement de cette ligne droite exponentielle. C’est là où les recherches postcoloniales nous rappellent toutes ces cultures-représentations extra-européennes, passées à la moulinette meurtrière des lignes droites des conquêtes coloniales, dont les rythmes symboliques antérieurs sont circulaires, où il est question de cycles et de cercles, de ces temps qui tournent et se retournent, qui coexistent aussi. De ce rapport différent au temps et donc aux espaces, des co-dépendances avec nos environnements, ce qui a valeur de progrès ou d’être-bien, des interrelations autant vivantes que non-vivantes.
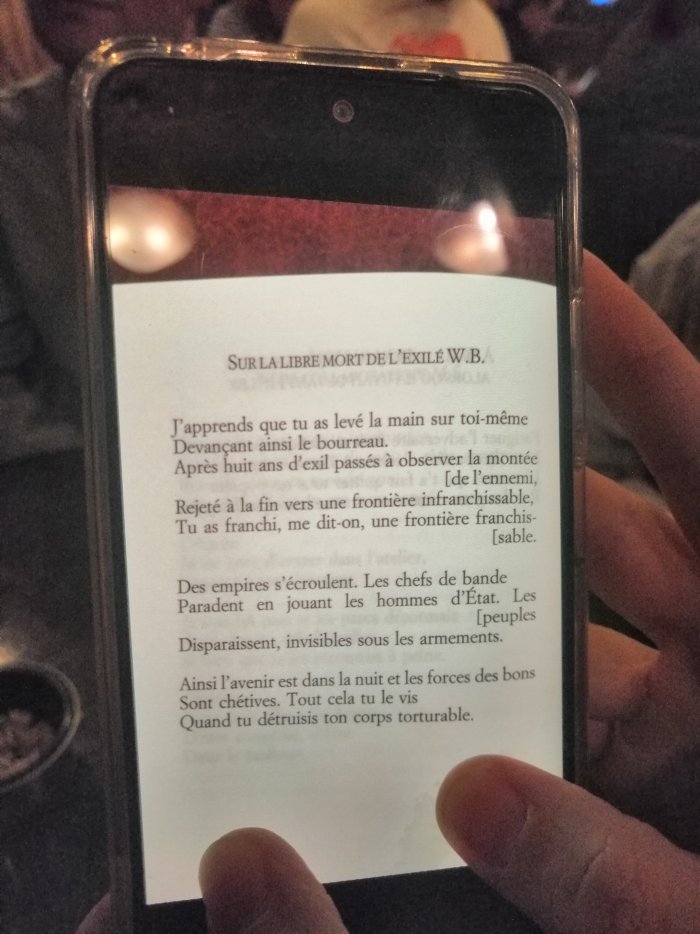
Nous essayons d’éviter de considérer ces histoires comme des paradis perdus ou des modèles héroïques sur lesquels baver depuis l’Europe - la fascination de l’exotisation comme de la culpabilisation masochiste ne nous semblent pas saines ni constructives. D’autant plus que, nous semble-t-il, la même tendance se retrouve sur nos terres par ses histoires religieuses monothéistes alliées au pré-capitalisme patriarcal, qui ont commencé les transformations symboliques de nos temporalités sur leur propre territoire avant de les exporter et de les décliner sous toutes formes d’exploitations imaginables. Des temps cycliques païens et animistes qui ont survécu un moment dans les campagnes européennes, de mystiques et des croyances cosmogoniques qui se sont transformées, ont été ingérées et intégrées aux religions dominantes, nos églises. Des réappropriations et des assimilations plus ou moins forcées, de l’assujettissement des pouvoirs symboliques, des chasses aux sorcières historiques - non pas celle récente des réacs mascus qui pleurent quand on balance les porcs sur la place publique, mais celle qui a fait entre cinquante et cent mille victimes à la fin du Moyen-Age, et a désintégré étape par étape tout un système social, économique et symbolique. Parmi les recherches récentes à ce sujet nous nous tournons vers Silvia Federici et son travail de fond sur comment l’éviction politique des femmes-sorcières a favorisé le changement des modalités de transmission économique et d’accès à la propriété des terres, qui était possible en terme d’héritage pour les personnes de sexe féminin sous certaines conditions, entre autres choses. Et que cela a été une des composantes dans les structures prédatrices pré-capitalistes et des institutions politico-économiques qui ont suivi. De comment il était vraiment question de rôles et de places stratégiques, de rapports de forces et d’influences collectives, avec aussi cet héritage de connaissances des domaines médicinaux et autres gestes d’expertises qui donnaient place à ces figures politiques ; qui ont été séparées, déplacées à d’autres figures. De l’Eglise et de l’Etat, les vieux potes indécrottables. Les désirs et les peurs ont fait le reste sûrement.
Si la redécouverte récente et la réintégration au récit collectif de ces héritages et de leurs histoires paraît bienvenue, cela est au risque des mêmes biais nostalgiques et mélancoliques, surtout dans le contexte de ce “monde désenchanté” et de tous nos bordels actuels. Dans les jeunes générations du monde l’art en ce moment il y a cette tendance relevée par un ami dernièrement dont nous avons discuté, les farfadets et les farfadettes : des artistes qui prennent pour acquis les nocivités et les puissances de leurs héritages coercitifs - souvent des personnes issues de la dite blanchité privilégiée, qui font acte du monde qui brûle et qui sont une partie de leur temps en retrait, en milieu dit rural pour mettre en oeuvre des modes de vies collectives plus ou moins proche des mouvements autonomistes et écologistes. Tout en faisant des sculptures et des peintures dans les forêts et les prés, en postant le tout sur instagram, et en finissant par revenir à la grand-ville pour vendre des céramiques mystiques où le bourgeois de galerie aura l’impression d’un retour à ses racines, de magie bienveillante et salvatrice. Grosso merdo ce portrait un peu au vitriol donne surtout un constat de fait sur les formes de survies financières à trouver aussi, des interdépendances ciblées et maîtrisées, de ce qui peut se produire de manière fonctionnelle et prendre l’argent, pour faire exister d’autres possibles ailleurs.
De ce qui va soutenir et alimenter, des temps et des disjonctions qui y sont possibles, de comment s’articulent les degrés de dépenses et de compromissions. Ce qui se fait déjà au-delà du monde de l’art bien sûr, autant dans les squats que dans les zones autonomistes où le collectif dépend autant des entités qui restent sur place que de celles qui ont des liens vraiment en dehors, qui vont travailler et œuvrer à l’extérieur, celles de passages ponctuels et de soutiens discrets. Ce genre de dynamiques nous semblent être des pistes de ces négociations de besoins comme pratiques de soin et de laisser-place aux indéterminations. Pour revenir du côté des artistes de l’art, nous voyons surtout actuellement des processus de remises en questions de tous ces bordels, ça tente des alternatives et ça cherche des formes d’engagements autant quotidiens que esthétiques en conséquence. De comment ralentir ou suspendre les cadences des temps politico-économiques, y interférer ou les utiliser pour y soutenir d’autres gestes ailleurs. C’est là où nous pouvons repasser par Maggie Nelson et sa postface, où sous l’apparence de l’espoir indéterminé nous y relevons une détermination ambitieuse d’endurance pour garder les mains vides :
« Nous devons tenir bon - nous aurons tenu bon - et continuer à croire en l’amour, l’étude et la lutte, la trinité révérée de Robin D. G. Kelley, où chaque élément est inséparable des autres, et où chacun est là pour nous tenir la tête hors de l’eau quand les autres échouent. (...) Une des leçons de l’interdépendance est que pour connaître une chose il faut d’abord apprendre à connaître ses cousins ou ses voisins. Je ne serais pas la première penseuse (ou personne) à découvrir la parenté terrible, et peut-être fertile, qui unit l’angoisse et la liberté - j’ai dû l’éprouver par moi-même. Mais après de nombreuses, et souvent douloureuses, excursions, j’ai fini par détecter les habitudes de pensée qui génèrent davantage de panique, étouffent et empoisonnent le coeur (la peur des drames et des mauvaises surprises ; le désir féroce d’éviter la souffrance, la maladie, ou la mort ; les tentatives de contrôle qui ne font que l’amoindrir), et celles qui mènent à l’amplitude, à l’espace vide, au ciel bleu, quel que soit le nom que vous lui donnez - le silence et le rien à la fin de l’écriture, et tout le reste. Je ne savais pas, et je ne sais toujours pas, ce que ça fait de s’ouvrir à une telle amplitude. (...) sans échappatoire. » p.326-27
“CÉSAR DOIT MOURIR”
L’adaptation cinématographique de la pièce de théâtre Jules César de Shakespeare par les frères Taviani en 2012, tournée dans une prison de haute sécurité italienne avec les prisonniers comme interprètes, est un cadre de transmission des expériences qui a laissé apparaître des laisser-faire narratifs et esthétiques vers ces territoires de l’a-fictionnel, à travers ce processus de genre qu’est la docufiction. Et dont les réalisateurs témoignent que le peu de leur travail préparatoire a vite volé en éclat et laissé la place au moment du tournage à la coexistence des vies carcérales et de leurs contraintes, aux mains vides des incarnations et des résonances du texte avec le vécu de ces hommes intriqués dans des traditions et des systèmes de redevabilités, provoquant en-soi la réactualisation esthétique des derniers jours de l’empereur romain. Du hasard qui y apparaît. Le montage et la chronologie de César doit mourir ne sont pas linéaires malgré le fil dramatique couru d’avance, il y a ces moments de suspensions des entre-deux des espaces carcéraux, des couloirs et des murs, des lumières et des pénombres qui deviennent scéniques. Un mélange de perspectives et un partage des poétiques de puissances contraintes, de ce que le symbole ramène au réel, y revient sans cesse et ne s’en échappe pas ; de ces faux acteurs et vrais interprètes qui rendent visibles ces jeux de pouvoirs dont ils ne s’échappent pas non plus. Les mises en scènes tiennent au dénuement du noir et blanc où s’entre-mêlent les échanges des prisonniers entre leurs rôles authentiques documentaires et les moments d’incarnations théâtrales : des mises en abîmes de dépossessions qui renoncent, pour tenir sur une porosité de contradictions. Des humains enfermés en pratique d’être-libre peut-être, à certains moments. Le soin esthétique comme endurance de ces quatre murs qui écrasent trop de corps et de regards.
« L’impression d’être piégé sur un escalier - dans la vie, dans son âge, dans son corps, dans la douleur, dans l’histoire, dans le deuil -, incapable de percevoir le sens de son existence et de son époque autrement que de manière opaque, à travers une vitre, est relativement familière. En tout cas, elle ne manque pas d’illustrations. Pour autant, elle ne doit pas être l’unique interprétation possible de notre situation, ni la seule manière de conjuguer le temps. Comme la philosophe italienne Rosi Braidotti (entre autres) nous le rappelle, il existe également un futur antérieur, un temps dont la caractéristique est de faire apparaître le futur avant le futur, un petit gousset - un pli ou une poche - depuis lequel on peut déclarer, à l’instar de Braidotti : “Vous aurez changé”, “ils se seront battus pour la liberté” ou “nous aurons été libres”. Braidotti nomme ce type d’assertions “réminiscence nomadique”.
Réminiscence nomadique. De quoi s’agit-il, au juste ? A quel lieu, quel temps ou quelle voix appartiennent de telles assertions ? Quel genre d’abondance temporelle nous permet de nous souvenir de ce qui n’a pas encore été ? Est-ce que ce Nous aurons été libres m’émeut parce que j’en fais mon lot de consolation, dans le style de la morale de l’esclave, ou parce que j’y perçois une vérité inéluctable ? Émane-t-elle d’un locuteur qui espère - qui sait - que les paroles prononcées au présent peuvent façonner le passé et l’avenir ? Est-ce une assurance qui s’élève d’on-ne-sait-où (l’au-delà ?), à l’image de ce refrain fugué de Moten et Harney : “S’ils vous interrogent, dites-leur que nous étions dans les airs” ? L’étions-nous ? Le sommes-nous, là, maintenant ? » (p.321)
« Nous aurons tenu bon » pour revenir à la citation précédente de Nelson qui vient après ce passage par la réminiscence nomadique, ces mouvements à l’arrêt qui partent et reviennent, des dynamiques de relations qui peuvent parfois tenir à distance les entraves des angoisses. Garder ces replis et ces poches de temps, ces circulations de tendresses et de confrontations, les entremêlements encore à faire. La poétesse ne sera pas beaucoup plus précise si ce n’est de s’engager elle-même dans ces pratiques de liberté comme consciences et négociations des besoins et des contraintes, des soins et des cassages de mâchoires qui alternent leurs temporalités et leurs nécessités. Elle semble sous-tendre une sorte d’espérance ou d’empathie un peu mystique de laquelle nous doutons cependant, autant en termes d’esthétique que d’éthique. Elle croit en l’art, nous croyons en ce qui est symbole, nous sommes voisines. Peut-être faut-il aussi renoncer aux au-delà et aux réconforts, des indéfinies à déplacer et à faire advenir encore autrement, dépossédées et destituées.
Des formes de renoncements qui ouvrent les possibilités - le silence du poème, ce calme de la tempête. Que les tristesses comme les joies ne soient pas des fuites mais des forces, des symboliques qui font lien de nos recours et non séparation de nos impasses ; nous avons encore et toujours du chemin pour destituer nos habitudes de représentations et de transmissions autant politiques que esthétiques. Maggie Nelson nous laisse pour finir sa balade-pensée de la liberté sur ce sans échappatoire, une sereine urgence du choix de vivre face au vide et d‘apprendre à reconnaître les incertitudes comme sources de puissances en devenir.
AHL
Cet article est le troisième d’une série, pour lire les deux précédents :
Shapeshifters
du pouvoir symbolique : nécessités et légitimités esthétiques
Coups de grâces
Du pouvoir symbolique II : appropriations et Destitutions esthétiques






