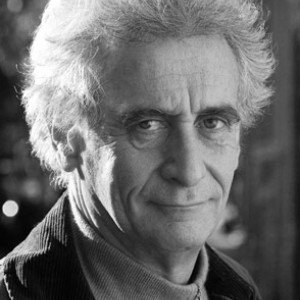Peut-être moins dans la sélection du Goncourt que parmi les livres de sociologues critiques et de militant.e.s fûté.e.s à la prose affutée. C’est ainsi qu’à côté de quelques romans, d’autres livres qui n’en sont pas participent au travail du Balzac collectif de notre époque. Illustration ici avec deux bouquins qui entrent étonnamment en résonnance : Elie Guéraut, Le Déclin de la petite bourgeoisie intellectuelle et Juliette Keating, Gilles Walusinski, A la rue.
La lecture du premier m’a fait penser à ce roman de Philip Roth où il parle d’une tante qui s’abstient soigneusement de dire quoi que ce soit en sa présence, de peur qu’il ne le rapporte dans son prochain roman. A lire la description fine qu’offre Guéraut des comportements et des trajectoires individuelles dans une ville moyenne du centre de la France, on se dit à la fois qu’il a, malgré ses inévitables et lourdes prétentions à la scientificité, un vrai talent de conteur, et aussi qu’on éviterait sans doute de devenir un de ces amis, par crainte de finir dans la peau ce qu’il appelle un « enquêté ».

Anonymisée sous le nom de Lergnes (les prénoms aussi ont été changés), cette commune où l’auteur a pratiqué pendant des années l’observation participante voit 2014 l’arrivée de la droite à la mairie, en remplacement d’un PS qui avait été pendant des décennies prodigue en subventions pour « la culture » et ses fabricants. Après un historique des différentes générations, depuis les militants associatifs des années Lang, rockers qui se sont notabilités dans les années 2000 en accédant à des postes de direction dans les collectivités locales, jusqu’à la nouvelle couche des « étudiants de retour », constituée de jeunes revenus au pays après des études ailleurs, l’histoire de la petite bourgeoisie intellectuelle locale est celle d’une précarisation croissante, les derniers arrivés subissant de plein fouet la droitisation du pouvoir politique aux niveaux national et local. Le robinet à subventions se tarit et la petite bourgeoisie intellectuelle est à la peine, elle se retrouve en concurrence aigüe avec d’autres groupes sociaux, celui des jeunes entrepreneurs issus de milieux populaires aspirant à rejoindre la bourgeoisie locale, et celui des pauvres qui investissent un centre-ville en déshérence.
Sur l’arrière-plan de cette histoire collective, le croisement des destins individuels donne lieu à des scènes d’une cruauté chabrolienne. Ainsi de la confrontation entre Sylvain président aux dents longues de la Jeune Chambre économique et Alice, responsable d’un café associatif abritant des événements culturels, dont la municipalité vient de sucrer les subventions. Ou du frottement entre les jeunes entrepreneurs d’origine populaire de la JCE, qui rêvent de s’intégrer dans la vieille bourgeoisie, et cette dernière.
[Extrait du chapitre 5 « Une légitimité contestée »]
En 2014, Sylvain et quelques autres décident ainsi d’investir le domaine de la création et de la diffusion de biens culturels, encore partiellement sous contrôle des institutions de la petite bourgeoisie culturelle, en organisant un concours de création d’œuvres d’art qui ambitionne de faire « dialoguer les mondes économiques et ceux de la culture ». La réussite de cette incursion vers la compétence culturelle s’explique par le fait que la Jeune chambre économique parvient, dès les premières années de son existence, à monopoliser une grande partie de la « préoccupation de la jeunesse » des élus. La facilité qu’ont les membres de l’association à se poser en représentants de la jeunesse auprès du pouvoir politique local s’explique à la fois par la fragilité de leurs concurrents (les associations culturelles d’implantation récente) et par la victoire électorale de cette bourgeoisie économique, plus encline à favoriser les initiatives se réclamant de « l’économie » que ne l’étaient ses prédécesseurs. Ce soutien est d’abord symbolique : le maire et ses adjoints se rendent à l’ensemble des manifestations publiques organisées par l’association. Ensuite, le maire convie régulièrement les représentants de la JCE à certains événements municipaux, comme la cérémonie annuelle d’accueil des nouveaux arrivants, à l’occasion de laquelle le ou la président(e) de l’association prend la parole afin d’en présenter les activités. Ce soutien est ensuite matériel. Les nouvelles modalités d’attribution des subventions aux associations mises en place par le maire, qui visent à instaurer un financement sur projet, favorisent tout particulièrement la Jeune chambre économique, dont la stratégie est de multiplier les « actions au service du territoire », de manière à maximiser sa visibilité dans l’espace public et la captation des financements publics et privés. Dès 2015, une dizaine de « projets » sont présentés aux services municipaux, qui obtiendront presque tous un financement allant de 500 à 1 000 €. Par ailleurs, la municipalité apporte un soutien logistique, que ce soit en mettant à disposition de l’association du matériel et des agents municipaux, ainsi que les lieux où se tiennent ces manifestations. Au printemps 2015, un local municipal situé en centre-ville est par exemple laissé à disposition de l’association pour une durée indéterminée, et ceci au moment même où le café associatif d’Aurélien et Alice est fermé sur arrêté municipal.
L’ascension de la JCE est ainsi en partie portée par la nouvelle majorité municipale, qui, dès son arrivée au pouvoir en mars 2014, soutient avec plus de force et de constance l’association que ne le faisaient les socialistes. Le nombre « d’actions » menées augmente, tandis que la visibilité de l’association dans l’espace local s’accroît, notamment par l’intermédiaire de la couverture de ces manifestations par la presse locale. L’arrivée au pouvoir de cette bourgeoisie économique ne vient ainsi pas seulement précipiter le déclin des associations contrôlées par la petite bourgeoisie culturelle, elle participe aussi à l’ascension de certaines autres, qui incarnent ou se réclament des mêmes dispositions éthiques (traditionnellement associées à la « droite » de l’échiquier politique) et esthétiques (inclinaison à se référer aux manifestations les plus évidemment bourgeoises et conservatrices de la légitimité culturelle).
Forte de cette nouvelle légitimité, l’association va, à partir de 2014, orienter une partie de ses activités vers un nouveau domaine d’intervention publique : la culture. L’objectif affiché est alors d’organiser un vaste concours artistique associant des artistes locaux et des partenaires privés et publics. Mais les premières difficultés apparaissent : comment constituer une base de données référençant les artistes locaux et les professionnels de l’art ? Une liste d’une centaine de noms est finalement fournie par une chambre consulaire représentant les artisans d’art locaux. Une quinzaine d’entre eux répondent favorablement à la proposition qui leur est faite d’exposer gracieusement une de leurs créations à l’occasion de l’exposition collective, et ainsi de peut-être gagner l’un des quatre prix annoncés. La question de la nature de ces récompenses et des modalités selon lesquelles elles seront décernées n’est, elle aussi, pas sans poser de sérieuses difficultés. En premier lieu, Sylvain ne parvient pas à réunir, comme il le souhaite, un jury constitué de « professionnels de l’art ». Il contacte pour cela les gérants des quelques galeries privées lergnoises, qui perçoivent le projet de Sylvain comme une « concurrence déloyale ». Le jeune homme se tourne aussi vers les professeurs d’art du lycée de la petite bourgeoisie culturelle. Il contacte notamment un professeur de design graphique, ami proche d’Alice et de Sandy, qui oppose à Sylvain un refus catégorique. Plusieurs pionniers déclinent également la proposition. C’est par exemple le cas du président du centre d’art contemporain qui, au même moment, est mis au placard par la nouvelle équipe municipale.
Cette absence de coopération de la petite bourgeoisie culturelle vient ainsi mettre en péril la tenue de l’exposition. Face aux refus essuyés, le jeune homme abandonne l’idée de constituer un jury. Quatre prix sont désormais envisagés : celui du « public », celui du « jeune talent », délivré par les visiteurs, celui de la « Jeune chambre économique », délivré par les membres de l’association, et celui du « partenaire », délivré par le représentant d’une banque qui a accepté de soutenir financièrement la manifestation. Il est décidé d’offrir pour les trois premiers prix une exposition personnelle dans un bâtiment municipal prêté gracieusement, tandis que le lauréat du prix « partenaire » se verra accorder un chèque de 1 000 €. Les récompenses apparaissent ainsi bien modiques en comparaison des lourds investissements engagés par certains participants. Un peintre, auteur d’une grande toile de deux mètres sur deux, me dira par exemple le soir du vernissage avoir consacré plusieurs mois de travail à cette œuvre et près de 600 € de fournitures.
Au contraire des manifestations organisées par les associations de la petite bourgeoisie culturelle, l’essentiel du budget est assuré par des partenaires privés : une banque (2 000 €) et l’entreprise qui emploie Sylvain (2 000 €), donc 4 000 € pour un total de 5 900 €. L’examen des dépenses engagées fait également apparaître une autre spécificité importante : la propension à concentrer les investissements humains et financiers sur les sociabilités périphériques à la manifestation. Au traditionnel vernissage de l’exposition sont associées une soirée de lancement et une soirée de remise de prix. Au total, l’essentiel du budget couvre les dépenses engagées à ces occasions : 1700 € pour les frais de traiteur, 500 € pour une performance artistique et 2500€ pour la location d’une salle de réception dans le parc d’un château à proximité de Lergnes, où se déroule la soirée de lancement. Cette dernière est organisée au printemps 2014, six mois avant le vernissage de l’exposition. Elle vise à révéler le thème du concours aux artistes participants ainsi qu’à présenter publiquement la manifestation. L’événement n’est cependant pas public : seules 62 personnes, soigneusement sélectionnées, ont reçu un carton d’invitation. Cette liste, que j’ai pu me procurer, permet d’observer la place prépondérante faite aux élus des chambres consulaires et des collectivités locales (23 sur 62). On y trouve également un grand nombre de journalistes (14) ainsi que des chefs d’entreprise et des commerçants (14). En revanche, le nombre de cadres du public, et plus particulièrement d’enseignants, est faible (respectivement 9 et 2). Ajoutons qu’aucun artiste, à l’exception de ceux ayant manifesté le désir de participer, n’est invité. Ces choix révèlent une fois de plus la volonté des membres de la JCE d’approcher les classes supérieures lergnoises, en particulier celles appartenant à la fraction économique et/ou occupant un mandat électif.
Cette recherche d’une proximité relationnelle à leur groupe de référence, la bourgeoisie économique, s’accompagne d’une démonstration de leur proximité symbolique. Cette modalité particulière de bonne volonté culturelle s’observe par exemple dans le choix de ce château, et plus généralement tout au long de cette soirée à travers le formalisme bourgeois qui y est adopté. Lorsque j’arrive sur les lieux en début d’après-midi, plusieurs heures avant l’arrivée des invités, les membres de la Jeune chambre économique s’attellent aux derniers préparatifs sur une pelouse au soleil, à proximité de l’entrée. Au bout d’une allée longée de buis et de statues décoratives, j’aperçois le château. « Viens, je vais te faire visiter » me propose Sylvain. Sur le chemin qui mène à la porte principale, le jeune homme me fait part de son admiration pour le lieu (« C’est encore plus beau quand y a du soleil ! »). Une femme vient à notre rencontre, il s’agit d’Odile, que Sylvain me présente comme la châtelaine. Cette dernière le corrige : « Non, non, je ne suis que la gérante ! La châtelaine est à Paris ! » Après cette visite rapide, Sylvain m’accompagne jusqu’aux anciennes écuries, aménagées en salles de réception, où est organisé l’événement. Alors que je m’étonne que celui-ci n’ait pas lieu dans le château, il m’apprend que le coût de la location du bâtiment principal pour la soirée aurait été bien trop élevé. Il est cependant prévu que les invités arrivent jusqu’au portail en voiture, suivent la grande allée et se garent sur le parking qui jouxte le château. Devant ce dernier ont été installées deux tonnelles sous lesquelles se fera l’accueil des invités, qui entreront tout de même « par la grande porte » me dit Sylvain. La localisation de la manifestation, à la fois à proximité et en périphérie du château, n’a ainsi rien d’anodin. Elle cristallise au contraire la frontière sociale qui sépare toujours les membres de la JCE de cette bourgeoisie économique qu’ils cherchent à intégrer. Cette aspiration se heurte ici à la réalité de l’inégale distribution des capitaux, qui les portent in fine à s’approprier imparfaitement le formalisme bourgeois de leur groupe de référence.
Dans la grande salle de réception, des chaises ont été alignées en rangées rectilignes, face à l’estrade derrière laquelle a été déroulé un écran de projection. Tandis que le public commence à s’installer, je reste à l’extérieur, où les membres de la JCE tentent de rassurer Sylvain, visiblement paniqué. Il rejoint finalement l’estrade et fait face à la cinquantaine de personnes assises, qui cessent alors leurs discussions. Plusieurs éléments dans la prestation de Sylvain trahissent la distance qu’il entretient encore avec le style de vie de cette bourgeoisie économique. D’abord, le jeune homme commet un grand nombre de fautes de français et s’exprime dans un style alambiqué. Il utilise par exemple un mot pour un autre, commet des fautes d’accord ou des erreurs de construction de phrase. Si ces écarts au langage scolaire font apparaître la distance du jeune homme au registre scolaire du capital culturel, il faut aussi y voir la conséquence de son manque d’assurance en cette occasion, qui lui fait littéralement perdre ses moyens. En représentation, debout face au public, tout dans l’attitude de Sylvain laisse percevoir l’appréhension qui l’envahit alors : les tremblements qui se saisissent de son corps, de sa main avec laquelle il tient la feuille où est inscrit son discours, sa voix, qui nous parvient saccadée, ou encore la transpiration qui coule de son front, qu’il est à plusieurs reprises contraint d’essuyer avec le revers de sa manche. Pour terminer, ce haut degré de formalisme, employé tout au long de la prestation de Sylvain, apparaît, à plusieurs égards, désajusté au contexte. Dans les discussions informelles qui lui font suite, plusieurs personnes critiquent ouvertement la longueur du discours (près de vingt minutes) et doutent de l’opportunité de l’usage d’un diaporama. Par ailleurs, au contraire des membres de la JCE, aucun des élus, des chefs d’entreprise ou des cadres du privé présents ne porte un costume complet, privilégiant plutôt une simple veste associée à un jean ou à un chino, qu’ils ont jugés plus adaptés à ce samedi de mai ensoleillé. (…)
À un mois du vernissage, les membres de la JCE parcourent la ville, ses lieux de sociabilité et ses commerces, afin de distribuer les affiches annonçant la manifestation culturelle. C’est à cette occasion que Sylvain entre dans le café associatif d’Alice et Aurélien, où je me trouve justement ce mercredi après-midi du mois de novembre 2014. On ne compte qu’une dizaine de personnes présentes, essentiellement des habitués, étonnés par l’arrivée du jeune homme. Chemise blanche rentrée dans un jean neuf coupé près du corps, montre en métal au poignet, chaussures en cuir noires pointues et cheveux peignés en brosse, son hexis corporelle – qui fera a posteriori l’objet de moqueries – suffit à se rendre compte qu’il n’est ici pas à sa place. Visiblement mal à l’aise, ce dernier se dirige vers Alice, assise derrière une table à l’entrée du local, et lui présente à grands traits cette manifestation. Pendant les longues minutes que dure la présentation, Alice ne dit mot et n’accorde pas un regard à Sylvain qui, encore plus mal à l’aise, finit par laisser une affiche sur une table et sortir du local. « Bon, euh... je laisse une affiche là. » L’affiche en question, après avoir suscité rires et plaisanteries, est finalement saisie par Alice et littéralement mise en morceaux. Quelques semaines plus tard, alors que je réalise un entretien avec la jeune femme, je reviens avec elle sur l’événement. (…)
Alors que je lui demande les raisons qui l’ont poussée à refuser de dialoguer avec Sylvain, elle m’explique que celui-ci n’a « rien à faire là » compte tenu du fait qu’il ne « comprend rien à l’art », justifiant ainsi sa position par la distance au capital culturel de son interlocuteur qu’elle sait être membre de la JCE. Nous revenons alors sur l’affiche dont j’ai conservé une copie dans mon ordinateur, commentée dans l’extrait par Stéphane qui s’est joint à l’entretien qui se déroule dans le local de l’association. (…)
Je montre une photo de la remise des prix. (…). Le « style associatif » que l’on y observe (le port du costume par exemple, et plus largement la mise en scène sophistiquée que l’on devine) témoigne d’un haut degré de formalisme que l’on ne retrouve effectivement pas dans les manifestations de la petite bourgeoisie culturelle qui, elles, donnent à voir une distance maîtrisée aux normes de présentation de soi des classes supérieures. Ainsi, ce que moquent ici Stéphane et Alice, c’est aussi une soumission docile à un certain « formalisme bourgeois » qui trahit les aspirations économiques des membres de la JCE (« c’est ça que je ne comprends pas, c’est toujours ce besoin d’officialiser un truc »). Enfin, il est question de la peinture du lauréat du prix. Stéphane, une fois de plus, m’exprime sa consternation et son dégoût pour le tableau (« c’est horrible »). Dans un second temps, il va même plus loin et refuse de considérer celui-ci comme une « peinture ». Le tableau est ainsi jugé emblématique d’une culture de masse (« culture Ikea »), inscrite dans des objets de consommation courants et dénuée de toute valeur symbolique positive (« c’est un papier peint, quoi »).
Ces considérations trahissent ainsi d’évidentes différences d’habitus mais, ici, le dégoût des biens symboliques s’exprime moins envers les objets qu’à l’égard des personnes qui les portent ou les produisent, se faisant alors mépris de classe.
« Mépris de classe », le terme vaut aussi pour le sentiment que les petits-bourgeois intellectuels nourrissent pour ceux qu’ils regroupent sous l’appellation « cassos » - les cas sociaux, les pauvres. Lergnes a connu une évolution qui a affecté beaucoup de villes moyennes en France, souvent d’ailleurs administrées par un PS (on songe à Limoges) grand constructeur de mégacentres commerciaux en périphérie, lesquels sont source de très importants revenus : pour la collectivité sous forme de taxes et pour certains responsables à travers des bureaux d’études peu avares en pots-de-vin et fausses factures. On sait que, associé à une extension sans limite de l’habitat pavillonnaire, ce mouvement de déplacement, depuis quarante ans, de l’activité commerciale s’est traduit par un essor sans précédent de la laideur urbaine et de la désertification des centres. Ce qui ne fait pas l’affaire de cette P.B.I. héroïne de notre histoire :
Si la petite bourgeoisie culturelle est ainsi contestée sur son propre terrain, cette première modalité de fragilisation est redoublée par les dynamiques de paupérisation et de décroissance qui menacent le travail d’appropriation et de réhabilitation symbolique mené sur le centre-ville. D’une part, la dégradation et la vacance du parc immobilier viennent contrarier l’image que tentent de construire ses membres d’un centre-ville médiéval idyllique, animé par une vie de quartier intense. Ensuite, la présence accrue de jeunes ménages de classes populaires dans ces quartiers, dont le style de vie – et plus particulièrement les modes d’occupation de l’espace public – tranche avec celui de la petite bourgeoisie culturelle, donne lieu à un certain nombre de tensions entre les deux groupes. Les pratiques constatées (entorses au règlement sur le tri des déchets, consommation d’alcool, réparations mécaniques dans l’espace public, etc.) et supposées (vote FN, toxicomanie, etc.) de ces voisins font l’objet d’un commérage intensif, qui construit in fine l’image d’une altérité populaire anomique et de ce fait indésirable. À mesure que la visibilité de ces pratiques progresse au sein de ces quartiers de centre-ville, ces classes populaires « donnent le ton », au grand dam des membres de la petite bourgeoisie culturelle, qui voient ainsi la perspective d’une gentrification de leur espace résidentiel s’éloigner un peu plus.

Le tableau ainsi tracé par Elie Guéraut mérite d’être confronté à une photo de Gilles Walusinski, telle que nous la décrit Juliette Keating. Il s’agit d’un rassemblement sur la place devant la mairie de Montreuil, devant laquelle des familles rroms expulsée d’un squat ont dressé leurs tentes :
Visible sur l’image, le groupe des familles. Hors champ, celui des militants et sympathisants regardant le premier, exposé sur ce perron comme sur une scène. Visible mais en marge, cet homme de la communauté qui assure traduction et médiation. Cette photographie, une des milliers que G. a faites de la mobilisation, n’est pas la plus spectaculaire mais c’est une de celles qui poussent à se coltiner la question du eux et du nous. Parce que oui, il y a eux, il y a nous. S’attarder sur la composition presque entièrement blanche du groupe des personnes solidaires, presque entièrement de la classe moyenne, presque entièrement détentrice d’un capital culturel élevé, qui maîtrisent les codes variés de la communication orale, écrite, ont une culture politique, l’expérience des luttes passées, savent comment il faut s’y prendre pour les tracts et les manifs, ce qu’il faut dire ou taire, comment se comporter devant les représentants de l’Etat, devant la police, les élus de la majorité, ceux de l’opposition et de l’opposition dans la majorité, qui connaissent les services sociaux, les procédures, les recours, croient savoirs pourquoi elles sont là, jusqu’où elles s’engageront au côté des sympathisantes d’occasion que le scandale des enfants à la rue a arrêtées sur leur chemin, a conduites comme moi sur la place, soutiens qui se fondent sur leur bonne volonté, agissent selon ce qu’ils pensent adéquat au sens pratique et aux valeurs humaines universelles mais qui s’éloignent quand ils se rendent compte du malentendu, qu’il y a autre chose que le seul secours humanitaire, il y a de la politique là-dessous.
Ah oui, tiens, la politique… A tous ces personnages du récit de Guéraut qui, tels que l’auteur les décrit, paraissent enfermés dans la cage de leur classe et incapables d’en sortir pour trouver un contact vrai avec d’autres catégories de population, on aimerait rappeler la possibilité d’une politique du commun. Qui expliquerait sans mépris mais fermement au président de la Jeune chambre économique le caractère merdique de son idéal et de la forme de vie qu’il représente – plutôt que de ricaner dans son dos parce qu’il n’a pas les codes de la culture telle que l’entend la P.B.I. Ou qui chercherait à mener avec les cassos une lutte collective contre la paupérisation. Le genre de lutte que le parti organique de la P.B.I., le PS, n’a jamais tenté d’aborder autrement que sous la forme d’une récupération au service du néolibéralisme dont il se veut l’aile gauche. Une lutte aux côtés de non-intégrables comme celles et ceux que Keating décrit si bien :
S’attarder sur les Rroms, précaires parmi les précaires, racisés parmi les racisés, ramenés à leur être-victimes, que leurs alliées ne peuvent que discerner superficiellement. Leurs différences, leur langue, la vêture particulière des femmes. Ce qu’il y a d’indépassable dans leur refus d’un devenir marchandise, parce que les pauvres, les exclus, les marginalisés, n’ont pas été oubliés par le capitalisme qui les intègre volontiers en tant que marchandises de l’économie solidaire et sociale, toutes ces associations subventionnées de secours aux miséreux, matière première et produits. Leur incompréhension des parcours sociaux, leur refus de se plier à ce jeu de l’oie qu’est l’insertion où à la fin ils perdent. Mauvaise volonté pour se conformer aux cases impossibles à remplir. Passivité qui finit par agacer parce qu’elle empêche la sortie de crise par l’entrée dans le cadre imposé par le même pouvoir qui les a jetés à la rue. Passivité qui est résistance à se laisser instrumentaliser pour d’autres enjeux que leur besoin vital d’un logement. Défaite n’est pas la leur quand la lutte leur est confisquée.
A cette tentative d’approche de ce non-intégrable qui est à la fois le cœur de la lutte et la raison de sa défaite, s’ajoute une conscience aigüe des limites du militantisme :
Mais les petites histoires de la militance, cette arrière-cuisine souvent confuse, parfois comique, parfois mesquine, ennuient. Entre exaltations et querelles hermétiques, ce ressassement obstiné d’une mobilisation locale laisse de marbre ce qui en est extérieur. Fiction au cœur même du réel : cte façon de faire bulle, de se replier sur l’entre-soi militant, de s’enfermer à quelques-uns dans la même monomanie, le même psychodrame, l’illusion de ne vivre la vraie vie que dans la lutte, cette lutte qui cesse d’un coup comme éclate une bulle.
Cette capacité à transcrire dans une belle prose les complexités et les contradictions irrésolues du réel : la voilà, nous l’avons trouvée, la militance balzacienne que nous appelons de nos voeux !
Serge Quadruppani
Illustration : G. Walusinki