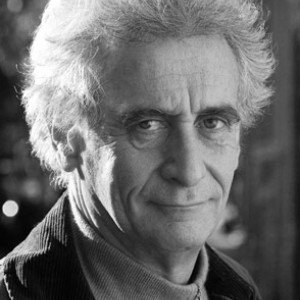S’il existe un petit trou de souris par lequel échapper à la glissade mortifère universelle, on n’y arrivera qu’en commençant à comprendre ce qui a fabriqué cette impuissance et ce qui la fabrique encore. Repérer, dans les institutions et l’économie, les pratiques et les circuits aboutissant à déposséder l’immense majorité de la population de tout pouvoir d’intervention sur la catastrophe en cours, passe par une réflexion sur le rôle des lobbies. Les complotistes, de l’abbé Barruel à Louis Fouché et ses compagnons de route ultra-gauche, rejouent inlassablement le même mauvais tour consistant à remplacer le combat entre exploiteurs et exploités, qui est le moteur de l’histoire, par un combat contre des lobbies. Mais ne pas saisir à travers quels acteurs précis, quelles pratiques et quels réseaux s’incarne la mortifère dynamique capitaliste c’est se condamner aux généralités creuses.
On souhaiterait inaugurer ici une série de bonnes feuilles documentant l’action des lobbies les plus néfastes et les plus puissants, ceux qui interagissent sans cesse avec les gouvernants, et qui déterminent leurs actions autant pour des raisons d’intérêts individuels et de classe que par une proximité idéologique fondamentale. L’invraisemblable arrogance de ces gens n’est pas que morgue de classe, c’est aussi la traduction de cette conviction que leurs médias, leurs spécialistes et leurs grandes écoles leur ont inculqué : le réel, c’est eux. Le mérite des ouvrages qu’on présentera ici devrait être de montrer la vraie gueule de leur réel.
On trouvera ci-après les introductions à deux ouvrages. Le premier est peut-être passé trop inaperçu au moment de sa publication en 2020. L’affaire Sovaldi : La Santé Hors de Prix, d’Olivier Maguet, expose comment un médicament efficace contre l’hépatite C a été délibérément vendu à des prix exorbitants sans aucun rapport avec les coûts de production et comment l’Etat français s’est plié aux diktats du laboratoire producteur, alors même qu’existait la possibilité de déroger aux sacro-saints droits du propriétaire du brevet. Analyse fine de la façon dont le Sovaldi a été inventé, du rôle de chercheurs qui sont dès le départ aussi des entrepreneurs dont la seule motivation manifeste est le profit, ce livre répond à la question : Comment les gouvernements des pays riches ont-ils, dans un mouvement unanime, décidé d’accepter un prix anormalement élevé pesant lourdement sur leurs budgets nationaux, alors qu’ils avaient tous la même possibilité que la France, dans le cadre du droit existant des brevets, de garantir l’accès à ce médicament à un moindre coût ? La question pourrait être formulée de façon plus brutale, pour mieux en saisir la mesure : comment les pays riches ont-ils découvert qu’ils partageaient désormais le triste sort des pays pauvres confrontés à la barrière financière dans l’accès aux traitements ?
Et la réponse est politique. Tout comme est politique l’activité de l’agro-industrie, telle que décrite dans Des lobbys au menu, de Daniel Benamouzig et Joan Cortinas Muñoz. Explorant les diverses catégories d’activités politiques des organisations du secteur, les auteurs peuvent ainsi exposer comment l’industrie façonne la décision politique :
« Concrètement, les ressources utilisées pour créer ou entretenir de nombreux réseaux sont pour l’essentiel des incitations visant à attirer des scientifiques, des experts ou des décideurs : financement de recherche, rémunération individuelle, espaces de sociabilité, cadeaux divers, accès à des espaces sociaux exclusifs. Si ces incitations ne sont pas suffisantes, l’industrie mobilise des moyens de pression – ponctuellement, sur un député, avec l’argument de la perte d’emplois dans une circonscription, ou sur un scientifique à travers une action judiciaire ou la simple menace d’en engager une. Ces incitations et menaces ont des effets à long terme qui ne sont pas toujours visibles, mais qui s’avèrent souvent structurants en raison de leur caractère dissuasif et implicite. Ainsi, progressivement, l’industrie façonne la structure décisionnelle des scientifiques, des experts, des décideurs. »
On n’est pas obligé de partager les positions de ces auteurs qui paraissent un peu trop croire à la possibilité d’un Etat qui serait enfin celui du peuple tout entier, pour saisir l’importance de leurs travaux. En réalité, ce que tous les matériaux qu’ils ont mis à notre disposition semblent démontrer de manière définitive, c’est qu’une politique détachée des lobbies serait forcément une politique détachée de toute pratique étatique.
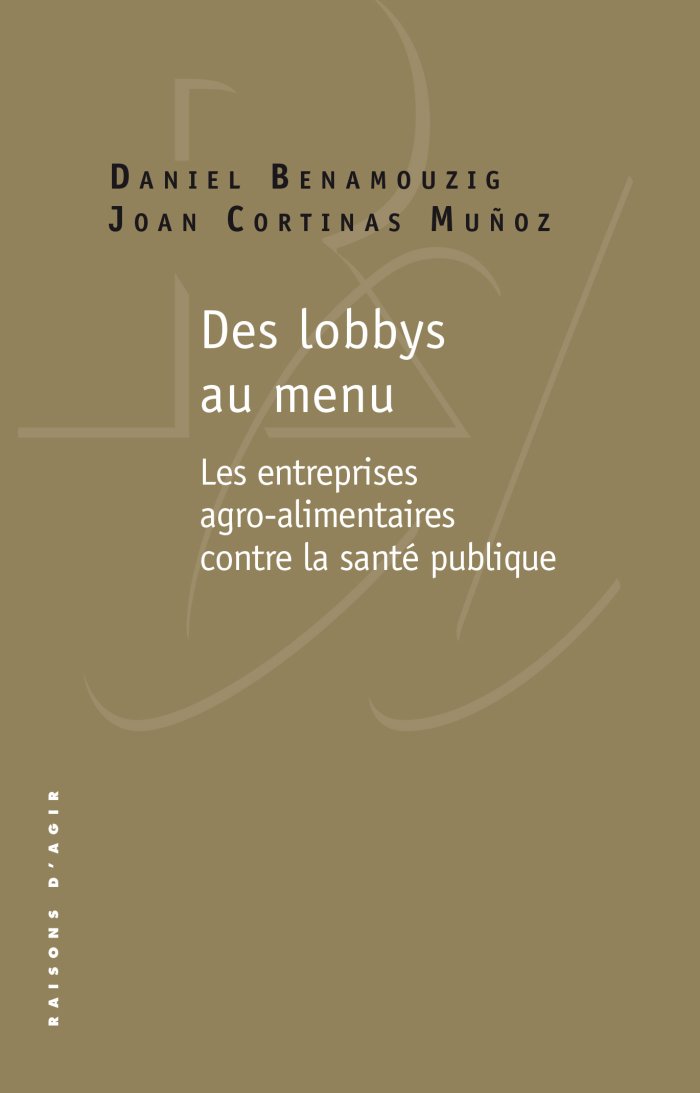
Des Lobbys au menu
Les entreprises agro-alimentaires contre la santé publique
Daniel Benamouzig et Joan Cortinas Muñoz
Avant-propos des éditeurs
Le lobbyisme fait l’objet, en France au moins, d’une réprobation générale : cette pratique qui consiste pour des agents économiques puissants à utiliser les moyens les plus divers – et souvent les plus pervers – pour exercer une influence sur les décideurs politiques afin d’établir un cadre juridique favorable à leurs intérêts propres, suscite la plus grande défiance, mais aussi un véritable sentiment d’impuissance, tant leur emprise semble inéluctable, et difficile à contrer.
L’oxymore de la corruption légale semble le mieux adapté pour désigner les activités des groupes de pression. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le lobbyisme est bien une pratique officiellement reconnue et réglementée dans de nombreux pays. Alors qu’il a acquis une existence légale depuis longtemps dans le monde anglo-saxon et au niveau européen, c’est en 2009 qu’il est réglementé, et donc légalisé, en France. Les groupes d’intérêts s’y trouvent soumis à un « Code de conduite » et ils peuvent s’enregistrer officiellement pour être présents à l’Assemblée nationale ou au Sénat.
Si cette reconnaissance officielle a pour le moins l’avantage d’en faire l’objet d’un contrôle, ce livre de D. Benamouzig et J. Cortinas montre qu’au lieu de fournir de l’information aux décideurs publics, les lobbys renforcent le pouvoir dont les entreprises disposent pour imposer leurs intérêts face à des consommateurs qui ne disposent pour ainsi dire jamais des ressources pour défendre – ou plus exactement construire – leurs propres intérêts. Il est d’ailleurs assez stupéfiant de voir le parti des lobbyistes ériger le rôle de l’UFC-Que Choisir en modèle de progressisme, alors que cette association constitue l’incarnation tout à fait exceptionnelle d’un lobbysme des faibles qui parvient parfois à peser sur les forts.
Le cas de l’agro-industrie étudié dans Des lobbys au menu est important à plus d’un titre, tant les questions d’alimentation sont parasitées par les effets dramatiques du lobbyisme du secteur sur la santé publique. Il y en aurait d’autres bien sûr et, les coûts exorbitants du lobbyisme de l’industrie pharmaceutiques en constituent une illustration non moins marquante, alors même que celle-ci fait l’objet de contrôles plus serrés – on pense notamment aux brevets hautement lucratifs dont un cas particulièrement scandaleux est présenté dans l’ouvrage d’Olivier Maguet à propos des médicaments permettant de soigner l’hépatite C [1].
Les transformations du secteur agro-industriel et de ses techniques de production ont permis de mettre sur le marché des aliments certes peu chers, mais « riches en graisses, en sucres et en sels ajoutés, apportant des satisfactions faciles [2] ». Et le prix n’a pas été, loin de là, le principal instrument de la propagande par laquelle le marketing alimentaire a favorisé un modèle industriel qui conduit non seulement à une consommation de produits alimentaires excessive en quantité, mais aussi de pauvre qualité nutritionnelle. Les promoteurs du soutien public à l’industrie alimentaire ne reconnaîtront sans doute jamais que leur action conduit à une déformation des goûts par l’apport de produits addictifs, et c’est l’idée même d’une information transparente et accessible à tou.te.s, qui est corrompue, en toute légalité, par les lobbys.
L’inégalité devant les informations utiles, mais volontairement cachées pour avoir un peu la maîtrise des effets nutritionnels de modes de consommation imposés par l’agro-industrie, démultiplie en réalité les inégalités sociales au détriment des catégories les plus défavorisées en matière de pouvoir d’achat mais aussi en termes d’information et de capacité à maîtriser l’information. Alors que l’alimentation est un problème central de santé publique, l’emprise de l’agro-industrie sur les politiques publiques de santé est telle que, dans certains cas, elles tendent à se substituer à l’État, en faisant obstacle à la mise en place d’interventions favorables à la santé publique.
Des lobbys au menu montre dans quel souci du détail se situe l’industrie alimentaire pour y parvenir : non contente de peser sur les normes de production, elle fait tout son possible pour contrôler les conditions de production et de diffusion de l’information. Les lobbys de l’agro-alimentaires sont actifs à tous les niveaux : étiquetage nutritionnel, limitation de la régulation des dispositifs marchands, freins aux politiques agro-industrielles favorisant la qualité des produits. Bien plus, si les questions de santé publique résistent sans doute plus que d’autres à la volonté de manipulation des lobbystes, ils trouvent un levier extensible à l’infini dans la promotion du « plaisir gustatif » et de la « gastronomie française » qui n’a pas, en première vue au moins, à rendre des comptes à un point de vue objectif et incontournable.
Pour comprendre ce double jeu qui rend l’action des lobbyistes de l’agro-alimentaire insaisissable, il n’est pas besoin de chercher des « révélations » (même si, en réalité, les scandales ne manquent pas en la matière). Il faut, comme le montrent D. Benamouzig et J. Cortinas, revenir à des situations ordinaires et, sur la base d’une enquête sociologique rigoureuse, proposer de nouveaux outils de connaissance pour l’action politique. Les mécanismes par lesquels l’agro-industrie impacte les politiques nutritionnelles et la décision publique ne se situent pas seulement dans les antichambres du pouvoir et dans les couloirs des parlements. Ils se développent à tous les niveaux de la « chaîne de production alimentaire » : dans la fabrication des savoirs et des catégories de pensée en matière de santé publique, à travers les relations tissées par le secteur agro-industriel avec des chercheurs au service d’une expertise complaisante ; dans la production d’arguments juridiques destinés à limiter les mesures régulatrices en matière d’étiquetage nutritionnel ; ou encore dans l’attaque de personnalités considérées comme gênantes pour les intérêts de l’industrie.
Parmi l’ensemble des moyens de lutte possibles contre les lobbys agro-industriels, ce livre montre l’importance d’une régulation des marchés alimentaires, où le rôle de l’État ne devrait plus se cantonner à garantir l’approvisionnement mais s’attacher à protéger fondamentalement la santé publique. Restaurer l’autorité de l’État, en matière de production de connaissances et d’information, de promotion de normes alimentaires de réglementations officielles dotées de capacités de contrôle. Il ne s’agit pas d’attendre des industriels qu’ils fournissent à ceux qui gouvernent et à ceux qui consomment, une information objective et neutre, parce qu’ils seraient les mieux placés pour le faire, du fait même de leur position de producteurs. En réalité, les informateurs sont aussi ici des formateurs, qui formatent les « goûts » des consommateurs à l’aune de leurs intérêts de producteurs, au détriment de la santé publique. Les lobbyistes des entreprises les plus puissantes, avec l’assentiment de gouvernants aveuglés par l’idée d’un consommateur parfaitement maître de ses choix, s’arrogent le droit de déposséder le consommateur de sa capacité de choisir, c’est-à-dire d’avoir accès à la maîtrise collective et avertie des conditions dans lesquelles il peut choisir en toute connaissance de cause.

La santé hors de prix :
l’affaire Sovaldi
Olivier Maguet
INTRODUCTION – L’AFFAIRE SOVALDI
Le 20 novembre 2014 est publié au Journal officiel de la République française un arrêté signé deux jours plus tôt par Marisol Touraine, alors ministre de la Santé et des Affaires sociales. Ce texte réglementaire, rédigé avec la terminologie habituelle à ce type de document, est « relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché ». Derrière ce langage propre au Code de la Sécurité sociale, l’arrêté annonce qu’un médicament du nom de Sovaldi pourra être prescrit à l’hôpital et qu’il sera pris en charge à 100 % par la collectivité.
Le Sovaldi guérit, dans la quasi-totalité des cas, les personnes infectées par un virus qui détruit leur foie : l’hépatite C. Jusqu’ici, c’est plutôt une bonne nouvelle. Mais il convient cependant de lire les annexes de cet arrêté, qui définissent précisément les conditions de la prise en charge : ce médicament ne pourra être prescrit qu’aux malades les plus gravement atteints. En appliquant les critères cliniques spécifiés dans ces annexes, cela signifie que la moitié environ des 200 000 personnes infectées par le virus de l’hépatite C en France ne pourra pas y avoir accès. Derrière le langage technico-administratif propre aux textes réglementaires, l’arrêté ministériel de novembre 2014 témoigne d’une décision politique exceptionnelle et inédite : c’est la première fois depuis la création de la Sécurité sociale en 1945 qu’un médicament est officiellement et administrativement rationné par les pouvoirs publics.
Pourquoi rationner un médicament offrant aux malades l’espoir de guérir d’une infection chronique potentiellement mortelle ? La réponse est simple : son prix. Car la veille de la signature de l’arrêté de Marisol Touraine, un autre texte administratif a été validé, cette fois-ci par un organisme interministériel totalement inconnu du grand public mais jouant un rôle majeur dans la fixation du prix du médicament en France : le Comité économique des produits de santé (CEPS). Par décision datée du 17 novembre 2014, le CEPS informe que le prix du Sovaldi sera de 41 000 euros pour une cure standard de douze semaines. Ce tarif, décidé au terme d’une longue négociation avec l’industriel détenteur du brevet, sera appliqué aux hôpitaux et imputé sur le budget de la Sécurité sociale. Les calculs sont rapides : avec 200 000 malades en besoin de ce traitement, la facture pour la Sécurité sociale serait de 8 milliards d’euros. Même dans un pays qui est considéré comme un des plus riches du monde et qui a la réputation d’avoir l’un des meilleurs systèmes de protection sociale, cette dépense n’est tout simplement pas supportable pour la branche assurance maladie de la Sécurité sociale. Pour bien saisir son caractère exceptionnel, il faut mettre en regard cette somme avec le montant total pris en charge par l’assurance maladie cette année-là au titre des médicaments pour tous les assurés sociaux, toutes pathologies confondues, qu’il s’agisse de médicaments préventifs ou curatifs : environ 30 milliards d’euros.
D’un strict point de vue budgétaire et par souci d’équilibre des comptes sociaux, la décision ministérielle paraît de bon sens et nourrit le sentiment qu’il n’y avait pas d’autre choix. Ce sentiment diffus est d’autant plus prégnant que l’équilibre budgétaire des comptes sociaux et la réduction du fameux « trou de la Sécu » sont devenus la norme des dirigeants politiques de tous bords depuis une vingtaine d’années – et par voie de conséquence de l’infrastructure technico-administrative en charge de la gestion de la santé et de la Sécurité sociale. En outre, cette norme impérative de la maîtrise des dépenses de santé est constamment relayée et diffusée par de nombreux médias et relais d’opinion, la plupart du temps sans analyse critique, ce qui contribue à forger l’idée qu’il n’y a pas d’alternative aux économies, au risque de « tuer la Sécu ».
Pourtant, en novembre 2014, le gouvernement avait le choix. Plus exactement, deux possibilités s’offraient à lui : soit rationner le Sovaldi en raison d’un prix exorbitant, soit déclencher une disposition légale prévue dans la loi sur les brevets et visant justement à répondre à la situation où un médicament est vendu trop cher. Cette seconde option n’a jamais été envisagée. Pire : elle a été violemment dénigrée et refusée lorsque des associations, comme Médecins du Monde, ont rappelé aux pouvoirs publics que non seulement ils avaient cet outil à leur disposition mais surtout qu’ils étaient les seuls à pouvoir l’utiliser.
De quoi s’agit-il ? C’est en fait un principe de précaution avant l’heure, introduit dans le droit français en 1959 lorsque la Ve République naissante décide d’étendre aux médicaments le régime des brevets – c’est-à-dire que l’inventeur d’un médicament a désormais le droit de déposer une demande de brevet, ce qui n’était pas le cas auparavant. Cette décision met un terme à un débat politique de longue date sur la brevetabilité du médicament, entamé dès la Révolution française quand l’Assemblée constituante adopte la loi de janvier 1791 sur les brevets pour toutes les inventions, y compris pharmaceutiques. Des voix avaient alors très rapidement émergé pour réclamer un statut particulier pour le médicament, ce qui avait conduit le législateur, en juillet 1844, à décider d’exclure le médicament du régime des brevets. Dans un mouvement inverse, au cours de la centaine d’années qui suivirent, d’autres voix avaient réclamé la protection brevetaire, ce qui aboutit cette fois-ci à la décision gouvernementale de 1959 aux termes de laquelle la France intégrait, jusqu’à nouvel ordre, les inventions pharmaceutiques dans le système des brevets. Le même mouvement de normalisation du brevet pharmaceutique était d’ailleurs constaté dans tous les pays du Nord, ces derniers créant ainsi une norme internationale puissante – norme qui s’appliquera au reste du monde lors de la création de l’Organisation mondiale du commerce bien des années plus tard. Toutefois, soucieuse d’un État protecteur de l’intérêt public et de la santé de sa population, la France gaullienne avait alors explicitement prévu un mécanisme de dérogation à ce principe du brevet pour le médicament. Cette dérogation pouvait être activée par le gouvernement dans le cas où il courait le risque de devoir rationner l’accès pour la population à un médicament en raison de son « prix anormalement élevé ». Aux mots exacts, l’expression figure telle quelle dans l’ordonnance du 4 février 1959 qui institue le « brevet spécial pharmaceutique » et qui crée en même temps ce mécanisme de dérogation.
Les dispositions de cette ordonnance sont intégralement reprises dans la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, loi qui fonde toujours en France le socle en vigueur pour définir et encadrer le brevet en général. Le mécanisme d’exception au brevet sur le médicament est aujourd’hui intégré dans l’article L-613-16 du Code de la propriété intellectuelle, sous le nom de « licence d’office ». Cet article autorise le gouvernement français à lever temporairement le monopole de commercialisation associé à un brevet sur un médicament si ce médicament est « mis à la disposition du public […] à des prix anormalement élevés, ou si le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt de la santé publique ».
Dans cette situation, le gouvernement peut alors proposer à tout industriel produisant une version générique de ce médicament de fournir le marché français – ce que l’exclusivité associée au brevet sur le médicament princeps (le médicament « référence ») interdit en temps normal. Le gouvernement émet alors une licence d’exploitation au concurrent, et parce que cette licence n’est pas accordée par le détenteur du brevet, elle est qualifiée « d’office ». Son intérêt : permettre au pays de se procurer un médicament de même qualité et de même efficacité thérapeutique que celles du médicament princeps protégé par le brevet, mais à un moindre coût. Cela permet ainsi de lever, légalement, la barrière financière qui provoquait le rationnement. Il ne s’agit en aucun cas d’une expropriation ou d’une nationalisation, puisque l’industriel détenteur du brevet est indemnisé par des royalties calculées sur le montant des ventes de la version générique du concurrent, pendant toute la période où la licence d’office s’applique.
En novembre 2014, avec le Sovaldi, la France est confrontée à l’une des situations autorisant et légitimant le gouvernement à déclencher une licence d’office. La facture du Sovaldi en aurait été réduite à 20 millions d’euros pour traiter la totalité des 200 000 malades, compte tenu du prix de vente d’une centaine d’euros de la version générique qui existe alors sur les marchés. Rappelons que, pour ce type de médicaments, les dépenses sont prises en charge en totalité par la ressource publique alimentée par les cotisations sociales et l’impôt.
La même année où il pouvait faire ce choix de la licence d’office, le gouvernement adopte le plan d’économie des dépenses publiques. Dans une communication du 16 avril 2014, intitulée « Vérité, Efficacité, Confiance », le Premier ministre Jean-Marc Ayrault présente les mesures arrêtées pour traduire la demande que le président de la République – alors François Hollande – avait formulée le 14 janvier 2014 : réaliser une réduction des dépenses publiques à hauteur de 50 milliards d’euros à l’horizon 2015-2017. Le paquet de mesures proposé par le gouvernement cible quatre domaines : l’État, les collectivités locales, l’assurance maladie et la protection sociale. La diminution des dépenses d’assurance maladie est alors censée contribuer à elle seule à hauteur de 10 milliards d’euros, dont une partie doit explicitement reposer sur des économies dans les dépenses de médicaments. À deux milliards près, l’économie demandée à la Sécurité sociale est équivalente à celle qui aurait pu être obtenue si le gouvernement avait fait le choix de la licence d’office pour réduire la facture exorbitante du Sovaldi.
La question est simple : comment en sommes-nous arrivés là ? Et cette question ne concerne pas que la France. En effet, la quasi-totalité des pays considérés comme riches a été confrontée à cette impasse budgétaire avec le Sovaldi. Prenons le périmètre géographique des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui est généralement considérée comme le club réunissant les économies les plus florissantes de la planète. L’OCDE publie en janvier 2017 un rapport consacré aux enjeux en matière d’accès à l’innovation thérapeutique, où elle constate que « les nouveaux traitements contre l’hépatite C, qui sont très efficaces, sont inabordables pour de nombreux potentiels bénéficiaires dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE en raison de leur impact budgétaire élevé ». L’OCDE corrobore ainsi les alertes lancées depuis déjà trois ans par des associations et des professionnels de santé ; mais il est vrai que, à la différence de ces derniers, l’organisation internationale n’utilise pas le mot « rationnement », terme que rejette alors farouchement la ministre française de la Santé. Ainsi, au refus obtus d’utiliser la licence d’office prévue par la loi sur les brevets, qui constitue un déni d’« Efficacité », s’ajoute aussi le déni de « Vérité ». Il devient dès lors difficile de ne pas douter de la « Confiance » proclamée par le gouvernement dans son plan d’économies…
Comment les gouvernements des pays riches ont-ils, dans un mouvement unanime, décidé d’accepter un prix anormalement élevé pesant lourdement sur leurs budgets nationaux, alors qu’ils avaient tous la même possibilité que la France, dans le cadre du droit existant des brevets, de garantir l’accès à ce médicament à un moindre coût ? La question pourrait être formulée de façon plus brutale, pour mieux en saisir la mesure : comment les pays riches ont-ils découvert qu’ils partageaient désormais le triste sort des pays pauvres confrontés à la barrière financière dans l’accès aux traitements ? Nous pourrions même aller plus loin dans la formulation de la question : pourquoi les pays riches, confrontés à cette même barrière financière que les pays pauvres, ont-ils reculé devant des solutions légales que ces mêmes pays pauvres n’avaient pas hésité à utiliser pour protéger leur population ?
Ce sont les questions auxquelles répond cet ouvrage, en s’appuyant sur l’histoire du Sovaldi. La genèse de ce médicament, la stratégie de l’industriel pour en définir le prix et le commercialiser mondialement, les décisions des États régulateurs du marché du médicament – qui en sont aussi les payeurs – face au prix exigé : autant d’aspects qui révèlent plus largement les facettes du système dans lequel les médicaments sont actuellement développés et mis en vente. C’est en ce sens que l’histoire du Sovaldi, un médicament propre à une situation clinique singulière, devient une affaire publique de portée générale.
La première partie de l’ouvrage revient sur les faits : l’histoire du Sovaldi est d’autant plus intéressante qu’elle s’appuie sur des sources de première main. Ces sources permettent de décrypter tous les aspects de la trajectoire de ce médicament, de sa découverte dans un laboratoire de recherche d’une université publique en Angleterre au record mondial de vente jamais obtenu par une firme pharmaceutique privée, en passant par le rachat d’une start-up qui avait déposé un brevet bancal. Jusqu’alors, les éléments objectifs d’information sur le médicament étaient compliqués à collecter et les arguments d’autorité, peu fiables, l’emportaient sur l’autorité de l’argument – non seulement chez les industriels mais aussi, il faut bien l’admettre, parfois dans les associations. C’était bien souvent parole contre parole, avec évidemment une dissymétrie dans le poids des paroles respectives. Le cas du Sovaldi est différent : de très nombreux documents rédigés par les industriels et les banques d’affaires, habituellement protégés par le secret des affaires ou très difficiles à obtenir, ont été collectés et réunis grâce aux travaux d’investigation sur le prix du Sovaldi menés pendant dix-huit mois par la commission des finances du Sénat américain. Le rapport d’enquête publié en décembre 2015 a permis de rendre publics des milliers de pages de documents internes.
La seconde partie de l’ouvrage analyse la rupture mise au jour par l’histoire de ce médicament : elle dévoile à proprement parler « l’affaire Sovaldi » au sens où elle identifie en quoi le système actuel de développement et de commercialisation des nouveaux médicaments est devenu un danger pour la santé des populations, car il porte en lui les germes du rationnement institutionnalisé, voire d’une médecine à deux vitesses. Ces germes sont identifiés : conséquences de choix industriels dictés par la financiarisation du secteur du médicament ; dévoiement des principes de la propriété intellectuelle par les firmes pharmaceutiques grâce au laxisme des États chargés d’appliquer les lois sur les brevets qu’ils ont eux-mêmes instituées ; régulation actuelle du marché du médicament par les États inadaptée alors même que la solvabilité est assurée par la ressource publique ; renoncement des États à faire valoir leurs droits, voire à faire appliquer le droit – y compris parfois au mépris de leurs propres principes constitutionnels.
L’affaire Sovaldi permet ainsi de déconstruire un certain nombre de mythes à l’œuvre dans le secteur du médicament – par exemple les mythes historiques sur les coûts de production, sur les coûts de la recherche & développement (R&D) pharmaceutique qui expliqueraient les prix élevés ou encore sur le mythe, plus récent, du prix du médicament qui serait fondé sur sa valeur thérapeutique (« plus c’est efficace, plus c’est cher »). La logique ayant concouru à la fixation du prix du Sovaldi n’a rien à voir avec ces trois mythes.
Cet ouvrage est né d’un constat : le débat public sur le médicament est difficile pour plusieurs raisons. En premier lieu pour des raisons liées au corpus de connaissances requises, car il renvoie objectivement à des sujets très techniques, relevant de la science, du droit (propriété intellectuelle, réglementation du médicament, concurrence, etc.), de l’économie, de la norme budgétaire, de la régulation des marchés, du soutien à l’innovation, de la fiscalité, etc. Mais la difficulté technique intrinsèque du sujet est renforcée par le langage utilisé par les personnes qui définissent les termes du « débat » sur le médicament ou qui en sont désignées comme les « experts ». La plupart d’entre elles utilisent un langage si obscur au profane qu’il est légitime de se demander s’il ne s’ajoute pas à la complexité du sujet une complexification plus ou moins volontaire. Cette véritable « fabrique de l’ignorance » apparaît de manière exemplaire dans cet énoncé utilisant le vocabulaire complexifié propre au débat sur le médicament en France : « une fois que l’ANSM a délivré une AMM, la HAS définit d’une part le SMR, sur lequel s’appuiera le ministre de la Santé pour arrêter les conditions d’éligibilité à la prise en charge par l’assurance maladie, et d’autre part évalue l’ASMR, qui sera ensuite pris en compte par le CEPS pour négocier le prix avec l’industriel, tout en étant contraint par la garantie de prix européens de l’accord-cadre avec le LEEM pour les médicaments avec une ASMR 1 à 3 ». Cette phrase reprend peu ou prou des éléments que l’auteur a pu entendre un jour lorsque ses interlocuteurs lui signifiaient qu’il n’avait pas sa place dans le débat ; derrière son apparente complexité, elle décrit en fait ce qu’on appelle le « circuit du médicament » en France qui commence avec le tampon apposé sur le médicament par les autorités sanitaires et va jusqu’à sa prescription effective au malade dans le cadre du système de Sécurité sociale [3]. Elle est bien sûr totalement incompréhensible pour le profane. Pourtant, c’est bien trop souvent avec ce langage que sont traitées les questions relatives au médicament.
Dès lors, il ne faut pas s’étonner si la technicité sur le fond et la complexité sur la forme agissent comme des barrières et découragent parfois même des parlementaires dont une des prérogatives les plus importantes est pourtant de voter le budget annuel de l’assurance maladie. Finalement, il ne reste que bien peu d’options pour le profane qui souhaite s’intéresser au sujet et s’inviter dans le débat. En plus d’être en nombre limité, ces options sont minimalistes, au sens où, sans préjuger de la légitimité et de l’intérêt de chacune d’entre elles, leur angle d’approche appelle immédiatement des contre-arguments utilisant ce langage d’expert et tendant à caricaturer les positions qu’elles expriment.
Une première option est de considérer le médicament comme une illustration des dérives du modèle économique néolibéral mondialisé ambiant. Le taux de profit net après impôt réalisé par l’industrie pharmaceutique – singulièrement atypique avec une moyenne de 25 % quand un résultat net de 5 ou 6 % est considéré comme une très bonne nouvelle dans les autres secteurs de l’industrie – agit comme un révélateur de pratiques dénoncées comme prévaricatrices : superprofits alimentés par des prix exorbitants et insoutenables pour les budgets nationaux de la santé, mécanismes d’optimisation fiscale, privatisation des résultats procurés par les ressources publiques affectées à la recherche & développement, etc. Cette critique portant sur l’industrie pharmaceutique s’inscrit dans une contestation plus générale de la marchandisation du monde. Mais cette approche ne permet pas de saisir le fonctionnement et la dynamique de l’écosystème actuel propre au médicament tel que l’a révélé le Sovaldi.
Il existe une seconde option pour s’inviter dans le débat : lorsque soi-même ou un proche subit l’effet indésirable grave d’un médicament et que cet effet est provoqué par un problème de sécurité qui aurait pu être évité. Ces défaillances dans les filets de contrôle et de sécurité du médicament font le lit des scandales sanitaires. Les raisons en sont nombreuses : mélange des genres, comme avec l’affaire du sang contaminé dans les années 1980 lorsque l’ex-Centre national de la transfusion sanguine a privilégié son métier de vendeur de poches de sang qu’il collectait au titre de sa mission d’organisateur de la transfusion sanguine, alors même qu’il savait ses produits infectés par le virus du sida ; mensonge des industriels sur le profil de sécurité de leur produit, comme avec l’affaire du Médiator où l’industriel Servier a commercialisé de 1976 à 2009 un médicament contre le diabète en le présentant comme un coupe-faim et dont il connaissait les risques pour la santé du patient ; mise sous le manteau d’effets indésirables majeurs d’un médicament lorsqu’il est prescrit en masse, comme avec l’affaire du Vioxx où l’industriel Merckx a étouffé les alertes de plus en plus nombreuses sur les complications et les décès liés à son anti-inflammatoire – le Vioxx, c’est à l’époque un record de vente pour un médicament avec un chiffre d’affaires annuel de 2,5 milliards de dollars pendant six ans jusqu’à son retrait en 2004, avec 40 000 morts aux États-Unis. Ces défaillances ne sont pas de la seule responsabilité des industriels et impliquent les agences publiques de contrôle de la sécurité des médicaments, comme l’a particulièrement mis en lumière l’affaire du Médiator. L’émotion légitime des victimes et de leurs familles ouvre à chaque fois un débat salutaire, qui permet de comprendre les défaillances du circuit du médicament afin de l’améliorer ; mais cette option n’est pas suffisante, elle non plus, pour mettre en lumière ce qu’a révélé le Sovaldi.
Dans les deux cas de figure, il est donc difficile de saisir pleinement ce qui est en train de se jouer sur le marché mondial du médicament, et en particulier dans les pays historiquement considérés comme riches (Amérique du Nord, Europe, Japon, Australie), comptant pour 80 % de ce marché et qui se croyaient jusqu’alors protégés des rationnements. L’affaire Sovaldi expose au grand jour les limites d’un système à bout de souffle : aujourd’hui, un pays riche qui ne peut pas payer pour les médicaments dont il a besoin est une réalité, pas une vue de l’esprit. Il convient donc de créer les conditions pour un débat éclairé sur le médicament – un problème qui renvoie à des questions essentielles au fondement de la vie démocratique, comme le consentement à l’impôt, l’allocation de la ressource publique ou le respect d’obligations constitutionnelles sur le droit à la santé.
En s’appuyant sur le Sovaldi, cet ouvrage entend contribuer à rendre accessible au plus grand nombre le sujet complexe du médicament pour alimenter ce débat public. De 2014 à 2017, période de rationnement effectif des médicaments contre l’hépatite C, la France n’a pas été en capacité de soigner une population dont la taille s’exprimait en centaines de milliers de personnes (les 200 000 malades de l’hépatite C) avec des traitements dont le prix de vente s’exprimait en dizaines de milliers d’euros (40 000 euros pour le Sovaldi). Avec le même système à bout de souffle, on peut s’interroger sur la façon dont notre pays pourra traiter une population dont la taille s’exprime en millions de personnes, comme c’est le cas avec le cancer, avec de nouveaux traitements en oncologie dont le prix de vente s’exprime aujourd’hui en centaines de milliers d’euros. Les enjeux d’un tel débat ne peuvent être plus clairs.
[1] Le circuit du médicament en France se déroule en trois étapes successives : l’autorisation de mise sur le marché (AMM), l’évaluation médicale et la fixation du prix. En premier lieu intervient l’agence du médicament, aujourd’hui dénommée Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), qui délivre les AMM après avoir vérifié la sécurité de la molécule en comparant le bénéfice apporté par le médicament aux risques potentiels générés par son administration au corps humain, comme les effets indésirables (c’est ce qu’on appelle la balance bénéfices/risques, qui doit pencher en faveur des bénéfices). Dans les faits, depuis la création d’une agence européenne du médicament en 1995, la procédure d’AMM est de plus en plus centralisée au niveau de l’Union européenne. Puis la Haute Autorité de Santé (HAS) procède à l’évaluation médicale, qui consiste à poser deux questions : quelles sont les performances cliniques du médicament au regard de son indication ? Et s’il en a, le médicament améliore-t-il la réponse thérapeutique par rapport à l’existant ? La réponse à la première question est appelée le Service médical rendu (SMR), noté de 1 à 5 selon l’intensité décroissante de ses performances, la note 5 signifiant que ce service est inexistant. Les médicaments sans SMR (note 5) ne sont pas admis au remboursement par l’assurance-maladie. Pour les autres est posée la seconde question, dont la réponse est appelée Amélioration du service médical rendu (ASMR). La HAS attribue une note de 1 (amélioration majeure par rapport aux médicaments existants) à 5 (aucune amélioration). Les améliorations les plus significatives, notées de 1 à 3, définissent généralement ce qu’on appelle les médicaments innovants – ce qui fut le cas pour le Sovaldi. Ce cas de figure est rare et depuis plusieurs années, l’écrasante majorité des médicaments remboursables évalués par la HAS ont des ASMR 5 et 4 comme en témoignent les chiffres relatifs à l’année 2018 : 62% des médicaments n’apportent aucun progrès thérapeutique et 24% seulement une amélioration mineure. Comme pour l’instruction des dossiers de demandes d’AMM, la décision des experts se fonde sur les données produites par les industriels. Enfin, le circuit se termine avec la fixation du prix, décidé par une instance gouvernementale, le Comité économique des produits de santé (CEPS), au terme d’une négociation qu’il a menée pour le compte de l’Etat et de la Sécurité sociale avec les industriels. La procédure de fixation de prix est déconnectée de celle de l’évaluation clinique. Le seul lien légal qui relie les deux procédures est l’ASMR, le code de la Sécurité sociale précisant que « la fixation de ce prix tient compte principalement de l’amélioration du service médical rendu apportée par le médicament ». Sur le papier, les choses semblent assez claires, mais la réalité est beaucoup plus complexe (le rapport de force dans la négociation jouant en faveur des industriels qui s‘appuient sur le monopole conféré par leurs brevets) et très peu transparente (les négociations sont secrètes). Par ailleurs, l’Etat a décidé d’organiser ses négociations avec les industriels en signant un accord-cadre avec le syndicat représentant l’industrie pharmaceutique en France (le LEEM), accord qui, dans les faits, conduit à restreindre les marges de négociation pour certains médicaments, comme les médicaments innovants dont le prix doit être aligné sur celui de ses voisins européens – ce que n’exigent nullement ni la loi française, ni la réglementation européenne.