C’est avec une grande satisfaction que je vous présente la traduction anglaise tant attendue de l’interview de Mario Tronti sur le pouvoir destituant. Dans mes différentes réflexions sur le sujet, j’ai parlé de lui avec beaucoup d’emphase, comme de « la clef de voûte de l’opéraïsme », du « parangon du marxisme italien » et même de « la dernière incarnation vivante du communisme lui-même » [1]. Mais, malgré mes propres penchants pour l’hyperbole, ces termes d’affection exagérés étaient destinés à faire allusion à la façon dont Tronti tend à se voir lui-même comme un homme d’un autre temps, piégé dans une époque inconnue et hostile [2].
D’une manière certes assez maladroite, j’essayais aussi de faire un plaidoyer en faveur des interventions plus récentes de Tronti, comme l’interview que l’on trouvera ci-dessous. Indépendamment de leurs autres mérites, la valeur de ces interventions réside particulièrement dans la volonté de reconnaître les défaites et les échecs qui ont accompagné les cinq dernières décennies de triomphe du capitalisme néolibéral. Ainsi, Tronti devrait être crédité d’avoir eu l’audace de dire « Nous ne gagnons pas », contrairement au slogan altermondialiste vide de sens, et d’avoir eu le courage de reconnaître la débâcle pour ce qu’elle est vraiment.
Comme d’autres l’ont déjà signalé, parfois les gestes les plus forts consistent simplement à refuser de chercher une lueur d’espoir dans des circonstances qui ne peuvent engendrer rien d’autre que la misère et l’angoisse. Pour des raisons similaires, un autre camarade italien a écrit un jour : « Le marxisme n’est pas la doctrine pour comprendre les révolutions, mais les contre-révolutions : tout le monde sait comment agir au moment de la victoire, mais rares sont ceux qui savent quoi faire quand la défaite arrive et que la situation compliquée s’éternise [3]. »
De la même manière, le poète Sean Bonney a également fait valoir de manière convaincante que, paradoxalement, la révolte et ce qui est véritablement révolutionnaire ne coïncident pas nécessairement. Que ce soit en Italie après les années de plomb ou aux États-Unis après notre été chaud et pandémique, [l’insurrection suite à la mort de Geroge Floyd pendant le premier confinement en 2020] il nous pousse à sortir de notre zone de confort et à continuer sans relâche « à rendre compte du retour douloureux au business-as-usual capitaliste après l’intensité du bouleversement social, et de l’agonie du « moi-collectif » retournant doucement et non sans peine à son individualité alors que le soulèvement est vaincu [4]. »
Ainsi, aussi étrange que cela puisse paraître, raconter la façon dont la contre-révolution en vient à reconquérir notre être physique et psychique avec les armes de la solitude et de la mélancolie participe, en quelque sorte, d’un élan émancipateur. En fait, cette approche a été confirmée par Marx lui-même, lorsqu’il a annoncé dans sa fameuse lettre de 1843 à Ruge que : « Si je ne désespère pas, c’est parce que la situation désespérée de cette époque me remplit d’espoir » [5].
Suivant ce point de vue, il serait juste de considérer les conjectures de Tronti sur le potentiel de la destitution comme, précisément, une ébauche de mobilisation de ce type de désespoir. Mieux encore, on peut les concevoir comme les plans initiaux de ce que Walter Benjamin a appelé « l’organisation du pessimisme » [6]. Plus particulièrement, l’idée probablement la plus précieuse que l’on puisse tirer de l’entretien réside en son hypothèse sur les cinq traits caractéristiques qui seraient nécessairement attribués à toute configuration possible d’un pouvoir destituant.
I.
Une compréhension exacte et approfondie de notre temps conduit à une conception duale de l’humanité, depuis que l’ensemble des attributs accordés précédemment aux dieux est accessible au moyen d’une étude approfondie de soi-même, une telle introspection n’est rien d’autre que l’humanité croyant en l’humanité. (Velemir Khlebnikov)
En premier lieu, le pouvoir destituant est en tout point l’antithèse du pouvoir constituant, car il refuse de rechercher une fin, un but ou un objectif politique. En particulier, pour Tronti, l’exemple le plus emblématique d’une politique constituante se retrouve dans le mouvement ouvrier historique, avec son objectif principal de réaliser l’idéal socialiste. Alors que dans une phase antérieure d’accumulation capitaliste, il y aurait pu avoir une certaine logique stratégique pour promouvoir le socialisme au niveau d’un objectif constituant, Tronti soutient que les conditions actuelles d’exploitation ont rendu un tel programme politique obsolète, fournissant ainsi les débuts d’une justification pour rechercher plutôt une alternative destituante [7].
Dans ses allusions au « lever de soleil » et à un « avenir radieux », Tronti fait un subtil clin d’œil à la critique énigmatique du paradis des socialistes utopiques, telle qu’elle a été formulée dans la quatrième thèse de Thèses sur le concept d’histoire de Benjamin :
« De même que certaines fleurs tournent leur corolle vers le soleil, le passé, par un mystérieux héliotropisme [8], tend à se tourner vers le soleil qui est en train de se lever au ciel de l’histoire. Quiconque professe le matérialisme historique ne peut que s’entendre à discerner ce plus imperceptible de tous les changements » [9].
Ce passage mentionne deux images métaphoriques qui avaient une signification profonde au sein du mouvement ouvrier allemand. Mis en évidence dès la première phrase de l’ancien hymne du parti social-démocrate allemand, « Brüder, zu Sonne, zur Freiheit (Frères, au soleil, à la liberté) », le soleil symbolise la façon dont une politique fondée sur le pouvoir constituant est essentiellement une politique orientée vers l’avenir, toujours tournée vers un objectif de liberté future. Quant à la fleur – et plus précisément l’œillet rouge - elle représente le parti social-démocrate lui-même, qui s’oriente vers une victoire radieuse.
Or, pour Tronti comme pour Benjamin, un tel regard tourné vers l’avenir est la marque du réformisme le plus abject. Ainsi, le « mystérieux héliotropisme » mentionné dans la quatrième thèse sous entend un renversement hégélien, dans lequel le parti historique tourne sa perspective vers « ce qui a été », dans les époques révolues du passé. De plus, dans les Thèses sur le concept d’histoire, ce coup d’œil dans le rétro est censé créer un lien avec une conception du présent qui souligne la centralité de la lutte des classes : « il existe un accord secret entre les générations passées et la notre » [10]. C’est précisément et exclusivement dans la lutte, ici et maintenant, que Tronti situe la force du pouvoir destituant : puisque le réalisme capitaliste nous a dépouillé de toute capacité à imaginer un futur sans oppression, les fausses promesses des lendemains qui chantent sont moins susceptibles de nous séduire et de reporter le conflit à plus tard.
Compte tenu de leur passé tumultueux, il est intéressant de noter que Tronti s’en prend également à la vision plus sophistiquée et actualisée du pouvoir constituant d’Antonio Negri, élaborée dans Il potere constituente de 1992 [11]. En fait, il ne s’agit là que de l’un de leurs nombreux désaccords remontant à la dissolution de la revue Classe Operaia en 1967, qui a marqué la fin de leur collaboration commune dans le domaine théorique [12]. Bien qu’il n’y ait pas la place ici pour aborder l’étendue de leurs divergences intellectuelles, celles-ci peuvent être sommairement résumées par une différence de caractère. Pour le dire crûment, le pessimisme mélancholique de l’intellect de Tronti s’oppose à l’optimisme de Negri.
II.
Let my wretched bones be buried / in a nameless cemetery in Sverdlovsk. / Because there my friends are laying / with their profiles in marble and roses. / On acid blue fields of snow / they fell with lead in their skulls / these frontline soldiers of Perestroika. (Boris Ryzhy)
Que mes misérables ossements soient enterrés / dans un cimetière sans nom de Sverdlovsk. / Car c’est là que reposent mes amis / avec leurs profils en marbre et en roses. / Sur des champs de neige d’un bleu acide / ils sont tombés avec du plomb dans le crâne / ces soldats de première ligne de la Perestroïka. (Boris Ryzhy)
Deuxièmement, l’émergence du pouvoir destituant est concomitante avec la disparition du sujet Moderne. Cette affirmation découle d’un retournement inattendu que Tronti opère au sein d’un récit généalogique vu et revu, dans lequel le travailleur prolétaire traditionnel est élevé au-dessus de son rôle classique de sujet politique pour atteindre le sommet de la subjectivité en tant que telle. Partant des premiers stades de la Modernité, lorsque la pensée spéculative a commencé se pencher sur la subjectivité individuelle en tant que concept philosophique abstrait, il observe une progression historique qui culmine finalement avec le sujet collectif, social et politique incarné par l’appartenance à la classe des travailleurs salariés. Cependant, malgré son vernis socialiste, l’histoire qu’il raconte corrobore tacitement le lien historique entre le pouvoir constituant et l’époque qui a donné naissance à l’État bourgeois.
Selon Tronti, le problème n’est pas seulement que, depuis au moins l’époque de l’abbé Sieyès, le pouvoir constituant est resté intrinsèquement lié au Tiers État [13], mais le fait que, même sous son apparence socialiste, la politique constituante n’a plus sa pertinence d’antan et se révèle de plus en plus déficiente dans la formulation d’aspirations capables de galvaniser les masses exploitées. Ce n’est pas un hasard si le vieil idéal socialiste a disparu de l’imaginaire populaire au moment même où la figure du sujet ouvrier traditionnel, qui s’efforçait de le mettre en place concrètement, s’est elle aussi effacée. Et ceci nous amène à un autre aspect de la dispute entre les deux anciens alliés intellectuels : pour Negri, l’éclipse du mouvement ouvrier historique inaugure une phase de progrès qui révèle aujourd’hui la véritable envergure de la subjectivité ouvrière et la force de son pouvoir constituant ; à l’inverse, pour Tronti, la phase actuelle de l’accumulation capitaliste marque la fin d’un sujet capable d’actualiser un tel projet constituant positif.
En d’autres termes, Negri et Tronti diffèrent radicalement dans leur lecture de la situation inaugurée par ce que l’on appelle « la troisième révolution industrielle » [14]. Le premier voit d’un œil favorable la désindustrialisation du travail comme une recomposition de la classe ouvrière en un sujet plus redoutable, doté des savoirs et des socialisations caractéristiques de la production immatérielle. Le second considère cette situation comme la fragmentation extrême du travail et une impasse, qui place le salarié dans un état de précarité. De plus, si la subjectivité doit être jugée en terme de puissance d’agir politique, alors, quelque soit les mesures de la situation objectives ou subjectives ; la classe ouvrière traditionnelle a quitté la scène historique. À sa place, il n’y a plus que les restes des victimes de la « perestroïka » ou de la « reconstruction », comme on dit dans le monde libre.
Au milieu de ces sombres circonstances, Tronti réussit néanmoins à trouver un fil rouge, car la sublimation de la classe ouvrière dépassée « signifie aussi conserver l’essence de sa méthode, le mouvement de sa politique » [15]. En d’autres termes, il situe dans la disparition de la figure de l’ouvrier une inversion dialectique implicite, digne de l’aphorisme bien connu de Sun Tzu : « Quelques critiques que puissent être la situation et les circonstances dans lesquelles tu te trouves, ne désespère de rien ; c’est dans les occasions où tout est à craindre qu’il faut ne rien craindre ». Ainsi, en étant privé de ses dimensions subjectives et constitutives préalables, l’exploité et l’exclu peuvent désormais libérer leur véritable puissance destituante contre l’ordre actuel des choses. De plus, les prolétaires peuvent enfin acquérir la capacité de concentrer leur lutte directement contre les conditions de leur exploitation sans se laisser tromper par des illusions idéologiques utopiques.
III.
Camarades ! / Aux barricades ! - / les barricades des cœurs et des âmes. / Le seul vrai communiste / est celui qui a brûlé tous les ponts de retraite... / Effacez tout ce qui est ancien de vos cœurs. / Les rues sont nos brosses / les places nos palettes... (Mayakovsky)
Troisièmement, toute théorisation du pouvoir destituant est issue de l’expérience de la révolte concrète. En fait, le terme a été dès le début intimement lié à la révolte, puisqu’il a été initialement inventé par le collectif de recherche militant Colectivo Situaciones, dans son analyse du soulèvement argentin de décembre 2001. De même, Tronti établit un lien entre le pouvoir destituant et les soulèvements réels, mais élargit sa portée pour prendre en compte une séquence de révoltes plus large. A titre d’exemple, il examine le soulèvement de masse en Argentine en 2001 en comparaison avec le mouvement de réaction au coup d’Etat qui a éclaté dans les barrios de Caracas en 2002 ; l’action directe du black bloc à Seattle en 1999 et à Gênes en 2001 ; et se penche enfin particulièrement sur les émeutes qui ont secoué les banlieues d’Île-de-France en 2005. À partir de cette perspective plus large, il est en mesure d’affiner le concept en le distanciant davantage des pièges institutionnels du pouvoir constituant.
Dans son examen des émeutes de 2005, Tronti perçoit la perspective de nouvelles méthodes de lutte, mais reconnaît également que ces explosions de frustration présentent les faiblesses caractéristiques du climat prédominant de défaite et de décomposition prolétariennes. En effet, au cours des dernières années, nous nous sommes habitués à voir les soulèvements décliner vers des accès de désespoir jusqu’à ce qu’ils finissent par s’épuiser totalement. Ainsi, de la même manière que les grands partis socialistes ont canalisé le pouvoir constituant contenu dans le mouvement ouvrier historique, Tronti soutient qu’une certaine forme d’organisation est nécessaire pour une nouvelle politique destituante d’impact comparable.
Son insistance répétée sur le fait que l’organisation est le seul domaine du pouvoir, de la force et de la puissance conduit au dilemme le plus crucial abordé dans l’interview : l’incohérence paradoxale entre les masses et leur organisation, la spontanéité et la spontanéité de l’action. C’est-à-dire que, d’une part, la nature rebelle du pouvoir destituant signifie qu’il est enclin à des éruptions inattendues ; mais que d’autre part, une planification calculée est la seule option pour exploiter son potentiel maximal. Puisque le problème brûlant de la relation entre spontanéité et organisation sera probablement présent jusqu’à ce qu’une révolution mondiale réussisse pleinement, Tronti s’abstient de proposer des réponses superficielles, laissant les solutions attendre leur vérification empiriques dans le laboratoire de la subversion.
IV.
Je m’apelle JAZRA / Ici je suis clandestin, malgré la gauche / Je suis né dans le crépuscule de l’Ouest/ Et cette soirée est juste splendide / Pour casser des têtes de fascistes. (Jazra Khaleed)
La politique du pouvoir destituant se distingue de l’approche constituante traditionnelle par son désaccord irréconciliable avec le réformisme. Une fois encore, le mouvement ouvrier historique, sous la direction des socialistes, illustre le mieux cette voie des réformes fragmentaires. Tout en affichant des ambitions utopiques à long terme, l’approche socialiste était en fait principalement une recherche pragmatique de victoires immédiates et plus lointaines comme le droit de vote, les augmentations de salaire et l’amélioration des conditions de vie. Pourtant, comme le diagnostique Tronti, l’apparent progrès qu’on pourrait voir dans les réformes à petits pas revient à rendre sa cage plus confortable et empêche la classe ouvrière d’atteindre son objectif révolutionnaire. Ce que les armes de la critique exposent de l’idéologie réformiste, c’est la manière dont elle opère en assurant un gain relativement faible en échange d’une perte beaucoup plus grande et dévastatrice.
De manière quelque peu ironique, Tronti se tourne vers les réflexions de Marx sur la vague révolutionnaire de 1848, non seulement pour étayer la critique du réformisme (ci-dessus), mais aussi pour donner quelques indications sur le caractère putatif d’une forme d’organisation manifestement nouvelle. Surtout, la première leçon à tirer de son interprétation de La Guerre des Classes en France est qu’un pouvoir destituant fait grandir et consolide sa propre force en déterminant plus clairement ses cibles dans son attaque de l’ordre existant. Alors que la contre-révolution est généralement perçue comme une menace extérieure, il affirme à l’inverse, et de manière contre-intuitive, qu’elle est en réalité engendrée par les avancées révolutionnaires du parti insurrectionnel. Cette idée remonte à la publication en 1966 d’Ouvriers et capital. Dans la description de conflit de classe proposé dans le texte, les patrons tentent de maintenir les exploités dans la prétendue objectivité de la sphère économique, alors que la classe ouvrière lutte en parallèle pour atteindre une autonomie subjective qui divise le capital et le travail en deux camps antagonistes. De même, un mouvement ne peut aujourd’hui muter en un pouvoir destituant organisé qu’en provoquant une fracture similaire qui fait apparaître un ennemi de classe distinct, et avec lui, une nouvelle forme de contre-révolution.
V.
The orange sun is rolling across the sky like a severed head, gentle light glimmers in the ravines among the clouds, the banners of the sunset are fluttering above our heads. The stench of yesterday’s blood and slaughtered horses drips into the evening chill. (Isaac Babel)
Un soleil orange roule dans le ciel comme une tête coupée, une clarté douce flamboie dans les crevasses des nuages noirs, et les étendards du couchant flottent sur nos têtes. L’odeur du sang d’hier et des chevaux tués goutte dans la fraîcheur du soir. (Isaac Babel)
La force destituante précipite une faille dans l’ordre des choses qui aboutit à des états d’exception, la guerre civile et l’ingouvernabilité. Avec le développement des hostilités entre le parti de l’insurrection et le parti de l’ordre, entre la révolution et la contre-révolution, Tronti envisage le passage d’une véritable guerre civile à un état de désordre absolu. Se démarquant implicitement des conceptions de Giorgio Agamben sur la guerre civile mondiale et l’états d’exception, Tronti soutient que l’ère néolibérale actuelle est caractérisée par le règne étouffant de la normalité. Dans un article de 2009, il insiste même sur le fait que l’ordre mondial apparaît précisément comme une stabilité démocratique impériale, une Pax Americana : ’Contrairement à ce que l’on entend souvent, en particulier dans les milieux progressistes, je rejette l’idée que nous vivons actuellement une séquence de guerre centrale. Il me semble que toute cette emphase mise aujourd’hui sur le tandem paix/guerre est tout à fait disproportionné. Toutes les guerres ont lieu aux frontières de l’empire – qu’on pourrait appeler ses lignes de faille critiques - mais l’empire vit intérieurement une nouvelle paix, même si je ne sais pas si elle durera cent ans elle aussi. C’est dans ces conditions, la paix à l’intérieure et la guerre à l’extérieur, que la démocratie ne se contente pas de l’emporter, mais qu’elle connaît un triomphe retentissant’ [16]. Le seul moyen possible de perturber le fonctionnement routinier de l’imperium global est d’organiser une puissance destituante capable de produire un ennemi diamétralement opposé, et de provoquer ainsi un affrontement si sauvage qu’il débouche sur une situation totalement ingérable, incontrôlable et ingouvernable. A ce titre, ce n’est nullement une coïncidence, mais plutôt une confirmation, qu’après trois années de troubles généralisés et de soulèvements récurrents, la guerre s’abat à nouveau aux portes de l’Europe. Cependant le mot d’ordre reste alors le même qu’à l’époque où elle menaçait d’engloutir le continent : transformons la guerre impérialiste en guerre civile !
Idris Robinson
Une version espagnole est accessible ici.
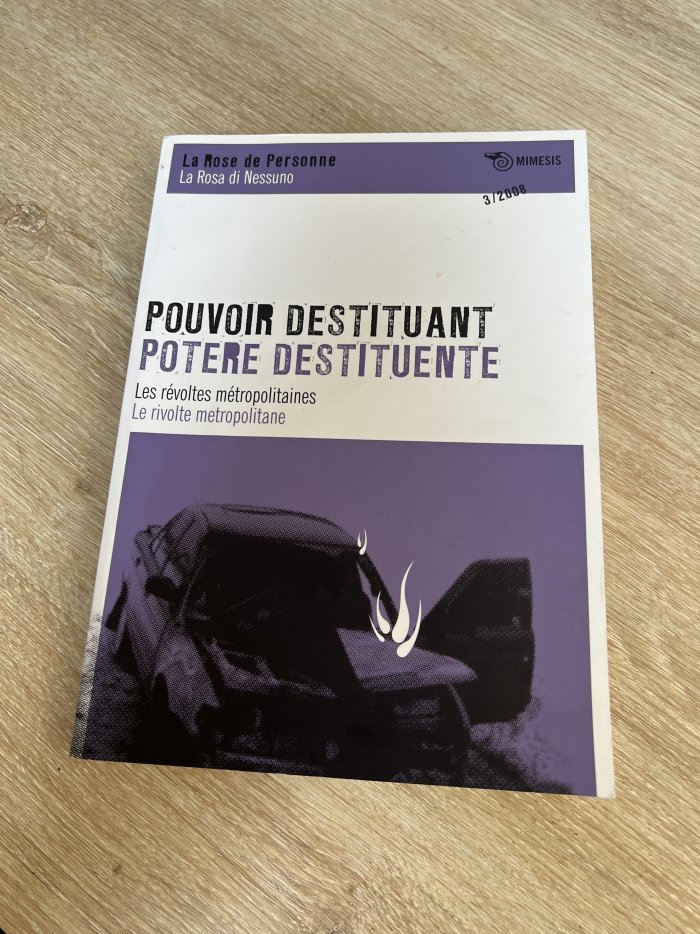
Sur le pouvoir Destituant - Un entretien avec Mario Tronti
- Adriano Vinale : La première chose qu’il m’intéresse que nous analysions ensemble c’est le problème de la subjectivité politique, à savoir si cette subjectivité se produit aujourd’hui et si oui, comment. De manière plus générale, si le processus de subjectivisation est bien le mécanisme à travers lequel nous pouvons aujourd’hui encore penser l’action et le militantisme politique. Ce que je me demande, en fait, c’est s’il ne faut pas tirer quelques enseignements de l’histoire du féminisme, en en acceptant le court-circuitage du processus même de subjectivisation, du sujet comme lieu privilégié de la formation de l’action politique, auquel il a procédé. Car il est évident que les processus de subjectivisation ont montré leurs limites et qu’il convient peut-être de commencer à penser le politique et la politique en partant de cette impossibilité à raisonner dans les termes traditionnels de la subjectivité politique.
- Mario Tronti : En réalité cela fait un certain temps que je ne raisonne plus en termes de subjectivité, et cela, pour une raison bien précise : parce que lorsque l’on parle de subjectivité, on a le besoin d’en avoir une en face, à portée de main ou en action. Mais quand ces conditions ne sont pas réalisées, parler de subjectivité équivaut à parler d’autre chose. De plus, derrière cette question, il y en a une autre qui est peut-être plus fondamentale encore, qui est celle de la crise du sujet moderne, qui s’identifie avec le dépérissement du projet moderne, projet qui était fondé précisément sur le sujet. Nous sommes longtemps restés enfermés dans cette dialectique projet-sujet. Je crois que Marx lui-même a suivi un parcours identique. Je pense que cette logique a continué à fonctionner pendant une longue période qui ne se compte pas seulement en décennies, mais en siècles, depuis le début de l’ère moderne jusqu’à la moitié du XXe siècle. Cette idée de subjectivité - et l’idée même de sujet - a connu différentes évolutions. Il y a eu une réflexion philosophique importante, jusqu’à ce qu’avec l’apparition du marxisme, la naissance du mouvement ouvrier, cette subjectivité se transforme en une subjectivité collective, une subjectivité sociale, politique. Je crois en outre que l’arc décrit par la modernité, du sujet individuel, de l’individu-sujet au sujet social, met un point final à l’histoire du sujet. Cette forme de présence à l’histoire est entrée en crise. Mon impression est qu’une autre histoire est en train de s’ouvrir, une autre histoire, dont les développements possibles ne sont pas encore clairs. J’ai l’impression qu’avec l’émergence de la classe ouvrière, du sujet ouvrier, de la subjectivité ouvrière, l’histoire moderne du sujet, l’histoire du sujet moderne, ou si l’on veut, de la subjectivité, a été menée jusqu’à son terme. Si bien que l’irruption de la classe ouvrière m’apparaît davantage comme le point final plutôt que le début d’une histoire. Il ne s’agit de rien de moins que de la conclusion de l’histoire moderne en tant que telle. Cette constatation n’a aucunement pour but de minimiser la présence de la classe ouvrière. Je crois au contraire qu’elle aboutit à exalter cette présence, dans le sens où elle a été une force qui est parvenue à porter à son terme tout un parcours historique, qui n’est en fin de compte rien d’autre que le parcours long et complexe de l’histoire moderne. Sa défaite a le double effet de mettre en crise l’idée de sujet et de ne pas laisser l’élément résiduel d’un autre type de subjectivité, mais semble au contraire signifier la fin de la subjectivité elle-même.
- Dans La politica al tramonto [Le crépuscule de la politique], il y a quelque chose qui m’a surpris : tu y soulignes en effet à plusieurs reprises et avec une emphase évidente, le sens du positionnement et tu réhabilites l’idée d’une « révolte éthique », qui est classiquement antithétique avec celle de la révolution. Cela apparaît comme un espace nouveau qui est ouvert par cette décadence de la subjectivité politique qui s’est achevé avec les années Soixante. Il est bien clair que nous n’avons plus affaire à la dichotomie classique - celle d’un Camus, pour me faire comprendre. Mais alors en quel sens peux-tu parler de révolte éthique ?
- Effectivement cette expression est un peu étrangère à mes habitudes mentales. J’ai toujours eu une pensée antithétique, qui en tant que pensée politique forte ne laissait aucun espace à l’éthique. A l’évidence la crise de la révolution politique que nous avons connue, en tenant compte des événements dont nous venons de parler, ouvre des espaces nouveaux. Avant tout parce que le champ politique se révèle être un champ limité par rapport au type de réponse que le monde tel qu’il est nous pousse à formuler. Ce type de monde, ce modèle social dominant a pris une forme totalisante. Il a désormais envahi tous les espaces, y compris ceux de la personne humaine, si bien qu’une réponse qui ne serait que purement et seulement politique ne peut apparaître que comme inadéquate, ne peut pas être à la hauteur du problème pose, qui est précisément un problème global. Cette considération coïncide avec cet autre sujet qu’est la redécouverte de la dimension anthropologique du politique. Ce qui se fait jour ici c’est la nécessité de se mesurer à nouveau avec la substance de l’être humain, qui est sans doute plus complexe que ne l’avait proclamé la tradition révolutionnaire marxiste ou celle du mouvement ouvrier. Il y a eu une réduction de l’homme à son statut de travailleur, à son statut d’homme maniant l’instrument de son travail. En élargissant la représentation anthropologique, on élargit du même coup la possibilité de réponse. En outre, on ouvre des espaces nouveaux, parce que ce type de monde et cette forme sociale, en ayant pris cet aspect totalisant, devient d’autant plus méprisable de tous les points de vue, et donc est d’autant plus exposé au rejet. La révolte éthique nous dit que nous ne pouvons que nous opposer d’une manière aussi totale qu’est totalisante la réalité à laquelle nous sommes confrontés et qui se trouve en-dessous, au-dessus, à l’intérieur de nous-mêmes... Il y a eu de puissants processus d’intériorisation de cette totalité au niveau des individus, et pas seulement des individus, mais aussi des subjectivités sociales. Ce processus d’intériorisation des esprits animaux bourgeois, cet embourgeoisement de la forme-individu, s’empare de ce qui subsiste ou de ce qui se dessine encore, même si c’est d’une façon désormais mystificatrice et décadente, en matière de subjectivité sociale. Au sein même des subjectivités sociales il y a désormais intériorisation d’un monde ennemi. C’est ce qui explique que les organisations collectives des individus fournissent le même type de réponse que les individus eux-mêmes. De même que l’individu isolé se résigne aujourd’hui au fait qu’il faut qu’il se modèle sur ce qu’on lui demande d’être - c’est-à-dire un bourgeois : si tu veux vivre, si tu veux vivre convenablement, et tout le monde aspire à vivre convenablement, il faut devenir un bourgeois -, de même les organisations collectives, le syndicat, le parti, se résignent à cet impératif. Si l’on veut bien agir dans ce monde, il faut intérioriser cette caractéristique qui consiste à être ce que l’on vous demande d’être. C’est cela qui est à l’origine de la révolte éthique, parce qu’il y a un processus qui fait pénétrer à l’intérieur de nous-mêmes l’ennemi qui autrefois n’était qu’extérieur à nous et qui devient donc à présent plus compliqué, plus dangereux, puisqu’il s’agit d’un ennemi intérieur, beaucoup plus difficile à combattre.
- A propos du syndicat, dans le plan de ton ouvrage Operai e capitale [Ouvriers et capital] le parti avait une fonction purement révolutionnaire, tandis que le syndicat avait lui une fonction de médiation des besoins sociaux et fonctionnait donc comme vecteur des instances de la classe ouvrière afin de les intégrer au système capitaliste. Il y a peu de temps encore j’aurais dit que le rapport entre syndicat et parti, du moins en Europe, semble se renverser, ou plutôt que le militantisme politique s’effectue dans le syndicat. Les récentes consultations italiennes sur le welfare semblent cependant changer encore les données du problème : le syndicat se propose à nouveau comme une sorte d’entonnoir de médiation des instances du capital. Quel est ton avis à ce propos.
- Les destins de ces deux formes d’organisation ont évolué de manière assez parallèle, disons qu’elles se développent aussi de manière convergente, dans le sens où il s’agit de deux formes organisées qui ne disposent que d’une marge pour se soustraire aux mécanismes dominants et qui opèrent donc en leur sein avec des caractéristiques différentes. J’ai toujours pensé que le syndicat représentait de façon plus empirique la condition sociale et que, par conséquent, il était moins intégré que le parti. Précisément en raison de la proximité plus grande qu’il avait par rapport aux besoins du sujet-travailleur, il ressentait de manière plus juste la pression de la réalité et avait donc un caractère un petit peu plus représentatif. Le parti, en en médiatisant encore plus la politique, en s’éloignant, est complètement entré dans la logique du système. Aujourd’hui, en toute franchise, cette distinction me semble beaucoup moins pertinente qu’autrefois.
- Dans une interview que tu a donnée à Ida Domnijanni dans Il Manifesto à l’occasion du quarantième anniversaire de la parution de Operai e capitale, tu concluais en invoquant un nouveau Lénine afin d’organiser le travail qui actuellement n’est pas syndicalisable. Si nous mettons entre parenthèses le syndicat classique, l’ultime héritier de la politique du siècle dernier, l’effort pour syndiquer le travail immatériel et précaire constitue peut-être le défi majeur auquel est confronté l’organisation politique et donc, le militantisme politique, lui aussi.
- C’est là un champ complètement déserté de toute initiative aussi bien syndicale que politique. Je suis toujours stupéfait de constater qu’on ne concentre pas l’attention sur ce secteur et que l’on n’y retrouve des formes, même plus faibles que par le passé, de nouvelle subjectivité. Je suis bien conscient des difficultés, car nous avons toujours travaillé sur des formes de présence sociale objectivement et structurellement concentrées sur le lieu de travail, sur le territoire, la ville. Ce type de concentration objective permettait justement une forme d’organisation directe. Ce n’est pas un hasard si on parle aujourd’hui de boulots au pluriel plutôt que de travail - à tort d’ailleurs, car de cette façon on ne fait qu’entériner de manière empirique la fragmentation du travail. A mon avis il faut remettre au centre du débat la catégorie de travail au singulier, précisément la tâche des organisations est de réunifier ce qui a été fragmenté. Cette tâche ne consiste pas à organiser les fragments, mais à les unifier en une définition unique du travail qui soit à la hauteur de l’actuelle société de la connaissance, de la flexibilité, de la précarité... Unifier autant qu’il est possible, malgré les grandes difficultés à surmonter, car il s’agit de formes de travail qui échappent à toute unité objective. Ceci me semble encore plus vrai aujourd’hui que ce ne l’était par le passé. Autrefois on parlait d’apporter la conscience aux ouvriers de l’extérieur, il s’agit à présent d’apporter de l’unité de l’extérieur, c’est-à-dire l’unité d’une condition de travail.
- Et le non-travail ? Selon une interprétation assez courante, en effet, les récentes révoltes en Europe, en particulier celles des banlieues françaises, représenteraient une rébellion contre le non-travail. Pas un refus du travail, mais une instance presque hérétique de révolte contre la non-exploitation…
- …Une revendication d’exploitation, en quelque sorte. Le non-travail est encore plus difficile à organiser. De plus, il existe deux sortes de non-travail. Il y a le non-travail contraint, qui est le manque de travail, sur lequel on pourrait échafauder des formes empiriques d’organisation, pour obtenir un revenu unifié, un revenu garanti... Et puis il y a le non-travail voulu, à savoir cette grande problématique que l’ouvriérisme avait soulevé à une époque plus propice, et qui était celle du non-travail comme refus du travail, ce qui ouvrait un pan très complexe et très délicat de réflexion qui n’a pas été compris. Je ne crois pas qu’aujourd’hui on puisse revenir à cela, parce que le refus du travail surgissait dans un contexte de plein emploi.
- Beaucoup de penseurs contemporains pensent notre époque comme une époque d’état d’exception. Au contraire tu as pour ta part insisté avec une certaine fréquence sur le fait que la subjectivité politique classique, la dialectique même entre ouvriers et capital, était liée à un horizon étatique d’exception qui n’existerait plus aujourd’hui, de même qu’aurait disparu avec lui la dialectique classique entre subjectivités politiques antagonistes. Une fois l’époque de l’état d’exception achevée, dans les années Soixante, la lutte de classe prend fin. Mais ne serait-ce que sous l’aspect politico-militaire, notre époque n’est-elle pas malgré tout ’époque par excellence de l’état d’exception ?
- Franchement, lorsque je regarde autour de moi, je ne vois aucun état d’exception. Il est toujours étrange de revendiquer la normalité. Un pays « normal », une gauche « normale »... Je ne vois pas comment les choses pourraient être plus normales qu’elles ne le sont ! L’état d’exception est un état objectif d’ingouvernabilité. Pas au sens strictement gouvernemental, mais dans le sens de contrôle de la situation, de gestion de la situation en général. L’état d’exception existe quand cette possibilité de contrôle et de gestion échappe à ceux qui tiennent les rênes du pouvoir réel, à savoir les classes dominantes. Pour ma part, je pense qu’on a assisté à un large processus de normalisation. C’est ce qu’ont été fondamentalement les années Quatre-vingts, à savoir la transformation d’une condition, d’une situation de contradictions parfois insolubles, en une phase d’étroit contrôle social et politique. Depuis la Trilatérale, on a assisté à ce tournant de la part du capital, qui a complètement repris en main les rênes du monde. Il me semble que cette reprise en main constitue une nouvelle Paix de Cent Ans.
- Tout cela vient du fait que tu interprètes comme incompatibles état d’exception et normalité, état d’exception et processus de normalisation. Il est clair que notre horizon de référence est celui de la démocratie - absolue, réelle, totale, on peut l’appeler comme tu veux. Dans un tel contexte, il me semble que la démocratie a réduit au rang de norme son fonctionnement fondé sur l’exception, sur la crise - qui peut aussi bien être une crise de production, une crise politique, sociale, militaire... il s’agit à l’évidence d’un autre type d’exception que celle à laquelle tu penses. Mais si nous nous penchons sur les dix ou vingt dernières années, la crise est devenue le mécanisme géopolitique de contrôle des ressources économiques et humaines. C’est par la crise qu’on gère le front intérieur et le front extérieur. Cela n’équivaut pas en quelque sorte à recourir à un état d’exception, même s’il est normalisé ?
- Oui, dans ce sens-là, on pourrait en effet exprimer les choses de cette manière... mais, personnellement, ce qui me frappe le plus, ce n’est pas tant l’état de crise que le fait que cette crise justement n’explose pas. L’exemple qui me vient aussitôt à l’esprit, un exemple banal, empirique, c’est celui de la crise périodique des places financières. Régulièrement on voit pointer ce fameux « vendredi noir » et il semble soudain que tout soit sur le point de s’écrouler, de sombrer à pic et c’est l’alarme générale. Cela dure pendant quelques jours, une semaine, puis la semaine suivante tout redevient normal parce qu’il y a la Banque Centrale, les banques qui investissent, il y a présent au niveau institutionnel des formes de contrôle qui n’existaient auparavant. C’est cela la mondialisation. Une capacité plus grande de contrôle sur le cycle économique, qui tant qu’il ne fonctionnait qu’au niveau national était impossible. Car l’Europe est intégrée, le marché mondial est intégré, et plus on intègre, plus on contrôle. Plus rien n’échappe à présent, plus rien n’explose. Je ne pense pas qu’il s’agit là d’un état permanent pour l’avenir. C’est à Marx que j’ai emprunté cette manière d’envisager les choses. Jenny Marx disait : « Aujourd’hui Marx est heureux parce qu’il y a eu une crise de production à Londres, il est plein d’allégresse ». Je pense qu’au bout du compte quelque chose finira par s’effondrer, car l’une des caractéristiques du capital c’est son caractère ingouvernable, c’est-à-dire cet aspect anarchique de la production capitaliste qui en constitue le fondement. Aujourd’hui cet aspect est toujours plus dissimulé car ils existent des mécanismes institutionnels qui le réglementent et le contrôlent, mais un jour viendra où quelque chose échappera à ce contrôle. Nous ignorons quand et comment cela se produira. Mais quand je pense à l’état d’exception, je pense au moment de la guerre civile. La guerre civile est le moment où personne n’a plus la capacité de maîtriser l’équilibre des conditions. Voilà pourquoi je considère comme un peu pathétiques les mouvements que l’on appelle pacifistes. Car plus il y a de paix, plus il y a d’ordre, et plus ceux qui dirigent ont de capacités de contrôle. La seule chose qui peut disloquer cet ordre et cette possibilité d’hégémonie c’est justement une forme de conflit tellement dur et âpre que l’on n’est plus capables de la contrôler. Il est vrai qu’aujourd’hui on assiste aussi à une utilisation des conflits pour remettre de l’ordre, mais ce n’est pas un hasard s’il s’agit toujours de guerres périphériques. Il faudrait que nous raisonnions un peu plus sur la forme de la guerre. La forme de la politique à un moment donné correspond à une forme de guerre. Il faut que nous parvenions à comprendre la correspondance qui existe entre la forme de la politique et la forme de la guerre aujourd’hui. C’est un point intéressant, parce que la guerre se déploie aux marges de l’ordre mondial et assure en retour un ordre au centre. J’ignore si cela est le fruit d’une élaboration stratégique, ou si cela se produit de manière spontanée, mais il est de fait que la guerre n’explose plus désormais au centre du système.
- En énumérant la série des expériences de conflits qui ont éclaté dans la période précédente, il me semble que nous pouvons procéder à des appariements : Caracas et Buenos Aires, Seattle et Gênes, Los Angeles et Paris. Mais en l’occurrence c’est Paris qui sort un peu de la norme, car là ce n’est pas la crise économique qui explose, les couches moyennes ou les ouvriers qui se révoltent, comme c’est le cas en Amérique Latine, ce n’est pas non plus les secteurs militants contestataires, comme à Seattle ou à Gênes. Pourtant il nous faut apprendre de ces mouvements et en comprendre les instances. Quelle interprétation donnes-tu de l’explosion de violence qui touche désormais la France de manière cyclique ?
- Ce qui se passe à Paris suscite chez moi beaucoup d’intérêt, et, bien entendu, lorsque je vois les banlieues exploser, je suis satisfait parce que tout élément de perturbation et de désordre constitue un fait positif. Cependant j’en reviens toujours au point qui est, à mes yeux, central, quand je dis que ce qui manque aux jeunes d’aujourd’hui, aux jeunes générations, c’est le Vingtième siècle. Ayant vécu ce siècle - et mon seul regret c’est d’y être arrivé trop tard - quand je pense à la crise économique ce qui me vient en tête c’est 1929, quand je parle de guerre, je songe aussitôt à la Première Guerre Mondiale, à la Seconde Guerre Mondiale... Puis quand je suis confronté à des événements comme la guerre des Balkans ou la crise boursière je reste sur ma faim, car l’étalon de mesure est tout à fait différent. Certains ont ironisé sur le fait que j’utilise trop le qualificatif de « grand ». Cependant, pour moi, la différence qui existe entre le « grand » et le « petit » est d’importance, même au niveau quantitatif. Aujourd’hui lorsqu’un soldat est tué dans l’un de ces pays, on organise des cérémonies à grands renforts de drapeaux et de larmes... Mais à Dresde ce sont 80.000 personnes qui ont péri ! C’est pourquoi, lorsqu’une crise surgit, je suis immédiatement porté à faire des comparaisons. Non pas pour minimiser les crises d’aujourd’hui, mais simplement pour affirmer qu’elles ne débouchent sur rien d’autre. C’est justement pour cela que je ne suis pas un grand admirateur des mouvements. Beaucoup sont opposés aux mouvements parce qu’ils y voient une pratique de violence excessive. Pour moi ils traduisent au contraire une pratique faible. Le mouvement n’a pas de force. Et c’est peut-être précisément parce qu’il n’a pas de force, qu’il débouche sur la violence, qu’il se traduit par une violence gratuite, comme est toujours gratuite toute violence. La force, elle, est une chose sérieuse, elle influe sur les contradictions principales, elle se fait sentir. La force est toujours une force organisée, pensée, presque planifiée. Et ce n’est pas un hasard si le mouvement de même que les banlieues sont…
- ...Structurellement anti-léninistes.
- C’est vrai que j’ai cette matrice léniniste que je conserve à la vérité de manière un peu anachronique. Mais il n’y a que quand elle s’organise que la force peut réellement agir sur le réel. Et c’est pourquoi je dis que les mouvements doivent avoir leur propre force. Les mouvements devraient devenir la force d’aujourd’hui, étant donné que la forme du parti politique n’a plus aucune force. Les expériences du mouvement devraient s’auto-organiser de façon à se transformer en une puissance, plus seulement une force, mais une puissance. Mais pour cela, il faut une capacité de durée, de gestion, et je comprends bien que cela est contradictoire avec l’idée de mouvement, car si on gère un mouvement, si on aboutit à la transformer d’une manière ou d’une autre en une forme organisée, alors, il ne s’agit plus d’un mouvement. C’est là une impasse dont moi-même je ne parviens pas à sortir, malgré toute la sympathie que je peux avoir par ailleurs, car chaque Gênes, chaque banlieue constitue pour moi un moment important.
- Ne penses-tu pas que précisément la démocratie, en tant que mode de gouvernement par la crise, et ce caractère événementiel, imprévu du mouvement, qui est propre à la fin du XXe siècle et du début de ce nouveau millénaire, constituent un binôme indissociable ? C’est précisément parce que la démocratie a appris à se gérer par la crise et par la menace de la crise - sûrement d’intensité réduite, mais justement par là-même plus facile à contrôler -, que le mouvement finit par devenir un mouvement destituant, c’est-à-dire qui se révolte contre une structure qu’on veut lui imposer, ou qu’on voudrait lui imposer, sans parvenir à être constituant, et en se condamnant ainsi lui-même à une temporalité absolument ingérable, étant donné la conformation actuelle du travail.
- J’aime beaucoup cette idée de pouvoir destituant. Je pense qu’il s’agit d’une belle idée. Il faudrait y réfléchir dessus, approfondir et articuler un peu notre discours à ce propos. Car selon moi, c’est peut-être bien ce sur quoi débouche la crise de la subjectivité. La subjectivité, surtout quand elle devient subjectivité sociale, avec une possibilité, une réalité et une pratique d’organisation, était tout naturellement constituante, elle était porteuse d’un projet positif. Elle reliait en effet la lutte à la solution des problèmes davantage qu’aux raisons mêmes de cette lutte. Telle a été un peu la logique dans laquelle le mouvement ouvrier s’est enfermé, et qui était parfois davantage basée sur un messianisme socialiste que sur une critique du capitalisme. C’est-à-dire que l’idée du socialisme primait sur la critique du capitalisme. On comprend bien pourquoi. On pensait alors s’adresser à des classes subalternes, et à des classes subalternes on ne peut offrir une pure et simple raison de lutter qui n’inclue pas dès le début la perspective de l’issue vers un monde différent. Si tu y réfléchis, c’est le mouvement socialiste, davantage encore que le mouvement communiste, qui était le soleil de l’avenir. Aujourd’hui on est en train de réévaluer considérablement les aspects symboliques. Dans le passé, ces aspects symboliques étaient très forts : les hymnes, les chansons, les drapeaux, l’emblème du parti, qui évoquait toujours un avenir radieux... cette vision a connu une faillite complète, et c’est là un des seuls points positifs que je vois par rapport au passé - y compris par rapport au passé de la tradition socialiste. Aujourd’hui il me semble moins important d’avoir une idée du socialisme du XXIe siècle. Moins important dans la mesure où aujourd’hui il me semble possible de faire une critique pure et simple des conditions objectives, qui possède en elle-même assez de force pour avoir la même capacité de rassemblement et de mobilisation. Ne serait-ce que parce que nous n’avons plus affaire à des classes subalternes. Ce type même de travail que nous évoquions tout à l’heure, fragmenté, dispersé et s’effectuant cependant à un niveau de conscience supérieure par rapport au travail traditionnel - parce qu’il implique à présent des travailleurs de la connaissance, du savoir -, rend possible un discours plus réaliste, moins idéologique. Moins messianique et plus au cœur de la pratique de lutte effective contre ses conditions mêmes de travail, plutôt que contre ceux qui les mettent en oeuvre. C’est dans ces conditions que peut reprendre corps l’idée de pouvoir destituant. Car la priorité n’est pas tant le projet de construction de quelque chose, mais la destitution de ce qui existe, la mise en crise de ce qui est. C’est là l’idée sur laquelle j’insisterais. Je crois que tu conçois le pouvoir destituant comme alternatif au pouvoir constituant, tandis que les idéologies de la multitude continuent à parler de pouvoir constituant…
- ...je suis d’accord avec ton discours, dans le sens où il est clair que les partisans de la multitude, en continuant à proposer un pouvoir constituant, fonctionnent encore implicitement sur un principe de subjectivité. Il n’y a aucun doute là-dessus. C’est si vrai qu’ils placent le travail, même « dématérialisé », au sein du noyau fondateur de ce processus de subjectivisation immatérielle. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on ne comprend pas bien sur quel mécanisme de coopération sociale, de proximité physique, peuvent se fonder l’organisation et la lutte. A l’inverse, réfléchir sur un pourvoir destituant peut-être intéressant précisément pour penser au-delà d’une force révolutionnaire classique com prise comme subjectivité politique classique. Mais une fois qu’on a dit cela, reste entière la question de l’imagination. Car même si on refuse d’accepter de manière excessivement acritique l’idée d’une dématérialisation du travail ou celle du travail cognitivo-affectif comme seule forme du travail, il n’en demeure pas moins que l’imagination joue un rôle fondamental. Tu relèves de manière très nette la proximité qui existe entre l’idée d’homo democraticus, et celle d’homo œconomicus. Pour ma part je leur adjoindrais celle d’homo affectivus. La démocratie parvient à exercer un contrôle social à travers un système de production capitaliste, justement parce qu’elle agit, en partie du moins, sur les centres vitaux de l’imagination, c’est-à-dire sur un contrôle basé sur la dynamique désir/besoin. Il suffit de relire le début du Capital, où Marx affirme noir sur blanc que le besoin, même s’il est immatériel, n’en reste pas moins un besoin. La démocratie a toujours été basée là-dessus, aussi est-ce que son aspect le plus négatif ne se révèle que maintenant, ou bien est-ce que quelque chose a bougé sur le front de l’imaginaire et de l’imagination ?
- Je ne sais pas si la démocratie est un organe de reproduction élargie de l’imagination. Moi je la vois plutôt comme une manière de restreindre la capacité imaginative de l’être humain. Dans le sens où elle ne lui fournit que peu d’échappatoires, où elle l’enferme dans un horizon qui est assez répétitif. En outre, l’imaginaire a d’autres façons de s’exprimer, car il a le monde du marché, le monde de la consommation, le monde des loisirs, qui tous sont inscrits dans le temps de la démocratie. Je pense au contraire que nous devrions réévaluer de manière assez importante la force de l’imagination, dans un sens positif, et trouver un moyen de recharger nos forces - qui ne soit pas celui de la vieille conception de l’idéologie, d’une déconstruction de l’idéologie - afin d’élargir notre champ de vision.
- C’est dans ce sens que tu utilises la figure de la mythologie...
- Il y a longtemps désormais que j’ai tenté de me réapproprier ces territoires qui nous avaient été interdits par un excès de rationalisme, auquel le marxisme a contribué, en reconsidérant une complexité humaine beaucoup plus difficile à enfermer à l’intérieur de schémas matérialistes. Il y a tant de ressources humaines que l’on peut utiliser, et qui ont été détruites par ce mode de vie, par ce mode d’organisation de la vie que nous a imposé la société moderne, la société capitaliste. C’est le même type de pensée que je pratique depuis quelques années, à savoir une pensée très imaginative, y compris dans l’écriture, dans le style, très transversale, très allusice, tendant toujours à inciter à penser de manière différente, c’est-à-dire pas de cette manière froide, mathématique ou bien propre à l’économie politique, mais au fond, d’une manière qui favorise un élargissement et un approfondissement de l’être humain. Les mouvements contestataires devraient reprendre tous ce refrain : accuser le monde d’aujourd’hui de réduire l’être humain a bien peu de chose par rapport à ce qu’il pourrait être. Ce n’est pas d’un nouvel humanisme dont je veux parler…
- ...Ce que je voulais dire c’est que le processus d’intériorisation démocratique auquel tu te réfères est véhiculé de manière parfaite par la fonction conceptuelle et pratique de l’imagination. L’important travail de cartographie des passions affectives effectué par Spinoza, qui constitue pour nous l’irruption triomphale de la modernité révolutionnaire, a en réalité créé aussi un appareil catégoriel de manipulation affective.
- La manipulation affective est très importante dans les processus réels. L’imagination est quelque chose à manier avec beaucoup d’adresse, avec une grande capacité de contrôle, car elle peut se révéler dangereuse. Je pensais récemment au jeune Marx (et j’ai pourtant été de ceux qui tenté de s’en libérer dès que possible, lorsque dans les années Soixante on est passé au Capital, en laissant tomber les ’bavardages’ contenus dans les Manuscrits...). Je pense que nous aurions intérêt aujourd’hui à le relire d’une manière différente. C’est le seul moment où Marx adopte un discours un peu anthropologique, puis l’abandonne parce que d’autres problèmes, extrêmement importants, se présentent à lui. Cependant, c’est alors que ce que j’ai appelé la « critique de civilisation » trouve ses points d’appuis les plus forts. Car c’est là que Marx commence son discours sur le dépassement de l’aliénation, sur l’homme comme être générique - des notions qui ont été aujourd’hui rendues banales par le marxisme écologiste. Il faudrait au contraire les confronter avec leur origine. Si l’on parvient à surmonter quelques mouvements de défiance, ces écrits peuvent peut-être nous dire encore quelque chose.
- Lors de l’une de tes récentes interventions, à une question sur la biopolitique, tu as répondu que pour toi le seul horizon est celui de la géopolitique. J’aimerais bien comprendre ta position sur ce point ainsi que sur ce que tu viens de dire en référence à Marx et au concept d’homme générique, qui selon moi est précisément la racine de la biopolitique, comprise comme action sur l’humain en tant qu’espèce.
- Le discours sur la biopolitique, si nous le comprenons au sens que tu lui donnes, c’est-à-dire si nous pouvons lire ce discours du jeune Marx sur l’être générique en terme biopolitiques, peut être légitime. Mais j’ai l’impression que dans ce discours il y a également autre chose. En quelques mots : la politique sociale a subi toute une série d’échecs et elle en est arrivée au point où aucune évolution positive ne semble possible. Dans ces conditions, en revenir au bios m’apparaît davantage comme une régression qu’un pas en avant susceptible de nous permettre de contourner l’obstacle. Je crains qu’adopter cette position équivaille à subir de manière inconsciente l’hégémonie de la pensée adverse, c’est-à-dire celle de l’individualisme exacerbé, du retour à cette figure centrale de la singularité. C’est pourquoi j’aurais plutôt tendance à interpréter le bios comme une tentative d’adhérer à cet horizon, en changeant les termes du problème et en le reprenant à son propre compte, mais en s’y impliquant aussi plutôt qu’en le critiquant. L’importance de la géopolitique est quelque chose dont je suis plus que convaincu, mais cela est véritablement lié à la forme de pensée qui est la mienne et qui considère toujours la politique comme un terrain de forces qui s’affrontent. Mais quand j’essaie de circonscrire ce terrain, je ne le trouve plus au sein des pays pris individuellement, mais bien au niveau mondial, dans les grandes aires qui s’entrechoquent, et c’est là que je redécouvre l’idée des grands espaces. Cela me paraît être la chose la plus intéressante, la seule à propos de laquelle je garde encore aujourd’hui l’espoir d’une véritable crise, d’une crise radicale des équilibres existant. Les seuls conflits qui apparaissent comme difficilement solubles et peu gérables sont ceux qui impliquent les grands espaces mondiaux. Lorsque je considère ces grandes puissances asiatiques en pleine expansion, qui revendiquent leur présence politique dans le monde, je constate que peuvent en découler des nœuds de contradictions dont l’explosion peut remettre en cause l’équilibre d’ensemble. Je n’exclus pas que de ce type de conflits puissent surgir de nouvelles subjectivités actuellement indiscernables et qui pourraient par la suite s’opposer de façons stratégiques, créant des situations nouvelles, qui selon moi ne peuvent naître que des ces fractures. J’ignore si les choses se passeront exactement de cette manière, car il peut se faire qu’il s’agisse de faits solubles et donc susceptibles en dernière instance de créer de nouveaux équilibres. Mais ce que je conseille c’est de prêter une grande attention à ces espaces, à la présence de ces espaces, car il me semble que la politique aujourd’hui dépend plus de cette réalité que constituent un milliard et demi de Chinois que de la notion individu qui connaîtra probablement une crise.
- Une dernière question. Tu as récemment soutenu, de façon un peu rhapsodique, que la critique de l’économie politique elle non plus ne suffit pas, car elle ne parvient pas à échapper à l’horizon général de l’économie politique. Je voudrais bien comprendre ce que tu entends par là.
- Pour moi c’est un point crucial. C’est là une de mes conclusions les plus récentes. Peut-être Marx nous a-t-il entraîné sur une mauvaise voie, en restant prisonnier des limites de cette critique de l’économie politique, et non seulement en ne prenant pas en considération le reste, mais en en parvenant pas à s’émanciper de l’économie politique elle-même. Car si l’on se situe sur le terrain de l’économie politique, alors on ne se ménage aucun espace d’émancipation. Il s’agit en effet d’une science totale, d’un savoir total qui ne laisse rien à l’extérieur de lui, qui englobe tout. C’est la raison pour laquelle il est rare de trouver un économiste anti-capitaliste, un économiste révolutionnaire. Il y en a quelques-uns, mais ce sont des bêtes rares. Et si tu y regardes de plus près, tu t’apercevras qu’il ne s’agit pas d’économistes au sens strict, mais de personnages qui sont aussi autre chose. Je ne cesse de répéter qu’on parle trop d’économie. Les gouvernements politiques ne font aujourd’hui rien d’autre que de gérer l’économie. Mais le gouvernement d’une société peut-il se réduire à cette seule dimension ? Peut-il se résumer à la seule gestion de l’entreprise économique ? Jour après jour, il n’est question que de cela, on fait des campagnes électorales politiques où l’on en fait que parler d’argent. Tout est réduit à cela. Afin que le capitalisme se développe. Le capitalisme c’est l’économie et l’économie politique c’est le capitalisme. C’est pourquoi si l’on se contente de faire une critique du capitalisme en se confinant au seul domaine de l’économie politique, on ne parvient pas à sortir du capitalisme. J’en trouve une preuve supplémentaire dans la construction des sociétés socialistes qui, en suivant le schéma de Marx, sont tombées dans le même piège. Elles ont construit le socialisme sur la base des schémas économiques de Marx. Pendant des décennies en Union Soviétique, on édifiait le socialisme selon les schémas établis dans le livre II du Capital. C’est ainsi que cela fonctionnait, il fallait que cela fonctionne ainsi : production, circulation, distribution, consommation... Résultat, ils ne sont pas parvenus à construire une société véritablement différente de la société capitaliste. C’est en cela que le socialisme a échoué. A la fin, ils ont été contraints de reconnaître qu’il valait mieux revenir au capitalisme, qui fonctionne mieux qu’une société socialiste qui prétend fonctionner selon les schémas capitalistes. Personnellement, je ne pense pas qu’il puisse y avoir une critique de l’économie politique qui puisse s’affranchir totalement de l’économie politique elle-même. Lorsqu’on reste dans les limites fixées par le Capital, même si l’on en parle et qu’on se rend compte qu’il s’agit bien du monde actuel, on est inévitablement pris dans l’engrenage. La seule fois où l’on a tenté d’en sortir, il a fallu briser la cage, cette cage que constitue le Capital de Marx. Ainsi, lorsque Gramsci définit la révolution d’Octobre comme une révolution contre le Capital, il a fait preuve, selon moi, d’une intuition géniale, parce que la Révolution d’Octobre ne découlait pas du Capital de Marx. Elle a été une invention de Lénine, une invention entièrement politique. Mais après le moment de l’invention politique, comme ils étaient marxistes, les révolutionnaires russes ont réintégré la cage. Ils en sont sortis un moment, puis y sont rentrés à nouveau. A mon avis, la faillite de la construction du socialisme a été causée par le fait qu’il n’a pas persisté dans la voie de la rupture et que dans la construction du socialisme, on est retombé dans les schémas de l’économie politique, qui n’est en définitive rien d’autre que l’économie capitaliste.
- Comme je te l’ai dit précédemment, je voulais discuter avec toi de ce bref passage du début des Luttes de classe en France où Marx écrit : « Ce n’est point par ses conquêtes tragi-comiques directes que le progrès révolutionnaire s’est frayé la voie ; au contraire, c’est seulement en faisant surgir une contre-révolution compacte, puissante, en se créant un adversaire et en le combattant que le parti de la subversion a pu enfin devenir un parti vraiment révolutionnaire ».
- Marx fait donc cette affirmation stupéfiante que « ce n’est point par ces conquêtes tragi-comiques directes etc. ». Je trouve la formule splendide ! Qualifier les conquêtes directes comme « tragi-comiques » constitue la plus cinglante critique du réformisme que l’on puisse faire. Car le réformisme tout entier, le pragmatisme, le mouvement ouvrier, y compris le mouvement communiste italien, s’est attaché à ces conquêtes directes. Les qualifier de tragi-comiques est extraordinaire, parce que cela reflète une vérité effective, parce qu’il s’agit de conquêtes directes qui se révèlent ridicules. Plus on obtient de conquêtes directes et plus on est lié par elles à la condition présente. Les conquêtes directes permettent d’améliorer les conditions de travail, les conditions de vie, mais elles ne constituent pas une base qui permette de passer à d’autres conditions de vie, alternative à celles qui existent, mais enferment les travailleurs dans les limites de ce qu’ils ont obtenu et met un terme à leur lutte. C’est pour cela que ces conquêtes sont tragiques malgré leur caractère comique. Mais Marx poursuite de la façon suivante : « ... C’est seulement en faisant surgir une contre-révolution compacte, puissante, en se créant un adversaire et en le combattant, que le parti de la subversion a pu enfin devenir un parti vraiment révolutionnaire ». Ce qui signifie que le processus révolutionnaire - voilà que surgit à nouveau la question du pouvoir destituant - le pouvoir destituant consiste aussi à faire surgir un adversaire, à faire surgir une véritable « contre-révolution compacte ». Ne pas combattre pour la révolution, mais faire en sorte qu’il y ait une contre-révolution tellement forte, qu’en la combattant l’on soit en mesure de dépasser la stagnation que constitue la situation immédiate. Je trouve ce point de vue lumineux. Le parti de la subversion ne peut atteindre sa maturité que quand il a face à lui un adversaire puissant. Voilà pourquoi lorsque je vois l’adversaire gagner en puissance, j’éprouve un véritable enthousiasme. Quand j’ai vu naître le mouvement des neocons, unique en son genre, j’ai pensé qu’enfin nous avions ce qu’il nous fallait. Parce que ce mouvement représente une contre-révolution puissante. Par la suite ils ont perdu, car les mécanismes démocratiques sont assez forts pour tout récupérer. Mais c’était quelque chose qui jouait en notre faveur, je veux parler de cet adversaire fort, puissant, visible, explicite, contre lequel on pouvait décharger ses armes et aussi mener à leur maturation les forces du mouvement. Ces forces avaient besoin de cela, car si à la place d’un pouvoir qui les réprime dans un premier temps, puis les tolère et les contrôle, elles avaient vu enfin se dresser face à elles ce grand adversaire, elles auraient gagné en maturité.
- Oui, mais il s’agit de deux mouvements liés, comme si dans cette dialectique polarisée, forces du mouvement et contre-révolution compacte étaient complémentaires. C’est comme si le mécanisme démocratique réussissait à contrôler la manifestation de la contre-révolution compacte, afin de susciter une révolte qui lui permettrait ensuite à reprendre le contrôle de cette crise en s’en faisant le garant. C’est comme si la dialectique Bush-Clinton n’était absolument pas antinomique, mais complémentaire : mettre en avant les neocons pour permettre à la démocratie de reprendre en mains le gouvernail.
- C’est ce qui est en train de se passer, aujourd’hui on constate en effet cette capacité de reprise en main très forte. C’est avec une grande admiration que j’ai lu le livre de Huntington, Le choc des civilisations, qui, à la différence de ce que disent la plupart des gens, est un grand livre d’un auteur très réaliste en politique. Tout le monde s’est polarisé sur le titre et chacun l’a interprété à sa manière, mais Huntington a été capable d’interpréter ce qui était en train de se passer. La stratégie neocon est dictée par la peur qu’inspirent la Chine et la Russie nouvelle. C’est cela qui est à l’origine de la tentative de contourner les frontières, de passer par l’Irak, par l’Iran, par la Corée du Nord, par l’Afghanistan. Contourner le colosse constituait une stratégie mondiale très militarisée - la grande politique est toujours une stratégie militaire. C’est là que j’ai ressenti un grand enthousiasme, que j’ai pensé que nous avions trouvé l’adversaire qu’il nous fallait. En revanche, quand le conflit ouvert va s’éteindre, nous n’aurons plus qu’à rentrer chacun chez soi et même si cette solution apparait comme la plus progressiste, nous nous endormirons tous à nouveau et il ne se passera plus rien.



(Traduit de l’italien par Bernard Rienzi)
2022-06-13T07:43:04






