Dans le noir nous verrons clair, mes sœurs et mes frères.
Dans le labyrinthe nous trouverons la voie droite.
En 2001 paraissait « Faut-il pendre les architectes ? », un coup éditorial au contenu insignifiant. Malgré sa nullité on pouvait éprouver une certaine jouissance à lire le carnage introductif. L’auteur s’y livrait à contre-cœur à l’énumération des réalisations architecturales que, selon lui, la « vox populi » serait prête à mettre à bas sur le champs. La « fureur populaire » y défonçait à coup de pioches la BNF et Euralille ; les tours de la Défense, de Montparnasse et de la Part Dieu tombaient comme les cartes d’un château ; les villes nouvelles et les palais de justice y était passés à la dynamite, et ainsi de suite. Plutôt enthousiasmant. Mais ensuite l’auteur se disait prêt à lutter pour défendre des chefs-d’œuvre que l’inculture crasse de la populace n’aurait pas le bon goût d’épargner comme Orly-Sud ou les Cités Radieuses de ce bon vieux fasciste de Le Corbusier. Le reste de l’opus était consacré à chouiner sur les multiples contraintes qui faisaient que les architectes étaient si mauvais et si mal aimés.
En 2011 l’auteur y ajoutait une postface tout aussi dispensable en forme d’exercice d’autosatisfaction à propos de son "pamphlet modéré". Le constat est amer : le désamour de la plèbe pour les architectes est toujours aussi criant. « L’architecte, s’il a su prendre place dans les pages des rubriques "people", reste un personnage à abattre ». Mais un espoir est en train de naître : le Grand Paris. Et il félicite au passage Sarkozy qui a fait œuvre de volonté « en invitant le gratin de l’architecture mondiale à plancher sur le développement futur de la capitale et en assignant à l’architecture le soin de replacer Paris dans le peloton de tête des villes qui compteront à l’avenir ». Seulement voilà, lorsque le rêve métropolitain est proche, il y a toujours quelques fâcheux pour venir vous importuner, ici même : les "khmers verts". « La réalité est crue. La présence au sein de la mairie de Paris d’un fort contingent d’élus verts bloque toute initiative autre que défensive et patrimoniale. L’emprise des bloqueurs, des réacs, est omniprésente ». Pestant contre « la vulgate du moment qui veut que nos prophètes s’appellent Yann Arthus-Bertrand et Nicolas Hulot » il s’en prend courageusement à cette arme forgée par les primitivistes de l’écologie profonde : le label HQE. Écoutez bien : « Désormais l’ombre du HQE flotte sur la marmite comme hier celle des QHS dans les centrales pénitentiaires ».
Quelques mois plus tard, à l’automne 2012, une chansonnette parcourait un bocage de la périphérie de Nantes où allait brillamment s’embourber une opération impériale d’ « aménagement du territoire » :
« Urbanistes. Architectes.
Pendez-vous ! Pendez-vous !
Laissez-nous tranquilles, laissez-nous tranquilles.
DïngdingDong ! DïngdingDong ! »
Faut-il pendre Paul-Emmanuel Loiret ?
Oh monde, monde étranglé, ventre froid !
Même pas symbole, mais néant, je contre, je contre,
Je contre et te gave de chiens crevés.
Le 4 mars 2021 paraissait simultanément sur Reporterre et Topophile une tribune de khmers verts qui invitaient les architectes à « quitter le monde des lobbys et du béton ».
Loin de s’en tenir à la dénonciation indignée des compromissions avec le « marché néolibéral » qui fait l’ordinaire du pétitionnisme inconséquent et son culte des signatures, les rédacteurs invitent à réconcilier les mots et les gestes en refusant d’« aménager le désastre » et en rejoignant des formes offensives contre celui-ci. D’abord « oser dire non », refuser non seulement « les logiques de métropolisation et de gentrification » mais refuser également « l’imaginaire cynique de la "transition" ou de la ville "durable" ». Ensuite, « penser le politique dans la vie, cesser d’en faire un champ séparé » : « dessiner et tailler des charpentes pour installer des maisons du peuple en lieu et place de grands projets inutiles. Participer à des actions de blocage d’entreprises qui intoxiquent le monde. Prendre part à des actions de reprises de terres pour soutenir une agriculture paysanne. S’engager dans le quotidien d’un territoire pour développer avec ses habitant·e·s une culture de la résistance face à la métropolisation. »
Plus de 80 personnes, essentiellement des architectes et des universitaires, ont signé cette tribune pour le moins déter’. Parmi elles : Paul-Emmanuel Loiret (PEL).
Qui est Paul-Emmanuel Loiret ? Dans une enquête sur la marchandisation de la construction en terre parue dans la revue Terrestres (Le retour à la terre des bétonneurs, novembre 2020) on y découvrait que PEL est un homme qui ose. Mais PEL n’est pas un de ces êtres bassement négatifs. C’est un homme qui ose dire « oui ». Dire oui, par exemple, au Grand Paris. Loin d’être seulement « maître de conférence-chercheur » - tel qu’il se présente modestement – PEL travaille également main dans la main avec le Grand Paris sur deux projets : d’une part avec le projet Cycle Terre, il assure la « valorisation » des terres excavées en les transformant en matériaux de construction (briques, enduits, panneaux) ; d’autre part il a remporté l’un de ces concours « Réinventer la Seine » qui sont à l’avant-garde de la financiarisation de la ville avec le projet « Manufacture sur Seine ».
« "Faire prendre" un nouveau morceau de ville comme une greffe sur un corps vivant est l’étincelle la plus difficile à impulser pour nous, bâtisseurs de villes » nous dit la présentation. La « Manufacture sur Seine » c’est, si l’on en croit les chirurgiens-architectes , « La fabrique d’un projet-processus où l’on explore l’espace-temps du transitoire pour préfigurer les lieux de demain avec les forces vives en présence ». Passé le bullshit, on découvre 58 150 m² de logements et de bureaux qui ressemblent en tout point à n’importe quel néo-quartier hors sol, entièrement agencé selon les exigences de la logique marchande, mais le bâti est en terre et en bois, et va accueillir, entre-autres joyeusetés, un maker-space, un foodlab, un centre de balnéothérapie et bien sûr, un potager urbain. Tout ça à Ivry-sur-Seine, ancienne ville ouvrière en voie accélérée de gentrification.

C’est qu’entre temps, depuis 2011, le Grand Paris n’est plus la bête noire des écologistes. Il est devenu écologiste. Même plus seulement durable mais bien circulaire. L’Économie circulaire, c’est la solution. Le capitalisme produit trop de déchets en détruisant le monde ? Pas de problème : on va les revaloriser. Exemple : Le Grand Paris Express et ses 650 000 mètres cubes de béton livrés par Lafarge pour 110 millions d’euros va nécessiter l’excavation de 43 millions de tonnes de terre. Mais la terre c’est du déchet ! Solution : Paul-Emmanuel Loiret va transformer cette terre en marchandises, puis celles-ci en un nouveau quartier métropolitain. Plus de déchets. Mais de la marchandise. C’est écologique. C’est circulaire. On pourrait appeler ça Cycle-Terre. L’écologie n’est pas seulement la logique de l’économie totale, c’est aussi la nouvelle morale du Capital.
Alors comment faut-il comprendre cette signature ? Comment peut-on appeler à lutter contre tout projet de métropolisation et de gentrification et en même temps prendre part activement au plus grand projet de métropolisation et de gentrification en cours ? Dissociation cognitive ? Signaturisme compulsif ? Notre hypothèse est celle-ci : PEL a la souplesse d’un Diplomate, de celles qui permettent à d’autres – Diplomates également - d’organiser un grand festival « pour le vivant » sous la bannière de champions de l’écocide, ou bien, de proposer comme issue au Capitalocène de faire dialoguer des représentants des entités naturelles avec des représentants des multinationales.
Les Diplomates ont tellement approfondi leur dépassement de tous les dualismes qu’ils semblent avoir opéré un saut par-dessus l’une des bases de la logique : le principe de non-contradiction. Car contrairement à ce qu’une approche naïve pourrait penser, PEL ne se contredit pas. La contradiction c’est trop négatif. Dans la grande positivé qui caractérise sa démarche, il est deux fois pour. Il n’est pas pour le Grand Paris et contre le Grand Paris (contradiction). Il est pour le Grand Paris et pour celle·ux qui sont contre le Grand Paris (diplomatie).
On notera par ailleurs la présence de Science-Po parmi les partenaires de la « Manufacture sur Seine », projet que le Journal du Grand Paris qualifie de « ville hybride ». Eh oui, même le Grand Paris s’est mis à parler le Latour.

Destituer les Architectes
Je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes,
Des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses,
Contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie
Tomberont en fadaises et galimatias et poussière de sable sans raison.
Ce qui ne lasse pas d’étonner lorsque l’on prend temps de poser son regard sur les habitations du monde entier – des villes et campagnes françaises aux lieux les plus éloignés de la planète - c’est à quel point les hommes et les femmes qui les ont bâties étaient distraits. L’immense majorité ont oublié de signer leurs constructions. Les Sâhôs du Mali, pas de nom, les Trulli des Pouilles, pas de nom, les extraordinaires maisons Batak de Sumatra, pas de nom. Comme s’ils avaient mieux à faire. Et pourtant ça a quand même une autre gueule que la Bibliothèque François Mitterrand. « Tandis que le moindre cube de béton est désormais signé par un architecte, Notre-Dame de Paris est un édifice en grande partie anonyme » note Anselm Jappe dans un chapitre intitulé « Faut-il pendre les architectes ? ». Décidément.
Ce culte des signatures propre aux architectes et à leur modestie inégalée n’est pas un effet de la transformation du métier en « Star-system ». La naissance des architectes est celle du « star-system » - celui du Quattrocento – qui vit un ensemble d’artisans - peintres, sculpteurs, graveurs et architectes, qui en avaient marre de côtoyer la populace des métiers manuels - réclamer l’attention des puissants pour rejoindre les arts dit « libéraux », ceux de des nombres et du langage. Ainsi naquirent les artistes, sortes de Demi-Dieux annonciateurs de l’individualisme bourgeois qui forma le socle de l’hypothèse libérale. Et la plupart de ces artisans de la représentation qui se sont fait une place auprès du pouvoir, et ainsi se sont « fait un nom », ont été amenés à se faire architecte. Ainsi en est-il allé de Brunelleschi, Raphael, Michel Ange, Léonard de Vinci, pour ne citer qu’eux. L’outil qui les distinguait était le disegno, le dessin, le plan d’architecture.
« Pour Paul Valéry, l’œuvre de l’architecte n’est rien de moins que la continuation de l’œuvre du démiurge, créateur du monde : « Il prend pour origine de son acte le point même où le dieu s’est arrêté. » En 1945, c’est cette mythologie prestigieuse du métier qu’invoque Auguste Perret, peut-être pour faire oublier que les architectes doivent au régime de Vichy la création de l’Ordre des architectes et l’institutionnalisation de leur métier : « Mes chers confrères, devant l’immense tâche qui nous attend, rappelons-nous qu’au cours du temps : architecte celui qui s’asseyait à la droite de César et dans le triomphe le précédait immédiatement, architecte celui qui fit le Parthénon, architecte aussi le Pharaon lui-même constructeur de palais et de temples ; et qu’appelés que nous sommes de commander aux élites de la nation, le moment est aujourd’hui venu de nous montrer dignes de ce glorieux passé. » (Histoire du métier d’architecte, Gérard Ringon)
C’est un fait entendu, l’histoire de l’architecte est consubstantielle de celle du parti de l’ordre. De la cour des Médicis à l’Ordre des Architectes fondé par Vichy, en passant par l’Académie Royale d’Architecture créée en 1671 par Louis XIV, toute l’histoire de l’architecte est une histoire de dépendance et de servilité aux pouvoirs en place. D’autre part, tous les pouvoirs des plus autoritaires aux plus démocratiques ont été fascinés par l’architecture, par son pouvoir de façonner leur propre mise en scène ainsi que d’imposer des formes à la vie des populations. « Architecture » nous vient du grec « arche » (principe, commandement ) et « tekton » (charpentier, ouvrier), et désigne donc comme nous le rappelle Platon, « l’art de commander aux ouvriers », et l’architecte, celui qui les commande. De cette fascination et de cet art naîtront un être, l’architecte, qui s’est séparé de tous les mondes communs pour mieux les dominer , et des odes aux pouvoirs, comme La Cathédrale de Lumière d’Albert Speer, les monuments présidentiels dédiés à la culture du narcissisme que sont le Centre Pompidou ou le Musée du Quai Branly Jacques Chirac, l’urbanisme contre-insurrectionnel des Grands Ensembles ou la Dysneylandisation du nihilisme des villes nouvelles.
Seulement voilà, nous sommes face à une énigme. A partir des années 70, une partie de la profession se réclamant de mai 68 et de l’esprit de la contre-culture semble remettre en cause cette position d’autorité, affirme vouloir se mettre au service des habitant·e·s, et se tourne vers l’élaboration d’une architecture écologique. Une architecture – donc un art du commandement - anti-autoritaire et écologique est-elle possible ? Pour répondre à cette question, nombres d’architectes alternatifs vont aller cartographier ce qu’ils nommeront « les architectures vernaculaires », expérience qui pour beaucoup d’entre eux sera raconté sur le mode de la transfiguration. L’histoire de cette redécouverte prend canoniquement comme point de départ l’exposition « Architectures sans Architectes » de Bernard Rudofsky en 1965 au MoMA de New York.
L’énigme qui nous échoit est donc celle-ci : Comment comprendre que les architectes convertis au « néo-vernaculaire » et au « frugal » n’ont de cesse de s’émerveiller des arts de bâtir du monde entier pour en éluder la conclusion la plus massive, la plus évidente ? C’est à dire : leur inutilité. Si ce n’est leur nocivité.
Ce fait que l’architecte, cet homme sans monde, est ennemi des mondes habités et de leur cultures constructives, voilà ce que Ivan Illich avait déterminé une fois pour toutes dans un discours fulgurant prononcé lors du 150e anniversaire du Royal Institute of British Architects, en 1984 :
« Créer des habitations est une activité qui est hors de portée de l’architecte. Non seulement parce que c’est un art qui est à la portée de tout le monde ; non seulement parce qu’il progresse par vagues qui échappent au contrôle de l’architecte ; non seulement parce que sa délicate complexité le situe hors de l’horizon des simples biologistes et analystes des systèmes. Mais par dessus tout parce qu’il n’existe pas deux communauté qui habitent pareillement. Les coutumes et l’habitation signifient presque la même chose. Chaque architecture vernaculaire (pour reprendre le terme des anthropologues) est un langage unique.
Il s’agit de l’art de vivre dans sa totalité, art d’aimer, de rêver, de souffrir, de mourir, qui rend unique chaque mode de vie.
C’est pourquoi cet art est trop complexe pour être enseigné [...] par des maîtres d’écoles ou par la télévision, c’est un art qui ne peut être que volé, appris sur le tas. Chacun devient un maître bâtisseur vernaculaire en grandissant d’une initiation à l’autre, en devenant une habitante, un habitant. Par conséquent, l’espace cartésien, tridimensionnel, homogène, que les architectes conçoivent, et l’espace vernaculaire que l’usage fait exister sont des catégories entièrement distinctes. »

Governing the vernacular
Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard
Et du son de peau de tambour
Comment donc comprendre ce paradoxal « avant-gardisme vernaculaire » qui propose de se mettre à la tête de cultures constructives constitutivement acéphales ? « Si le vernaculaire est l’inverse de la planification, que peut bien signifier son accaparement par ce même champ ? » se demande Edith Hallauer dans sa thèse sur le sujet. Des architectes, bouleversés par les soulèvements de 68 auraient-ils décidé de déserter ?
Revenons un peu en arrière. Ironie de l’histoire, l’architecte va voir sa profession reconnue institutionnellement au moment même où son socle métaphysique se dérobe. En effet, la modernité libérale - avec son sujet rationnel, ses lois de l’économie, et son gouvernement par la représentation – qui était déjà sortie grandement mutilé des charniers de 1914, s’effondre littéralement à la sortie de la seconde guerre mondiale. Difficile de continuer à défendre la rationalité du sujet, l’économie et de l’État devant les chambres à gaz. Dès lors trouver une nouvelle forme de gouvernementalité devient impératif pour le commandement capitaliste.
C’est dans ce contexte de deuil de la souveraineté individuelle et étatique que des chercheurs de disciplines très différentes (neurologues, psychologues, économistes, mathématiciens, anthropologues…), en lien avec le complexe militaro-industriel vont élaborer une nouvelle « science du contrôle et de la communication chez l’animal et la machine » : la cybernétique. L’hypothèse de base est la suivante : tout les milieux – la famille, la société, jusqu’au Système-Terre « Gaïa » de James Lovelock - et tous les organismes qui les composent – les machines, les individus, les animaux - peuvent être compris comme des systèmes de communication auto-régulés, réductibles à un certain nombre de paramètres. Leur modèle est le cerveau-machine : l’ordinateur. Gouverner ne se fera donc plus selon les vieilles conceptions souverainistes du pouvoir, ce sera désormais inventer une coordination rationnelle des flux d’informations et de décisions qui circulent dans le corps social. Ce sera en optimiser le pilotage.
La mutation cybernétique de l’économie vise à corriger la tendance du capitalisme à l’entropie, au désordre due à sa part destructrice. Il s’agit à présent de pouvoir reproduire et réparer le monde du Capital à mesure que celui-ci détruit tout les mondes vivants desquels il tire sa substance. Il s’agit d’en maintenir l’équilibre écologique, c’est à dire l’ordre. La cybernétique, bien avant Latour et Descola, se construit donc sur la ruines des dualismes occidentaux que furent le Sujet et l’Objet, l’Individu et la Société, la Nature et la Culture. Et les cybernéticiens, se dépouillant des anciens oripeaux de l’autorité, se constitueront dès lors en parti des intermédiaires.
Cette hypothèse va construire une image des acteurs de l’économie comme étant pris dans une circulation d’informations qui les façonnent, dans une architecture de flux, dans un environnement. Des acteurs-réseaux, en somme. Et c’est désormais cet environnement (que ce soit celui d’un open-space, d’un écoquartier ou d’un parc naturel) qu’il s’agit de designer et de gérer, en maximisant la participation et la collecte d’informations, les feed-backs et les instances de coproduction. Organiser la mise en boucles de l’économie, sa circularité, son devenir environnemental.
En 1966 Steward Brand, biologiste formé à Standford, et sa compagne Lois Jennings, militent publiquement pour que la NASA publie la première photo de la terre vue de l’espace. Cela dans le but de provoquer une prise de conscience écologiste, celle d’être, selon eux, embarqués dans le même vaisseau. Deux ans plus tard c’est donc sans surprise que cette photo mythique fera la une du premier numéro du Whole Earth Catalog (WEC), revue qu’ils créeront et qui deviendra la bible de la contre-culture américaine et internationale.
Le WEC va être le point de jonction entre l’architecture et la pensée cybernétique. Il est organisé en sept sections (Comprendre les systèmes d’ensemble/Abris et utilisation du terrain/Industrie et artisanat/Communications/Nomades/Apprentissage) et se présentent comme un grand catalogue de vente par correspondance à propos de tout ce qui à trait à la contre-culture. Dans le WEC, on trouve tout autant des plans pour fabriquer un poulailler ou des habitats légers, que des articles de Nobert Wiener ou de Gregory Bateson, des manuels d’autoconstruction que des éloges de l’ordinateur individuel. Fred Turner a montré tout ce que la cyberculture des GAFAM doit au WEC et à Stewart Brand, qui fut aussi le fondateur d’une des premières communautés en ligne, le WELL (Whole Earth ‘Lectronic Link). Steve Jobs ne l’a pas oublié, lui qui déclarera en 2005 à Stanford : « Quand j’étais jeune, il y avait une extraordinaire publication, le Whole Earth Catalog , qui était l’une des bibles de ma génération... C’était une sorte de Google en livre, 35 ans avant que Google n’existe »
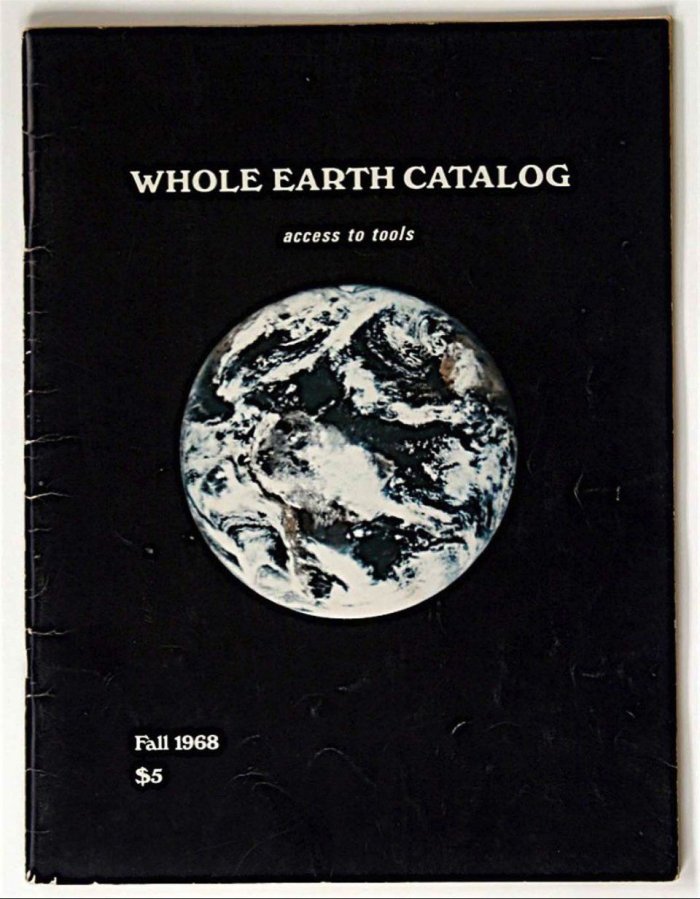
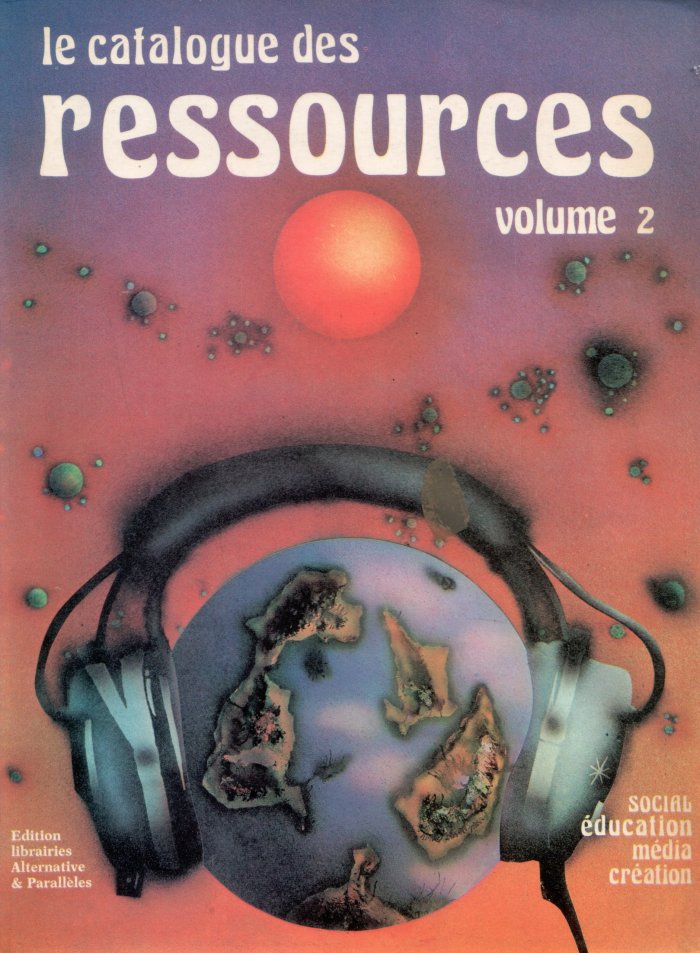
A partir de 1975 paru la version française du WEC : le Catalogue des Ressources. Il suivait la même formule et eu un tel succès qu’il permit de financer la création des éditions Alternatives et de leur célèbre collection AnArchitectures qui publia des titres tel que La Maison Autonome, Construire en Terre, Habitats autogérés, Maisons vivantes.
Yona Friedman, architecte et sociologue qui contribua au Catalogues des Ressources, offre une synthèse théorique assez remarquable de ce mouvement. Très critique de la figure de l’architecte moderne il considère en 1976 que « société » et « environnement » sont des synonymes, et soutient que « les réseaux tant matériel qu’immatériel, couvrent à présent pratiquement toute la Terre, ils conduisent à la ville globale. […] Depuis quarante ans, je préconise l’apparition de ce que j’appelle la « ville-continent » : une centaine de villes qui existent depuis des siècles et qui sont maintenant reliées entre elles par un réseau de transport très rapide. » (Utopies Réalisables)
Mais loin de promouvoir l’uniformisation, Yona Friedman est persuadé que la diversité à droit de cité au sein de l’Astronef Terre, cette utopie réalisée. Se demandant comment répondre à « la nécessité d’une organisation politico-technique qui puisse gouverner notre astronef », il se propose d’« échafauder une esquisse d’organisation sociale. Cette organisation se présenterait ainsi : une multitude de petits groupes séparés, reliés par un réseau de communication qui couvrirait la surface terrestre, réseau dont la maintenance serait assurée […] par des organismes de gérance, qui se différencient fortement des autres services gouvernementaux : ils sont inter et supra-gouvernementaux, et continuent à fonctionner indépendamment de la naissance ou de la chute des gouvernements. »
On voit là tout le rêve des cybernéticiens de la contre-culture dessiné en quelques lignes : des petits groupes habitant selon leur mode propre et reliés par un grand réseau. Mais quel va être le rôle de l’architecte dans cette belle utopie ?
C’est deux ans plus tard, dans ce qui est, quoiqu’il en dise, un manuel de survie de l’architecte en temps de crise, que Friedman nous donnera la réponse. Tout d’abord il pose le problème : l’objet d’architecture devrait donner satisfaction aux habitants, or l’architecture ne répond en rien aux besoins des habitants, donc l’architecture « viole le bon sens ». Quel est le problème selon Friedman ? L’impérialisme du marché immobilier ? La misère de l’exploitation salariale et de la propriété privée ? Non, absolument pas. Le problème c’est une mauvaise communication entre l’habitant et l’architecte. (L’Architecture de survie)
D’une part l’architecte a, de par sa formation, « acquis la certitude que c’est lui qui sait, mieux que chaque habitant, un à un, comment ceux-ci désirent vivre » et d’autre part l’habitant, cet idiot, « est rarement capable d’exprimer ses désirs. Il les connaît bien, mais il n’est pas capable de les expliquer. »
Mais Friedman insiste, si l’on veut que l’architecture cesse de « violer le bon sens » il faut que l’habitant devienne le propre concepteur de son habitation, il faut donc qu’il apprenne à « faire les plans », pour devenir un « autoplanificateur ». Seulement pour arriver à ce but, il lui manque le langage de l’architecture, c’est à dire sa grammaire. Voilà donc quel sera le nouveau rôle de cet architecte fraîchement converti : « La première des nouvelles fonctions de l’architecte est d’écrire cette grammaire et de commencer à l’enseigner. » Cet enseignement, il tient d’abord à le distinguer « de la "participation de l’habitant" tant vantée par les irréfléchis. [...] Avec cette soi-disant participation, l’habitant ne décide rien, mais il aide les planificateurs à décider pour lui. Avec l’autoplanification, nous sommes en présence d’une attitude bien différente : l’habitant prend ses décisions lui-même, après avoir appris le langage. [...] L’architecte "grammairien enseignant" équivaut donc à un professeur de langues. »
On comprend mieux maintenant comment la figure de l’architecte alternatif s’est construite. Délaissant une image en faillite de l’autorité, il abandonne la posture démiurgique du créateur pour adopter celle du médiateur et de l’éducateur, il devient le deus ex machina. Il sera désormais l’agent de la codification et de la négociation, l’organisateur de la participation, celui qui maîtrise la logique d’ensemble. Aucune désertion ou récupération ici, juste une reconversion. Fini la politique de la table rase, dorénavant il faudra étudier au plus près le milieu d’implantation du projet, collecter les informations auprès des usagers ou des futurs usagers, peut-être trouver des matières locales ou à « réemployer », lui donner l’apparence d’une intégration à l’histoire des lieux, en tout cas, en construire le récit.
La fascination de l’architecte alternatif pour les cultures constructives vernaculaires est dominée par une nostalgie morbide. Il voit bien qu’il s’agit là de bien plus que de constructions, qu’un monde s’y exprime, tout une cosmologie. Mais, étant pour sa part dépourvu de tout monde, il est pris de vertige et ne peut en saisir que des lambeaux. Pour combler ce vertige il se voit obligé de les réduire à la seule langue qu’il connaît, et d’en faire « un stock de dispositifs ingénieux ». Il les découpera donc en matériaux, et en techniques.
Ivan Illich qualifiait de vernaculaires « les actions autonomes, hors marché, aux moyens desquels les gens satisfont leurs besoins quotidiens — actions échappant, par leur nature même, au contrôle bureaucratique, satisfaisant des besoins auxquels, par ce processus même, elles donnent leur forme spécifique » (Le Travail fantôme) et appelait à ce que cette dimension de l’existence soit réappropriée et étendue. Aujourd’hui, alors que l’éco-construction conquiert de plus en plus de parts sur le marché du bâtiment la fonction du « néo-vernaculaire » se fait de plus en plus claire : traduire les arts de bâtir vernaculaires dans le langage véhiculaire du Capital - la marchandise.
Illich situait le passage de « l’âge de l’autoritarisme professionnel » à l’ « âge des systèmes » au début des années 80. Et ce n’est bien sûr pas innocemment qu’il s’en prend aux « analystes de systèmes » dans son discours aux architectes, lui qui luttera pied à pied contre la diffusion de ce « rêve cybernétique » qui avait, selon ses mots, « avalé » un certain nombre de ses amis.
Mais c’est bien plus loin dans le temps qu’il date le début de la destruction du vernaculaire. Il fait démarrer cette guerre avec un événement historique négligé : En 1492, Elio Antonio de Nebrija offre sa Gramática castellana à la Reine d’Espagne, la première grammaire d’une langue européenne moderne. « L’ouvrage de Nebrija visait à être outil de conquête à l’étranger et, à l’intérieur, arme pour mettre fin au parler "spontané". »
« Souvenons-nous bien de la date de parution que porte la Gramática castellana, imprimée à Salamanque : 18 août, soit exactement quinze jours après l’embarquement de Christophe Colomb.
Mon Illustre Reine. Chaque fois que je médite sur les témoignages du passé qui ont été conservés par l’écriture, la même conclusion s’impose à moi. Le langage a toujours été le conjoint de l’empire, et il le demeurera à jamais. »
Patrick Bouchain ou l’auto-construction de la métropole
Dans sa thèse sur le néo-vernaculaire, Edith Hallauer nous offre un exemple presque paradigmatique de l’usage que ses continuateurs feront d’Illich : s’approprier l’essentiel de ses analyses pour le trahir au moment décisif. Après avoir longuement détaillé les raisons d’Illich de classer les architectes et les designers au Panthéon des « Professions mutilantes », elle s’interroge : « Cet endroit – la création et la conception industrielle, et celle des "cadres de vie" au sens large – étant au plus proche des transformations physiques des modes de vie, du passage de la subsistance à la rareté, n’est-il pas justement le lieu du frottement et de l’invention, de la résistance possible ? N’est-ce pas stratégiquement la plus juste place pour ouvrir des zones de négociations possibles dans cette marche globale du monde ? »
L’option retenue ne sera pas celle du « décrochage » illichien vers une existence plus autonome, mais celle d’un « entrisme stratégique » au sein de l’industrie, à la façon du designer écologiste Victor Papanek dont elle reprend le propos : « Le choix ne se situe pas entre une sécurité de technocrate couleur gris charbon légèrement estompé, d’une part, et une défonce fébrile dans le ruisseau avec une bonne dose de LSD, d’autre part. Il y a une troisième voie. Le Bureau des Possibilités économiques, le Projet Sud-Appalachien, l’Organisation internationale du Travail à Genève, l’Unesco, l’Unicef, ainsi que bien d’autres organisations (de tendances politiques diverses) dans tous les domaines concernés par les besoins essentiels de survie de l’être humain : voilà quelques-unes des directions que devraient et doivent prendre les designers. »
Une illustration de cette « troisième voie » nous est donné par le témoignage d’un des plus illustres représentants des architectes alternatifs : Patrick Bouchain, signataire de plusieurs tribunes de soutien à la zad de Notre-Dame-des-Landes. Ce qui est souvent compliqué lorsque l’on s’intéresse aux logiques qui traversent le monde architectural, c’est qu’il faut constamment se débattre avec des couches incroyables d’enrobage philosophique à vocation marketing. Une des méthodes envisageables pour s’épargner ce plaisir est d’écouter ce qu’ils disent :
« En Afrique, j’ai vu un continent puissant, magnifique. Ce n’était pas ce que j’avais appris à l’école. Non seulement ça a mis en cause la façon dont on m’avait appris l’Histoire, j’ai aussi découvert ce que c’était de vivre, avant d’éventuellement s’enrichir. J’ai découvert une architecture modeste, avec laquelle on vit, on reconstruit et on répare. Une architecture contextuelle, faite de matériaux locaux, et très diverse. Quand je suis revenu en France, j’ai décidé de ne jamais construire et de ne faire qu’un travail modeste sur l’habitation et l’accompagnement de ceux qui voulaient construire sans savoir comment s’y prendre. C’est comme ça que j’ai rencontré le monde artistique, où beaucoup d’artistes utilisaient des friches ou des squats. J’ai été le maillon qui leur permettait de rester dans ces lieux. »
On a déjà là plusieurs éléments de notre histoire : l’Afrique et son « architecture » vernaculaire, la conversion et la décision de ne pas construire, l’architecte comme conseiller, si ce n’est comme sauveur en l’occurrence. De retour d’Afrique, où il effectuait son service militaire, Patrick Bouchain va se spécialiser dans la réhabilitation de friches industrielles en lieux de Culture : Le Théâtre Zingaro à Aubervilliers, Le Magasin Centre Nationale d’Art Contemporain à Grenoble, le Lieu Unique à Nantes, sans oublier la Condition Publique à Roubaix inaugurée lors du lancement de Lille 2004, capitale européenne de la culture.
Dans L’envers des friches culturelles (Revue du Crieur n°11), Mickael Correia a dressé un portrait implacable de ces réhabilitations de friches industrielles, souvent situées dans ou à proximité de quartier populaires, qui se sont désormais systématisées en une véritable industrie de la gentrification avec des entreprises dédiées telles Cultplace, La Lune Rousse ou Sinny et Ooko. Se réclamant de l’héritage de Patrick Bouchain, ces entreprises vendent du tiers-lieu culturel « éco-solidaire et DIY » à l’« esthétique squat » livrée en kit, à des promoteurs comme la SNCF Immobilier qui en a fait « un levier essentiel de valorisation » ou au Grand Paris qui l’a pleinement intégré dans sa stratégie de marketing territorial. Soit dit en passant, il faudra bien se résoudre un jour à forger un autre concept que celui de gentrification - qui a aujourd’hui pour principale fonction de faire briller les yeux des promoteurs immobiliers - pour nommer les brutales opérations de dépeuplement et de valorisation financière qu’elle recouvre.
Concevant le Grand Paris Express comme une « œuvre d’art totale » wagnérienne et affirmant que « "Avec" sera leur maître mot », 80 designers, architectes, urbaniste, directeurs artistiques et l’ensemble des partenaires du Grand Paris ont poussé cette logique coloniale à son terme et la revendique dans un petit ouvrage intitulé Grand Paris Express – Manifeste de la création. « Notre projet a mis la culture au centre. […] Les arts y seront florissants, littérature, musique, arts plastiques, danse, cinéma, vidéo, théâtre, design, graphisme, mode, architecture, photographie, street art, paysagisme, jardinage, gastronomie… chemineront de conserve. Le sport, élément constitutif d’une catharsis collective, ne manquera pas à cet appel ». Ce Manifeste fut publié en 2017 aux éditions… Alternatives. Comme on dit, la boucle est bouclée.

Mais Patrick Bouchain ne s’est pas seulement occupé d’aider la petite bourgeoisie culturelle à s’accaparer des lieux de la mémoire populaire, il s’est également intéressé aux pauvres, lui qui depuis longtemps se vante de faire une architecture à Haute Qualité Humaine. En 2017 lors d’un entretien radio intitulé Auto-construction : habiter autrement, il nous détaillait la méthode qui avait été la sienne pour la réhabilitation de la ZUP de Blois dans les année 80 :
« Un jour il y avait un débat public et je dis : "Voilà j’ai pris la décision de déménager l’Atelier au rez-de-chaussée d’un immeuble désaffecté et muré qui va être détruit d’une tour dans la ZUP". [...]
Donc j’ai occupé une loge de concierge. On a mis l’atelier là, et on s’est rendu compte que tout le monde venait là. J’étais très proche de Jack Lang, mais quand il voulait me voir il venait là. Le préfet, il venait là. Le directeur départemental, il venait là. Les adjoint ils venaient là. Les associations elles venaient là. Et on a vu d’un seul coup qu’en déplaçant une activité publique dont l’objet était justement l’aménagement de cette zone ça avait changé la situation. »
Le journaliste, un peu étonné qu’il n’en fasse pas mention, lui demande : « Et la population elle venait aussi ? Les habitants ? »
« Bah la population elle était là ! Du coup c’était assez drôle, parce qu’au début il y avait de la drogue à cet endroit là. Il y avait un peu de prostitution. Il y avait du commerce illicite. Il y avait des gens qui vendaient aux pieds des camions des choses volées. Et donc le fait qu’on soit là ça n’a pas policé les choses mais disons que ça les a rendues normales. J’ai fait tailler les arbustes qui ne servent à rien pour la visibilité, refait l’escalier, refait un devant, changé des places de parking. Des enfants sont venus jouer, des enfants on vu des gens travailler, et du coup les commerces illicites se sont "structurés" comme on dit. Et puis j’ai commencé à dire "mais pourquoi ça ne marche pas ?". Alors les gens m’ont dit que ça ne marchait pas parce que toutes les rues qui mènent au immeubles sont en impasses. C’est à dire qu’en fin de compte, la rue c’est un parking, c’est pas une rue. Et donc on a commencé à travailler sur « déboucher » les rues : faire qu’on puisse passer par la ZUP comme on passe dans un quartier. Du coup c’est presque un système d’auto-contrôle. On est pas obligé de faire rentrer la police puisqu’il y a des voitures qui passent. Si la police elle y va c’est pour régler la circulation. Mais ce n’est pas pour contrôler. Et si une voiture passe elle peut repérer un dealer, ou je ne sais quoi.[...]
Et après, très vite je me suis dit "on va peut-être mettre un commerce pauvre". Parfois j’achète dans les Lidl. Je me suis rendu compte que la bourgeoisie du centre-ville elle achète aussi des produits de lessives dans ces magasins, parce que des fois il y a des marques et tout. Donc on a commencé a faire venir des gens du centre ville qui ont commencé à faire leur courses en ZUP. Il y avait un marché arabe avec beaucoup d’épices et tout : on l’a réellement réadapté comme un vrai marché. Pas sur des places de voiture.[…] . Après j’ai remarqué qu’il y a moins de jardiniers en ZUP qu’en ville par rapport au nombre d’habitants. Alors on a réparti uniformément les personnels techniques. Et j’ai fait, et j’ai fait, et j’ai fait. Vous voyez ce n’est pas de l’architecture. Mais je vous jure, il s’est passé à un moment donné un truc où on s’est dit "mais c’est bizarre ça a changé". Il s’est passé un truc quoi. Comme quoi c’est donc possible. Mais pour moi c’est de l’architecture. »
Il s’est passé un truc, quoi. Dans les années 90, ce truc qui n’est pas de l’architecture mais qui est de l’architecture a reçu un nom dans le monde anglo-saxon : Crime prevention through environmental design. Ce que les français ont traduit plus platement par prévention situationnelle mais qu’un vieux terme qu’employait déjà Nicolas de La Mare au 18e siècle pour décrire tout ce qui avait trait à l’entretien et l’aménagement de la voirie en vue de la sérénité publique rend tout aussi bien : police.
En février 2020 Patrick Bouchain apportait sa signature à une tribune qui proclamait « Avec le Grand Paris, le temps de la citoyenneté métropolitaine est venu ». Deux mois auparavant, alors qu’il recevait le Grand Prix d’Urbanisme 2019, la ministre de la Cohésion des territoires déclarait : « La position originale et singulière de Patrick Bouchain, dans un climat d’exacerbation des tensions au sein des territoires urbanisés, paraît plus utile que jamais ». À n’en point douter.
« "Diplomatie" provient du grec ancien δίπλωμα (diploma), signifiant "plié en deux". Le plié-en-deux, c’est celui qui se trouve à la frontière, contorsionné de telle manière à avoir une partie dans chaque camp, et qui, ce faisant, rend possible une communication par le partage d’un code hybride : il constitue un interprète qui joue le rôle de membrane à l’interface entre deux entités hétérogènes.
Le diplomate est plié en deux, entre deux langages et deux ethos, entre deux systèmes d’intérêts : c’est ce qui le rend apte à être négociateur et interprète, entre tous les fronts collectifs à bords nets : entre les hommes et les loups, mais plus loin entre les éleveurs et les écologistes, les instance européennes et l’opinion publique. »

Prendre parti
Je vous construirai une ville avec des loques, moi !
Je vous construirai sans plan et sans ciment
Un édifice que vous ne détruirez pas
« Nous sommes foncièrement impuissants et nous ne discutons que parce que nous essayons de trouver des moyens de renforcer nos amitiés naissantes avec des personnes qui pourraient, avec nous, comprendre leur propre impuissance et l’impuissance collective. » A la fin de sa vie, Ivan Illich pense que pour être tout à fait lucide il nous faut admettre que nous avons perdu le futur. Que celui-ci à été englouti par l’« anesthésie cybernétique ». Il refuse de rejoindre la « danse de fou » des partisans de l’hypothèse Gaïa qui, selon lui, constitue « la base idéale sur laquelle on veut bâtir la nouvelle religiosité qui nous rend gouvernables, manipulables ». Il trouve refuge dans l’ascèse et l’amitié comme seuls accès à une présence vertueuse.
Comment lui donner tort ? Dès les années 70 le capitalisme cybernétique déploie ses filets prompts à rattraper tout ce qui déserte, tout ce qui sort du rang. Parmi d’autres, les architectes et les ingénieurs critiques se voient attribuer une place, ils travailleront à la valorisation et à la réparation écologique du système, ils seront alternatifs. Les anciennes figures de l’autorité se dérobent. Les cybernéticiens miment l’autonomie, gouvernent par l’autonomie. Et c’est bien ce qu’ils sont essentiellement : les usurpateurs de l’autonomie. Au fond, le capitalisme cybernétique n’est-il pas la principale force destituante de l’époque ? Lui qui démantèle une à une les institutions de l’État moderne pour leur substituer ses plateformes et ses flux ? Et nous, qui refusons de vivre plié-en-deux à réparer le monde du capital, n’avons-nous aucune voie pour sortir de la métaphore du réseau, de sa lâcheté et de son impuissance ?
« Habiter le monde ». Avant de devenir un créneau éditorial ce fut un cri de guerre. Celui de toute une génération politique qui, désertant les inconsistances du mouvement antiglobalisation, décida de se doter de lieux communs, puis celui des zads, qui lui donnèrent ses lettres de feu. « Il ne peut y avoir d’art d’habiter en l’absence de communaux » disait Illich qui au début des années 80 faisait encore de ceux-ci les derniers points de résistance à la mise en boucles du monde. Les communaux étaient pour lui tout ce domaine du vernaculaire, tout ce qui nourrissait la subsistance populaire, le parler quotidien avant son expropriation par la grammaire étatique puis cybernétique, les usages populaires de la rue avant leur expulsion par la circulation automobile. On se plaît a imaginer la joie avec laquelle il aurait accueilli ce mouvement multiforme qui a fait de l’habiter une lutte, une lutte pour des autonomies communales, lui qui s’était résolument placé du côté des favellados de Rio de Janeiro, des squatteurs de Kreuzberg, et de tous les « "débranchés" qui cherchent de nouvelles formes d’habitat qui rendraient le paysage industriel habitable – au moins dans ses brèches et ses zones grises ». Avec André Gorz il appelait "Archipel de la convivialité" cette multitudes d’expériences hors-marché qui "décrochent" et se réapproprient le domaine vernaculaire de l’existence à distance de tout passéisme. « C’est une quête de l’autonomie, mais dans une nouvelle synthèse et non par un retour au "bon vieux temps" ou à une prétendue "vie simple" ».
Mais, et cela a été plusieurs fois souligné, un ensemble d’expériences localisées ne fait pas automatiquement une force, encore moins une force partagée. Pour cela il faut un imaginaire qui les lie, des fictions opérantes. Avant que la figure du réseau ne s’impose dans tous les pans de nos existences, et ce jusque parmi celles et ceux qui tente de construire une perspective révolutionnaire, une figure dominait la politique occidentale : celle du Parti. Dans la tradition révolutionnaire hégémonique – celle du marxisme – la figure du Parti s’imposait comme celle de l’Architecte de la révolution. Hypertrophie du volontarisme propre au sujet moderne occidental le Parti était la tête pensante qui devait donner forme au « sujet révolutionnaire » - les masses, la classe ouvrière – et dessiner les plans pour conquérir le Pouvoir. Pouvoir depuis lequel il pourrait architecturer matériellement, esthétiquement, et donc existentiellement la nouvelle société révolutionnaire. Cela mena au désastre que l’on sait.
Mais serait-il possible que cette forme, ce Parti-Architecte – conçu sur le schème d’une organisation centralisée dirigée par une élite – soit venu écraser d’autres formes partisanes mineures ? Des formes qui par exemple ne suivraient pas une logique architecturale mais des logiques vernaculaires, et donc autonomes ? Je vois bien tout le danger qu’il y a là à réanimer cette vieille figure et ainsi bien malgré moi venir redorer le blason du sectarisme et du radicalisme rigide. Mais je pense sincèrement que bien plus qu’à travailler à des figures que l’on projette sur un futur hypothétique nous avons à tracer celles à même de nous aider à ressaisir notre présent, à nous mettre en contact avec notre puissance, et donc notre possible.
Nous l’avons vu, la gouvernementalité cybernétique se constitue pour prévenir toute sécession au sein du corps social, empêcher que des parties ne se détachent du tout. Elle veut bien admettre que la totalité soit divisée en fragments – même, elle part de là - mais sa tâche sera de les maintenir connectés à celle-ci. L’écologie moderne, dont la généalogie est toute entière mêlée à celle de la cybernétique, partage ce fantasme de réconciliation totale nourrissant une peur panique de toute prise de parti trop saillante. Ce fantasme configure un certain éthos qui voudrait que tout différend, et même tout antagonisme, puisse se résoudre par la modération d’un dialogue rationnel, par la discussion apaisée. Réduisant tout conflit, au fond, à un problème de communication. Bruno Latour poussera cette utopie de la communication jusqu’à l’indécence en affirmant en juin 2018 – alors qu’à Notre-Dames-des-Landes l’État et sa police venait de détruire des habitations, de blesser des dizaines de camarades jusqu’à arracher la main de l’un d’ell·eux – que « dans la fumée des fumigènes et l’éclair des cocktails Molotov, on ne le voit peut-être pas, mais le rapport entre la ZAD et l’État est bien d’éducation réciproque » (Éloge des mauvaises herbes).
Dans Nous ne sommes pas seuls, Antoine Chopot et Léna Balaud tentent de dessiner une voie praticable entre le « léninisme écologique » de certains éco-marxistes et la neutralisation dépolitisante du compositionnisme latourien. Dans leur tentative de se doter « d’une méthode de perception écologique dans l’élaboration d’une stratégie anticapitaliste » ils font tenir ensemble la recherche de nouvelles manières de penser et de sentir propices à élaborer des rapports aux mondes attentifs à leurs relations aux non-humains, et la nécessité de tracer des lignes de front capables de « rendre possible l’émergence d’un nouveau camps politique à part entière ». Ils pensent un « communisme interspécifique » contre l’ « écologie-monde du capitalisme ».
Mais « à la différence de l’internationalisme ouvrier des XIXe et XXe siècles, nous disent-ils, la communauté politique de celles et ceux qui portent l’horizon de l’habitabilité ne peut être homogénéisée : le nom donné, par chaque groupe constituant cette communauté, et la ligne de partage avec notre adversaire commun ne peuvent être que situés. C’est à chaque fois une formulation locale mais porteuse de plus qu’elle-même. » Plus loin ils ajoutent : « si la désignation de cette ligne de conflit acquiert alors une part de flottement, c’est néanmoins la condition préalable pour faire consister le parti des mondes habitables contre l’écologie inhabitable du capitalisme – celle qui rend tous les autres mondes impossibles. »
Un parti des mondes habitables. C’est exactement ce que se proposait de penser un des textes révolutionnaires les plus important du jeune 21e siècle. Il était anonyme et s’intitulait Appel. Considérant que « Les techniques politiques du capitalisme consistent d’abord à briser les attaches où un groupe trouve les moyens de produire d’un même mouvement les conditions de sa subsistance et celles de son existence. A séparer les communautés humaines des choses innombrables, pierres et métaux, plantes, arbres aux mille usages, dieux, djinns, animaux sauvages ou apprivoisés, médecines et substances psycho-actives, amulettes, machines, et tous les autres êtres en relation avec lesquels les groupes humains constituent des mondes. […] Ces techniques politiques du capitalisme, les métropoles contemporaines en forment les points de concentration maximale. » Le texte proposait une stratégie : « établir dès maintenant un ensemble de foyers de désertion, de pôles de sécession, de points de ralliement. Pour les fugueurs. Pour ceux qui partent. Un ensemble de lieux où se soustraire à l’empire d’une civilisation qui va au gouffre. Il s’agit de se donner les moyens, de trouver l’échelle où peuvent se résoudre l’ensemble des questions qui, posées à chacun séparément, acculent à la dépression. Comment se défaire des dépendances qui nous affaiblissent ? Comment s’organiser pour ne plus travailler ? Comment s’établir hors de la toxicité des métropoles sans pour autant « partir à la campagne » ? Comment arrêter les centrales nucléaires ? Comment faire pour n’être pas forcé d’avoir recours au broyage psychiatrique lorsqu’un ami en vient à la folie, aux remèdes grossiers de la médecine mécaniste lorsqu’il tombe malade ? Comment vivre ensemble sans s’écraser mutuellement ? Comment accueillir la mort d’un camarade ? Comment ruiner l’empire ? »
Faire consister une force commune à ces foyers de désertion, à ces pôles de sécession, l’Appel appelait cela « construire le Parti » : « Le Parti est un ensemble de lieux, d’infrastructures, de moyens communisés et les rêves, les corps, les murmures, les pensées, les désirs qui circulent entre ces lieux, l’usage de ces moyens, le partage de ces infrastructures. »
Ici se dessinait donc une idée du parti non représentatif et non institutionnel, qui prenait pour point de départ non pas une idéologie – fut-t-elle communiste – mais des matérialités autonomes, et les pratiques de communisation qui les font consister. Le parti c’était désormais des lieux et des liens. Se doter de lieux communs – en ville ou à la campagne, les habiter pleinement, expérimenter les techniques à même de défaire nos dépendances à la métropole, les peupler de liens, élaborer les modes de partage qui leur sont propres, et surtout, les lier entre eux. Construire le parti ce n’était plus construire l’organisation totale au sein de laquelle toutes les différences éthiques pourraient être mises entre parenthèses, en vue de la lutte ; mais établir les formes-de-vie dans leurs différences, intensifier, complexifier les rapports entre-elles. Construire le parti c’était donc : organiser la circulation de l’expérience - dans toute sa densité affective - en vue de rendre ces autonomies communales de plus en plus vivantes, tout en demeurant offensives. Et la notion de Parti répondait « à la nécessité d’une formalisation minimale, qui nous rende accessibles tout en nous permettant de demeurer invisibles. »
Seulement voilà, il n’est pas sûr qu’il soit si aisé de manier un notion qui comporte une telle charge historique, et de la faire dévier de cette charge. Deux obstacles majeurs semblent se dresser sur ce chemin. D’une part le parti, à l’instar de l’architecte, est une figure archétypique de la virilité classique. De cette masculinité blanche qui se pense comme le point neutre du monde, et ainsi cultive une ignorance à soi et un analphabétisme émotionnel des plus néfastes. Si rien n’est mis en place pour l’en empêcher cette figure s’impose, et domine, réduisant le champs du dicible et la gamme des affects communisables.
D’autre part la notion de parti – si éminemment politique - comprend le risque d’une rigidification, des relations en son sein comme de celles à son extérieur, inhérente à la prévalence de ce que d’autres ont appelé le « schéma schmittien ». Carl Schmitt, juriste nazi penseur de l’état d’exception, a forgé une théorie du politique définie par la distinction ami/ennemi qui structure toutes les dimensions de l’existence. Or si cette distinction peut en effet nommer ce qui se joue dans un conflit politique, lorsque des mondes s’affrontent, il devient particulièrement dangereux lorsqu’il est appliqué à la totalité des relations, et notamment à l’amitié. Car l’amitié, si elle peut mener au combat, n’en a nul besoin ni pour naître, ni pour se déployer. L’amitié est une grâce disait Illich, elle se donne gratuitement et trouve sa plénitude en elle-même. Au contraire vouloir la surpolitiser amène à promouvoir des subjectivités paranoïaques et un utilitarisme des liens des plus destructeurs, si typique malheureusement dans l’histoire du militantisme révolutionnaire.
Imperceptiblement le rapport à l’ennemi devient premier, entraînant des conséquences dans deux sens différents : pacification des relations en interne où le maintien de la cohésion empêche de problématiser les rapports de domination qui traversent les amis, et perception paranoïaque du dehors qui clôture l’espace possible des rencontres. Là où l’on voulait destituer la politique, elle finit par nous engloutir. Et puis la réalité c’est que la majorité des êtres ne sont ni amis, ni ennemis, car la politique n’est qu’un certain degré d’intensité au sein de l’élément éthique, et qu’au sein de l’éthique mille nuances ont cours en deçà de l’amitié et de l’inimité. Mille nuances qui font sa richesse et sa vitalité.
Parti-guérilla, parti-communication, parti-enquête, parti-mouvement. Dans L’hypothèse autonome Julien Allavena nous emmène dans un précieuse traversée des différentes formes qu’a pris le parti de l’autonomie selon ses temps et ses géographies particulières. Au cours de cette histoire il met à jour une voie mineure, un autre rapport à la conflictualité, qui fut pratiquée en Italie par les féministes autonomes. Alors qu’une partie du mouvement féministe rejette la violence comme « symbolique viriliste », une autre se pose la question de sa réappropriation.
Deux raisons à cela : d’une part et bien que se considérant « incapables de vivre la politique selon les schémas masculins » - et donc rejetant tout autant la fétichisation de l’affrontement que l’identification paranoïaque à l’ennemi – elles refusent néanmoins de réduire « le féminin [à] un "négatif photo" du masculin » et, dans l’intensification de la conflictualité sociale qui a alors cours, elles estiment que « déclarer que la violence, quelle qu’elle soit est masculine et fasciste, signifiait renoncer à se défendre et choisir de rester à la maison sans rien déranger » (L’Italie au féminisme. Louise Vandelac). « Accepter les différences entre nous et affirmer que les femmes sont différentes et non le contraire de l’homme signifiait accepter l’agressivité des femmes sans la liquider par la boutade "tu te comportes comme un homme" ». Dès lors, des groupes d’auto-défense s’organisent, des commandos se forment pour attaquer les agresseurs.
D’autre part, dans le déploiement de leurs pratiques qui, partant de soi, refuse de séparer le politique du personnel, la politique des femmes, qui était née dans les groupes d’auto-conscience et avait impulsé un grand mouvement de réappropriation des savoir-faire médicaux, en vient à organiser les premières grandes manifestations de femmes. Mais celles-ci sont attaquées, non seulement par des groupes fascistes, mais également par des mecs des partis gauchistes qui refusent de leur laisser la tête de cortège. La question de se défendre s’impose.
« Vers mai 76, nous avons sorti un journal à Bologne qui s’appelait Siamo isteriche (nous sommes hystériques), car nous sentions la nécessité de poser le problème de la violence et d’organiser le débat qu’il y avait sur ce thème dans le mouvement, de lui donner une possibilité d’expression et de structuration. Au début, les questions tournaient autour de la violence exercée sur la femme et la violence de la femme. Celle-ci n’est pas une violence organisée, « rationnelle », mais une violence spontanée, « sauvage », « hystérique ». La violence n’est pas que le fait des hommes, mais elle est toujours renvoyée à la femme comme une manifestation hystérique inhérente à son sexe et dont elle doit se sentir coupable ; l’image de la femme traditionnelle étant empreinte de douceur ou de son contraire, sorcellerie, folie, hystérie. Le problème était d’affirmer la spécificité de notre violence de femme par rapport à celle, toute différente, des mecs, et, de se servir de l’hystérie comme d’une arme politique dans la mesure ou elle est la seule forme d’expression possible pour une femme face à une oppression obstinée qui s’exerce sur elle quotidiennement et à laquelle elle ne peut que répondre par une explosion spontanée : plus clairement, l’hystérie n’est que l’expression politique de l’oppression des femmes. Comment organiser l’hystérie ? La violence des femmes de façon collective en lui donnant sa connotation politique ? » (Où étions-nous ? Où en étions-nous ? Anna Orsini, Silvia Schassi)
« Organiser l’hystérie » sera donc pour les féministes autonomes, non plus viser la destruction de l’ennemi à la manière masculine, non plus se mesurer à l’ennemi, mais, partant de la force qu’elles ont constitué ensemble dans le partage du personnel et le refus de la normalisation patriarcale, se rendre capable de défendre cette force, selon les modalités qui leur conviennent, et renverser ce qui la limite. Julien Allavena commente : « Ce cheminement a donc ceci de particulier que c’est à partir de soi et des expériences collectives qui en découlent que les ennemis sont identifiés en tant qu’obstacles à la libération en cours. C’est une inversion de la logique schmittienne, selon laquelle l’ennemi est premier et polarise les amitiés en second lieu seulement […]. Ici donc, l’amitié est première, et le rapport belliqueux ne survient qu’au cours de son déploiement. »
Construire le parti des mondes habitables. Destituer les Architectes.
Ce pourrait donc être cela. Avant de les pendre, les inviter à déserter.
En tout cas. Enterrer le culte des signatures. Nourrir une politique du geste.
Multiplier les sécessions. Se réapproprier les techniques nécessaires.
Bâtir sans eux. Des mondes habitables. Organiser leur rencontre.
Prendre parti. Contre la destruction des mondes vivants. Contre la métropole.
Mais tout cela. Depuis nos liens. En problématisant les rapports entre nous.
En prenant soin de nos amitiés. De nos joies, de nos colères. De notre puissance.
Suivant la sagesse d’un camarade. Qui faisait du critère de vitalité d’une Commune.
Sa capacité d’autodérision. « Construire le parti » pourrait être une blague.
Mais une blague des plus sérieuses. Et dont le principal danger.
Serait de se prendre au sérieux.
En souvenir de l’éruption du 24 janvier 2009






