La Critique défaite
Après avoir écrit Philosophie et révolution. De Kant à Marx (La Fabrique, 2017), Stathis Kouvélakis enchaîne avec un second livre d’histoire de la philosophie, paru à l’automne 2019 aux éditions Amsterdam : La Critique défaite. Emergence et domestication de la théorie critique. Il y retrace l’aventure de l’école de Francfort depuis ses origines jusqu’à nos jours, en axant son analyse sur trois figures principales qui correspondent chacune à une époque définie, ou « génération » : Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Axel Honneth. Comme l’indique le sous-titre, il s’agit d’analyser la manière dont la Théorie critique s’est vidée de sa substance depuis son émergence dans les années Vingt du siècle dernier jusqu’à nos jours. Apparue d’abord comme un effort théorique visant à renouveler le marxisme, le premier temps de la « défaite » consiste, avec Horkheimer, à entériner après 1945 le pacte anticommuniste des démocraties libérales. L’aspiration à transformer les rapports sociaux n’est dès lors plus qu’un résidu mélancolique. Le second temps intervient avec Habermas qui, des années Soixante-Dix jusqu’à la Réunification allemande, élabore une normativité rationnelle d’inspiration kantienne. A la mélancolie d’Horkheimer succède un rationalisme constitutionnel mi-inquiet, mi-jovial, reparcourant en sens inverse le chemin qui mena de Kant à Marx. Enfin la « défaite » franchirait un nouveau palier en 2015 avec la publication par Honneth de L’Idée du socialisme, essai que Kouvélakis commente en ces termes :
Le traitement de « l’idée du socialisme » que propose cet ouvrage est exemplaire à cet égard : en définissant le socialisme comme un principe moral, soigneusement disjoint d’un quelconque mouvement de rupture avec le capitalisme – il n’est en effet question du socialisme qu’en tant qu’ « idée » - l’auteur peut se présenter comme un critique du capitalisme tout en se livrant à une opération d’évidage systématique de tout ce qui, dans la tradition socialiste qu’il prétend renouveler, permet de penser l’alternative comme mouvement réel de rupture avec l’ordre existant. Se réclamer du socialisme ne signifie pas, pour Honneth, réfléchir à un « ordre nouveau », bien qu’issu des contradictions de l’existant, mais aux moyens de rendre la société existante « réellement sociale », c’est-à-dire davantage conforme à son concept, qui n’est encore que partiellement parvenu à sa réalisation (p. 501-502).
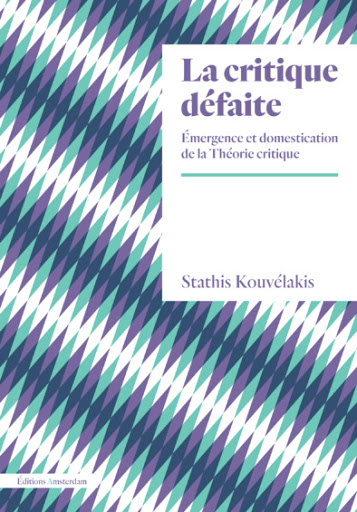
Le fil conducteur de La Critique défaite, c’est donc le passage d’une théorie qui s’efforce de « penser l’alternative comme mouvement réel de rupture avec l’ordre existant », à une théorie qui, à l’inverse, se propose d’accompagner le mouvement de l’ordre existant, entérinant de la sorte le célèbre constat de Thatcher : « il n’y a pas d’alternative ». Cependant Kouvélakis montre que l’infléchissement qui conduit à la « domestication » de la Théorie critique est amorcé bien avant le tournant néolibérale du début des années 1980, puisqu’il serait repérable dès Horkheimer, lorsque sous sa plume « la catégorie de contradiction perd son ancrage dans l’objectivité des rapports antagonistes de classe » (p. 142). C’est en effet d’un point de vue rigoureusement marxiste, ou « marxien », que l’auteur analyse la trajectoire de l’école de Francfort. Et à le suivre, la « domestication » est d’ores et déjà achevée au sortir de la seconde guerre mondiale, lorsque la politique d’extermination nazie devient le « Mal » par excellence et que l’horizon de la Théorie critique est réduit à un « plus jamais ça ! » d’autant plus inoffensif qu’il déguiserait un retour du religieux :
La critique n’est plus le nom d’une théorie en rupture avec les formes traditionnelles de l’activité intellectuelle, avançant un programme de recherche interdisciplinaire visant à saisir historiquement la totalité des rapports sociaux du point de vue de la praxis transformatrice qui leur est immanente. Elle n’est même plus au service de la poursuite d’un objectif rationnel posé comme idéal à réaliser ou comme impératif catégorique. La « critique », si le mot a un sens, ne peut désormais que signifier le refus du Mal au nom d’un absolu indéterminé, irréductible noyau éthique qui reprend le contenu de vérité des anciennes croyances religieuses (p. 247).
Dans l’histoire de la « domestication » de la Théorie critique, il semble donc que les chambres à gaz nazies - le « Mal » - marquent un tournant. Pour le comprendre, il faut revenir au projet initial de l’école de Francfort dans le contexte particulier de la montée des fascismes. Kouvélakis le définit en ces termes :
L’idée rectrice est que, loin d’être une aberration de l’histoire ou un corps étranger à la modernité bourgeoise, le fascisme révèle une possibilité inhérente au capitalisme mais qui ne se manifeste que dans des conditions de crise exacerbée de la domination de classe et de rivalité entre puissances impérialistes, sur fond de défaite et d’impuissance du mouvement ouvrier. Là où la doctrine officielle des partis communistes, peu différente sur le fond des visions libérales et social-démocrates, y voit un élément « archaïque » et « rétrograde », la Théorie critique discerne dans le fascisme une expression des tendances les plus modernes du mode de production et des techniques de mobilisation des masses mises au service de leur propre oppression. Un aphorisme de Horkheimer en donne une formulation condensée : « Celui qui ne veut pas parler du capitalisme doit aussi se taire à propos du fascisme » (p. 18).
Telle serait donc l’orientation théorique et pratique qui, à l’origine, singularisait le projet d’études interdisciplinaires conçu par Horkheimer. Or, au terme du processus de domestication, son aphorisme est devenu au mieux un hiéroglyphe incompréhensible, au pire le témoignage d’un égarement dont Habermas, puis Honneth, auraient su se prémunir :
Dans une révocation du questionnement fondateur de la théorie critique, le fascisme est vu comme une parenthèse régressive sur la route de la modernité. Les moments de crise systémique et d’exacerbation de la conflictualité sociale au sein même des métropoles capitalistes sont ramenés à des différends solubles dans le cadre de la normalité libérale. Ni souhaitable, ni réalisable, voire même nocive, l’idée de remonter à la racine des maux pour « renverser toutes les conditions sociales où l’homme est un être abaissé, asservi, abandonné, méprisable » en quoi consiste la tâche de la radicalité critique ainsi que Marx la définissait, est mise au rebut de l’histoire (p. 23).
La révocation du « questionnement fondateur » aurait donc pour origine les chambres à gaz nazies, en ce sens qu’elles auraient attesté qu’il y a bien une solution de continuité (c’est-à-dire une rupture) entre capitalisme et nazisme, et par là même disqualifié l’aphorisme initial pour lui en substituer un autre, rigoureusement contraire : celui qui veut parler du capitalisme doit se taire à propos du nazisme. Et c’est donc ici qu’interviendrait l’objection de Kouvélakis : dès lors qu’on s’interdit de réinscrire le génocide antisémite dans la trame historique de la montée des fascismes, le « refus du Mal », quand bien même on l’érigerait en nouvel impératif catégorique, est inoffensif, puisqu’il ne s’appuie pas sur une analyse précisément critique du « Mal » en question, ce qui supposerait, pour commencer, d’en contester peut-être la majuscule.
Esclavagisme et colonialisme
En effet, envisagé sous un certain angle, le nazisme ne serait pas tant une exception que la suite, sinon nécessaire du moins logique, d’une expansion coloniale dont les ressorts prédateurs et xénophobes ont été patents depuis 1492. De cette continuité témoigne notamment l’exploitation de la main-d’œuvre étrangère sous le régime nazi. Dans un livre récent, Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui (Gallimard, 2020), l’historien Johann Chapoutot observe :
Alors que le territoire national se vide de ses hommes, appelés sous les drapeaux, les étrangers prennent leur place, travailleurs volontaires ou forcés : le IIIe Reich, qui voulait épurer son territoire de toute altérité, accueille 15 millions de travailleurs étrangers en 1945. Ces deniers sont considérés comme un fond d’énergie, à exploiter jusqu’à épuisement dans le cas des travailleurs polonais, des travailleurs de l’Est (Ostarbeiter) et des détenus des camps de concentration. Considérés biologiquement comme des sous-hommes, ils constituent, du point de vue économique, une ressource subhumaine ou infra-humaine, à traiter comme telle. Aucun management et nul ménagement : c’est la seule contrainte, doublée d’une répression féroce, qui prévaut pour les étrangers à la communauté (p. 76).
En exploitant la main-d’œuvre étrangère par « la seule contrainte, doublée d’une répression force », le régime nazi s’inscrivait dans le droit fil des politiques esclavagistes menées par les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, les Anglais, les Français, etc., dans le Nouveau Monde. Et à ce propos, je pense avoir montré dans la troisième partie d’un livre qui vient de paraître aux éditions Amsterdam, L’Occident, les indigènes et nous, que la réduction en esclavage et la déportation de millions d’Africains avaient pour fondement historique, outre l’esclavagisme, non pas un racisme mais une xénophobie, en ce sens que c’est la différence entre le travailleur étranger, esclave africain, et le travailleur autochtone, amérindien devenu sujet des royaumes catholiques, qui a servi de ressort aux premiers développements de la traite atlantique. Le racisme est en effet une conséquence de « l’esclavage des nègres », non sa cause. Cependant avec l’avènement du nazisme, le racisme devient l’idéologie officielle d’un régime politique, ce qui est sans doute une différence notable. Mais la continuité n’en est pas moins établie avec les régimes esclavagistes européens qui ont dépeuplé l’Amérique et ponctionné l’Afrique de ses forces vives durant près de quatre siècles, jusqu’à ce que la colonisation prenne le relai de la traite, notamment à partir du partage de l’Afrique (conférence de Berlin de 1884-85). C’est pourquoi, au sujet de la férocité esclavagiste du nazisme, Césaire évoque un « formidable choc en retour » subi par l’Europe colonialiste, comme si le traitement infligé aux populations des tropiques revenait tel un boomerang frapper les populations européennes. Toutefois, à y regarder de plus près, ce sont principalement, en Europe, les « travailleurs de l’Est (Ostarbeiter) » qui subirent donc, en termes d’esclavagisme, ce « choc en retour ». Et à cette lumière le régime nazi a précisément renoué avec une vieille pratique européenne, attestée depuis l’antiquité jusqu’au Moyen-Age, lorsque les victimes de la traite étaient principalement des « slaves », ce dont témoigne l’étymologie du mot « esclave » dans bien des langues européennes (slave en anglais, esclavo en espagnol, schiavo en italien, etc.).
L’observation de Césaire n’en est pas moins pertinente : les nazis ont introduit en Europe des pratiques qui semblaient ne devoir concerner que les seules populations des tropiques. Et suivant ce fil dans un livre paru en octobre 2019, La Tropicalisation du monde (Puf), Xavier Ricard Lanata observe un semblable « choc en retour » dans l’Europe contemporaine, en ce sens que le démantèlement systématique des « acquis sociaux » contribue à livrer la population européenne pieds et mains liés aux intérêts du Capital ; d’où l’argument de son ouvrage : « Le monde se tropicalise à mesure que la condition coloniale déborde le cadre géographique des Tropiques et prend à revers les maîtres d’autrefois ».
Reféodalisation
Dans l’article qu’elle a consacré au procès de la direction managériale de France-Telecom, paru dans LM (#200), la romancière Sandra Lucbert écrit :
On pourrait se demander, à assister au procès France Télécom, comment des techniques disciplinaires aussi violentes ont été et sont encore (La SNCF, la Poste) utilisées à grande échelle, en toute décontraction. La visibilité structurelle d’un ordre social que peut produire un roman, le procès France Télécom la produit également. C’est pour harcèlement systémique que comparaissent la personne morale de l’entreprise et les six prévenus. Le procès France Télécom raconte une destruction d’échelle, organisée par des protocoles et des techniques. L’effet de liste des journées d’audience, où sont recensés, exposés, discutés des supplices - toujours les mêmes -, est comme la suite des péripéties de K, ou du narrateur de Ferdydurke : le spectacle d’une astreinte institutionnelle dégondée. Dans l’ordre salarial induit par des déréglementations concurrentielles voulues par l’Europe et nos gouvernements (pour France Télécom : privatisation sous Jospin, puis Fillon), les salariés, comme Joseph K, découvrent un matin un nouvel agencement - des injonctions démentes. Il y en a qu’elles massacrent (les salariés, surtout les fonctionnaires), et d’autres qui en tirent parti (les actionnaires).
La référence à Kafka s’impose en effet à plus d’un titre. On a souvent souligné le caractère « prémonitoire » des péripéties bureaucratiques de K. en les rapportant au totalitarisme des Etats socialistes. Il me semble que l’usage qu’en propose Lucbert est précisément novateur en ceci qu’elle les rapporte donc aux pratiques managériales du capitalisme contemporain, lesquelles, via Kafka, s’apparentent à une reféodalisation des rapports sociaux plus encore qu’à une bureaucratisation. Dès l’entame du Château, le décor est dressé : un village paysan et un château. Et la première intervention en style directe est celle d’un « jeune homme » portant « des habits de citadin » qui explique à K. : « Ce village appartient au château ». C’est donc le clivage seigneur/paysans, ville/campagne qui structure l’horizon social du récit. Le Procès également peut être lu à cette lumière, en ce sens que la justice féodale distingue entre les hommes libres, qui participent aux assemblées et peuvent bénéficier de la justice royale, et les serfs, soumis à l’arbitraire du seigneur. Dans son Histoire des Carolingiens. VIIIe-Xe siècle, Marie-Cécile Isaïa explique :
Le souci d’ordonnancement du monde des carolingiens, leur désir d’assigner à tous une place dans un corps social radicalement inégalitaire provoquent ainsi au cours du IXe siècle une simplification radicale des statuts personnels et un déclassement social réel. Charlemagne l’affirme dans une réponse donnée à un missus (801/814) : « Il n’y a pas d’autres catégories que celle du libre et celle du servus. » Le roi sait pourtant d’expérience qu’il y a des moins-libres et de nombreuses situations intermédiaires. S’il ne décrit pas la réalité, il fait part d’un projet : la participation à la vie politique ne peut être que le privilège des libres. […] A chaque occasion, l’incapacité politique des hommes libres et de ceux qui leur sont assimilés est publiquement rappelée. C’est à partir de cette exclusion vécue que se joue l’entrée en servitude. Il y a des hommes qui participent à la vie publique ; et il y a ceux qui sont progressivement exclus des assemblées ou qui préfèrent ne pas y figurer ; ces derniers ne peuvent plus, même par la médiation d’agents subalternes, entrer en relation avec le roi (Points, 2014, p. 192).
Dès lors, mourir « comme un chien », le sort de Joseph K dans Le Procès, exprimerait le fait de n’avoir pu bénéficier de la justice royale, sorte d’utopie illusoire dont K. ne sera précisément délivré qu’une fois qu’il aura entériné qu’il est un « chien », c’est-à-dire un serf. Enfin Lucbert évoque les « supplices » subis par les salariés de France-Telecom, ce qui nous renvoie cette fois à La Colonie pénitentiaire et à la question de l’asservissement des corps à un mécanisme tortionnaire. Dans K comme Kolonie. Kafka et la décolonisation de l’imaginaire (La Fabrique, 2020), Marie José Mondzain en propose une lecture décoloniale. La puissance de Kafka est telle, en effet, qu’elle permet d’analyser les ressorts de pratiques managériales, ou coloniales, ou féodales, comme elle peut introduire à une remarque de Moïse Finley dans Esclavage antique et idéologie moderne, au sujet du basculement des citoyens romains les plus pauvres dans la condition servile, basculement qui intervient lorsque les châtiments corporels, qui auparavant ne concernaient que les seuls esclaves, leur sont pareillement appliqués. Tropicalisation et reféodalisation des rapports sociaux fonctionneraient donc de concert, le principe général étant finalement le suivant : Le souci d’ordonnancement du monde des [capitalistes], leur désir d’assigner à tous une place dans un corps social radicalement inégalitaire provoquent ainsi au cours du [XXIe] siècle une simplification radicale des statuts personnels et un déclassement social réel.
Une fois restituée la force inentamée de l’aphorisme d’Horkheimer - « Celui qui ne veut pas parler du capitalisme doit aussi se taire à propos du fascisme », comme il doit finalement se taire à propos de l’esclavagisme, du féodalisme et du colonialisme -, il n’en demeure pas moins que d’un autre côté, aux exploitations parfois génocidaires de la force de travail succède, à Auschwitz, son anéantissement pur et simple, pratique antisémite qui ne procède pas d’une contradiction ancrée dans l’objectivité des rapports antagonistes de classe, non plus que d’une extorsion de plus-value, ou encore d’une assignation inégalitaire ordonnant les fonctions productives du corps social. Et en ce sens, n’est-il pas exact que celui qui veut parler du capitalisme doit se taire à propos d’Auschwitz ?
Qu’appelle-t-on penser Auschwitz ?
Abordant la question de l’antisémitisme nazi, Kouvélakis pointe, à juste titre sans doute, une faiblesse théorique d’Horkheimer et Adorno, leur reprochant notamment d’envisager l’antisémitisme comme « un trait anhistorique de la raison occidentale » et concluant : « Un tel cadre obère tant la compréhension de la spécificité de l’antisémitisme moderne que celle du mécanisme de la mort industrielle mis en place dans le cadre de la ‘‘guerre totale’’ du nazisme contre le judéo-bolchevisme » (p. 246). Mais comment appréhender en théoricien authentiquement « critique » la politique nazie d’extermination des Juifs ? Kouvélakis, concernant Horkheimer, diagnostique une abdication : « A la notion, problématique mais riche, d’une subjectivité constituante, structurée par une praxis dont il s’agit de repenser les coordonnées, vient se substituer une théologie négative, seul recours d’individus condamnés à l’impuissance » (p. 248-249). Et c’est précisément entre 1939 et 1945 que cette désastreuse substitution interviendrait. Car dans « Les Juifs et l’Europe », écrit en 1939, Horkheimer maintient encore le cap de la Théorie critique :
En réalité, le propos de ce texte, dont il faut noter qu’il correspond à une phase où les persécutions antijuives revêtent le caractère de pogrom et d’actes qui se déroulent sur la place publique, à l’opposé de la mécanique exterminatrice qui se mettra en place à l’abri des regards lors du passage à la phase génocidaire, est de replacer l’antisémitisme dans une perspective historique. Il s’agit de le saisir, en d’autres termes, comme le point d’aboutissement d’une logique inhérente à la société bourgeoise en tant que telle et non comme une aberration ou une pathologie exclusivement allemande. […] Cet essai représente à la fois sa première et ultime tentative de traiter la question de l’antisémitisme dans une perspective anticapitaliste d’inspiration marxienne […] » (p. 170-171).
Kouvélakis souligne donc que la perspective « anticapitaliste » sert d’ossature à l’analyse du nazisme tant que « les persécutions antijuives revêtent le caractère de pogrom », d’où suit que ce serait bien au terme de la « phase génocidaire », une fois avérée la « mécanique exterminatrice », que la perspective d’Horkheimer a été bouleversée. Un tournant est toutefois déjà perceptible dans l’essai de 1939, puisque deux pages plus loin Kouvélakis observe que l’analyse du totalitarisme nazi conduit déjà Horkheimer à s’affranchir du cadre théorique « marxien », parce que les catégories de l’économie politique ne permettraient pas d’en appréhender la singularité. Kouvélakis restitue alors en ces termes la pensée d’Horkheimer :
En effet, le ressort du système n’est plus à proprement parler la recherche du profit économique mais un principe plus général, dont la motivation du profit n’est qu’un cas particulier, à savoir la « poursuite du pouvoir [Macht] social ». La sphère de l’économie n’a plus de consistance propre : à son emprise s’est substituée celle de l’exercice directe de la domination. De là découle une conséquence historique décisive : les catégories de l’économie politique, qu’il faut entendre ici dans le sens de la critique marxienne, ont atteint leur limite. […] L’ordre totalitaire n’est plus un « mode de production » à proprement parler mais le lieu d’un exercice direct de la violence nue et même, nous le verrons, dépourvue de forces antagonistes (p. 172-173).
C’est donc bien le totalitarisme nazi qui conduirait Horkheimer à privilégier la catégorie politique de « domination » au détriment d’une contradiction ancrée dans l’objectivité des rapports antagonistes de classe. Faut-il le lui reprocher ? Oui, suggère Kouvélakis, en ce sens, précisément, que la domination totalitaire, tel qu’analysée par Horkheimer, apparaît « vidée de tout principe de contradiction interne enracinée dans les rapports sociaux propres à cette phase historique » (p. 174). Autrement dit, l’analyse du régime nazi deviendrait le cheval de Troie d’une liquidation théorique du marxisme, l’argument étant notamment que « L’ordre totalitaire n’est plus un ‘‘mode de production’’ ». Je me permets donc d’évoquer brièvement ici un livre paru en 2009, Qu’appelle-t-on penser Auschwitz (Lignes), puisque son enjeu était pour une part de penser l’antisémitisme nazi comme un « mode de production », ceci à partir des analyses de Heidegger, d’Arendt et de Lacoue-Labarthe au sujet de la « fabrication de cadavres dans les chambres à gaz ». Mais suivant une intuition de Lacoue-Labarthe, il s’agissait toutefois de situer la matrice de ce nihilisme essentiel très en amont de l’émergence du capitalisme, dans le droit fil de ce qu’il appelait une « captation hellénistique et romaine » de l’héritage hébraïque, ce qui consonnait donc avec certaines analyses d’Horkheimer et d’Adorno, mais sans pour autant liquider l’héritage marxien, le livre se concluant précisément sur le mot « ouvrier ».
Je ferme la parenthèse et reviens aussitôt à La Critique défaite. Dans le texte de 1939, « L’Europe et les Juifs », Horkheimer analyse donc le totalitarisme nazi comme une rupture avec l’ordre existant, en ce sens que « La sphère de l’économie n’a plus de consistance propre : à son emprise s’est substituée celle de l’exercice directe de la domination ». Entre cette description du totalitarisme nazi et le processus de « domestication » de la Théorie critique analysé par Kouvélakis, il n’y a cependant nul enchaînement nécessaire. Bien au contraire, l’analyse d’Horkheimer pourrait illustrer un enseignement précieux de l’école de Francfort : la domination de l’homme sur l’homme n’étant pas apparue avec le capitalisme, s’ensuit qu’il est une rupture possible avec l’ordre existant (l’ordre capitalo-parlementariste) qui ne serait pas pour le meilleur mais pour le pire. Il est en effet deux écueils : l’un consiste à juger a priori que toute rupture avec l’ordre existant est vouée au pire, l’autre jugeant qu’elle est vouée au meilleure. La théorie critique consisterait dès lors à discerner deux formes de rupture, celle qui oriente vers le meilleur, celle qui oriente vers le pire. Et il me semble donc qu’Horkheimer, commenté par Kouvélakis, analyse avec discernement, en 1939, ce en quoi le national-socialisme est une rupture avec l’ordre capitalo-parlementariste : « le ressort du système n’est plus à proprement parler la recherche du profit économique mais un principe plus général, dont la motivation du profit n’est qu’un cas particulier, à savoir la ‘‘poursuite du pouvoir [Macht] social’’ ». Et c’est donc, à suivre Horkheimer, dans cette rupture avec l’ordre marchand, au bénéfice du « pouvoir social », que pourrait résider la singularité antisémite du totalitarisme nazi, d’où la nécessité de modifier la perspective.
L’analyse de ce « principe plus général » pourrait par exemple nous reconduire à la Bible hébraïque, précisément au livre d’Esther, lorsqu’un décret d’extermination des Juifs a pour origine le refus du « Juif Mardochée » de se prosterner devant Haman, le représentant du « pouvoir [Macht] social ». Danny Trom, dans Persévérance du fait juif. Une théorie politique de la survie (EHESS/Gallimard/Seuil, 2018), s’est du reste efforcé d’opérer un tel retour au livre d’Esther, mais son interprétation privilégie l’alliance apparente entre Mardochée et Assuérus, l’empereur perse, ce qui me paraît être discutable, sachant que la tradition talmudique reproche précisément à Mardochée sa proximité finale avec le « pouvoir social », proximité corrélative, selon les rabbins, d’une désertion de la maison d’étude. Autrement dit, la tradition talmudique célèbre chez Mardochée son refus de se prosterner devant Haman, non son apparente proximité finale avec le royaume, une fois Haman destitué [1]. L’intérêt remarquable du travail de Trom consiste néanmoins dans la révolution qu’il fomente, en termes de perspective historique et politique, puisque selon lui la proximité avec le royaume (en hébreu « karov le-malkhout »), sorte d’alliance avec l’Etat dont la fonction est de « garder », c’est-à-dire de protéger les Juifs du dessein criminel des forces sociales antisémites, introduit précisément une distance critique en lieu et place d’une identification : « S’il est une leçon ‘‘universelle’’ de la tradition du gardien, elle tient dans cette extériorité entre Etat et peuple, extériorité que l’avènement de l’Etat ‘‘juif’’ n’abolit précisément pas » (p. 415). C’est donc du biais de cette « extériorité » maintenue que Trom reformule la défiance rabbinique (talmudique) à l’égard du pouvoir.
Quoi qu’il en soit des interprétations du livre d’Esther, l’analyse d’Horkheimer paraît donc pertinente, en ce sens que la politique nazie opère bel et bien, à Auschwitz, une rupture avec la logique du Capital, d’où la nécessité de modifier à la fois la perspective historique et le cadre théorique de l’analyse. L’erreur fut cependant d’abandonner l’éclairage marxiste, ou « marxien », plutôt que de le compléter. Et c’est me semble-t-il en ce sens qu’il convient d’entendre la critique qu’adresse Kouvélakis à Horkheimer et en explorer le bien-fondé.
Le totalitarisme de la Troïka
Prenons un exemple concret pour illustrer la manière dont les deux analyses – marxiennes et non marxiennes - doivent fonctionner de concert plutôt que l’une au détriment de l’autre. Dans Notre Printemps d’Athènes (Les Liens qui Libèrent, 2015), Yanis Varoufakis expose les tenants et les aboutissants des négociations qu’il a menés avec la Troïka, lorsqu’il était ministre des finances du gouvernement Tsipras. Et ce qu’il met en évidence tout au long de cet ouvrage, c’est le caractère apparemment insensé de l’intransigeance de l’Eurogroupe. En effet, les mesures d’austérité préconisées par le passé avaient fait la preuve de leur totale inefficacité, puisqu’en bridant l’appareil de production grec, elles rendaient impossible une croissance économique qui seule pouvait permettre de rembourser la dette. Varoufakis fit donc de nombreuses propositions qui, tout en respectant les principaux paramètres de la bonne « gouvernance » libérale, pouvaient néanmoins permettre à la Grèce de se restructurer économiquement et financièrement et ainsi, à terme, de rembourser, dans la mesure du possible, ses dettes. Pourtant l’Eurogroupe ignora délibérément toutes les propositions de Varoufakis, préférant s’en tenir à une politique de prêt conditionnée par des mesures d’austérité de plus en plus drastiques, lesquelles ne pouvaient que prolonger la spirale de la crise et de l’insolvabilité. Une telle intransigeance ne servait donc les intérêts ni des Grecs débiteurs, ni des Européens créditeurs, puisqu’il était clair que la politique d’austérité imposée par l’Eurogroupe ne permettrait pas à la Grèce de rembourser quoi que ce soit mais, au contraire, allait contribuer à déstructurer davantage l’appareil de production grec et donc à aggraver l’endettement. Quelle était, en ce cas, la motivation de l’Eurogroupe ? C’est à cette question que répond Varoufakis à la page 42 de Notre Printemps d’Athènes :
La seule réponse, c’est qu’il ne s’agit pas d’économie, mais bien de pouvoir politique. La plus grande crainte de la Troïka était que notre gouvernement puisse réussir, que sa grande sagesse et son autorité à elle, la Troïka, soient mises en cause par vous, chers amis, par les peuples d’Europe. La Troïka ne se préoccupe pas de la permanente plaie suppurante qu’est la Grèce. Le ministre allemand des Finances ne se soucie même pas que les contribuables allemands soient remboursés. Ceux qui mènent la danse en Europe sont prêts à verser beaucoup plus d’argent de leurs contribuables dans la fosse grecque sans fond, pendant que les Grecs souffrent, si c’est la seule façon qu’ils ont de perpétuer leur emprise sur leur propre peuple. La dette est le pouvoir du créancier et la dette insoutenable donne au créancier encore plus de puissance.

L’analyse de Varoufakis concernant l’Eurogroupe rejoint donc celle d’Horkheimer concernant le totalitarisme, telle que Kouvelakis la restitue : « le ressort du système n’est plus à proprement parler la recherche du profit économique mais un principe plus général […], à savoir la ‘‘poursuite du pouvoir [Macht] social’’ ». Cependant Varoufakis n’ignore pas que par ailleurs, la position de l’Eurogroupe répond bel et bien à une logique économique, celle du Capital, puisqu’auparavant, en pages 17-18 du même ouvrage, il a expliqué :
L’austérité diminue les revenus tandis que les dettes grossissent. Toujours plus de dette, sous la forme de nouveaux prêts d’urgence, à condition qu’une austérité de plus en plus forte sape de plus en plus les revenus, cela conduit avec une précision mathématique à une catastrophe. Tout le monde le savait. Alors, pourquoi l’Europe l’a-t-elle fait ? Parce que l’objectif n’était pas de renflouer la Grèce, l’Irlande, le Portugal ou l’Espagne : l’objectif était de sauver la Deutsche Bank, BNP Paribas, Finanz Bank, la société Générale, les banques allemandes et françaises, et cela, avec l’argent des contribuables, en faisant peser le fardeau sur les plus faibles des Européens, en provoquant une crise humanitaire en Grèce et une récession à combustion lente en France.
C’est également le constat d’Alain Badiou dans Un Parcours grec (Lignes, 2016) : « Les régents étatiques de ce système doivent, pour en perpétuer l’existence, ouvrir une nouvelle période particulièrement oppressive et fermée, ils doivent durcir considérablement ce que le capitalisme dominant exige de tous, afin de maintenir, dans des conditions de concurrence acharnée, le taux de profit qu’ils estiment nécessaires à leurs appétits » (p. 20). Il semble donc qu’il faille articuler deux volets : l’un relève du « pouvoir social » et n’est pas réductible à la logique du Capital ; l’autre lui est en revanche intégralement redevable, puisqu’il relève de la « recherche du profit économique » tel que le conçoit et le réalise le Capital. Et dans le cas du nazisme, ces deux volets, ou logiques, se sont d’abord articulés de manière cohérente. Ainsi, Hitler accède au pouvoir le 30 janvier 1933 et dès le 4 février « le président signe un décret pour la protection du peuple allemand permettant de suspendre les droits fondamentaux de la Constitution [2] », ce qui avère d’emblée le projet nazi de « mise au pas » de la forme juridique et politique parlementaire. Mais la suite des événements indique aussitôt la manière dont le dictateur a su rallier, dans un premier temps, les intérêts du Capital à son entreprise totalitaire. Chapoutot et Ingrao expliquent en effet :
Le 23 mars, Hitler obtient les pleins pouvoirs pour quatre ans. Il a mis à profit le fait que les communistes ont été interdits et qu’une grande partie des socialistes sont intimidés. Ils sont les seuls à essayer de s’opposer à cette loi remettant à Hitler les pleins pouvoirs, mais la séance qui en décide a lieu en présence de forces armées de la SS et de la SA, officiellement là pour maintenir l’ordre – mais la dimension d’intimidation est évidente. A partir de la semaine suivante commence la Gleichschaltung (mise au pas). […] Le 1er mai, les nazis se lancent à l’assaut des syndicats. Dans toute l’Allemagne, les locaux sont investis selon un plan concerté, leurs dirigeants sont arrêtés et frappés et leurs biens saisis. Le 10 mai, le Deutsche Arbeitsfront (Front allemand du travail) est créé. Pour les nazis, il doit remplacer le système syndicaliste et jouer le rôle d’interface entre le monde du patronat et les mondes ouvriers, afin de pallier la lutte des classes (Hitler, Puf, 2018, p. 113-115).
A cette lumière, l’erreur d’Horkheimer, ou son égarement, aura donc consisté à introduire une irréversible solution de continuité (une rupture) entre totalitarisme nazi et capitalisme. C’est pourquoi je me permets de nouveau de renvoyer au livre L’Occident, les indigènes et nous, puisque la continuité d’une praxis esclavagiste et xénophobe de 1492 à 1945 en est un fil conducteur et que la question des rapports entre nazisme et capitalisme y est notamment introduite par une citation extraite d’un entretien avec les cinéastes Jean-Marie Straub et Danielle Huillet :
J-M. S. : Je pourrais dire que l’Europe actuelle est celle dont rêvait Goebbels. Cela continue. Il n’y a pas de rupture entre le rêve de Goebbels et le rêve du capitalisme. Il n’y a que Bertolucci pour croire qu’il y a une différence de nature. C’est même à cause de cela qu’on ne se parle plus, parce qu’il ne voulait pas admettre une différence… D. H. : … de degré tout au plus, et encore. (Rencontres avec Jean-Marie Straub et Danielle Huillet, Ecoles régionales des Beaux-Arts, 1995, p. 49).
Une différence essentielle entre l’Europe dont rêvait Goebbels et celle dont rêve la Troïka n’en reste pas moins la notion d’un continent « Judenrein », c’est-à-dire débarrassé de la présence des Juifs. Mais plutôt que d’embrasser la cause du capitalo-parlementarisme en arguant qu’il s’est avéré être victorieux du « Mal », ainsi que se serait fourvoyé Horkheimer, Kouvélakis préfère, pour sa part, retenir une tout autre leçon de l’histoire : « C’est dans les champs de bataille de Stalingrad et dans les maquis de l’Europe occupée que débutera la réponse à cette autoliquidation de l’une des entreprises intellectuelles les plus prometteuses du XXe siècle » (p. 249). Et de fait, c’est en raison de l’engagement des forces progressistes dans la Résistance qu’en France, à la Libération, la refondation constitutionnelle prit une forme résolument « sociale », ou « socialisante », édifice que la Réaction néolibérale, depuis le tournant de la fin des années 1970, s’est employé à détruire avec un rare esprit de système. Et il semble qu’aujourd’hui, dans l’Allemagne réunifiée, la Réaction s’estime suffisamment sûr d’elle et dominatrice pour entreprendre de balayer un autre héritage, apparemment devenu facultatif, celui d’une mémoire érigée en impératif moral. Dans un article paru le 17 février dans le journal La Croix, Ruben Honnigmann explique en effet que le mot d’ordre « plus jamais ça ! » semble être aujourd’hui, en Allemagne, singulièrement revisité :
À la sortie de la gare de Cologne, une exposition photographique est accolée à la célèbre cathédrale de la ville, montrant l’état de la ville dévastée en 1945. L’exposition laisse le visiteur abasourdi par le renversement historiographique qui y est à l’œuvre. À commencer par le titre de l’exposition : « Hurra, wir leben noch ! » (« Hourra, nous sommes vivants ! »). Les habitants de Cologne sont présentés comme des survivants à une agression extérieure, occultant le fait que la guerre a été unilatéralement provoquée par Hitler, soutenu par l’immense majorité des Allemands jusqu’aux dernières heures de la guerre. Le peuple allemand se souvient-il que c’est en son sein qu’a été planifiée et mise en œuvre avec une monstrueuse méticulosité la mort de millions d’innocents ? Peut-il en conscience jubiler (« Hourra » !) de sa propre survie, et se livrer à la bravade – malgré les bombes, nous sommes toujours là ? Tout cela a quelque chose d’indiciblement obscène [3].
De l’exposition de Cologne aux pratiques managériales de France-Telecom, en passant par l’écrasement du « printemps d’Athènes », se pourrait-il qu’une même logique « indiciblement obscène » soit à la manœuvre ?
Le régime pulsionnel du management néolibéral
Par son entreprise de mise au pas des souverainetés populaires et des syndicats, la politique de la Troïka n’est certes pas sans témoigner d’une certaine parenté avec le fascisme. Et la généalogie historique de cette parenté est apparemment l’enjeu d’un récent livre de Johann Chapoutot, déjà évoqué plus haut : Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui. L’argument de l’historien y est le suivant, exposé page 16 :
L’Allemagne était le lieu d’une économie complexe et développée, avec une industrie puissante et abondante, où les ingénieurs-conseils, comme en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs en Europe, réfléchissaient à l’organisation optimale de la force de travail. Le management a une histoire qui commence bien avant le nazisme, mais cette histoire s’est poursuivie et la réflexion s’est enrichie durant les douze ans du IIe Reich, moment managérial, mais aussi matrice de la théorie et de la pratique du management pour l’après-guerre.
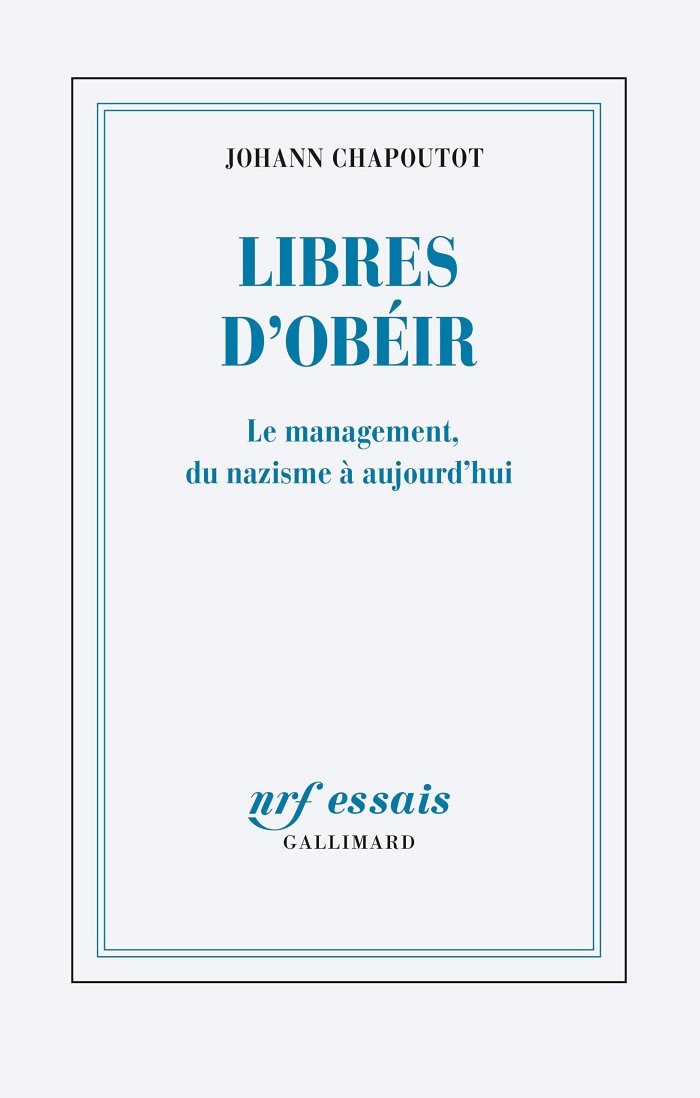
Chapoutot s’intéresse notamment à la trajectoire de Reinhard Höhn, un juriste nazi qui, après-guerre, va développer une théorie du management dite « méthode de Bad Harzburg » :
Après 1945, et plus encore depuis la création de la RFA en 1949, l’heure est justement à la liberté, celle des masses et celle de l’individu. Une Constitution fédérale et démocratique a créé un nouvel Etat qui se veut le poste avancé de la démocratie face au bloc de l’Est. La RFA est à la proue du « monde libre » contre l’éternel ennemi communiste, celui que combattait le Reich. Comme des dizaines de milliers de représentants des anciennes « élites d’Hitler » - universitaires, journalistes, chefs d’entreprise, juristes, médecins, policiers, militaires… - Reinhard Höhn va se mettre consciencieusement au service des nouveaux idéaux du temps – la croissance économique du « miracle » éponyme, et le triomphe de la liberté occidentale. De manière tout à fait opportune, les conceptions du commandement et du management développées par Höhn et ses collègues dès les années 1930 se révélaient étonnamment congruentes à l’esprit des temps nouveaux (p. 105).
Suivant à la trace le parcours de cet ancien dignitaire nazi devenu un théoricien, dans la RFA, des nouvelles méthodes de management, Chapoutot conclut son ouvrage par les observations suivantes :
Gros travailleur, enseignant infatigable, polygraphe frénétique, homme de réseaux et d’activité constante, Reinhard Höhn garda du nazisme cette idée que, dans la lutte pour la vie comme dans la guerre économique, il faut être performant et encourager la performance. C’était un darwiniste social impénitent qui, à ce titre, fut tout à son aise dans le monde du « miracle économique » des années 1950 à 1970 : haute croissance, productivité, compétition étaient des notions que les nazis avaient portées à leur point d’incandescence dans leur insatiable course à la production et à la domination. Être rentable / performant / productif (leinstungsfähig) et s’affirmer (sich durchsetzen) dans un univers concurrentiel (Wettbewerb) pour triompher (siegen) dans le combat pour la vie (Lebenskampf) : ces vocables typiques de la pensée nazie furent les siens après 1945, comme ils sont trop souvent les nôtres aujourd’hui. Les nazis ne les ont pas inventés – ils sont hérités du darwinisme social militaire, économique et eugéniste de l’Occident des années 1850-1930 – mais ils les ont incarnés et illustrés d’une manière qui devrait nous conduire à réfléchir sur ce que nous sommes, pensons et faisons (p. 135).
Resituant l’émergence de la philosophie de Habermas dans le contexte de la RFA, Kouvélakis également ne manque pas de souligner la continuité mise en lumière par Chapoutot. Evoquant des Etats européens dans lesquels, au sortir de la guerre, un « compromis social se met en place sous la poussée des forces issues de la résistance antifasciste, majoritairement communiste en France ou en Italie, ou sous l’égide de puissantes organisations ouvrières social-démocrates (au Royaume-Uni, en Scandinavie ou en Autriche) » (p. 270), il souligne les spécificités allemandes, expliquant notamment :
L’une des plus marquantes réside sans aucun doute dans le rôle joué par le courant « ordolibéral » dans la mise en place de l’ « économie sociale de marché » (Sozialmarktwirtschaft), terme devenu le synonyme consacré du « modèle allemand ». La paternité en revient à Alfred Müller-Armack, un économiste influent au cours de la période nazie, lui-même membre actif du NSDAP, et devenu après la guerre une figure éminente au sein des cercles qui ont façonné la politique économique de la République Fédérale. Longtemps confiné aux marges de la discipline économique, malgré l’intérêt précoce qu’il suscita chez certains libéraux français et dans les cercles hayekiens – eux-mêmes relativement marginalisés pendant les « Trente Glorieuses » - ce courant bénéficie depuis quelques années d’une attention accrue. Fruit de recherches sur la généalogie de la pensée néolibérale, qui ont notamment bénéficié de la publication posthume (2004) des cours de Michel Foucault de 1978-1979 sur la « naissance de la biopolitique ». A n’en point douter, a également pesé dans cette tardive découverte la prise de conscience du rôle joué par les ordolibéraux dans l’élaboration des traités européens, tout particulièrement dans leur principe recteur : la « concurrence libre et non faussée » (La Critique défaite, op. cit., p. 271-272).
Y-aurait-il donc un fil conducteur, ténu mais néanmoins tenace, qui mènerait du totalitarisme nazi à celui de la Troïka ? Le fait qu’en 2015, Strauss-Kahn et Rocard, qui ne sont pas exactement des marxistes révolutionnaires, mais qui étaient à cette époque dégagés de toute responsabilité officielle et sans plan de carrière, ont pris l’un et l’autre position sur le cas d’école grec en appelant l’Europe et les institutions financières à annuler purement et simplement la dette, pourrait être révélateur. En témoignerait le fait que Fillon, notamment, qui à l’époque aspirait déjà aux plus hautes fonctions, a aussitôt recadré Strauss-Kahn en assurant que sa position au sujet de la dette était « irresponsable ». Ce qui peut paraître anecdotique est pourtant très significatif : ces hommes de pouvoir, lorsqu’ils sont un tant soit peu raisonnables, savent pertinemment que la logique du grand Capital mène au désastre, mais tant qu’ils sont astreints à la logique d’un « pouvoir social » lui-même sous condition du Capital, leur conception de la responsabilité consiste à assurer qu’il n’y a pas d’autre alternative. Cependant, une fois sorti de la course, leur langue, parfois, se délie :
En 2000, dans Mes idées pour demain, Michel Rocard citait Robert Reich, l’ancien ministre de l’Emploi de Bill Clinton, qui affirmait qu’ « aux États-Unis, les 1 % les plus riches ont accaparé 70 % des richesses nouvelles créées depuis dix ans. » À l’époque, tout le monde trouvait ce chiffre scandaleux. Mais, le 3 août 2012, l’éditorial du journal Les Échos citait Joseph Stiglitz : « Les 1 % les plus riches ont accaparé 93 % du supplément de richesse créé en 2010 aux États-Unis. Il faut cesser de dire que la démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. En vérité, c’est le gouvernement du peuple par le 1 % le plus riche et pour le 1 % le plus riche. » Les fous ont pris le contrôle de l’asile. Ce n’est pas Karl Marx qui le dit mais Joseph Stiglitz » (Michel Rocard et Pierre Larrouturou, La Gauche n’a plus le droit à l’erreur. Chômage, précarité, crise financière : arrêtez les rustines !, Flammarion, 2013, p. 108).
Et puisque la vie sexuelle des hommes de pouvoir est un sujet d’actualité, disons un mot de l’interview qu’accorda Dominique Strauss-Kahn le 18 septembre 2011 à Claire Chazal, la présentatrice du journal de 20h (TF1), après que les charges contre lui aient été abandonnées dans l’affaire « Diallo », l’employée d’un grand hôtel new-yorkais qui avait accusé le candidat pressenti à l’élection présidentielle de 2012 de l’avoir violée (d’une manière ou d’une autre, laissons les détails de côté). La journaliste télévisée posa donc les questions qui s’imposent en pareille circonstance : que s’est-il passé ? L’a-t-il contrainte ? L’a-t-il payée ? Que lui a-t-il fait ? Que lui a-t-elle fait ? Comment sa femme, Anne Sinclair, a-t-elle pris la chose ? Etc. Cela dura 18 minutes. Puis, durant les 4 dernières minutes, l’interview porta sur des questions politiques, et principalement sur la question de la « dette », et notamment de la « dette grecque ». Et alors Strauss-Kahn exposa en quelques mots sa position sur le problème, position qui n’était donc pas celle d’un candidat à de hautes responsabilités politiques, mais celle d’un observateur, ancien ministre de l’économie et ex-directeur du FMI, à présent définitivement disqualifié du fait d’un séjour en prison mondialement médiatisé. Il expliqua alors au sujet de la Grèce, mais pas seulement puisqu’il précisa d’emblée que « ce serait vrai pour d’autres Etats européens » : « La Grèce s’est appauvrie ; on peut dire les Grecs paieront tout seul, mais ils ne peuvent pas ! Ou on peut dire, parce que nous sommes dans une Union, on va partager cela, et il faut le faire, c’est la convergence budgétaire. Le problème c’est que pour cela il faut accepter de prendre sa perte. Il y a une perte, il faut la prendre ! » Et répondant à une question de la journaliste, il précisa qu’en effet les Etats et les banques européennes doivent se partager la perte sèche de la dette, car il serait contre-productif d’exiger son remboursement et de poursuivre indéfiniment une politique qui consiste à se réfugier dans le déni : « Les gouvernements ne le résolvent pas, ils poussent le problème [de la dette] devant eux, la boule de neige grossit et rend la difficulté de plus en plus grande, et la croissance est de moins en moins là » [4]. Mais le lendemain, les médias dominants ne s’intéressèrent pas tant à la position de Strauss-Kahn au sujet de la « dette » et de la « perte », qu’au crédit qu’il convenait d’accorder à ses explications au sujet de sa relation intime avec madame Diallo.
Analyser, en vue de s’en affranchir, ce qu’elle appelle le « régime pulsionnel » du management néolibéral sera vraisemblablement l’enjeu du livre que Sandra Lucbert s’apprête à publier en septembre 2020, et que nous lirons, d’autant que l’avant-goût qu’elle en a donné le « lundi soir » 17 février au théâtre de l’Echangeur rend le temps long d’ici septembre… En attendant, la lecture du livre de Grégoire Chamayou, La Société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire (La Fabrique, 2018) permettra au futur lecteur de Lucbert de se faire une idée autrement plus consistante de l’histoire théorique et pratique du management que celle qu’en peut donner le petit livre de Chapoutot, aussi pertinent soit-il. Ainsi, dans ce livre essentiel, Chamayou explique notamment :
Dans la fresque historico-critique que je m’efforce de retracer ici, nous avons rencontré trois grandes conceptions du gouvernement privé d’entreprise. La première, celle des managérialistes des années 1950 et 1960, le pensait par analogie avec le pouvoir d’Etat. La seconde, celle des économistes néoclassiques des années 1970, niant tout rapport de pouvoir, réduisait la question de la gouvernance à un « problème d’agence » consistant à aligner la conduite managériale sur la valeur actionnariale. On passait ainsi de la managérialité éthique à la gouvernementalité néolibérale dans son volet financier. Mais un troisième moment apparaît ici. A la gouvernance économique s’ajoute, en tant que complément pratique, un art du management stratégique de l’environnement social. […] Tandis que le managérialisme éthique se proposait de gouverner l’entreprise dans les formes d’un despotisme éclairé, cette nouvelle managérialité stratégique entend gouverner le monde social qui l’entoure en y déployant un art de « la manipulation de l’environnement externe – physique, social et politique – destinée à le rendre plus réceptif aux activités de l’entreprise » (p. 137).

« Managérialité stratégique » et « art de la manipulation », voilà qui pourraient avoir été les maîtres mots de la politique d’Orange, filiale de France-Telecom, afin de dégraisser les effectifs d’une entreprise endettée. Plus loin dans le même ouvrage, Chamayou observe :
La réorientation néolibérale de la gouvernance d’entreprise, son réalignement drastique sur le profit actionnariale ne va pas sans entraîner des impacts sociaux et environnementaux massifs, qui, si Polanyi a raison, tendent historiquement à susciter de puissants contre-mouvements sociaux auxquels le management ne saurait en retour faire face en restant dépourvu de pensée stratégique ad hoc (p. 153).
Mouvement des Gilets jaunes, grève des transports, occupation des locaux de Black Rock sont quelques exemples récents et divers, en France, de « contre-mouvements sociaux » auxquels le management doit donc faire face. Le combat s’annonce rude. Pour le mener à bien, convient-il de tirer des leçons de l’expérience grecque ?
Du printemps d’Athènes aux Gilets jaunes
Dans un livre d’entretien avec Alexis Cukier, La Grèce, Syriza et l’Europe néolibérale (La Dispute, 2015), Kouvélakis évoque « l’assassinat de Pavlos Fyssas par les néonazis en septembre 2013 » et la manière dont « le peuple a marqué de sa présence les événements et leur a donné une tournure qui n’était absolument pas prévue initialement » (p. 20). Les « événements » en question sont ceux de la montée en puissance d’Aube dorée, le parti grec d’extrême-droite qui cherche alors à profiter du déclin des mobilisations sociales pour réinvestir le devant de la scène et entreprendre une mise au pas musclé, voire meurtrière, des forces sociales progressistes. Mais contrairement à ce qui s’est passé en Allemagne durant l’année 1933, Aube dorée doit aussitôt affronter une importante mobilisation populaire. Et Kouvélakis d’expliquer en 2015 :
Cette mobilisation a incontestablement changé le cours des choses, elle a brisé la dynamique ascendante qu’Aube dorée connaissait depuis les élections de 2012, et que rien ne semblait alors pouvoir arrêter. La présence directe du mouvement populaire a marqué de son empreinte chaque étape de l’ascension de la gauche radicale ; et on en voit la confirmation ces derniers jours : la chantage de la Banque centrale européenne a provoqué une riposte immédiate, la série des rassemblements évoquée il y a un instant. […] C’est ce qui donne toute sa spécificité à la séquence grecque (p. 20-21).
En contraignant le gouvernement Tsipras à abdiquer, la Troïka aura donc non seulement témoigné de son mépris pour la souveraineté populaire, y compris lorsqu’elle prend la forme procédurale d’élections libres ou d’un référendum, mais elle aura également repris le flambeau d’Aube dorée, en ce sens qu’elle aura donc réussi là où le parti d’extrême-droite avait échoué. Est-ce à dire qu’il convient de reprendre la rue, puisque c’est dans le cadre des négociations avec l’Eurogroupe que la gauche radicale grecque a été défaite, tandis qu’elle avait vaincu Aube dorée au moyen de mobilisations populaires et, parfois, de véritables corps à corps ? A ce sujet, le livre que l’historien Eric Fournier a consacré aux antidreyfusards des abattoirs de Belleville est précieux : La Cité du sang. Les bouchers de La Villette contre Dreyfus (Libertalia, 2008). Il y montre comment les bouchers de La Villette ont rallié la cause antisémite, et comment ils ont été combattus – au sens littéral – par les anarchistes. C’est à cette tradition anarchiste que se rattachaient les manifestants qui lancèrent l’assaut contre les forces de l’ordre à Vichy, en novembre 2008, lorsque s’y réunirent les ministres de la police de l’Union européenne pour discuter du « problème » de l’immigration… Mais revenons aux bouchers de Belleville. Fournier explique :
Il y a entre l’antisémitisme des tueurs et celui des autres militants une différence de degré, non de nature. Pour les dirigeants de la droite révolutionnaire, l’antisémitisme est une « formule politique de rassemblement » qui permet de reconstituer l’unité nationale, et, dans l’immédiat, de fédérer sous la bannière d’une idéologie polymorphe les opposants multiples à la République, de la secte blanquiste égarée aux salons orléanistes. Afin de réaliser cette délicate alchimie, ils sont contraints de produire un discours, certes simpliste et agressif, truffé de sophismes, haineux, mais aux propos pesés. Avec les bouchers, le masque tombe. Nous pénétrons la véritable nature de l’antisémitisme. Ici, plus de badigeon intellectuel pour masquer ses angoisses, plus de rhétorique pour atténuer le temps d’un discours, ou d’un article, la haine viscérale (p. 88).

Qu’il s’agisse de combattre la montée en puissance des forces d’extrême-droite, ou la Troïka, c’est donc la mobilisation populaire qu’il conviendrait de privilégier, y compris sous la forme d’action d’éclats, telle celle que décrit Fournier page 101 de son livre : « A ce moment-là, plus d’une centaine de compagnons, drapeau rouge en tête, fendent la foule nationaliste en clamant : ‘‘Vive la Commune ! Vive Zola !’’ Les antidreyfusards évitent de se frotter à ce cortège frénétique, qui se fraye un passage à coups de poing et de cannes ». Le problème, c’est que l’analyse de Fournier semble pouvoir s’appliquer à certaines composantes du mouvement qui, en France, s’est évertué à « prendre la rue », à savoir le mouvement des Gilets Jaunes : « l’antisémitisme est une ‘‘formule politique de rassemblement’’ qui permet de reconstituer l’unité nationale, et, dans l’immédiat, de fédérer sous la bannière d’une idéologie polymorphe les opposants multiples à la République ». Certes, ce fut l’argument aussitôt avancé par l’idéologie gouvernementale pour disqualifier la révolte : « antisémite ». Mais sa récupération et son usage dans le champ idéologique ne doit cependant pas occulter les faits, puisque bien des intellectuels que, par ailleurs, on ne saurait soupçonner de prêter allégeance à la Troïka, les ont observés : par un côté le mouvement des Gilets jaunes prend le relai des mobilisations populaires qui, en Grèce, avaient porté au pouvoir Syriza, mais par un autre côté il intègre des composantes d’extrême-droite, comme si les militants d’Aube dorée et de la gauche radicale s’étaient associés lors de mobilisations populaires. L’abondance des slogans antisémites dans les cortèges de Gilets jaunes est en effet une observation de Kouvélakis – abasourdi par ce qu’il a vu et entendu - lors d’un entretien diffusé en janvier 2019 sur le site Hors-série [5]. S’il ne s’agit pas de se rallier à la thèse d’un antisémitisme « anhistorique », néanmoins le phénomène est décidément bien singulier. Toujours est-il que les réflexions de Kouvélakis, quant à l’urgence de renouer avec l’inspiration initiale de la Théorie critique, sont donc d’actualité :
L’idée rectrice est que, loin d’être une aberration de l’histoire ou un corps étranger à la modernité bourgeoise, le fascisme révèle une possibilité inhérente au capitalisme mais qui ne se manifeste que dans des conditions de crise exacerbée de la domination de classe et de rivalité entre puissances impérialistes, sur fond de défaite et d’impuissance du mouvement ouvrier.
Qu’est-ce qu’une autorité révolutionnaire ?
Plutôt que d’aborder maintenant les analyses que Kouvélakis consacre à la contre-révolution d’Habermas et d’Honneth, j’en resterai à Horkheimer et à la question de « l’impuissance du mouvement ouvrier ». Comment transformer l’impuissance en puissance ? Voyons le court développement que consacre l’auteur à la redoutable question de « l’autorité » :
L’autorité désigne un « état de dépendance accepté », la « soumission à une instance étrangère », extérieure au sujet. En tant que telle, elle apparaît comme l’opposé de l’autonomie du sujet proclamée par l’idéal critique des Lumières. Mais cette opposition est aussitôt médiatisée […]. L’hétéronomie peut « représenter aussi bien des rapports progressistes adéquats aux intérêts des individus en cause, favorables à l’épanouissement des forces humaines, que l’idée même de relations sociales artificiellement maintenues, depuis longtemps erronées, qui vont à l’encontre des intérêts véritables de la collectivité ». Elle peut, en d’autres termes, soit se construire comme médiation vers l’autonomie subjective, soit s’enfermer dans le mauvais infini d’une soumission intangible à la domination. Le concept véritablement critique de l’autorité se situe ainsi aux antipodes des conceptions « anti-autoritaires » propres aux mouvements libertaires – Horkheimer est sur ce point très proche des développements d’Engels dans son célèbre texte de polémique avec les anarchistes, « De l’autorité ». Dans une société émancipée, souligne-t-il, les individus, « dans la discipline de leur travail, se soumettront bien en fait à une autorité, mais celle-ci ne concernera que leurs propres projets, qui auront pris valeur de décision et ne seront pas les résultantes d’intérêts de classe divergents ». L’abolition de l’antagonisme de classe permet donc de lever, ou du moins de relativiser, l’extériorité du « commandement » auquel les individus se soumettent, sans pour autant le supprimer. Horkheimer va même plus loin, en soulignant que « dans la discipline et l’obéissance de ceux qui luttent pour l’avènement de cet état de fait [de la société émancipée] se dessine déjà l’idée d’une autre autorité ». Il rejette ainsi l’idée libertaire selon laquelle les formes d’organisation et de lutte dans la société actuelle ne seraient qu’une anticipation, une réalisation à petite échelle, de la société émancipée, elle-même conçue comme abolition de l’autorité en tant que telle. Sur ce point, c’est d’une proximité non seulement avec Engels mais également avec la conception léniniste de l’organisation et de la politique qu’il convient de parler (p. 101-102).
Kouvélakis rend hommage au premier Horkheimer sur ce point crucial : il a su se prémunir de ce que Lénine appelait une « maladie infantile », soit le fait de contester « l’autorité » en tant que telle plutôt que d’en penser une forme possiblement révolutionnaire. Le problème est que la « conception léniniste de l’organisation et de la politique » renvoie à une histoire qui est également celle de la répression sanglante de formes d’auto-organisation populaire, l’écrasement de la révolte des marins de Kronstadt étant l’un de ces événements inauguraux dont la mémoire continue de cliver les forces progressistes, bolcheviques d’un côté, anarchistes de l’autre. On se souvient de l’argument de Trotski au sujet des marins de Kronstadt : « Les soviets dominés par les socialistes-révolutionnaires et les anarchistes ne pouvaient servir que de marchepieds pour passer de la dictature du prolétariat à la restauration capitaliste. Ils n’auraient pu jouer aucun autre rôle, quelles qu’aient été les ‘‘idées’’ de leurs membres. Le soulèvement de Cronstadt avait ainsi un caractère contre-révolutionnaire ». Ces mêmes arguments ont servi ensuite à la collectivisation autoritaire des campagnes, laquelle provoqua de terribles famines. L’historien Nicolas Werth vient d’y consacrer un opuscule : Les Grandes famines soviétiques (Puf, 2020), expliquant d’emblée, au sujet des famines des années 1931-1933 :
A la différence des autres famines, celles de 1931-1933 ne furent précédées d’aucun cataclysme météorologique (sécheresse ou inondations). Ultime épisode d’un affrontement entre l’Etat et les paysans commencé peu après la prise du pouvoir par les bolcheviks, elles furent la conséquence directe d’une politique d’extrême violence : la collectivisation forcée des campagnes, véritable révolution anthropologique mise en œuvre, à partir du début de l’année 1930, par le régime stalinien dans le double but d’extraire de la paysannerie un lourd tribut destiné à réaliser l’ « accumulation socialiste primitive » indispensable à l’industrialisation accélérée du pays, et d’imposer un contrôle politique sur les campagnes, restées jusqu’alors largement en dehors du « système de valeurs » du régime (p. 3).
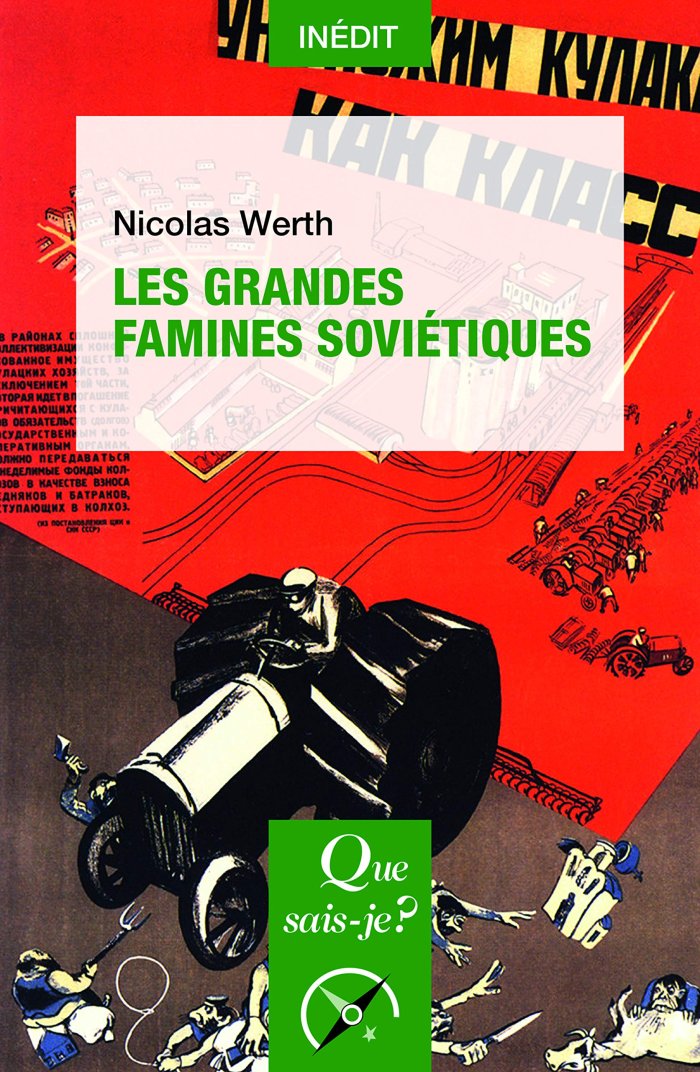
En contrepoint du propos de Kouvélakis, il convient donc de se reporter à l’intervention de Charles Reeve lors du « lundisoir » 3 février 2020, reproduite dans LM (#230). L’auteur de Socialisme sauvage. Essai sur l’auto-organisation et la démocratie directe dans les luttes de 1789 à nos jours (L’Echappée, 2018), y évoqua notamment Bakounine :
Bakounine avait critiqué avec clairvoyance — et dans un langage qui était celui de son époque —, l’ « idée théologique, métaphysique et politique, que les masses, toujours incapables de se gouverner, devront subir en tout temps le joug bienfaisant d’une sagesse et d’une justice qui, d’une manière ou d’une autre, leur seront imposées d’en haut. » Idée qu’il nomma « le principe d’autorité ».
Faut-il récuser le « principe d’autorité » en tant que tel, ainsi que le préconise Bakounine, ou bien faut-il, dans le sillage d’Engels, distinguer entre une « autorité » qui s’exerce au bénéfice de la classe dominante et conservatrice, et une autre forme d’« autorité » qui, elle, s’exercerait au bénéfice de la classe dominée et révolutionnaire ? Mais il est également une autre manière d’aborder ce problème, du biais cette fois du normativisme juridico-pratique d’Habermas, car une fois posé que « la conception léniniste de l’organisation et de la politique » a abouti, bon gré mal gré, au stalinisme, l’effort théorique d’Habermas n’est peut-être pas aussi vain que le laisse entendre Kouvélakis. En effet, le doit formel bourgeois, s’il est issu d’une logique étatique sur un versant, contractuelle et marchande sur un autre, n’en permet pas moins de combattre le totalitarisme, celui de l’Etat comme celui du Capital. Ainsi Hitler, pour ce qui est de l’Etat, s’emploie dès son accession au pouvoir à mettre au pas le droit constitutionnel bourgeois, appuyé en cela par Carl Schmitt, qui s’efforce de son côté de présenter cette mise au pas comme une rédemption de l’Etat et du droit. Et pour ce qui est du totalitarisme du Capital, le jugement rendu par la justice française, à l’issu du procès de la direction managériale de France-Telecom, doit nous arrêter. En effet, comme l’ont expliqué Sandra Lucbert et maître Tessonière le « lundi soir » 17 février, ce jugement pourrait « faire date », puisque l’autorité judiciaire a entériné l’argumentation des plaignants, à savoir que la politique managériale de France-Telecom a été un « harcèlement moral » dont l’ensemble des salariés ont été les victimes, et qu’un tel « harcèlement moral » est puni par la loi française. Sans doute, les peines encourus par les tortionnaires sont-elles dérisoires, mais comme l’a rappelé Lucbert en conclusion de son article, l’essentiel est peut-être ailleurs :
Maitre Teissonière -, dans une plaidoirie éblouissante d’intelligence analytique -, a rétabli le plan institutionnel de la lutte en cours. Conscient de ne pas avoir les moyens d’incarner le pôle répressif du droit (une structure jugée depuis elle-même), il en appelle au jugement de la Cour pour assurer la fonction expressive du Droit, la formulation des interdits structurants d’une société. De la cour, (tout) « ce qu’on peut attendre, c’est (…) un acte structurant. » La cour pourra indiquer une direction axiologique, inverse au sens unique auquel l’ensemble des structures (toujours en cours de raffermissement), nous assignent. Ce qu’on peut attendre de nous, c’est de la suivre, remonter les niveaux structurels jusqu’aux premiers - d’où vient le mal, très localisable.
Et l’autorité judiciaire a donc donné raison à l’avocat des salariés. Revenons maintenant au propos de Kouvélakis : « [l’autorité] peut, en d’autres termes, soit se construire comme médiation vers l’autonomie subjective, soit s’enfermer dans le mauvais infini d’une soumission intangible à la domination ». Du procès de France-Telecom, il conviendrait dès lors de tirer la leçon suivante : au « régime pulsionnel » dont un fil ténu, mais tenace, relie le totalitarisme nazi aux pratiques managériales du grand Capital, il serait possible d’opposer une praxis émancipatrice dont un fil ténu, mais possiblement tenace, relierait la praxis des Gilets jaunes à la condamnation, par l’autorité judiciaire, des dirigeants de France-Telecom. En effet ce jugement, à sa manière, s’efforce de « renverser toutes les conditions sociales où l’homme est un être abaissé, asservi, abandonné, méprisable ». Et à cette lumière, il convient peut-être de relativiser le sévère jugement de Kouvélakis au sujet d’Habermas. Après tout, l’ordre des choses est une imbrication du pur et de l’impur dont il n’est jamais simple de démêler tous les fils : du côté des Gilets jaunes, une réelle inventivité populaire polluée par de pénibles relents antisémites ; du côté de l’autorité judiciaire, des jugements révolutionnaires parfois, celui du procès de France-Telecom, mais également celui de « l’affaire Tarnac », cependant jaillis comme par miracle d’une institution qui, pour l’essentiel, exerce une justice de classe, du fait, précisément, de « son ancrage dans l’objectivité des rapports antagonistes de classe » ; ce à quoi s’ajoute le quotidien des pratiques xénophobes à l’encontre de la main-d’œuvre immigrée (voir notamment « Le procès Tarnac : le verdict. Farce soit par ailleurs rendu à la justice », LM #142).
Qu’est-ce qu’une autorité poétique ?
S’il s’agit donc de concevoir une « autorité » révolutionnaire, le poème pourrait être un meilleur prétendant que l’institution judiciaire. C’est du moins une conviction qui semble animer le livre de Kristin Ross, Rimbaud, la Commune de Paris et l’invention de l’histoire spatiale (Amsterdam, 2020, trad. C. Vivier). En tout cas, son approche de la question de l’engagement de Rimbaud dans la Commune est résolument située sur le terrain de la poétique :
Pour étudier le lien de Rimbaud avec les événements de la Commune, les historiens de la littérature et les biographes se sont généralement contentés de déterminer les lieux précis où le poète se trouvait entre mars et mai 1871. A-t-il activement participé à l’insurrection ? Quels informateurs doit-on croire ? […] L’absence, définitivement avérée, de Rimbaud sur les lieux du crime annule-t-elle pour autant les répercussions politiques et sociales de son œuvre ? (P. 73).
Puis, observant que la fulgurance, l’illumination suivie d’une nuit profonde, ont décrit tant l’œuvre de Rimbaud que celle de la Commune, Ross aborde la question de « l’autorité » :
La Commune, écrit Marx, devait être un corps en action, non un corps parlementaire. Son abolition de l’investiture hiérarchique entraîna le déplacement (la révocabilité) de l’autorité, le long d’une chaîne ou d’une série de « places », dépourvue de tout terme souverain. Chaque représentant, exposé à la révocation immédiate, devient interchangeable avec, et ainsi égal à, ceux qu’il représente. Cette autorité révocable et distribue a pour conséquence directe le dépérissement de la fonction politique en tant que fonction spécialisée. Ce n’est pas en 1875, lorsqu’il choisit le « silence », mais dès 1871 avec les Lettres du Voyant, que Rimbaud commence à dépasser l’idée d’un domaine spécialisé du langage poétique ou même de la poésie – la fétichisation de l’écriture comme pratique privilégiée. Dans ces lettres, l’écriture politique est considérée, entre autres, comme un moyen d’expression, d’action, et surtout de travail : « je serai un travailleur : c’est l’idée qui me retient, quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris – où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris ! » Le voyant, alors, on l’a souvent remarqué, « se fait voyant » : « je travaille à me rendre voyant ». L’accent porte ici sur le travail de transformation de soi par opposition au lieu commun romantique de la prédestination poétique. Dans les lettres, le projet du voyant n’apparaît pas simplement comme une volonté de combattre des pratiques poétiques spécifiques, contemporaines ou passées, mais comme une volonté de vaincre et de supplanter entièrement la « poésie ». Comme l’ « abolition de l’Etat », le processus exposé par Rimbaud est un processus révolutionnaire long, difficile et graduel. Ce travail n’est pas solitaire, mais social et collectif : « viendront d’autres horribles travailleurs ; ils commenceront par les horizons où l’autre s’est affaissé ! » (p. 98-99).
Travaillant à sa manière à « se rendre voyant », le collectif « Plein le dos » vient de publier un bel ouvrage intitulé : 365 gilets jaunes (Bout Ville, 2020). C’est une série de photographies de gilets jaunes, vus de dos, comme si, à destination du pouvoir, il s’agissait d’exhiber, plutôt qu’un visage, une nuque raide, c’est-à-dire rétive au commandement. Mais surtout, la photographie donne ainsi à lire ce qui est écrit au dos d’un gilet jaune. C’est donc, au sens propre, un livre de photographies. Et j’ai pu m’en rendre compte par moi-même, on n’y trouve pas la moindre pollution antisémite, mais exclusivement ce que j’appellerai, en souvenir des « laboureurs » médiévaux, une « conquête de culture ». Dans cet ensemble de 365 gilets jaunes, certaines photographies, bien sûr, sont plus expressives que d’autres. Ma préférée ? En termes d’autorité poétique, c’est incontestablement celle-ci : « Mon gilet jaune est noir ».
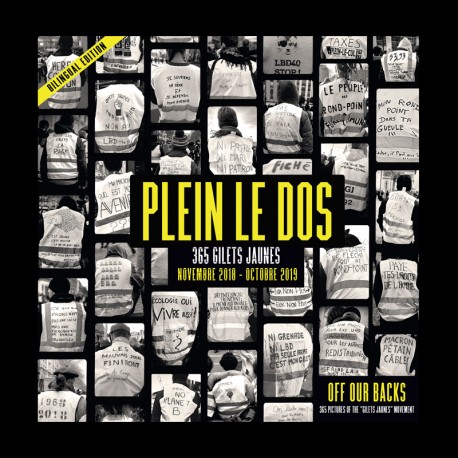
Une sociologue à la ZAD
Sylvaine Bulle rend compte dans un livre, Irréductibles. Enquête sur des milieux de vie de Bure à N. -D.- des – Landes (UGA Editions, 2020), des résultats d’un travail de terrain : sociologue, elle a enquêté sur la ZAD et, plus largement, sur une mouvance parfois appelée « anarcho-autonome ». Ce type d’étude peut donner le meilleur comme le pire. Cela dépend de l’observateur. Et en l’occurrence, le remarquable intérêt de ce livre, c’est que son auteur sait voir. Une première partie, théorique, expose les références doctrinales ; une deuxième et troisième partie s’efforcent d’analyser la forme politique – la forme « occupation » - inventée par ces « milieux de vie » ; une quatrième partie interroge l’avenir : « Au fond de la ZAD : la commune ou l’Etat ? ». Mêlant observations, documents, analyses, Bulle associe à la rigueur scientifique un esprit de finesse d’une intelligence par endroit lumineuse :
L’équilibre entre liberté et solidarité est immanent aux pratiques sur chaque lieu autonome. Par conséquent et dès lors que l’autonomie auto-institue ses règles à l’échelle singulière des bases de vie, il n’est pas d’obligation de légitimer des principes à l’échelle du territoire. Les chantiers, les non-marchés et les moments festifs ou défensifs sont, entre autres, les instances de médiation et d’ajustement des relations humaines, rappelant la définition simmelienne de la confiance villageoise. C’est donc dans le quotidien et au sein d’actions routinisées que les grammaires de l’égalité et de la solidarité se distribuent. Dans cette perspective, les milieux de vie comme NDDL et Bure accomplissent véritablement une séparation non pas entre démocratie représentative et démocratie directe, mais entre démocratie et praxis (p. 219).
La ZAD, serait-ce donc la continuité victorieuse de l’école de Francfort ?
Ivan Segré








