« quel heureux destin n’en peut être effacée
on te nomme et ce nom aux débris ingénieux
d’une faune ancienne
sans figure et sans bruit les rassemble à la vie »
Jérôme Abraham Benarroch, Les trois crânes [1]
Réflexions sur le banditisme
Le recteur de la mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, a finalement renoncé à poursuivre en justice Michel Houellebecq, apparemment suite à une rencontre avec l’écrivain organisée par le grand Rabbin de France Haïm Korsia. Il convient de s’en féliciter, car les bouffonneries de Houellebecq, pas plus que celles de Dieudonné ou de Charlie Hebdo, n’appellent de procès. On ne transige pas avec la liberté d’expression. Certaines bouffonneries sont drôles, d’autres moins ; certaines appellent l’indifférence, d’autres l’analyse.
Au cours d’un long entretien avec Michel Onfray, Houellebecq a d’abord évoqué l’immigration asiatique, très peu assimilée, mais commerçante et laborieuse ; puis il en est venu à l’immigration maghrébine : « Je crois que le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n’est pas que les musulmans s’assimilent, mais qu’ils cessent de les voler et de les agresser, en somme que leur violence diminue, qu’ils respectent la loi et les gens. Ou bien, autre solution, qu’ils s’en aillent ». Houellebecq ne serait ni raciste, ni xénophobe, puisqu’il valorise l’immigration asiatique. Le problème, à le suivre, réside dans la particularité de l’immigration musulmane, principalement en provenance d’Afrique du Nord dans le cas français : les « musulmans » auraient pour habitus de « voler » et d’ « agresser », autrement dit de ne respecter ni la « loi », ni les « gens ».
Pourtant, à condition de prendre un minimum de recul, il s’avère impossible de rapporter le banditisme à un habitus arabo-musulman, quelle que soit la proportion de Maghrébins dans les prisons françaises, puisqu’un banditisme similaire est observable sur le continent américain, par exemple, avec un degré de violence toutefois supérieur, sans que ne soit là-bas en cause une immigration arabo-musulmane. Le banditisme, vol et agression, est donc un fait social et non civilisationnel ou religieux. Il n’empêche, Houellebecq est manifestement convaincu que les « musulmans » sont voués à vivre en bandes nomades, lesquelles bandes nomades, depuis la révolution néolithique, forment des tribus gravitant dans les marges des populations agricoles sédentarisées et menant des razzias ponctuelles, de manière à récolter sans avoir à labourer ni semer. Dans son roman Plateforme (2001), il fait dire à un guide touristique égyptien, admirateur des pyramides : « l’islam est né en plein désert, au milieu de scorpions, de chameaux et d’animaux féroces de toutes espèces. Savez-vous comment j’appelle les musulmans ? Les minables du Sahara. Voilà le seul nom qu’ils méritent ». Aux yeux de Houellebecq, l’habitus arabo-musulman remonterait donc non seulement aux incursions des Sarrasins jusqu’à Poitiers, au VIIIe siècle, mais bien au-delà : il s’enracinerait dans le mode de vie des bédouins du Sahara. Les « musulmans » seraient donc des « barbares », au sens que donne à ce mot l’anthropologue James C. Scott, notamment dans Homo domesticus : « La notion de ‘‘barbare’’ et toutes celles qui lui sont apparentées – ‘‘sauvages’’, peuples ‘‘crus’’, ‘‘peuples de la forêt’’, ‘‘habitants des montagnes’’ – ont été inventées dans les centres étatiques afin de décrire et stigmatiser les populations qui n’étaient pas encore des sujets de l’Etat » (éd. La Découverte, p. 251). C’est donc bien une sorte d’atavisme bédouin que Houellebecq identifie dans le comportement supposé des « musulmans » vivant au XXIe siècle en France. Pourtant, la tribu bédouine qui jadis arpentait les sables du Sahara, aujourd’hui, elle dépense 200 milliards de dollars pour organiser la coupe du monde de football au Qatar plutôt qu’elle ne braque l’épicière chinoise d’un quartier du XIIIe arrondissement de Paris. Dans quel monde vit donc le romancier ? Quiconque n’est pas totalement abruti par la propagande islamophobe est pourtant censé le savoir : la petite délinquance, comme le grand banditisme, prolifèrent dans les couches paupérisées de la population, et les logiques marchandes des bandits reproduisent celles de la société dont ils sont un fruit, certes pourri, mais pas davantage que d’autres fruits qui, eux, sont pourtant légaux, et même normatifs, ce qui aggrave considérablement l’affaire.
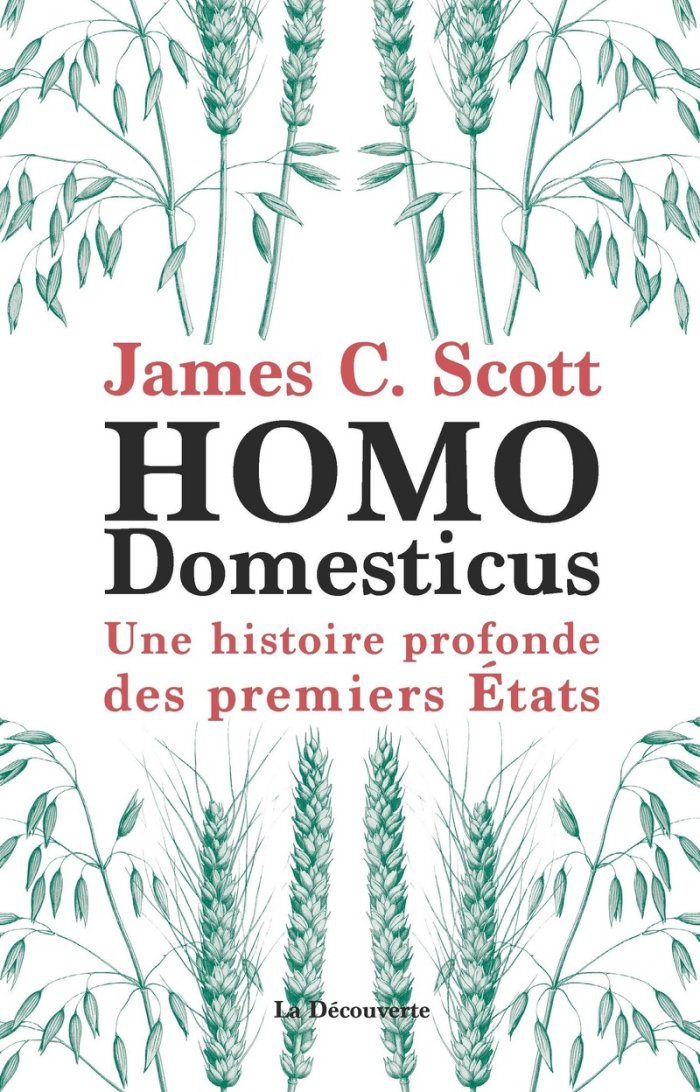
En témoigne, outre les faits de corruption touchant les institutions européennes (voire le « Qatargate »), l’ouvrage du journaliste d’investigation Victor Castanet : Les Fossoyeurs (Fayard, 2022 / J’ai lu, 2023). Son enquête a révélé la manière dont le groupe Orpéa s’est développé et enrichi, jusqu’à devenir un leader international des EHPAD. La recette miraculeuse était fort simple : appliquer à la gestion des maisons de retraite les techniques du management néolibéral. Lors d’un entretien sur BFMTV, en 2014, le journaliste Marc Fiorentino, recevant le président du groupe Orpéa, Jean-Claude Marian, était admiratif, sinon béat : « Orpéa, c’est juste un parcours spectaculaire, phénoménal. Une multiplication par six du nombre de lits en douze ans. Votre cours de Bourse multiplié par neuf depuis 2002. 23% de hausse sur le cours depuis le début de l’année. Quand vous regardez ça avec un peu de recul, vous êtes fier de vous ? » (cité par Castanet, p. 124). Le président du groupe Orpéa a le succès modeste ; il répond : « Non, de la fierté, certainement pas. […] De la satisfaction, oui ! Mais parce qu’on a la chance d’être dans un métier où on rend service » (ibid.). S’enrichir en institutionnalisant la maltraitance des personnes âgées, c’est donc une manière de « rendre service ». Le livre de Castanet a fait scandale, car malmener les résidents des EHPAD, c’est encore considéré comme inacceptable. Mais peu nombreux sont les commentateurs qui ont fait remarquer que le traitement des personnes âgées était en l’occurrence un dommage collatéral d’une maltraitance généralisée à l’ensemble du monde du travail, depuis les entreprises de téléphonie jusqu’à l’hôpital. Ainsi, un directeur d’EHPAD explique à Castanet qu’avec les nouvelles techniques de management, sa fonction sociale ne consiste plus à prendre soin des personnes âgées, mais à gérer des chiffres :
Il nous explique, à Laurent et à moi, que chez Orpéa il n’a tout simplement pas le temps de s’occuper de ses résidents, qu’il doit gérer des chiffres toute la journée, remplir des tableaux, faire des reporting (c’est-à-dire transmettre des indicateurs de performance à sa hiérarchie), s’occuper du remplissage de l’établissement, chercher des économies partout. « Tous les matins, avant 10 heures, j’ai un tableau de bord que je dois remplir, débute-t-il. Avec mon taux d’occupation, le nombre d’hospitalisés… C’est hyper-important, car ça va alimenter tous les services du groupe : le service « achat », l’alimentation, la pharmacie. Et le personnel. C’est de la gestion à flux tendu, hyper-poussé. C’est très malin. Si on veut faire des économies de masse, c’est ce qu’il faut faire. […] Dans ce groupe, j’ai le sentiment d’avoir un peu trahi mes valeurs. Je joue le jeu du commerce, du côté mercantile. On fait en sorte de vous exciter, de vous rappeler en permanence que ce TO [taux d’occupation], c’est lui qui va vous permettre de bien dormir ou de mal dormir. Vraiment ! L’obsession, ce n’est plus le résident, c’est le chiffre ! » (J’ai lu, p. 142-143).

De même, l’obsession de l’enseignant n’est plus la transmission des connaissances, c’est la gestion des chiffres ; l’obsession du médecin de l’hôpital n’est plus le soin prodigué au patient, c’est la gestion des chiffres ; etc. Les nouvelles techniques de management conquièrent un à un tous les domaines d’activité. « Si on veut faire des économies de masse, c’est ce qu’il faut faire » : l’organisation généralisée de la maltraitance des êtres humains, de sorte que les rentiers du Capital engrangent un maximum de profits, avec la bénédiction des administrations dont la fonction est a priori de contrôler l’usage des fonds publics.
Car ce que met également en évidence l’enquête de Castanet, c’est la manière dont ces sociétés anonymes à but lucratif (en l’occurrence le leader du secteur, Orpéa) non seulement s’enrichissent en malmenant les plus faibles, mais détournent les fonds publics alloués aux EHPAD, et ceci avec une marge de manœuvre d’autant plus grande que non seulement les mécanismes de contrôle sont ou bien déficients, ou bien corrompus, mais que, en outre, la philosophie qui prévaut en la matière est libérale, sinon généreuse. Castanet, qui est loin d’être un radical, le formule ainsi : « C’est incroyablement protecteur et arrangeant pour les groupes privés » (ibid., p. 247). En revanche, pour ce qui est des chômeurs qui touchent une maigre allocation de survie, les mécanismes de contrôle en usage sont de plus en plus expéditifs, comme le suggèrent cet article du Monde paru le 26 janvier 2023 : « Le nombre de radiations de chômeurs par Pôle emploi a atteint un record fin 2022 ». Et à ce sujet, l’administration est manifestement plutôt encline à frapper d’abord, discuter après : « Une radiation administrative est une suspension temporaire de l’inscription, et donc de l’indemnisation, à laquelle procède Pôle emploi lorsqu’une personne inscrite ne répond pas à une convocation, qu’elle ne recherche pas activement un emploi, qu’elle refuse à deux reprises une offre d’emploi ou qu’elle abandonne une formation sans raison [2] ». Autrement dit, dans le cas des chômeurs, le préjugé de l’administration, c’est qu’il s’agit de fainéants qui vivent aux dépens de l’argent public. C’est pourquoi il importe de les contrôler et de les réprimer. Dans le cas des groupes privés côtés en bourse qui ont investi dans « l’or gris », en revanche, le préjugé, à suivre les conclusions de Castanet, est très différent :
« L’idée, c’est de faire confiance, de se dire que les autorités ont alloué une somme déterminée pour tel ou tel établissement en fonction de sa capacité d’accueil et de ses particularités, et qu’il peut la dépenser comme il l’entend, qu’il sait mieux que personne ce dont ses pensionnaires ont besoin. C’est une idée séduisante sur le papier : les autorités de tutelle réduisent considérablement leur charge de travail et les groupes privés ont plus de marge de manœuvre. Mais, malheureusement, cela ne peut fonctionner que si les groupes en question ont des comportements vertueux » (op. cit., p. 239-240).
Autrement dit, la vision qui gouverne aujourd’hui la France est la suivante : les groupes privés côtés en bourse sont réputés vertueux, les chômeurs sont réputés vicieux. Comment, dès lors, reprocher à Orpéa d’avoir érigé en stratégie commerciale la maltraitance des gens faibles et le détournement des fonds publics, si c’est la philosophie implicite des dirigeants politiques ? C’est pourquoi je crois pour ma part que le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n’est pas que les managers du Capital s’assimilent, mais qu’ils cessent de les voler et de les agresser, en somme que leur violence diminue, qu’ils respectent la loi et les gens. Ou bien, autre solution, qu’ils s’en aillent.
Beaufs et barbares, Normands et Sarrasins
Dans Beaufs et barbares (La Fabrique, 2023), Houria Bouteldja fait « le pari du nous ». De prime abord, le titre de son livre avait de quoi inquiéter car, après Les Blancs, les Juifs et nous, intituler le second volet « Beaufs et barbares. Le pari du nous », c’était laisser entendre que « les Blancs » pouvaient intégrer le « nous », mais pas « les Juifs », auquel cas l’alliance des « beaufs » et des « barbares » aurait eu pour corollaire le refoulement des Juifs. Fort heureusement, il n’en est rien. Car c’est contre la classe dominante, ou « l’Etat racial intégral » selon sa terminologie, que Bouteldja souhaite réunir les « beaufs » et les « barbares », et non contre les Juifs. Et pour ce faire, elle propose de sortir de l’Union européenne. Est-ce à dire qu’elle entend s’allier avec Frédéric Lordon ? Le problème est qu’à s’en aller glaner chez les « beaufs », elle risque de réunir des lecteurs de Houellebecq plutôt que de Lordon.

Invité à « L’émission politique » quelques jours avant le second tour de l’élection présidentielle de 2017, le plus célèbre des écrivains français contemporains témoigne : « La deuxième France dont vous parlez, la France périphérique, qui hésite entre Marine Le Pen et rien, je me suis rendu compte que je ne la comprenais pas, que je ne la voyais pas, que j’avais perdu le contact, et ça quand on veut écrire des romans, je trouve que c’est une faute professionnelle assez lourde ». Ainsi Houellebecq craint d’avoir perdu le contact avec la « France périphérique », de même que le narrateur de Soumission (2015) a perdu le contact avec la « Vierge ». L’enjeu de Sérotonine, sorti en janvier 2019, était dès lors de reprendre contact. Dans le même temps, la « France périphérique », avec le mouvement des « Gilets jaunes », avait repris de la voix. Le roman de Houellebecq avait-il, encore une fois, un temps d’avance sur l’actualité ? C’est ce que bien des médias ont cru pouvoir observer. On a pu lire par exemple sur le site de France 24 : « C’est un ouvrage sombre et poignant que nous livre Michel Houellebecq pour cette rentrée. Dans ’Sérotonine’ (Flammarion), l’enfant terrible des lettres françaises plonge ses lecteurs au cœur de la France rurale. Écrit avant l’apparition des Gilets jaunes, le roman semble avoir anticipé ce mouvement qu’aucun responsable politique n’avait vu venir. [3] »
Le narrateur de Sérotonine, employé au ministère de l’agriculture, est témoin de la détresse du monde paysan. Et par un concours de circonstances, il va en devenir le témoin. Victimes de la politique libre-échangiste menée par l’Union européenne, des éleveurs normands s’insurgent. Aymeric d’Hartant est leur meneur. C’est un ancien camarade d’étude, issu d’une très vieille famille de la noblesse normande ; il s’est lancé avec son épouse dans la production laitière, mais malgré un travail accablant et des investissements croissants (il doit sans cesse vendre des terres héritées de ses ancêtres pour combler ses déficits et maintenir son activité), son exploitation bovine le ruine et son mariage périclite. Avec d’autres éleveurs normands, ils décident d’une action violente pour manifester leur désespoir : ils bloquent une autoroute et s’opposent, armes à la main, aux forces de l’ordre qui leur font face. Aymeric est à leur tête, muni du seul fusil qui puisse menacer la vie d’un CRS. Mais tandis qu’il s’avance vers les CRS en formation, il retourne l’arme contre lui et se suicide. Ses camarades, croyant qu’il est victime d’un tir policier, lancent l’assaut contre les forces de l’ordre. S’ensuit une fusillade : dix paysans sont tués et un policier. Le caractère christique du sacrifice d’Aymeric est plus qu’allusif, il est finalement explicite, le roman se concluant sur une brève exégèse de la vie de Jésus : « Et je comprends, aujourd’hui, le point de vue du Christ, son agacement répété devant l’endurcissement des cœurs : ils ont tous les signes, et ils n’en tiennent pas compte. Est-ce qu’il faut vraiment, en supplément, que je donne ma vie pour ces minables ? Est-ce qu’il faut vraiment être, à ce point, explicite ? Il semblerait que oui. »
Jésus, dans les évangiles, est issue d’une famille humble. Et dans le cas du printemps arabe, c’est l’immolation par le feu d’un marchand ambulant tunisien qui déclencha l’insurrection. Dans le roman de Houellebecq, c’est Aymeric d’Harcourt, un rejeton de l’aristocratie féodale, qui incarne la France dite « périphérique », restée à l’écart de la mondialisation marchande. C’est lui l’icône du monde paysan, rural, catholique. Il est comme un Christ d’Ancien Régime guidant le peuple des barricades :
« C’est pendant ces quelques secondes que furent prises la majorité des photographies reproduites, ensuite, dans tous les journaux du monde – et en particulier celle d’Aymeric, qui devait faire tant de couvertures, du Corriere della Sera au New York Times. Déjà il était souverainement beau, les bouffissures de son visage semblaient mystérieusement annulées, et surtout il paraissait paisible, amusé presque, sa longue chevelure blonde flottant dans un souffle de vent qui s’était, à cette seconde levé ; un joint pendant toujours au coin de sa bouche, et il tenait à demi dressé, contre sa hanche, son fusil d’assaut Schmeisser ; l’arrière-plan était d’une violence abstraite et absolue, une colonne de flammes se tordait sur un fond de fumée noire ; mais à cette seconde Aymeric paraissait heureux, enfin presque heureux, il paraissait à sa place tout du moins, son regard et sa pose décontractée surtout reflétaient une incroyable insolence, il était l’une des images éternelles de la révolte et c’est cela qui fit reprendre cette image par tant de quotidiens d’information dans le monde. »
Chevelure blonde au vent, joint à la bouche, fusil d’assaut « à demi dressé », « pose décontractée » tandis qu’autour de lui brûlent les flammes de l’enfer, « il était l’une des images éternelles de la révolte ». Mais de quelle « révolte » Aymeric d’Harcourt est-il l’image ? Au cliché iconographique succède aussitôt, sous la plume de l’écrivain, un autre cliché, cette fois idéologique :
« Aussi, et ça j’étais certainement l’un des seuls à le comprendre, il était l’Aymeric que j’avais toujours connu, un type gentil, gentil à la base et même bon, il avait simplement voulu être heureux, il s’était engagé dans son rêve agreste basé sur une production raisonnable et de qualité, sur Cécile aussi, mais Cécile s’était avérée être une grosse salope passionnée par la vie à Londres avec un pianiste mondain, et l’union européenne elle aussi avait été une grosse salope, avec cette histoire de quotas laitiers, il ne s’attendait certainement pas à ce que les choses se terminent ainsi. »
La « salope » est partie avec un autre ; elle a plaqué le noble normand pour un artiste anglais. L’Europe libérale trompe pareillement le paysan français, au prétexte d’une intrigue amoureuse avec « la vie de Londres ». Des éleveurs normands, menés par un héros aristocrate et rock and roll, ont tenté de relever la tête. Dix paysans et un policier sont tombés sous les balles. Le sacrifice est-il salutaire ? Le drame, abondamment relayé par les médias internationaux, provoque une secousse politique nationale : « il y avait chez les responsables politiques une gêne, un embarras très inhabituels chez eux, aucun ne manquait de souligner qu’il fallait, jusqu’à un certain point, comprendre la détresse des agriculteurs, et en particulier des éleveurs, le scandale de la suppression des quotas laitiers revenait comme un impensé obsédant, coupable, dont personne ne parvenait tout à fait à s’affranchir, seul le Rassemblement National semblait tout à fait clair sur ce sujet ». Aymeric, « un type gentil », sorte de kamikaze altruiste, innocent, s’est donné la mort pour qu’on rétablisse des mesures protectionnistes, notamment des quotas laitiers. Et ce faisant, il s’est montré fidèle à ceux de sa race : « il était mort les armes à la main pour protéger la paysannerie française, ce qui avait été de tout temps la mission de la noblesse ». Le combat d’Aymeric, serait-ce aujourd’hui celui du Rassemblement National, autrefois baptisé Front National ? Entre le salut et rien, que choisira, demain, la France périphérique, interclassiste et volontiers xénophobe ? L’argument de Sérotonine, aussi peu satirique que possible, signe le virage idéologique assumé par l’écrivain. Et il illustre parfaitement les analyses de Karl Polanyi dans La grande transformation (1944) :
« Mais si l’essor des industriels, des entrepreneurs et des capitalistes résultait de leur rôle directeur dans le mouvement expansionniste, la défense revenait aux classes terriennes traditionnelles et à la classe ouvrière en train de naître. Et si, dans la communauté commerçante, le lot des capitalistes était de défendre les principes structurels du système de marché, le rôle du défenseur à outrance du tissu social revenait à l’aristocratie féodale, d’une part, au prolétariat industriel naissant, de l’autre. Mais, alors que les classes terriennes allaient naturellement chercher la solution de tous les maux dans la conservation du passé, les ouvriers étaient jusqu’à un certain point en position de transcender les limites d’une société de marché et d’emprunter des solutions à l’avenir » (trad. C. Malamoud, Gallimard, 1983 p. 209).
Comment mieux dire que Sérotonine n’est pas seulement un marqueur idéologique mais bien, d’abord, un désastre littéraire ? Quoi qu’il en soit, à l’iconographie de Sérotonine, il convient d’opposer la parole mohawk. Aux éditions de l’Eclat vient en effet de paraître La Mohawk Warrior Society, sous-titré : Manuel pour la souveraineté et la résistance. C’est un recueil de textes qui témoignent de la lutte du peuple mohawk en Amérique du Nord. Quant à la philosophie de cette « société de guerriers », la résume admirablement ce propos de l’Indien Tekarontakeh Paul Delaronde, sorte d’antithèse affirmative au romantisme néofasciste de l’écrivain français :
« Quand les gens disent : ‘‘Je suis prêt à mourir !’’, ma réaction est de leur répondre que, dans ce cas, nous n’avons pas besoin d’eux. Les hommes morts n’accomplissent rien de bon. Nous avons besoin de gens qui veulent vivre, car ce sont eux qui sont prêts à assumer leurs responsabilités. Ce sont eux qui sont prêts à contribuer à la survie de leur peuple. N’importe quel idiot peut mourir ; mais vivre est une grande responsabilité » (op. cit., p. 60).
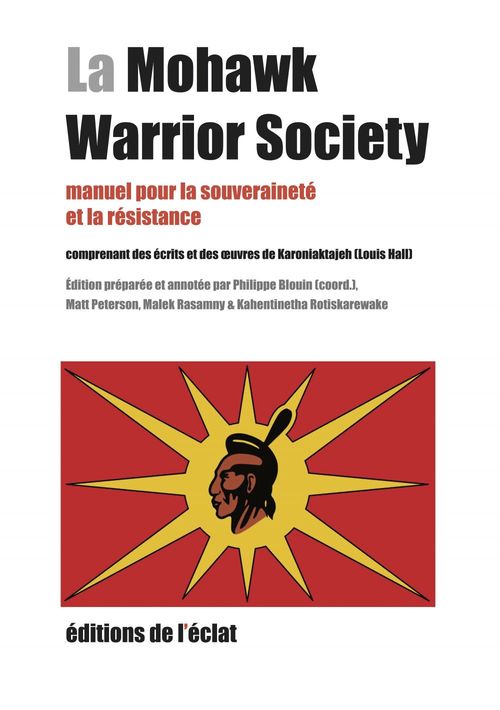
Par ailleurs, il est piquant que Houellebecq ait choisi pour héros de son roman un rejeton de la noblesse normande, sachant que l’historien Jean Yanovski, en 1847, analysant le rôle des invasions dans la décomposition du pouvoir central et l’effondrement des routes commerciales au IXe siècle, écrit :
« Les ravages des envahisseurs ne se bornaient point aux provinces extrêmes ; les Normands, en remontant les fleuves, pénétraient dans l’intérieur des terres. Ils pillaient les bords de la Meuse, de la Somme, de l’Aisne, de la Seine, de l’Oise, de la Marne et de la Loire. Ils avaient pénétré jusqu’en Champagne ; on les avait vus à Toulouse, et ils avaient poussé leurs incursions jusque dans le Limousin et dans l’Auvergne. D’autre part, les Sarrasins s’étaient établis en Provence ; aux environs de Nice : de là et de quelques-unes des stations qu’ils avaient sur les bords de la Méditerranée ils s’élançaient sur les villes et les campagnes, et, comme les Normands, ils enlevaient, pillaient ou brûlaient tout ce qu’ils rencontraient sur leur passage. Plus d’une fois dans leurs courses ils pénétrèrent jusque dans la Savoie, le Piémont et la Suisse » (L’esclavage ancien au Moyen-Âge : et de sa transformation en servitude de la glèbe, p. 98-99)
A suivre l’historien, les habitus des ancêtres des Normands sont donc rigoureusement similaires à ceux des ancêtres des Maghrébins. Pourquoi donc, dans l’imaginaire du romancier français, les uns produisent un noble héros, tel Aymeric d’Hartant, tandis que les autres sont voués au banditisme ? Est-ce un préjugé racial qui est en cause, l’un étant Normand, les autres Sarrasins ? Ou est-ce un préjugé social, l’un étant issu d’une famille noble, les autres issus de familles ouvrières ?
Le grand « X » de l’intersectionnalité
Le canevas idéologique de Sérotonine étant ce qu’il est, le lecteur de Beaufs et barbares reste un peu sur sa faim : comment le mot d’ordre d’une sortie de l’UE peut-il fonder une alliance entre « beaufs » et « barbares », si ce n’est en suivant le chemin tracé par « Egalité et réconciliation », dont l’autrice signale en effet la force visionnaire : « Il faut reconnaître à Alain Soral le mérite d’avoir su toucher simultanément les âmes de deux groupes aux intérêts contradictoires et d’avoir envisagé avant tout le monde une politique des beaufs et des barbares » (op. cit., p. 196). L’alliance entre Houellebecq et Bouteldja serait-elle rendue possible par l’intermédiaire de Soral ? L’hypothèse paraît abracadabrante. Mais nous verrons bien… En attendant, ce qui paraît assuré, c’est que Houria Bouteldja n’envisage pas de s’allier avec Alain Badiou. Au terme de Beaufs et barbares, elle cite longuement un propos du philosophe au sujet du « soldat inconnu » que Brecht a proposé de remplacer par « l’ouvrier inconnu », représentant anonyme de la condition prolétarienne, sujet d’une émancipation universelle ou, comme dit Badiou, « générique ». Et Bouteldja d’épingler et le dramaturge et le philosophe, l’un et l’autre communistes : « Pourquoi les humains génériques accepteraient-ils de rendre un hommage planétaire à cet inconnu au seul motif qu’il serait ouvrier alors qu’eux le voient d’abord comme un Blanc ? […] On voit bien la dimension sans doute générique mais encore ethnocentrique de la proposition » (ibid., p. 259). Et pour s’affranchir de cet ethnocentrisme, elle avance l’hypothèse suivante, non pas communiste, mais postcoloniale : « Et si l’Histoire nous faisait une énorme farce et que l’Inconnu était un Barbare ? » (Ibid.)
Mais à ce petit jeu, Bouteldja s’expose aussitôt, sur son flanc gauche, à l’offensive féministe : pourquoi les femmes génériques accepteraient-elles de rendre un hommage planétaire à cet inconnu au seul motif qu’il serait Barbare alors qu’elles le voient d’abord comme un Phallus ? Il suffit de parcourir les écrits féministes de Carla Lonzi (Nous crachons sur Hegel. Ecrits féministes, Nous, 2023) pour se convaincre qu’à l’ethnocentrisme supposé de Badiou aura dès lors succédé, en guise d’ « amour révolutionnaire », la soumission de Bouteldja au phallocentrisme : « Notre travail spécifique consiste à chercher partout, dans tout événement ou problème du passé et du présent, ce qui relève de l’oppression de la femme. Nous saboterons tous les aspects de la culture qui continuent tranquillement à l’ignorer » (Lonzi, op. cit., p. 56). C’est ainsi que Bouteldja, qui croyait saboter Badiou, se trouvera elle-même sabotée par Lonzi.
Et une fois le doigt glissé dans l’engrenage, rien ne va plus, la roue tourne : les militants LGBT, transgenres, queers et, pour finir, les intersectionnalistes vont s’engouffrer dans la brèche - et si l’Histoire nous faisait une énorme farce et que l’Inconnu était un homme devenu femme, ou une femme devenue homme, ou un queer, bref un(e) fomme ? Et si ces barbar(e)s et beauf(e)s, ou tout(e)s celleux qui pourraient s’identifier à elleux, iels appelaient de leurs vœux l’écriture inclusive et reconnaissaient l’intersectionnalité comme leur étendard ? Découvrant le reproche de Bouteldja à l’encontre de Brecht et Badiou, c’est ce à quoi pensera inévitablement le lecteur du livre de Sirma Bilge et Patricia Hill Colins : Intersectionnalité. Une introduction (Amsterdam, 2023). Les autrices y exposent les gains théoriques et pratiques d’un recours à « l’intersectionnalité » afin d’analyser les rapports de domination. Elles expliquent :
« L’analyse intersectionnelle met en lumière les effets différenciés des politiques publiques responsables des inégalités économiques sur les personnes de couleur, les femmes, les jeunes, les habitant-e-s des zones rurales, les sans-papiers et les personnes ayant des capacités différentes. […] Les Noir-e-s, les femmes, les pauvres, les personnes LGBT, les minorités religieuses et ethniques, les peuples autochtones, les membres de castes et de groupes inférieurs n’ont jamais joui des bénéfices d’une citoyenneté pleine et entière. Iels ont, en conséquence, moins à perdre et davantage à gagner » (op. cit., p. 51).
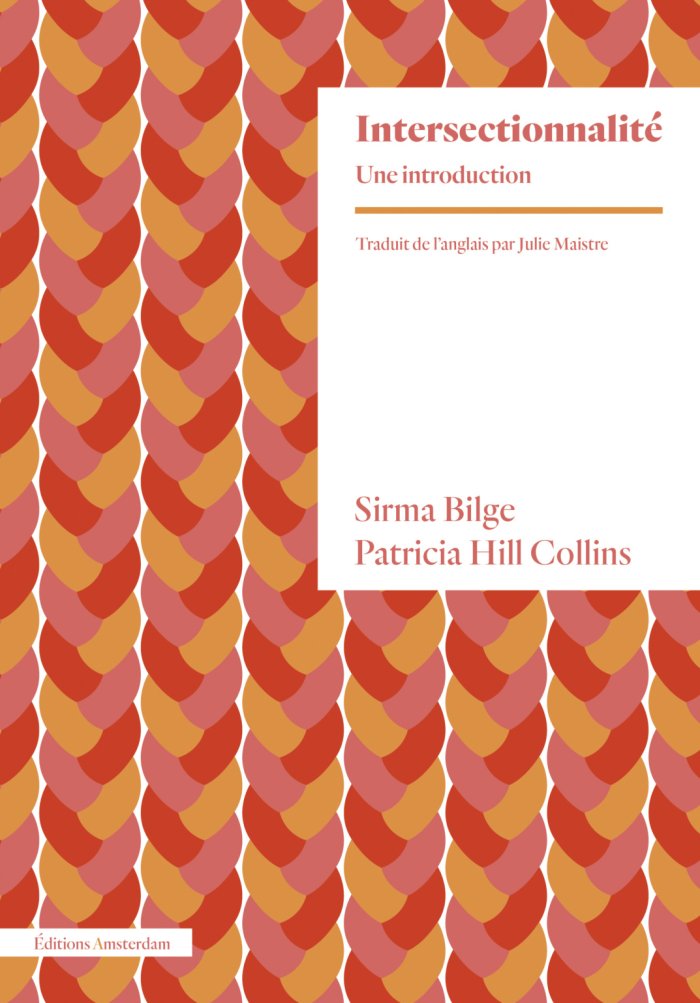
Donc cet Inconnu, représentant d’un humanité « générique », pourquoi, plutôt qu’un ouvrier, ou un barbare, ou une femme, ou une personne transgenre habitant une zone rurale, ce ne serait pas « une personne ayant des capacités différentes », autrement dit, pour celleux qui ne maîtriseraient pas encore le lexique de l’intersectionnalité : un handicapé ?
Les autrices de cette introduction à l’intersectionnalité incluent « les jeunes » parmi les catégories discriminées, mais pas « les vieux ». Or, nous qui avons lu l’enquête de Castanet, nous ferions volontiers l’hypothèse suivante : et si cet Inconnu, c’était un(e) résident(e) d’une EHPAD du groupe Orpéa ?
Mais ne serait-ce pas une manière d’exclure tant d’autres victimes de discriminations et ne risquerions-nous pas, ce faisant, de baliser le chemin d’une gérontocratie ? De fait, ce que souligne les autrices, Bilge et Hill Colins, c’est la formidable plasticité de leur outil conceptuel : outre la race, la classe, le genre, la sexualité, l’ethnicité, l’âge, le handicap, toute autre minorité discriminée est en capacité de produire une catégorie que les apôtres de l’intersectionnalité se feront un devoir d’enregistrer et de promouvoir. Autrement dit, la liste est ouverte, et les prétendants à l’incarnation de l’Inconnu sont nombreux. Je pense pour ma part aux dyslexiques, aux bègues, aux diabétiques, aux rouquins, aux dépressifs, aux allergiques au gluten, aux mythomanes, aux obèses, aux nains et, pourquoi pas, aux imbéciles, même si, dans ce dernier cas, leur caractère minoritaire reste à démontrer. Comme l’expliquent les autrices, enseignantes à l’Université : « L’intégration de nouvelles catégories dans la diversité se révèle utile en pratique lorsque l’on a affaire à une population étudiante hétérogène […]. Au fond, plus l’hétérogénéité interne à la population étudiante est devenue visible, plus la catégorie de diversité a gagné en élasticité » (ibid., p. 278). Quant aux populations qui se révèleraient hétérogènes aux manières d’écrire, de parler et de penser de celleux qui promeuvent l’intersectionnalité dans les milieux académiques, ils ne réussiront pas leur examen d’entrée à l’Université. Ils n’auront qu’à travailler à la cantine.
Bref, Bouteldja, avec son tirailleur sénégalais, risque de devenir bientôt old school. Et c’est tout le mal qu’on lui souhaite, car cette introduction à l’intersectionnalité confirme ce qu’on pouvait en penser, à savoir qu’il s’agit d’une infinitisation des particularismes, l’intersection désignant en effet, en géométrie, la rencontre ponctuelle de deux droites suivant chacune à l’infini sa trajectoire particulière. En termes de révolution sociale, ce qu’il s’agirait donc d’accomplir, in fine, c’est une réforme de la grammaire visant à inculquer aux masses laborieuses la bonne manière de penser, de parler et d’écrire, à savoir celle des intersectionnalistes, autrement dit de tout(e)s celleux qui ont entrepris de se faire une place au soleil dans l’univers feutré de l’Académie. Car rien ne témoigne davantage de l’éros du pouvoir que cette montée en puissance de la normativité en matière linguistique ; d’où la nécessité d’en revenir encore et toujours à ce qu’écrivait Georges Mounin dans ses Clés pour la langue française (1975) :
« L’attitude grammairienne ordinaire est normative. Elle enseigne comment il faut dire et, sans doute plus encore, comment il ne faut pas dire. Elle dit parfois pourquoi, souvent avec des raisons fausses, surtout quand elle se fonde sur des considérations de logique ou de psychologie. Cette mauvaise pédagogie de la norme est encore aggravée par le purisme, qu’on pourrait définir approximativement comme la norme la plus exigeante, la plus restrictive, la plus faussement raisonneuse, et tout ensemble la plus socialement tyrannique. »
Fort heureusement, les éditions Amsterdam, avant de faire paraître ce remake des précieuses ridicules, nous ont gratifié de deux livres antidotes que je vous recommande sans réserve : L’universel étranger de Michael Lucken et Le Malentendu. Race, classe, identité de Asad Haider. Car si les apôtres de l’intersectionnalité ont la ferme intention non seulement d’investir l’Académie, mais de régenter la langue, ces deux ouvrages contribueront en revanche à vous sortir la tête du trou.
Dans le premier, Lucken bâtit une sorte d’épistémologie de la rencontre, l’idée étant que la pensée, en dernière analyse, ne vise en tant que telle ni la différence, ni l’unification, mais la traduction, soit le transport d’un univers à un autre, l’aller-retour dialogique, ce qui suppose, plutôt que de tracer des droites en tous sens sur une page blanche, de s’exercer à passer d’un système de valeurs à l’autre, discipline – la « xénologie » - d’une toute autre portée théorique et pratique que celles des identités malheureuses, lesquelles sont décidément homogènes aux logiques réactionnaires qui nous gouvernent.
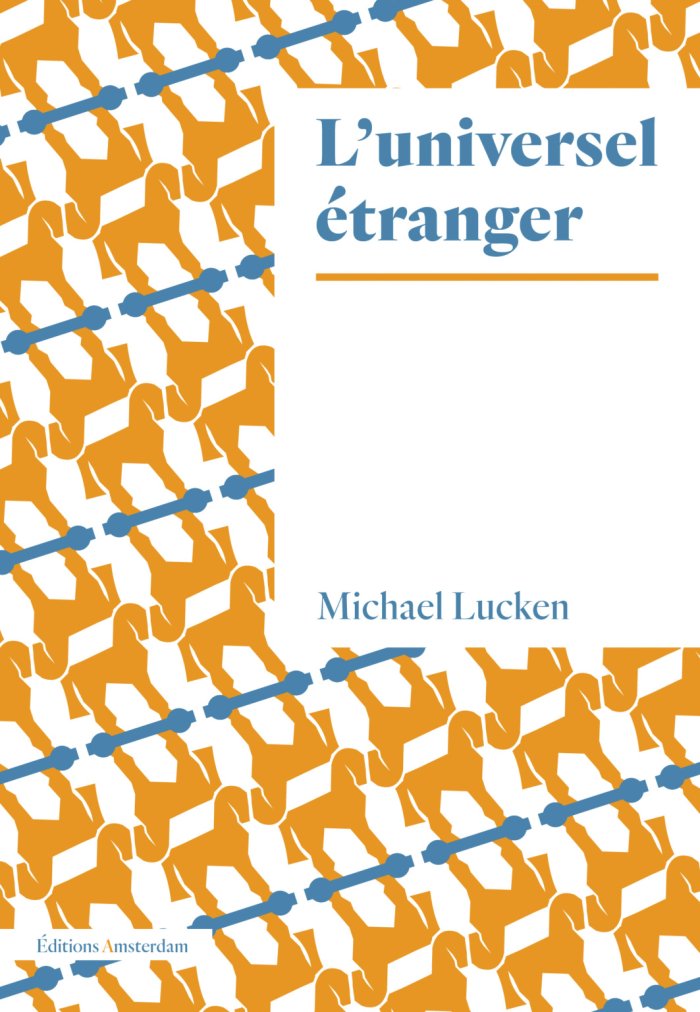
Dans le second livre, Haider se livre à un examen scrupuleux des pertes et profits de l’émergence de la logique identitaire au sein des courants progressistes nord-américains. Retraçant l’histoire d’un féminisme noir d’abord corrélée aux luttes ouvrières, il montre comment l’intersectionnalité est devenue non seulement une doctrine inoffensive, mais le cheval de Troie de l’idéologie dominante : « L’exemple le plus récent et le plus frappant en a été la campagne présidentielle de Hillary Clinton, qui a adopté le langage de ‘‘l’intersectionnalité’’ et du ‘‘privilège’’ et utilisé la politique de l’identité pour combattre l’émergence au sein du Parti démocrate d’une dissidence de gauche autour de Bernie Sanders » (op. cit., p. 24). On voit mal, en revanche, Hillary Clinton adopter le langage de la lutte de classes, ou de la distanciation brechtienne ; de là à conclure que l’intersectionnalité n’a d’autre finalité que de régler la question sociale en requalifiant le handicap en « capacité différente », il n’y a qu’un pas. Nous sommes donc gré aux éditions Amsterdam d’avoir, en publiant ces trois livres en une sorte de tirs rapprochés, donné à chacun les moyens de se faire une idée.
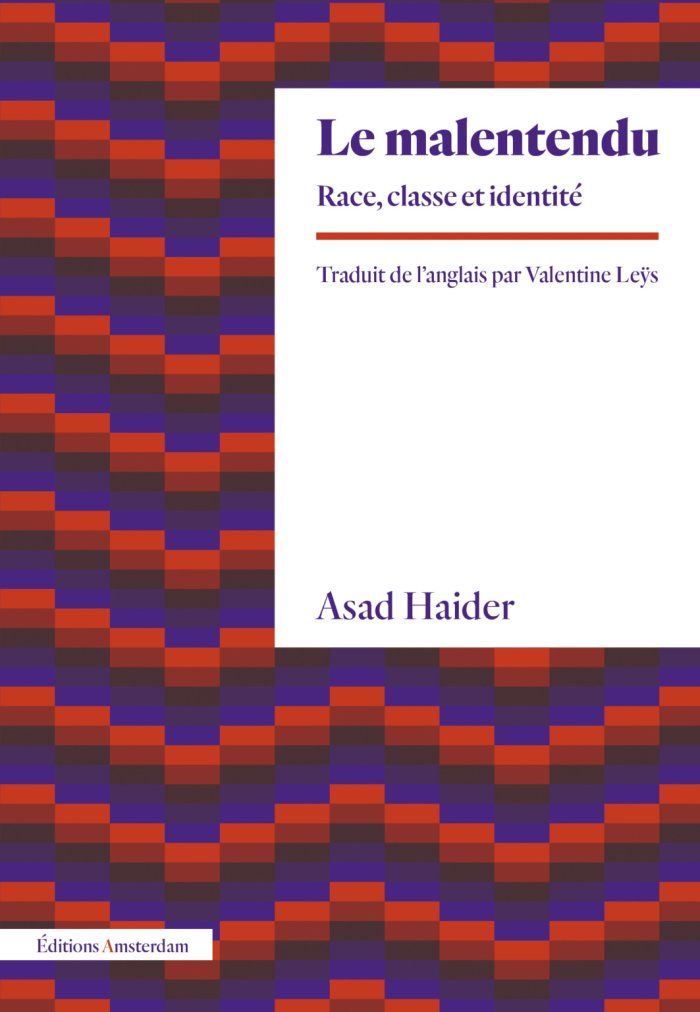
Ceci posé, je reviens à Bouteldja et au reproche qu’elle adresse au vieux Platon. Pour ce qui est de son internationalisme communiste, on ne saurait décemment reprocher à Badiou un quelconque chauvinisme « blanc ». Car son « ouvrier inconnu » n’est ni « blanc », ni « noir », ni métis ; il est, comme l’écrit Badiou dans l’un de ses livres, « incolore », caractéristique qui signale précisément « l’ordre de l’universel auquel l’humanité aspire » (Le Noir. Eclats d’une non couleur, Autrement, 2015, p. 122). Et il est tout de même curieux que personne, aux éditions La Fabrique, n’ait cru bon d’avertir Bouteldja que dans un autre livre, celui-ci pourtant paru aux éditions La Fabrique, Badiou a écrit :
« [Marx] le disait brutalement : ‘‘Les prolétaires n’ont pas de patrie’’. Comprenons : leur patrie est l’humanité. Ils doivent bien comprendre ça, tous ces jeunes qui partent du Mali, ou de la Somalie, ou du Bangladesh, ou d’ailleurs ; qui veulent traverser les mers pour aller vivre là où ils pensent qu’on peut vivre, ce qu’ils ne peuvent plus faire dans leur pays d’origine ; qui risquent cent fois la mort ; qui doivent payer des passeurs brigands ; qui traversent trois, ou dix pays différents, la Lybie, l’Italie, la Suisse ou la Slovénie, l’Allemagne ou la Hongrie ; qui apprennent trois ou quatre langues, qui font trois ou quatre ou dix métiers. Oui, eux, ils sont le prolétariat nomade, et tout pays est leur patrie. Ils sont le cœur du monde humain d’aujourd’hui, ils savent exister partout où l’être humain existe. Ils sont la preuve que l’humanité est une, est commune. Et c’est pourquoi nous devons non seulement les accueillir comme des frères, mais comme une chance. Et nous organiser avec eux pour que l’humanité, enfin, commence sa vraie vie planétaire » (Petrograd, Shanghai. Les deux révolutions du XXe siècle, La Fabrique, 2018, p. 18).
Si les éditeurs ne lisent plus les livres qu’ils publient, où allons-nous ? Au diable, probablement.
Race, classe et genre : essai de clarification
Dans Beaufs et barbares, Bouteldja commence par expliquer, au sujet de l’unité des classes populaires : « Les facteurs de la désunion sont nombreux mais parmi les plus structurels, les plus anciens et les plus effectifs, il y a la division raciale. C’est à ce nœud que je consacre ce livre » (op. cit., p. 11). Il ne s’agit cependant pas d’arguer que la « division raciale » prime sur l’antagonisme de classe (ou de genre), souligne-t-elle plus loin :
« Ainsi, on ne trouvera dans les lignes qui suivent aucune trace de primat de la race sur la classe (ou sur le genre). On pourra même affirmer sans ambiguïté que la race est une modalité de la classe (et du genre) comme on pourra dire que la classe est une modalité de la race (et du genre). Il s’ensuit que la lutte des races est une modalité de la lutte des classes. Il s’ensuit aussi que la lutte des classes est une modalité de la lutte des races. Tout dépend du temps, de l’espace et des enjeux conjoncturels » (ibid., p. 27).
Il s’ensuivrait également, à la suivre, que le genre est une modalité de la classe ou de la race, comme la lutte des genres est une modalité de la lutte des races ou des classes. Et si le genre est placé entre parenthèses, ce serait donc du fait des « enjeux conjoncturels » qui motivent l’écriture de Beaufs et barbares. Soit. Mais il n’en demeure pas moins que cette manière de jongler avec les catégories de race, de classe et de genre recèle une confusion conceptuelle dont la clarification pourrait être un enjeu conjoncturel de premier ordre. Car si la race, la classe et le genre sont des « modalités », il paraît un peu vain de les définir comme des « modalités » les unes des autres dans un jeu de miroir sans fin plutôt que d’identifier une fois pour toutes la substance dont elles sont les modalités. C’est pourquoi, pour ma part, j’ai ouvert Judaïsme et révolution (La Fabrique, 2014) sur ces mots simples : « Par révolution, j’entends la disparition de la servitude et de la domination dans la structure du social ». Race, classe et genre seraient donc des modalités de la servitude et de la domination dans la structure du social.
Ceci posé, il convient d’observer que dans Le Manifeste du PC, Marx et Engels commencent par identifier les modalités historiques de la lutte de classes qui ont précédé l’avènement du capitalisme et, partant, de l’antagonisme entre bourgeois et prolétaires : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire des luttes de classes. Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et compagnon, en un mot oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte ». Par « communisme », ce que les auteurs entendent principalement, c’est donc une organisation sociale qui serait fondée sur l’abolition de l’antagonisme de classe.
A cette lumière, qu’est-ce que le « genre » ? A suivre un certain courant du féminisme, l’idée est en gros la suivante : puisque partout où la division sexuelle a prévalu, les femmes ont été socialement subordonnées aux hommes, il convient de déconstruire la catégorie de « genre », de sorte qu’il n’y ait ni hommes, ni femmes, de même que dans la société communiste, il n’y aura ni maîtres, ni esclaves. Pour assoir le bien fondé de cette analogie, il faut dès lors à ce courant de pensée démontrer que les catégories « homme » et « femme » sont des constructions sociales au même titre que les catégories « maîtres » et « esclaves » ou « bourgeois » et « prolétaires ». Mais selon d’autres, dont je suis, l’analogie est bancale, car s’il est contradictoire de concevoir une société prétendument affranchie de la servitude et de la domination, mais où se perpétuerait néanmoins une division entre « bourgeois » et « prolétaires », il est en revanche non contradictoire d’envisager une société affranchie de la domination et de la servitude, et néanmoins fondée sur une norme hétérosexuelle. Certes, on peut arguer qu’une telle société n’a, de fait, jamais existé, puisque partout où il y a eu une division entre « hommes » et « femmes », les premiers ont subordonné les secondes. Mais la société communiste non plus n’a jamais existé, ainsi que le martèle les apôtres de l’ordre établi. Par conséquent, la question est ici conceptuelle et non factuelle, outre le fait qu’il existe des amours, des amitiés, des relations hétérosexuelles qui ne sont pas structurés par la servitude et la domination. Le problème que pose une société fondée sur une norme hétérosexuelle n’est donc pas nécessairement celui de la domination et de la servitude, il est en revanche nécessairement celui de l’illégitimité des pratiques ou des amours homosexuels qui découle de cette norme, et donc de l’ostracisme, de l’intolérance, voire de la répression policière qui risque de frapper ceux qui vivent en dehors de la norme. Reste que la condition d’un bourgeois homosexuel à l’ère victorienne, tel Oscar Wilde, n’est pas analogue à celle d’une fille ouvrière dans la capitale anglaise visitée par Dostoïevski en 1862, séjour qui lui inspira ses Notes d’hiver sur impressions d’été (trad. A. Markovwicz, éd. Babel) :
« C’est une ville qui s’agite jour et nuit, infinie comme la mer, ce crissement, ce hurlement des locomotives, ces chemins de fer posés au-dessus des maisons (et bientôt sous les maisons), cette audace de l’esprit d’entreprise, cette apparence de désordre qui est, en fait, l’ordre bourgeois porté à son degré suprême, cette Tamise polluée, cet air nourri de charbon, ces squares et ces parcs magnifiques, ces recoins monstrueux de la ville comme Whitechapel, avec ses habitants à moitié nus, sauvages et affamés » (op. cit., p. 66). « […] A Hay Market, j’ai vu des mères qui amenaient se vendre leurs filles mineures. Des petites filles d’une douzaine d’années vous saisissent le bras et vous demandent de les suivre. Je me souviens, une fois, dans la foule des gens, en pleine rue, je vis une petite fille, de six ans, pas plus, tout en guenilles, sale, pieds nus, faméliques, saoulée de coups ; son corps, transparaissant sous les guenilles, était couvert de bleus » (ibid., p. 73). « On ne laisse pas entrer les pauvres dans les églises, parce qu’ils n’ont pas de quoi payer leur banc. Les mariages entre ouvriers et, en général, entre les pauvres, sont, la plupart du temps, illégitimes, parce que ça coûte cher de se marier. A propos, beaucoup de ces maris battent effroyablement leur femme, les défigurent à mort, et surtout à coups de ces tisonniers qui leur servent à remuer le charbon dans l’âtre » (ibid., p. 75).
Pour arracher Oscar Wilde ou Alan Turing à la persécution policière, il faut décriminaliser l’homosexualité, et in fine la normaliser, et plus généralement combattre les pratiques discriminatoires que le groupe majoritaire tend à développer à l’encontre des groupes minoritaires, quelle que soit la différence en cause (homosexualité, handicap, etc.) au regard de la norme véhiculée par le grand nombre.
Dans le cas des « maris [qui] battent effroyablement leur femme », le problème posé est d’une tout autre nature, à savoir que dans une société fondée, en dernière analyse, sur la loi du plus fort, c’est l’homme qui manie le tisonnier, et la femme qui trinque. Autrement dit, dans une société où les groupes privés côtés en bourse, préjugés vertueux, engrangent des profits sur la base d’une maltraitance des personnes âgées et d’un détournement de fonds publics, avec la bénédiction des administrations d’Etat, tandis que les chômeurs, réputés vicieux, sont persécutés par ces mêmes administrations, eh bien le chômeur, une fois privé de ses allocations, parce qu’il a manqué un rendez-vous de contrôle, ou refusé un emploi d’aide-soignant dans une EHPAD d’Orpéa, s’en retourne chez lui après avoir noyé sa misère dans l’alcool, et plutôt que de s’épancher dans les bras de sa femme, il saisit le tisonnier, histoire d’entériner que chez lui aussi prévaut la loi du plus fort. Les intersectionnalistes pourront à souhait régenter l’usage académique de la langue et nous abreuver de « iels » et de « celleux », reste que le plus fort, dans la plupart des cas, ce sera lui, et non elle. C’est pourquoi, selon Marx et Engels, c’est une révolution sociale qui doit permettre d’affranchir les femmes des coups de trique, et non une préciosité académique.
J’en viens enfin à la « race ». Bouteldja use volontiers des catégories de la « race » et de la « blanchité ». Et certes, nul ne peut contester sa pertinence : en France, les Arabes et les Noirs sont préjugés vicieux, tandis que les « Blancs » sont préjugés vertueux. Mais au Qatar, par exemple, les « Blancs » sont des Arabes, et ils sont « Blancs » à un degré autrement plus poussé que les Français de souche, en France, ne le sont. La « race », ou la division entre « Blancs » et « racisés » est donc bien une catégorie non seulement relative, mais secondaire. Car ce qui est structurel, à l’échelle historique des sociétés humaines, depuis l’aube des temps, ce n’est pas la catégorie raciale, c’est celle de « l’étranger ». Et en dernière analyse, nous dirions, au moins provisoirement, que l’étranger est à l’autochtone ce qu’est la femme à l’homme, et ce qu’est le prolétaire au bourgeois.
S’ensuivrait un cheminement existentiel et métaphysique potentiellement libérateur : que l’autochtone s’étrangéise, qu’à cette lumière l’homme se féminise, et qu’enfin le bourgeois se prolétarise, non pas au sens d’une aliénéation sociale, mais au sens où j’ai pu écrire, ailleurs, que « le bourgeois se place, l’ouvrier œuvre ».







