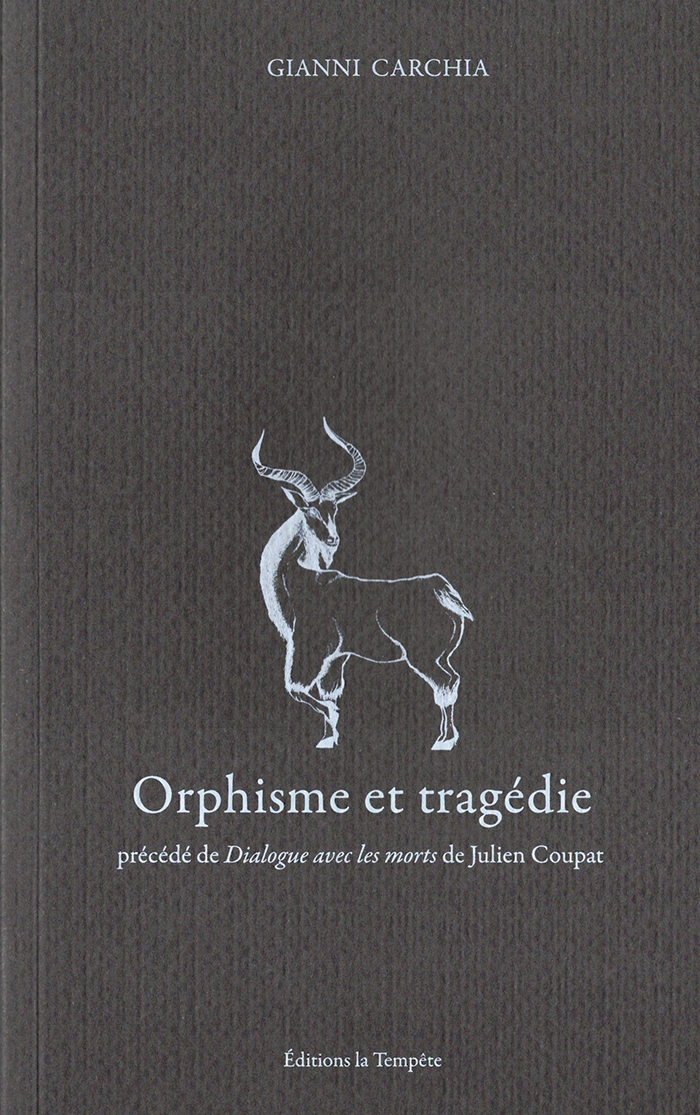D’entrée de jeu, ce petit livre de Gianni Carchia – introducteur de Benjamin en Italie dans les années 1970 et philosophe esthétique de la Grèce proche du mouvement autonome – nous renvoie au problème, à la fois étouffé par la tradition scolastique et toujours brûlant pour toute personne s’intéressant à l’art/la poésie, de l’autonomie de l’art : « L’attribution à l’art d’un espace d’indépendance toujours plus affirmé a procédé parallèlement à l’évanouissement du sens de son autonomie originelle ». Cette affirmation vient troubler la conception dominante de la modernité poétique qui situe, à renfort de citations isolées de Baudelaire ou de Mallarmé, sa grandeur dans son autonomie : le beau rompt la triade platonicienne qu’il composait avec le vrai et le bon pour ouvrir à ses sectateurs un horizon de liberté et de possibles spéculativement infinis, lequel horizon, comme les autres, n’a pourtant pas manqué de se boucher au cours des dernières décennies. En termes plus prosaïques : on peut certes faire tout ce qu’on veut en art/poésie, mais on voit bien que ça ne mène à rien du tout.
Gianni Carchia s’inscrit contre une telle banalisation de l’idée d’autonomie qui neutralise en réalité sa charge critique. L’autonomie « originelle » dont il parle dans Orphisme et tragédie ne revêt pas la forme de la liberté démocratique bourgeoise en vertu de laquelle l’art, comme n’importe quel autre domaine, aurait le droit à sa vérité et à ses valeurs propres (et aux subventions correspondantes, est-on tenté d’ajouter), de même que chacun a le droit d’avoir et d’exprimer ses propres opinions tant que cette expression ne remet pas en cause le statut quo économique ni le consensus politique. L’autonomie dont parle Carchia, et dont il va chercher des exemples dans la Grèce ancienne, n’est pas une autonomie garantie par l’ordre établi mais une autonomie critique de l’ordre établi.
En s’attachant à cerner un dénominateur commun, une constante entre des modes de gouvernements aussi divergents que ceux de Spartes et d’Athènes, pouvant constituer le fondement de l’ordre social dans la Grèce ancienne, Carchia en vient à repérer ce qu’il nomme la « religion sacrificielle ». C’est précisément aux sacrifices rituels de la religion olympienne – avec toutes les hiérarchies qui lui sont liées, du ciel sur la terre, etc. – que s’opposent, chacun à sa manière, l’orphisme et la tragédie. Leur autonomie consiste donc en une critique du sacrifice et de son fondement idéologique : le mythe. C’est particulièrement visible dans le cas de l’orphisme qui renverse dans sa doctrine les valeurs de la religion officielle. Si la spiritualité agraire née de la révolution néolithique, basée sur l’opposition entre (dieux) immortels et (hommes) mortels, légitime les pratiques sacrificielles et la reproduction de l’ordre économique et social, alors l’orphisme est cette pratique subversive qui en renverse les termes : en divisant l’homme entre une âme (immortelle) et un corps (mortel), la doctrine orphique ouvre aux êtres humains une voie de sortie hors du cycle de la reproduction et de leur cantonnement au pôle négatif, mortel, du cosmos. La pratique du végétarisme prônée par l’orphisme ne saurait dès lors plus être le moins du monde prise pour une forme de carême valorisant la privation : refuser de consommer de la viande, c’est une manière pour un Grec dissident non seulement de refuser de participer au sacrifice qui assure la cohésion sociale, mais aussi de rompre avec le fonctionnement économique sédentaire de la société issue de l’agriculture et de l’élevage. Il s’agit pour les membres de ces sectes d’assurer la reproduction de leurs corps communautaires sans se compromettre dans le mode de reproduction de la société basée sur le mythe et le sacrifice.
Que l’orphisme s’oppose au mythe, que son mythe de « l’âme exilée » dans le corps constitue une « mythe de la fin du mythe », c’est une idée intéressante, stimulante, mais qui prolonge plutôt qu’elle ne bouleverse les idées déjà en vigueur sur l’orphisme. Puisqu’il s’agit d’une « secte » (au sens étymologique de section, séparation), il est logique qu’il se trouve dans une relation antagonique aux valeurs de la cité. Là où Carchia surprend davantage, c’est lorsqu’il prolonge cette analyse dans la tragédie. Car le titre dit bien ce qu’il dit : il s’agit d’« Orphisme ET tragédie » et non, comme on pourrait le corriger spontanément, d’« orphisme OU/CONTRE tragédie ». Ils sont affirmés comme deux phénomènes d’une même réalité ou, plus précisément, comme deux stratégies qui, par-delà leur différences de stratégies, visent également l’autonomie : par le biais d’une opération destituante dans le cas de l’orphisme et d’une opération de dévoilement dans celui de la tragédie.
Il y a de quoi être surpris : on peine a priori à voir quoi que ce soit de subversif vis-à-vis de la cité dans le théâtre tragique. Ne constitue-t-il pas plutôt son expression institutionnelle la plus pure ? Les citoyens les plus pauvres ne sont-ils carrément pas indemnisés pour pouvoir chômer et assister aux représentations sans perte de revenus et communier ainsi dans la sociétése représentant elle-même ? De plus, les histoires d’Eschyle et de Sophocle ne reproduisent-elles pas encore un fois les vieilles histoires mythiques de la religion olympienne ? Qu’est-ce que l’esprit subtilement tordu d’un philologue italien va bien pouvoir trouver poursauverla tragédie du procès en idéologie qui la menace ? Eh bien l’autonomie artistique, tout simplement. Ce qui fait de la tragédie un phénomène critique, c’est son autonomie artistique. Et inversement, c’est son autonomie artistique quilui permet d’avoir une fonction critique.
Vous vous dîtes peut-être : nous y voici revenus, à cette fameuse autonomie de l’art dont on nous avait pourtant affirmé en début d’article la vacuité. C’est la grande restauration en un paragraphe : non seulement la tragédie grecque est réhabilitée, mais en plus on nous ressort les vieux poncifs sur l’autonomie et l’extériorité de l’art par rapport à la politique et la morale, etc. Oui, mais, ici aussi, il y a autonomie et autonomie. Il y a l’autonomie concédée/consacrée (par l’État à Baudelaire et à ses lecteurs, mettons, du moins après le fameux procès et d’après le récit officiel : la poésie a droit à son– petit – espace autonome à soi) et il y a l’autonomie critique (celle du mouvement autonome dont Carchia a fait partie, celle qui ne reçoit pas mais constitue son propre espace dans la confrontation). C’est cette autonomie de lutte, agonistique, qui est à l’oeuvre dans la tragédie.
Si l’autonomie de l’orphisme et des formes poétiques dites lyriques qu’il revêt opérait une critique de la conception officielle cyclique du temps, solidaire de la reproduction de l’ordre social et des pratiques sacrificielles, l’autonomie du tragique opère quant à elle à un niveau moins doctrinal et religieux que juridique et politique. Carchia ne nie absolument pas que la tragédie est un phénomène intrinsèquement lié à la structure politique de la polis (et il s’oppose explicitement, soit dit en passant, à toutes les lectures littératurisantes et scolaires qui font de la tragédie une catégorie poétique atemporelle, indifférente au contexte politique et qu’on retrouverait substantiellement inchangée, de Sophocle, à Sénèque, à Racine/Anouilh) : l’une comme l’autre sont conçues comme des phénomènes historiques assez éphémères, se développant sur quelques générations et résultant d’un équilibre précaire entre des forces historiques et économiques qui menèrent rapidement à leur double dissolution. Et c’est précisément dans ce caractère transitoire, presque évanescent qu’émerge une forme d’autonomie commune aux deux phénomènes. L’équilibre politique de la polis est basé pour Carchia sur la double logique de la mise en esclavage d’une majorité de la population reléguée aux marges de l’humanité et d’un compromis entre classes permettant l’émergence politique d’une bourgeoisie de petits propriétaires indépendants et capables de résister politiquement à la domination des familles aristocratiques. Cette situation institutionnelle apparaît comme le revers d’un autre équilibre, économique, entre le primat de la propriété foncière et aristocratique (l’oikonomia) qui s’effondre dans la seconde moitié du Vèmesiècle et l’émergence de la chrématistique, c’est-à-dire de l’économie au sens (proto-)moderne avec la montée en puissance de l’argent et de la valeur comme éléments organisateurs de la vie sociale. Lapolisest donc le résultat transitoire d’un double équilibre : politique (entre aristocratie et bourgeoisie, pour le dire grossièrement) et économique (entre propriété foncière et logique marchande). Ce qui signifie que « dans la cité antique, en tant que kairos entre status et contrat, entre l’oikonomia et la chrématistique, dominent effectivement des rapports publics et rationnels, mais pas encore dominés par l’impersonnalité et l’abstraction des mécanismes du marché ».
Carchia associe justement l’orphisme et la tragédie à chacun de ces deux domaines : l’orphisme, qui connaît une renaissance après la décadence des cités, constitue ainsi une « fuite hors du monde » dont la logique illimitée fait écho aumouvement déséquilibrant et potentiellement infini de la chrématistique. La tragédie serait au contraire « entièrement politique », au sens où son existence comme institution est intrinsèquement dépendante de celle de l’équilibre précaire de la polis. Dès lors, la tragédie ne dissout pas le mythe comme le faisait l’orphisme mais elle le dialectise dans une logique contradictoire qu’elle a en commun avec la sophistique. Il ne s’agit nullement de réduire l’orphisme au mouvement de l’argent ni la tragédie à l’équilibre politique mais de voir au contraire comment ils en émergent pour s’en distinguer et se construire comme espaces critiques autonomes.
Afin de comprendre l’opération esthétique de la tragédie, Carchia se situe explicitement dans le sillage de Hölderlin dont il oppose la compréhension du tragique à celles de Hegel et de Nietzsche. Ce dernier aurait en effet manqué la spécificité du tragique en confondant l’art et la vie : en faisant de l’apparence tragique apollinienne une simple figuration de la pulsion esthético-dionysiaque, il manquerait la spécificité du tragique qui consiste non pas dans l’exaltation mais dans la suspension de la vie. L’esthétisme confondant la vie et l’art rend ainsi aveugle à l’autonomie de ce dernier. L’erreur de Hegel serait quant à elle plus subtile : il y a, dans la Phénoménologie de l’Esprit, deux lectures différentes du tragique qui correspondent à deux moments distincts du mouvement de l’esprit. Dans le chapitre sur l’éthicité, le tragique est analysé comme le processus conflictuel sans résolution possible au cours duquel s’effondre l’éthique du monde archaïque au profit de l’instauration du droit. Cette lecture, encore marquée par une vision idéalisée de la Grèce qui voit dans la dissolution de ses structures archaïquesune forme de décadence et un tribut à payer au mouvement de l’histoire et de l’esprit, diffère de celle faite à propos de la religion de l’art où Hegel conçoit le tragique comme un processus d’autonomisation esthétique par rapport au sacrifice, de transformation du rituel en représentation artistique. Le tragique incarne donc successivement deux formes d’autonomies différentes : une autonomisation du droit par rapport à l’éthicité dans le premier cas et une autonomisation de l’esthétique vis-à-vis du sacrifice dans le second. C’est parce qu’il sépare en deux moments distincts ces processus d’autonomisation que Hegel manque, d’après Carchia, la spécificité du tragique : il ne saurait être réduit ni à une simple transition historique, aussi douloureuse soit-elle, d’une époque à une autre, ni à une forme littéraire s’éloignant de la vie dans une forme d’absolu spirituel.
Contre la lecture de Nietzsche qui confond la vie et l’esthétique et contre la seconde que propose Hegel en séparant au contraire l’esthétique de la vie, Carchia défend et prolonge l’analyse de Hölderlin précisément parce qu’elle maintient ensemble les deux sphères (de l’esthétique et de la vie) sans les confondre pour autant. Ce qui a lieu dans la tragédie est une suspension de la vie, son maintien et sa mise à distance tout à la fois, par l’élément que Hölderlin nomme « césure ». Le terme, qui désigne originellement la pause anti-rythmique coupant le vers sans égard pour le sens de l’énoncé, est étendu à tous les niveaux du tragique : il décrit également l’alternance entre les passages dialogués et les chants du chœur qui brise le « développement mécanique, au ‘transport vide’ de l’action ». La césure est en somme, avec les mots de Hölderlin, « l’interruption antirythmique (…) nécessaire pour affronter l’alternance déchirante des représentations (…) en sorte que ce ne soit plus alors l’alternance des représentations, mais la représentation elle-même qui apparaisse ». C’est dans cette mise-à-distance qui est simultanément une mise-en-évidence de la logique sacrificielle conduisant le héros à sa perte, que le tragique constitue son autonomie par rapport au sacrifice. Tandis que l’orphisme établissait une doctrine et une pratique absolument opposées et alternatives au rituel sacrficiel dont il refusait la monstruosité, la tragédie dévoile qu’il n’est rien d’autre qu’une « comédie de l’innocence sacrificielle » et en suspend la logique en laissant voir que cette comédie n’est rien d’autre qu’un rituel barbare perpétué aux dépends d’un bouc émissaire, d’un héros coupable d’une faute qu’il n’a pas commise. La condition de possibilité du dévoilement de cette comédie de l’innocence est donc bien la dimension esthétique qui établit une différence, une césure, vis-à-vis du rituel ; cette autonomie esthétique est à l’inverse indissociable de la dimension critique vis-à-vis de l’idéologie sacrificielle : c’est parce qu’elle démasque la comédie de l’innocence à l’oeuvre dans le sacrifice que la tragédie cesse d’en être un pour devenir une forme d’art autonome.
Par son interprétation de la tragédie, Carchia s’inscrit donc en rupture avec la tradition philosophique d’ascendance platonicienne, qui oppose le logos au mythe et consacre la victoire du premier sur le second. Ce qui s’oppose véritablement au mythe et à la logique sacrificielle qu’il sous-tend, ce n’est pas, pour Carchia, le logos. Logos et mythe sont renvoyés face à face comme logiques discursives du maintien de l’ordre qui se succèdent au cours du développement historique. Leur opposition n’est en ce sens qu’une transition historique d’une logique politique dominante à une autre. L’une des grandes forces de ce livre est de déjouer l’illusion d’optique qu’engendrent ces oppositions binaires et confortables qui nous enferment dans une fausse alternative assurant en dernière instance la reproduction de l’ordre. Et de proposer une voie de sortie : celle que Carchia découvre avec Hölderlin dans l’autonomie esthétique réelle, celle de l’orphisme et celle de la tragédie, par laquelle une forme poétique rompt avecle monde de la domination pour laisser entrevoir des voies utopiques obstruées par l’histoire. Carchia retrouve ainsi dans l’autonomie grecque le projet d’émancipation des avant-gardes. Ce n’est certainement pas un hasard s’il aperçoit cette possibilité au moment où l’Italie est agitée par le grand mouvement révolutionnaire autonome où c’est la masse ouvrière, prolétaire, humaine qui opère une césure radicale vis-à-vis du monde mystifié de la démocratie moderne.