Révoltes, exode, désertions...
On pourrait croire que la combinaison des effondrements écologiques, de la gouvernementalité asphyxiante de plus en plus réduite à son action policière et de la décomposition des scènes de la représentation politique remette au goût du jour la notion d’exode. Quitter la scène !Et pourtant depuis 20 ans des scènes de révoltes planétaires prolifèrent. Mais s’agit-il encore des scènes de la politique ? Qui croit encore à un projet révolutionnaire porté par des formes d’organisation des partis ? Qui croit encore aux improbables retrouvailles avec des sujets du conflit politique ?
La révolte comme exode alors ? Ainsi, lorsqu’on songe aux contrées latino-américaines, du passage du « Que se vayant todos ! » argentin de 2001 au leitmotiv « Evasión ! » des récentes révoltes chiliennes. Que nous disent d’autre les tags célébrés des Gilets jaunes dans le pays de l’identité national-républicaine ? « On met le gilet, on quitte le navire ». Ou encore : « Gilet jaune plutôt que Français ! ». Mais là encore, il faudra se méfier des formes génériques de caractérisation de l’expérience. A fortiori de l’expérience révolutionnaire. « Exode » nous incline à penser à la Terre Promise. Or, nous n’avons qu’une terre : celle que nous habitons. Et si nous pouvons partir c’est pour aller toujours ailleurs. Nous partons alors à la rencontre des multiplicités de la Terre. Alors, dans ce sens, oui : exode… Mais le Messie a été définitivement remplacé par l’appel des mondes qui sont en train de sombrer et qu’il nous faut malgré tout habiter. Alors, demeurer révolutionnaires dans notre temps de catastrophes suppose de faire exister des mondes : et donc de nous y rencontrer. Exode, mais en « faisant lieu » contre les espaces dépeuplés du désastre. L’exode n’a de sens que s’il permet de renouveler notre expérience commune. Peut-être qu’alors il serait préférable de parler de désertions et des nouvelles alliances qu’elles ouvrent. Nous ne pouvons habiter un monde composé d’une multiplicité de mondes qu’en quittant et en sabotant le monde Un de la destruction.
Et puis, d’ailleurs, quel exode pour le milliard d’humains qui habitent aujourd’hui dans des bidonvilles ? D’une certaine manière le monde du fascisme de la marchandise les a déjà plus ou moins quittés ; même s’ils demeurent des producteurs et consommateurs de valeur, par des voies détournées. Même si on y retrouve des millions de Smartphones. Mais toute action gouvernementale vouée à les enrôler dans les anciennes totalisations sociales semble avoir été abandonnée, à l’exception, peut-être, de l’action négative de la police.
Inversement, n’est-il pas question d’amorces de formes d’exode dans la constitution de certaines gated communities existentielles ? Ainsi en va-t-il pour celles et ceux qui en télétravaillant dans leur nouvelle maison à la campagne, s’adonnent avec quelques amis aux délices de la permaculture et cultivent le buen vivir, loin des turbulences urbaines et leurs pollutions. Dans ce sens, l’« exode » peut caractériser une fuite urbaine déjà en cours, une sorte de démétropolisation activée par le fantasme d’un retour à la terre. Ce qui n’empêche qu’elle exige des réappropriations techniques, des liens réactivés entre des humains et des non-humains. C’est une évidence : cet exode métropolitain est inévitable même s’il concernera d’abord des classes moyennes, plutôt « artistes » et « intellectuelles », plutôt de « gauche » et « écolo », des désaffiliés de la petite bourgeoisie nourris aux imaginaires de la sobriété et aux « alternatives » malgré la haute densité des branchements numériques qu’ils continuent à activer. Ce mouvement va à l’encontre d’une autre hypothèse, improbable, celle d’un scénario à la Mad Max. Il faudra revenir sur la question de la métropole. Elle ne se réduit évidement pas à une question territoriale.
Sauf appétence irrépressible pour le rôle de juge d’un quelconque tribunal des mœurs et des spiritualités, on peut se garder de ricaner à propos de ceux qui en « désertant » sont censés se fourvoyer dans les extases égotiques d’un nouvel imaginaire cosmogonique. Après tout il y a bien encore des gens qui font 15 ou 20 ans de psychanalyse (en particulier en France, éternelle Fille aînée de l’Église) et qui plongent dans un exode intérieur sans fin pour ne rien trouver d’autre que l’abîme de leur propre Moi, médusés par un besoin insatiable de re-connaissance (la maladie de l’Occident). Alors pourquoi ne pas soigner son « moi », dépeuplé par les dévastations du libéralisme existentiel, avec des relations interspécifiques entre des humains et non-humains ? Mais il ne faudrait pas, en retour, que celles et ceux qui s’y adonnent, loin du chaos métropolitain et des zones de relégation, loin de la haine sociale qui leur sont consubstantielles, nous fassent la leçon comme c’est le cas aujourd’hui en France de certains « représentants » de la galaxie cosmopolitique en vogue.

Ethopoïètique...
A la métaphysique de l’exode, on peut préférer l’engagement dans des processus éthopoïètiques et les contraintes qu’ils nous imposent : celles de faire advenir la communauté, et donc de « faire lieu », et donc de faire oeuvre de fragmentation en s’ouvrant à de nouvelles formes d’association (ou à des expériences transitives). Mais toute éthopoïètique a sa part de négativité et d’affrontement. Nous ne pouvons pas quitter notre monde dégueulasse, et créer d’autres mondes, sans affronter ce qui nous y rattache et nous rend captifs. Habiter à nouveau le monde c’est détruire ce qui le rend inhabitable. Car si le Capital est inhabitable, nous n’y sommes pas moins pieds et poings liés. Nous sommes attachés aux machineries de dépeuplement du monde : voici le paradoxe mortel de l’économie. Etre attachés, dépendants, contraints et forcés, à ce qui détruit les attachements. Il s’agit alors de mener une guerre à mort contre le dépeuplement. Et cette guerre éthopoïètique a déjà lieu partout, au même titre que les insurrections. Nous pouvons trouver les liens entre l’une et les autres. Les insurrections n’ont pas de devenirs possibles sans une attention scrupuleuse à l’émergence des lieux qui rendent le monde habitable. Nos lieux communs. La pire source de notre malheur c’est d’avoir désappris à prendre soin du partage et la transmission de l’expérience.
La nouvelle séquence de résistances et de soulèvements contre la nécrophilie capitaliste prend des formes diverses selon les pays. C’est une hybridation de géographies, de formes, d’héritages avec leurs lignes aberrantes qui empêchent toute caractérisation uniforme, et donc (et c’est tant mieux) la formation de nouvelles avant-gardes avec leurs prétentions hégémoniques. Cela met en échec la rêverie d’une re-totalisation par des processus révolutionnaires que nous avons payée si cher par le passé. Ces derniers ne peuvent être, aujourd’hui, que fragmentaires. Cela tombe bien, car le monde de l’économie est lui-même fragmenté malgré les monstrueuses synthèses opérées par la valeur. Il nous faut nous réapproprier la fragmentation comme l’occasion de faire éclore des zones formatives de l’expérience. Appelons celles-ci : « communauté ». L’expérience communale est la seule arme contre la tyrannie du social, avec ses divisions, son intégration à l’économie, son anéantissement de la différence. Dès lors, l’actualité des processus révolutionnaires consiste à oeuvrer pour des agencements entre fragments. Cela, en d’autres temps, dans certaines géographies, avait pris pour nom les associations de Communes.
En France, une partie du « peuple de gauche » rêve d’une VIe République. Et donc encore et encore de se soumettre à l’incurable verticalité national-républicaine, au culte maladif des institutions et à la naturalisation de l’administration de la vie sociale. Toujours l’appel à des régimes pastoraux et à ses polices. Et lorsque l’on dit « polices » (faut-il encore le rappeler avec Michel Foucault ?) nous devons considérer celles, « positives », vouées à la production d’individus à gouverner, toujours inséparables de la police négative : celle des matraques, des flash-balls, des flingues et des prisons (cela dépend du niveau de désaveu du gouvernement). Le pastoralisme, rappelons-le, a pour tâche première d’anéantir toute velléité de « séparatisme » dans le troupeau. Nous y sommes pleinement. En ce sens la détestation de la police, dans toutes ses formes, est bel et bien une des transversales planétaires de toutes les insurrections de ces dernières années.
Cet univers policier, à entendre dans un sens large comme une composition de dispositifs, porte un nom en France : République. Je ne sais plus quel fasciste français (certainement un haut fonctionnaire de l’administration, les hauts fonctionnaires ont toujours une sensibilité fasciste) à la fin du régime de collaboration avec les nazis avait dit : « la police de Vichy fût une police républicaine ». Et il avait raison. La République française, peut-être depuis ses origines, a été l’anéantissement des Communes. Elle porte en elle pour l’éternité, dirait-on, les germes de tous les fascismes français à venir. Egalitarisme et solidarisme dans la soumission à l’appareil d’État. Car le corps social ne peut exister sans le corps d’État. Et le but ultime, suprême de l’État est, comme le disait Michel Foucault, sa propre auto-manifestation.
Oui, il nous faut en sortir : évasion comme disaient les jeunes Chiliens révoltés. Ne ratons pas l’occasion, dans la cruelle et brutale dégénérescence des pouvoirs institués. L’occasion de nous barrer. Mais en fabriquant des lieux, en nous rendant présents les uns aux autres. Surtout n’écoutons pas les chants des sirènes d’une écologie de la représentation, ni ceux d’une refondation néo-léniniste de la gauche, ni ceux du management social-démocrate sous le vernis des News Green Deals, ni pire encore, les chantres des retrouvailles avec la souveraineté populaire, cette maladie sénile du communisme.

Métropole...
La métropole (et cela depuis les physiocrates français, les premiers grands acteurs de la métropolisation), avant même d’être une question territoriale, est un lent, insidieux, brutal processus d’anéantissement des mondes pluriels et des communautés qui leur sont attachées. Aussi bien dans les villes, avec la destruction de l’« âme » des quartiers, âme faite de sédimentations, interdépendances, migrations, que dans le « monde rural » administré (et donc ravagé) par les comptes de la valeur (dont l’agro-industrie en est le dernier avatar monstrueux), ou sanctuarisé en tant que Parcs naturels. La métropole, monde infrastructurel, avec son tissage asphyxiant de dispositifs de circulation de la valeur, ne peut opérer qu’en faisant tabula rasa des modes d’existence des communautés. Dans son paroxysme, elle dégage un parfum entêtant d’atomisation, celui des petites différences dont le design permet leur mise en équivalence dans le réseau. On peut dire encore que la métropole idéale du gouvernement (mais la métropole est gouvernement) c’est un univers d’étrangeté partagée : c’est à dire le monde du partage du non partage. Le monde de la séparation.
La métropolisation n’est donc pas seulement une question de géographies urbaines, aves leurs urbanistes et architectes plus ou moins psychopathes, mais surtout d’intégration et de distribution ontologiques. L’être métropolitain parfait est l’être mondialement intégré, n’habitant nulle part mais qui peut exister partout. Au sein de la métropole rien ne doit relier différents modes d’existence si ce n’est les frottements, de plus en plus paranoïaques, au cours de leur circulation balisée. C’est ici qu’il est utile de rappeler la différence que propose Tim Ingold entre « transport » et « itinérance ». Dans le transport on va d’un point à un autre. Avec l’itinérance on fabrique des lieux. Avec le transport nous restons identiques à nous mêmes, lors de nos itinérances nous sommes transformés.
Deus ex machina métropolitain : tout se passe alors dans les scènes de la représentation, dans la manifestation de l’apparence dans un espace public peuplé de fantômes stéréotypés, déliés. C’est en ce sens que l’on peut parler de société métropolitaine, même si elle compose (composition laissée en fin de compte entre les mains de la basse police) avec les inévitables masses croissantes de gueux (les irreprésentables). Mais ce qu’oublie le gouvernement métropolitain c’est que nous avons tous un devenir gueux, un devenir itinérant, des devenirs d’inadaptés. C’est-à-dire, que ça fuit de partout, et que ça résiste, au travers d’une multiplicité de modes d’existence partagées, de formes d’entraide, de solidarités, de coopérations, d’hospitalités interstitielles qui ne se laissent pas capturer. Notre incompossibilité avec la métropole c’est notre inadaptation. L’inadaptation peut conduire à des insurrections et à des expériences que nous pouvons communiser.
Ce que nous pouvons espérer, et c’est déjà le cas dans maints endroits, partout où quelque chose de vivant a lieu et fait lieu, c’est que l’expérience éthique, donc éthopoïètique, rapport situé au monde, prenne la place de la politique. On n’attend plus de Terre promise, on n’attend plus des illuminés en mission. Nous désertons les scènes de la représentation. On veut démettre l’assemblée politique pour nous engager dans de nouvelles créations.
Partons d’un postulat : exister c’est faire exister, de telle ou telle manière, ce qui nous fait en retour exister (David Lapoujade, Les existences moindres). Alors il faut prendre acte de notre appartenance aux relations. Exister c’est instaurer un monde auquel nous appartenons. Démissionner de notre place dans le monde social c’est quitter l’ordonnancement universel de la négligence où tout rapport se vaut. C’est-à-dire : où rien ne nous engage à tenir compte des contraintes qu’imposent les existences communes. Alors « se démettre », c’est rétablir un rapport éthique au monde qui nous oblige à prendre le parti de l’attention. Et cette attention traduit le refus de la dissociation entre nos perceptions et les actes qu’elles exigent. Une multitude de gestes confirment ce mouvement éthique : prolifération des émeutes, avec leurs présences intempestives, formes de réappropriation et de partage des savoirs techniques, nouvelles manières d’habiter des lieux. Par tous ces gestes, c’est l’être social qui est attaqué pour faire place nette à la communauté. Si le mot « politique » pouvait encore avoir un sens ce ne serait qu’accolé à celui de l’expérience. Une politique de l’expérience. Et celle-ci ne peut être qu’irréductiblement ennemie de la politique sociale de la représentation.
Donc la question demeure : il nous faut avec nos créations et nos réappropriations, conjurer encore et toujours les totalisations sociales et leurs sujets. Travail de désidentification par la création de nouveaux rapports, des nouvelles communautés. Il n’y a jamais eu, et il n’y aura jamais, de sujet central de la politique. Celui-ci a toujours été l’abstraction (mortelle) des identités. Autant en tirer les conséquences et ne pas perdre de temps à vouloir ressusciter au forceps des cadavres morts-nés. Surtout ne pas laisser encore le champ libre au parasitisme de la gauche, ni aux politiques des identités en tant que ces dernières n’existent que dans un rapport spéculaire au pouvoir d’identification.
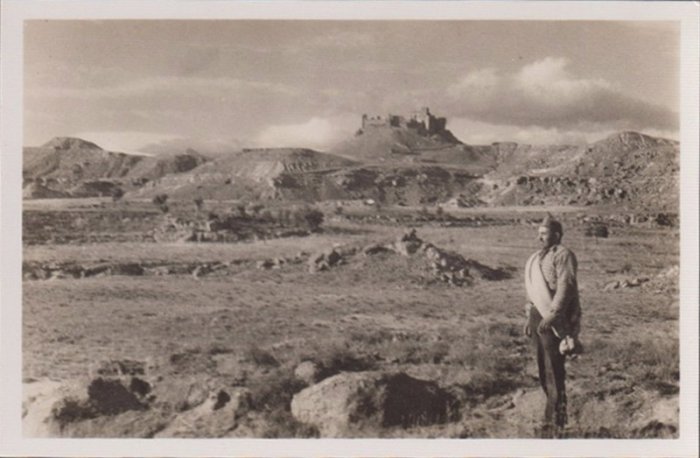
Libéral-fascisme de la dissociation...
Si l’on tente de caractériser le spectre du libéral-fascisme qui vient, partout, avec ses différents visages, de Bolsonaro à Macron, il nous faut bien admettre qu’il rend improbable la résurgence d’une quelconque centralité du conflit politique. Le libéral-fascisme est d’abord un fascisme métropolitain. Il se soutient d’une atomisation qui fait masse. Il est la forme d’un projet gouvernemental qui par un enchevêtrement de dispositifs s’attache à produire des âmes fantomatiques, des âmes spectatrices et désincarnées dans les signes d’identification qui ne tiennent que par des images. La seule chose qui devrait les relier c’est une informe négligence en fusion. Cette négligence de masse désigne un fascisme d’une nouvelle espèce, redoutablement destructeur. Ce mode générique et effroyable de subjectivation « sociale », fondé dans l’insensibilité, devient un auto-gouvernement qui accompagne sournoisement le désastre. Ce qu’il y a de dément, dans le nouveau fascisme, c’est qu’à la différence du fascisme historique, il n’opère pas par adhésion à une communauté fusionnelle et totale. Il n’est actif que comme renoncement à l’expérience fragmentaire de la communauté. Fascisme de la dissociation entre la perception, la sensibilité, la pensée et les actes qui devraient s’en suivre. C’est ce dispositif de dissociation qui permet au pouvoir d’empêcher, avec une redoutable efficacité, la résurgence du partisan. C’est-à-dire, la figure de l’amitié et du serment réunies dans le soulèvement ( Anonyme, Des forces et des vertus).
Peut-être n’est-ce pas inutile de rappeler que les vieux fascismes succédèrent souvent à la gauche, à son action de pacification, parfois meurtrière, des exacerbations de la division sociale et de ses formes communardes. Le fascisme historique fût en un sens, le plus parfait accomplissement socialiste portant jusqu’au paroxysme l’ordonnancement d’individualités in-différentes et in-divisées dans un « social » totalisé.
Si la lutte de classes conduisit à des expérimentations révolutionnaires inouïes, à chaque fois c’est la forme communarde des révolutions qui fût écrasée au nom de la société, au nom de la représentation, au nom de la politique et du Parti. Ainsi en fût-il lors du dernier affrontement radical dans le paysage européen entre le Travail et le Capital : l’insurrection italienne des années 70. On le sait, sa puissance émergea lorsque la classe ouvrière fût en mesure de se nier elle-même en tant que classe sociale productive, dans une radicale désidentification. Et alors quelque chose de parfaitement intempestif put advenir. Mais de la même manière que Mario Tronti nous dit que la classe ouvrière fut vaincue, non pas par le capitalisme mais par la démocratie (la représentation), on pourrait être tenté de dire que l’Autonomia ne fut pas vaincue par la police mais par la politique (ses scènes et sa sémiotique dégénérant en gauchisme).
Cependant, si nous ne pouvons pas regretter la disparition de la centralité supposée d’un « sujet » social, condamné à être représenté, identifié, catégorisé, diagnostiqué, faisant l’objet de prospectives par les pouvoirs institués, il nous faut considérer à nouveau l’expérience prolétarienne, et tout ce qui en elle demeure irréductible au social institué, ses communautés polymorphes, irreprésentables par le Parti et le Syndicat (« prolétariat diffus » : Nicolas Massimo de Feo, Contre la révolution politique. Netchaïev, Bakounine, Dostoïevski). On ne peut pas balayer d’un revers de la main les forces récalcitrantes du prolétariat, en tant que celui a été historiquement la plus puissante action plébéienne d’identification de l’ennemi. Il est toujours là le prolétariat. Tout comme ses ennemis.
Partout des communautés héritières de la plèbe subsistent. Pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, par exemple : l’âme polyphonique d’un quartier, avec ses formes d’obligation mutuelles et de réciprocité, foyers des insurrections. Le pire, les mafias nihilistes comme formes de communauté fermées et parasitaires de la valeur.
Pour finir. Il faudrait dire qu’aujourd’hui, malgré les discours de la gauche de gouvernement en lambeaux, nous n’assistons pas à un affaiblissement de l’État. Au contraire, nous sommes témoins de l’exaspération de son action. “Le renforcement de l’Etat et son pourrissement font bons camarades”, disait Henri Lefebvre une décennie avant la grande offensive néo-libérale des années 80. Il faut rappeler que Lefebvre était un philosophe mais aussi un géographe. Un précurseur de la critique de la métropolisation.
Fragmentation et associations : destitution
Soyons clairs : la fragmentation ne prélude en rien la détotalisation.
Nous ne pouvons pas ne pas tirer profit de l’actuelle vague d’enquêtes, recherches que l’on peut subsumer sous la dénomination aujourd’hui consacrée du « tournant ontologique ». Mais il ne faudrait pas s’y tromper. La pluralisation des milieux à laquelle nous invite cette constellation de pensée, ne saurait nous faire oublier la persistance des brutales opérations de totalisation capitalistes. Je reprenais dans un texte récent les mots de Donna Haraway dans Vivre avec le trouble : « Personne ne vit partout, tout le monde vit quelque part. Rien n’est lié à tout, tout est lié à quelque chose ». C’est vrai en termes expérientiels. Mais c’est faux en termes de dispositifs de pouvoir du gouvernement de l’économie. Il faut prendre acte que chaque chose, chaque être, reste lié au Tout par la grâce des monstrueuses opérations de composition de la valeur ; dont les réseaux en sont le dernier avatar mortifère. Dans le même ordre des choses, on peut rester dubitatifs face l’engouement pour le livre d’Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde. On pourrait croire qu’avec sa célébration des existences multi-spécifiques émergeant dans les forêts dévastées de l’Oregon, elle nous mène en quelque sorte en bateau : ce monde en fragments auquel elle nous fait accéder, composé de champignons, d’essences forestières anéanties, de néo-hobos survivants des désastres de la mondialisation marchande et des aventures militaristes impériales, n’est qu’un processus de recapture des hybridations ontologiques par le capitalisme mondialisé. S’il y a un semblant de communauté dans ce monde patchy, c’est encore sous le signe de la marchandise. Les fameux champignons matsutake, n’en finiront pas moins leur course compositioniste dans le plat d’un quelconque restaurant de luxe au Japon.
Certes, notre fragmentation à nous est communale, associative, faite de coalescences, de résonances et de savoirs-faire contrastés. Avec des connexions partielles : celles qui nous permettent de singulariser des rapports situés à nos milieux de vie. Avec le regard toujours porté vers un « ailleurs ». Mais notre fragmentation est aussi une machine de guerre contre leur fragmentation subsumée dans l’universalisme de plus en plus dégénéré de la marchandise et qui ne tient que par la pacification policière. Notre fragmentation doit créer la possibilité d’une coexistence entre les commoners et les communards : création, transmission, destitution. Destitution dans l’affrontement mais capable de nouvelles instaurations. Notre fragmentation exige des débranchements et des sabotages. Mais sa négativité réside aussi dans nos créations. Il n’y a là plus aucun ordre de prééminence.
Contre l’État et son « sujet moderne » (comment les séparer généalogiquement ?) nous, révolutionnaires, demeurons des êtres « primitifs », des êtres du dehors. Nous pouvons suivre ici Viveiros de Castro dans son commentaire de Clastres : « (…) si l’État a toujours existé, comme l’ont soutenu Deleuze et Guattari, alors la société primitive existera aussi toujours : comme extérieur immanent de l’État, force d’antiproduction toujours menaçant les forces productives, multiplicité non intériorisable par les grandes machines mondiales ». Dans ce sens il nous faudra revendiquer une dispersion permanente. Mais elle n’en exige pas moins des disciplines nouvelles ou plutôt, face à l’infamie bolchevique qui à recouvert le mot « discipline », des morales immanentes à la communauté. Ou des nouveaux devoirs (« Nous sommes prêts pour des nouveau devoirs », faisait dire Elio Vittorini au Grand Lombard dans ses Conversations en Sicile). Nous devons réapprendre à cultiver nos devoirs dans l’impérieuse nécessité de nous organiser et d’organiser nos rapports au monde.
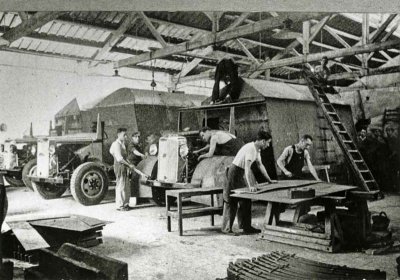
Institutions. Transitions techniques...
On nous rétorquera : il y a un impénitent infantilisme à imaginer que nous pouvons nous passer des institutions. La fragmentation qu’opère la gouvernementalité capitaliste conduit aussi à l’effondrement de pans entiers de ce que fût l’État social et dont il est vain d’imaginer que nous puissions nous passer (le revoilà un autre spectre : Hobbes contre Mad Max !). Ce sont ces institutions qui se sont appropriées historiquement du soin, des techniques, des subsistances... Je répondrai que les nouvelles formes communales doivent aussi conspirer dans les institutions. Elles doivent œuvrer à des transitions techniques à partir de la forme-institution de l’Etat pastoral ou de ce qu’il en reste (les services publics). Comment nous réapproprier le soin, comment penser des communs énergétiques, comment produire de la nourriture et nous passer des chaînes de distribution alimentaire, comment recycler des objets techniques dans le vaste champ de ruines de la marchandise… ? Certes, nos quelques idées politiques ne suffiront pas si nous sommes incapables de cultiver le moindre penchant pour la technique. Les savoirs techniques sont la condition d’une fragmentation révolutionnaire. Dans le répertoire des passions il y a la passion pour la technique : on la retrouve aussi bien chez un mécano automobile que chez un praticien du soin psy.
Mais alors, à la suite du philosophe Yuk Hui, il faudra les considérer comme des techniques situées, singularisées par des milieux eux-mêmes déterminés transductivement par leur action. Yuk Hui plaide pour des cosmotechniques. La réappropriation technique, éthopoïètique, devient alors une lutte acharnée contre les infrastructures technologiques qui nous absentent du monde. Ne nous y trompons pas : il est tout autant question de technique dans le soin (par exemple chez le chamane dans son transport auprès des êtres invisibles pour créer des nouveaux rapports à un monde singulier) que chez l’ingénieur transfuge qui met ses savoirs au service des conspirateurs communards. Ce n’et pas une question de sujets d’un côté (le soin) et d’objets de l’autre (les choses-objets) mais de techniques portant toutes également sur des modes d’existence partagés.
Que le pouvoir soit infrastructurel, comme le disaient il y a quelques années des camarades, c’est une des vérités ontologiques de notre époque métropolitaine absolutiste. Et ils eurent encore profondément raison de nous dire récemment que la révolution sera technique ou ne sera pas.
Ce qui semble nécessaire d’ajouter ici c’est que s’il n’y a rien d’inéluctable dans la téléologie d’une gouvernementalité cybernétique avec ses boucles autoréférentielles, ses feed-back et ses algorithmes, c’est parce ce qu’il y a une multiplicité de modalités de débranchement. Et que l’organisation de communs techniques est possible partout. Les « services publics » en sont une ancienne forme qui peut devenir associative, et qu’il faudrait ré-générer (« publics » : voilà la profonde erreur. Mais le goût pour rendre service, allons-nous le blâmer ?).
Antipolitique. Réalisme de la destitution (encore)...
A propos de la question destituante, au risque d’une trop grande insistance, il faut la concevoir comme une effraction dans l’ordre policier (le soulèvement) mais aussi comme l’entrelacement de formes de réappropriation de notre expérience. Pas de destitution sans l’instauration de vies communales qui mettent au travail leur incompossibilité avec la gouvernementalité des institutions sociales.
Donc gestes destituants oui, mais destituants de quoi ? Destituants aussi de ce qui, déjà là, résiste à l’institution, même si cela a lieu dans les institutions ? C’est le non-instituable, mais qui existe déjà comme forme de vie commune, y compris dans les institutions, qui nous assure de la possibilité de la destitution autrement que dans des fantasmagories solipsistes. Autrement on risque de tomber dans un contre-sens. Allons-nous nous passer en bloc de la psychiatrie, de la médecine, de certains services publics ? Il y a bien sûr urgence à abolir la police, les prisons dont il faut raser les murs et le CAC 40 à neutraliser comme une bande malfaisante de forcenés. Le non-instituable se niche dans mille détails, dans une multiplicité de plis d’expériences communes qui précédent la destitution. Il nous faut déplier ces formes de vie communales irréductibles à l’institution mais qui s’y nichent souvent. Et les manières de les faire exister, ailleurs : leur transmission. C’est un travail d’enquête au long cours, de retours d’expériences, de manières d’hériter de ce dont nous avons été spoliés et que les métastases institutionnelles détruisent. Ce travail d’enquête portant sur l’expérience est l’une des composantes d’un réalisme radical.
Les électriciens qui interviennent lors d’une nuit de tempête pour réparer des lignes électriques, les chirurgiens qui font face à une urgence dans un service hospitalier, les soignants qui prennent en charge un ami qui fait une bouffée délirante, tous ces savoir-faire partagés, les formes de coopération qui s’y expriment, le sens du devoir de ceux qui y sont attachés : tout cela fait partie du paysage des communaux en chantier. Mais il faut les désencastrer des institutions comme espaces clos de hiérarchies emboîtées les unes dans les autres, comme espace par excellence de la séparation (l’administration du social et de ses identités).
Ce dont veut nous priver la gauche, c’est de la possibilité de des-administrer les savoirs et les techniques pour les rendre communales. Représentation, gestion, délégation généralisée. Fourmilière de petites mains au service de l’Etat. Il lui faut, quoi qu’il en coûte, défendre la société. Pour pouvoir la gouverner.
Il faut cesser de croire en une politique de gauche et mesurer une fois pour toutes son effondrement éthique. C’est ce que nous a appris le soulèvement des Gilets jaunes. Moment de dissolution du clivage entre les perceptions et les actes. Refus des idéologies et destitution permanente des prétendants à la représentation balayés les uns après les autres. Bon courage aux sociologues qui s’acharnent encore à vouloir retrouver dans ce soulèvement des catégories sociologiques ! Malgré quelques maigres revendications, l’appel de certains à une nouvelle constituante, les vœux de quelques gauchistes à une « convergence des luttes », ce dont il fût question surtout ce fut de l’affirmation communale de la présence et donc de la détestation en acte des pouvoirs institués. Voilà qui nous laissa sidérés. Voilà ce qui nous entraina dans le bonheur des feux de joie dans les beaux quartiers de Paris et d’ailleurs. Voilà l’embarras des gauchistes comme des « autonomes » dans leur déliquescence avancée. Ne parlons pas de l’écologie politique effarouchée par tant de vitalité, engoncée dans sa phobie de toute négativité. Car il n’y a pas d’affirmation qui n’ait pour revers de puissantes négations.
Les affrontements avec la police et la dénaturalisation de sa légitimité, est certainement le trait commun de tous les soulèvements actuels. Ils sont le refus en acte de se laisser gouverner comme condition sine qua non de la vie en société. Nous sommes dans un champ de bataille où s’opposent deux formes de parti : le parti de la gouvernementalité renouvelée, avec ses nouvelles tentatives désespérées de retotalisation pour notre bien (La France Insoumise et les Ecolos en France, Podemos en Espagne, feu Syriza en Grèce). Et le parti insurgé, ingouvernable des Communes. J’ai proposé de nommer ce dernier par un oxymore : le Parti de la multiplicité.
« Faire différer » est le propre de l’expérience ingouvernable, rester fidèles à notre expérience, entrer dans la bataille qui oppose les corps des identités distribués dans le champ social, et les corps itinérants qui instaurent les lieux de la communauté. Des amis Chiliens appellent ceci « les parcours cinétiques de la révolte ». C’est dans ce champ de bataille que se déploie un réalisme radical qui nous contraint non pas « à être » mais à nous embarquer dans ce que nous pouvons devenir. Pas des identités donc, mais à chaque fois des positions et des déambulations qui sont aussi une inclinaison passionnelle pour la différence. Et ce mode passionnel ne peut être que celui du partage : « L’amour n’est pas concevable sans amants » disait E. P. Thompson dans La formation de la classe ouvrière anglaise. Et cela (faut-il le redire avec tant d’autres ?), dans notre époque d’effondrements écologiques, ne concerne pas que les humains. C’est le propre de notre temps d’aimer un arbre tout en nous demandant quelles sont ses manières de nous aimer.
Conjuration. Les épreuve du temps…
Surgit alors la possibilité de la conjuration révolutionnaire. Le serment que l’on se prête, nous le savons maintenant, ne cherche qu’à vouloir sauver l’amour et l’amitié qui sont les sources de toutes les révolutions. Sommes-nous encore capables de prêter serment ? Sommes nous capables des amours et des amitiés qui transfigurent ? Mais alors, comment faire pour ne pas devenir une énième secte politique, avec ses rituels autoréférentiels dégénérés. On pourrait ajouter quelque chose, c’est que tout serment véritable nous contraint à nous rendre capables de célébrer l’événement d’un « nous » qui s’affirme avide de nouvelles amitiés. Emergence de communaux : trame des expériences fragiles du partage. Ceci n’est pas une question de collectifs mais d’agencements et du soin qu’on leur porte.
(Première incise. Messianisme : on a été empoisonné par le messianisme. Si on considère avec Benjamin que la réactualisation de l’histoire est l’avènement d’un « appel » venu du fond des âges qui actualise des nouvelles déterminations de ce qui fût (et fût vaincu), on peut, oui, être fidèles à l’histoire nous projetant à nouveau dans des horizons d’attente. Les histoires des vaincus sont infiniment plus sensibles et plurielles que celle téléologique, pompeuse, satisfaite, linéaire, dégueulasse des vainqueurs. Par exemple celle que l’on a appelée le Progrès. Nous pouvons nous rendre sensibles à des horizons d’attente si nous nous penchons sur la tâche délicate de réactiver des nouvelles déterminations du passé. Ici, maintenant, en fabriquer les paysages et les passages. Ces histoires auront à nouveau leurs géographies si nous y tenons. Un ami disait récemment : il ne nous faut pas des Constitutions mais des géographies).
(Deuxième incise : dans un livre sur la Commune de Paris, l’historien Quentin Deluermoz, Commune(s), 1870-1871, fait surgir dans un passage vibrant d’intensité un aspect historiographique dans lequel se relient l’espace et le temps. Dans La Commune de Paris, il fut tout aussi question de géographies urbaines des quartiers de la ville que des spectres du temps. Les unes se déployant dans l’immanence du tissu urbain, au travers de ses sédimentations affectives, les contraintes de la coopération faisant lieu, les autres dans les rémanences d’un temps passé qui résiste et qui ne veut pas passer, à nouveau déterminé par l’actualité intempestive : du communalisme médiéval, aux guerres de religions, en passant par tous les iconoclasmes persistants contre la représentation. Ajoutons ceci : dans la Commune insurgée on détruisit la colonne de la Place Vendôme, mais on réorganisa en à peine deux mois les services postaux).
(Troisième incise : pour les catalans, être toujours des bâtards de la Guerre civile espagnole, quatre vingt ans ans après. Même les crétins de la movida espagnole le furent, alors qu’ils firent tout, y compris des mauvais films – évidement encensés – pour essayer de l’oublier en plongeant corps et âmes dans le vide sidéral de l’hédonisme. Des lignées prolétariennes persistantes dans la glaciation fasciste. Puis les années d’hiver espagnoles : le décor, l’époque balbutiante du « desarrollo » par laquelle débuta l’accordage de l’État franquiste avec le capitalisme déjà largement mondialisé. Epoque de « normalisation » du régime promue par les technocrates de l’Opus Dei. Epoque humiliante de tourisme de masse et d’émigration pas moins massive depuis les quatre coins paupérisés de la péninsule. Mais tout cela ce fut après. Avant il y eut la révolution anarchiste, ses luttes intestines, son écrasement, puis la Guerre civile : notre Oedipe à nous. Des obscurs secrets de famille, des souffrances si chères payées, les tribus issues de la débâcle post-révolutionnaire. Souvent, les seuls secrets de famille qui comptaient, portaient sur le souvenir proscrit de l’anarchisme, des trahisons, des collaborations qui avaient fait exploser les communautés de quartier et de village, l’héritage de la gauche anti-franquiste assis sur les basses oeuvres staliniennes d’un Parti communiste espagnol ayant mis la main sur le dernier gouvernement républicain, malgré son insignifiance dans le paysage révolutionnaire.
Mais pourquoi s’attarder sur ces histoires familiales dévastées. Cela pourrait être grotesque si ce n’était que c’est l’endroit, un endroit, depuis lequel il est possible de se ressaisir d’un entrelacement de mondes et de leurs rémanences historiques. D’essayer d’échapper à la tyrannie du présent. Ne pas se débarrasser des bifurcations ratées de l’histoire, ne pas poursuivre l’oeuvre renégate qui conduit au désaveu de l’actualisation des mondes écrasés. Nous appartenons au monde vaincu du prolétariat, qui persiste dans ses devenirs révolutionnaires. Quelque soit le côté où l’on se place. Oui, là encore, radicalisation de l’expérience dans une pluralité de temps historiques).
Les insurrections arrivent et passent, avec ses cadavres célébrés ou anonymes. Les révolutions insistent. Il en va de passés qui ne passent pas. Nous sommes tous des survivants d’anciennes histoires révolutionnaires. On pressent aujourd’hui la résurgence d’anciennes lignes prolétariennes qui sont autant de nouveaux chemins à frayer. Cela n’a rien à voir avec la lutte des classes. A nous de les cultiver, nous les communistes plébéiens sincères. Personne ne le fera à notre place. Ce n’est pas une affaire d’avant-gardistes mais de conjurés qui se promettent de mettre en partage les perceptions d’une archéologie du futur. Sans cela il n’y a pas de transmission. Pas de communauté possible. Après-tout, la condition d’existence de toute insurrection digne d’être vécue réside dans le tissu des vie communales dont nous avons hérité pour sortir du présentisme du présent.
Radicaliser notre expérience, c’est y rester fidèles, non pas par une stupide loyauté parfois meurtrière, mais par la joie que nous procure la co-appartenance à une situation qui est toujours une réactualisation des histoires anciennes – et les rendez-vous cachés entre les anciennes générations et la nôtre, comme nous le disent les mots lancinants de Benjamin.
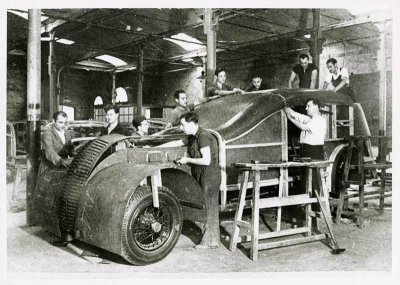
L’illimité de la partialité...
Tout est à notre portée ? Il faudra considérer de quoi « tout » est le nom. S’il est le nom des processus de totalisation, évidemment, non seulement ce tout n’est pas à notre portée mails il nous faut le refuser. Faut-il encore épiloguer sur les limites de la planète au regard de la totalisation marchande et de son cortège de destructions ? Mais sur un autre plan, faut-il, en suivant le puritanisme très catholique de la psychanalyse, obnubilée par la jouissance impossible, restaurer le sujet et sa limite fondatrice dans un manque-à-être doloriste ? Il ne nous manque rien ; il n’y a aucune limite si nous tenons à l’infinie variété de l’expérience dont nous ne sommes qu’une cristallisation, avant de devenir le parcours des expériences des autres. Alors, même la mort n’est plus une limite. « Je » n’est pas un Autre. Mais juste un passage pour, et « vers » les autres dans l’instauration fragmentaire de la communauté.
Mais on pourrait pourtant dire de chaque fragment qu’il contient en lui sa propre totalité, pris dans des multiplicités génératives : « le fragment est, au sens strict, un acte, une production, et même une productivité ; il est à la fois germinal et génératif : il essaime et il cultive », « (…) il ne disperse pas sa mise en œuvre, il ne la fait pas éclater, se morceler ; il la rend plurielle, nombreuse, la plus nombreuse possible ». (Daniel Wilhem, Les romantiques allemands). Il y a dans la fragmentation la possibilité d’infinies variations de ses connexions partielles. Dans ce sens, oui, tout est à notre portée. Mais il faut quitter les schémas de la causalité. Les causes ne sont jamais suffisantes, elles ne suffisent jamais à expliquer la variété des conséquences. Dans ce sens si tout est à notre portée c’est que nous ne sommes plus dans une logique du fondement, mais dans les formes génératives de la possibilité issues de la rencontre entre des différences. Le tout des multiplicités surgit par hétérogenèse : le monde redevient alors infini.
Ajoutons ceci : la limite ce n’est plus ce qu’il faut penser mais affronter (David Lapoujade, Deleuze, les mouvements aberrants), ce qu’il faut franchir. Isabelle Stengers nous dit aussi dans Réactiver le sens commun, que « respecter une contrainte ce n’est pas accepter une limite ». Mais parfois, l’attention portée à la contrainte nous amène à ne pas franchir une limite. On y renonce pour laisser vivre un monde dans lequel nous sentons que faire intrusion reviendrait à y amener des dévastations. Cela demande du tact, une attention scrupuleuse aux modes d’existence des fragments qui peuplent le monde de multiplicités. Ne pourrions-nous pas dire alors que le tact est une manière de cultiver le goût pour les versions, c’est-à-dire pour les traductions des rapports au monde, infinies dans leur possibilité ? A condition d’accepter que toute traduction renouvelle à chaque fois notre appartenance à une situation, nous transfigurant en nouveaux narrateurs. La traduction est le récit d’un retour d’expérience circonstancié auprès de ceux qui veulent l’entendre (« Ainsi adhère à la narration la trace du narrateur comme au vase en terre cuite la trace de la main du potier. Tout narrateur à tendance à commencer son histoire par une relation des circonstances dans lesquelles lui-même a appris ce qui va suivre ». W. Benjamin, Le narrateur).
Prenons un autre exemple à propos des limites : la question du temps. Le temps linéaire de la production, de la « croissance » infinie qui nous conduit non pas à la jouissance infinie mais à la limitation de nos rapports aux multiplicités par homogénéisation et destruction. Par contre les temps relatifs aux relations entre les êtres, les temps fragmentaires de la pluralité des modes d’existence sont, eux, infinis ! Donc oui : tout est à notre portée si nous ne prétendons pas au Tout, si nous cultivons la partialité. De fragment en fragment, il y a des singularités qui surgissent de leurs connexions partielles. Les compositions qui en résultent sont infinies à la mesure de leur partialité.
Rien n’est à notre portée si nous ne croyons pas en notre expérience. Le reste, (tout le reste, c’est-à-dire les infinies compositions possibles de l’expérience) est oeuvre de tact et de traduction. La voilà la seule limite : elle se situe dans les lieux d’effectuation d’un retour de l’expérience. Si je n’existe que de faire exister d’autres êtres qui en retour me font exister, c’est que ceux-ci dans leur mode d’existence, m’indiquent des nouvelles manières possibles d’habiter un autre monde. Et des manières de revenir à celui que j’ai quitté.
S’inscrire dans la réalité exige, non pas des limites mais des modes d’appartenance. Or, on n’appartient jamais seul au monde. C’est l’infirmité ontologique de ce que nous avons appelée Modernité – cette étrange conception d’une autonomie comme détachement – qui est parvenue à nous le faire croire. Ah ! le rêve maladif de l’autonomie, alors même que celle-ci n’est rien d’autre que la succession de nos interdépendances situées contre l’hétéronomie sans lieu !
Faire vivre l’expérience est une lutte très inégale contre les forces de totalisation qui sont aussi celles de la dépossession. Nous avons été abreuvés depuis presque trois mille ans par l’idée burlesque de l’autonomie comme fondement, l’égalité jouant sa scène dans l’espace clos de l’assemblée, celui où la rivalité politique prétend totaliser la cité des égaux (c’était évidement une question très masculine) tous également désincarnés. Le tout érigé en politeia totalisante. Du démos grec à l’ecclesia chrétienne, aux avatars ensuite du Leviathan étatique, dont l’infâme parlementarisme comme « chambre à part » depuis laquelle on lorgne vers le « peuple » : dégoûtante pornographie de la représentation.
Le choix de la différence.
Contre cette tradition malfaisante du tout de la représentation, il nous faut un sursaut éthique qui ne peut avoir lieu sans des cultures qui situent nos attachements. Mais ces attachements exigent aussi leur part de détachement. Détachement des formes sociales qui nous font vivre en faisant vivre en nous la totalité (même divisée : cela n’y change rien). Re-attachement aux formes communales que nous faisons vivre. Au fond, la seule limite est celle du choix, de la décision. Choisir ceci plutôt que cela. Et considérer une décision comme l’irrévocable radicalisation de notre expérience (à propos du choix comme hypothèse vivante, William James disait dans La volonté de croire : « Dire d’une hypothèse qu’elle possède le maximum de vie, c’est dire qu’elle dispose à agir irrévocablement »). Contre le scepticisme choisir toujours la croyance.
Il faudrait ajouter ici quelque chose : que tout choix est inséparable d’un univers normatif dans lequel la culture du partage, de la réciprocité rendent possibles des variétés singulières de l’expérience. Autrement dit la différence. La norme n’a jamais reposé dans des limites, des fondements, la transcendance de la Loi. Elle est l’effet des machines productives et immanentes de la communauté, elle surgit à même le sol de nos affections, de nos sensibilités, de nos perceptions. Elle fait toujours différer. C’est au travers de nos dépendances que naissent nos transfigurations. C’est par des transfigurations que nous sommes en mesure de sédimenter nos valeurs communes, dont celles des limites que nous acceptons.
Le « tout » inépuisable dans ses variations ne réside pas dans l’espace de l’assemblée, collection de sujets s’époumonant avec des subterfuges vicieux pour clouer le bec de leurs égaux également indifférents, mais dans les lieux de la métamorphose. La polis, et ses démocrates boursoufflés d’importance, nous lui opposerons les mystères et les transformations de la khôra. Pas besoin pour cela d’une Arcadie fantasmée. La khôra persiste aujourd’hui dans les forêts et les campagnes, même abîmées, tout autant que dans nos quartiers les plus ordinaires en cours de gentrification.
Les voilà nos seules limites révolutionnaires si nous ne voulons pas reconduire les désastres des anciennes révolutions. Tout est toujours à recommencer. Il n’y a pas de Terre promise, ni de communisme dans le ciel limpide des idées. Le communisme n’est pas une idée, il est toujours une pratique de communisation, c’est-à-dire le mystère de nos transfigurations. Celles-ci sont sans limites. Mais éprouver un monde c’est toujours une épreuve qui exige de nouvelles déterminations.
Fin du du sujet souverain. La thérapeutique.
Il y a un passage dans la Théorie du Bloom qui demeure des années plus tard d’une extrême justesse – même si on peut reprocher à ce texte brillant une réification quasi ontologique du simulacre et, en retour et par contraste, de « l’exil » censé s’incorporer en communauté. Il s’agit d’un passage où il est question de la « république bourgeoise » comme forme accomplie de la séparation (mais on pourrait dire que la Métropole – ils le disent aussi – en est le dépassement, en pire) : « En elle, de manière inédite, l’existence de l’homme en tant qu’être singulier se trouve formellement séparée de son existence en tant que membre de la communauté ». Mais sans vouloir fonder avec ce constat un quelconque aristocratisme critique, il semble difficile, dans notre actualité, de ne pas questionner et de mettre à l’épreuve ce que peut être la communauté retrouvée à l’âge de l’atomisation des réseaux et du fascisme nihiliste de la marchandise (c’est devenu la même chose). Dans ce sens, on pourrait reprendre un autre passage du même texte : « (…) nous persistons à assumer l’hypothèse extérieure de notre identité à nous-mêmes ; nous jouons au sujet ». Je me permets de convoquer ici, en résonance, ce que j’avais écrit en 2011 dans En finir avec le capitalisme thérapeutique, (« Fragments : communisme de la guérison ») : « Tout processus thérapeutique, avant de débuter par des concepts, s’engage dans des perceptions : plutôt qu’un univers de représentations, une pensée concrète de l’intentionnalité, là où la conscience vise quelque chose et, s’ouvrant à autre chose qu’elle même, est visée par les choses ». La thérapeutique est le soin porté, non pas à des sujets, mais à des relations. La communauté est une thérapeutique sans fin. La thérapeutique est l’épiphanie de fragments de communautés, ses nouvelles coalescences. Et ainsi de suite, sans fin. D’ailleurs, « Thérapeutes » était le nom donné par des Grecs à une secte essénienne dissidente exilée dans le désert qui se vouait au rapport égalitaire à Dieu. Avec la thérapeutique on a affaire à des relations. Elle est relation « à »… à Dieu, à des divinités à des humains et à des non-humains. Elle n’a rien à voir donc avec des collectifs en tant que ceux-ci sont une collection de sujets.
Toute thérapeutique digne de ce nom prend soin des relations qui font un monde. Il faudrait préciser alors, et aller plus loin comme le fait Isabelle Stengers : non pas des « relations » (on est ensevelis par des relations, on croule sous les relations dans un monde quadrillé par les réseaux) mais des rapports. Des manières de se rapporter au monde et à l’hétérogénéité des êtres qui peuplent le monde. Ou la possibilité de transfigurer nos manières d’exister. Si on n’existe que de faire exister, c’est que les relations n’ont pas affaire à des individus déjà individués mais à des zones formatives de l’expérience d’où surgissent les devenirs de l’individuation.
Pour cela il faut croire au monde. Ecouter ses appels. Mais c’est là une autre histoire, celle de la lutte à mort contre toute idée de souveraineté. Celle du sujet souverain comme condition d’existence de l’État moderne qui n’existe pas à son tour sans ses sujets à gouverner. Pas de société sans gouvernement. Et inversement, pas de gouvernement sans société et ses sujets. Et le meilleur sujet à gouverner est celui qui prétend à sa propre souveraineté : cruelle fiction d’un gouvernement de soi-même !
Nous ne sommes toujours pas sortis, dans ce sens, du précepte kantien rappelé ironiquement par Deleuze et Guattari dans Mille plateaux : « Obéissez toujours, car, plus vous obéirez, plus vous serez maître, puisque vous n’obéirez qu’à la raison pure, c’est-à-dire à vous-mêmes ».
A l’encontre de l’être du jugement, sujet d’une connaissance a priori, sujet du fondement : les êtres de la possession. Des êtres qui avec d’autres êtres trouvent leur manière d’exister dans les troubles de la possession. Sortir de la modernité et de ses désastres se résume peut-être à cela : en finir (encore) avec le jugement, celui de Dieu ou celui de la Raison, et avec l’autonomie du sujet comme fondement. Mais pour cela Il faut entendre les appels du monde.
A bon entendeur, salut.
Bonjour. Peut-être pourra-t-il apaiser
l’obscur vent, et que plus lentes,
suaves, accompagnées,
puissent venir les heures nouvelles
d’aujourd’hui.
Salvador Espriu, Mrs. Death
Josep Rafanell i Orra
(Ce texte est une version rémaniée d’un entretien pour la Revista Disenso, Santiago de Chile, réalisé par Gerardo Muñoz. Il paraîtra dans le prochain n° de la revue Parades).






