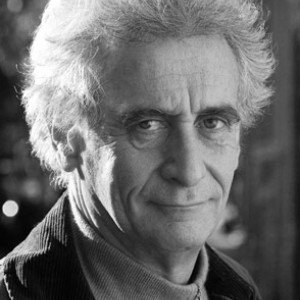A la démarche de l’anthropologue qu’elle est, le parti-pris du récit à la première personne ajoute une forme d’auto-analyse qui, tout en ajoutant une dimension émotionnelle bienvenue, ne l’éloigne pas d’une démarche rigoureuse et scientifique. A plusieurs reprises, Alpa Shah évoque son propre parcours de fille de migrants indiens au Kenya, qui y a connu une enfance privilégiée mais aussi les restrictions patriarcales, avant sa vie d’adulte à Londres. Comme le dit l’éditrice : « Le fait qu’elle soit indienne, mais aussi britannique, racisée et « occidentale », femme dans un monde d’hommes, dans l’escadron mais extérieure à lui l’aide à en décrire admirablement les rapports sociaux, n’oubliant pas de s’interroger sur le genre, la caste, la classe, dont les oppressions restent à l’œuvre dans un mouvement qui se réclame pourtant de l’égalité. »
Eprouvant vite dans ses propres muscles que cette forme de guérilla dans laquelle elle s’est plongée « ressemble à une marche d’endurance éternelle consistant, en chaque lieu, à essayer de survivre tout en effaçant sa présence », elle va découvrir, d’un parcours nocturne à l’autre, qu’on peut s’endormir et continuer à marcher. Expérience qui repose toute entière sur la puissance du collectif : seul, l’endormi tomberait. Mais dans cette file où chacun s’attache au pas de l’autre, l’ensommeillé reste constamment porté en avant, littéralement ou pas. L’auteure va même découvrir qu’un chef naxalite peut dormir tout en continuant à défendre la juste ligne de l’organisation : c’est ainsi, rapporte-t-elle qu’elle se retrouve à argumenter avec Gyanji, l’un des chefs de la rébellion, à qui elle déclare ne pas comprendre pourquoi il « idolâtre la famille monogame », et lui de marmonner dans un demi sommeil : « anarchie sexuelle ». « Il peut discuter avec moi toute la nuit dans cet état de somnolence », raconte-t-elle, « et, le lendemain, se souvenir de chaque mot échangé tout en m’assurant qu’il a très bien dormi ».
Gyanji, le rejeton d’une haute caste qui a voué sa vie à la Cause, est un des personnages auxquels Alpa Shah nous attache avec un talent de description que bien des romanciers lui envieraient. A chacune de ces figures est dédiée une partie du récit. Ainsi de Vinkas « le monstre de Frankentstein » et de Somwari, incarnation de la lutte contre le patriarcat. Le destin du premier, qui finira par passer à l’ennemi, comme celui de la seconde, que son goût de la liberté conduira en prison, quoique à l’opposé l’un de l’autre, sont ensemble représentatifs des contradictions du mouvement naxalite.
Le naxalite et son monstre de Frankenstein
Confrontés, suivant la théorie maoïste de prise du pouvoir, à la nécessité de s’appuyer sur les luttes paysannes avant, dans un deuxième temps, de marcher sur les villes, les naxalites se sont tournés vers les adivasis. Ces premiers habitants de l’Inde – 104 millions de personnes, 8,6% de la population du pays, répartis par le pouvoir en 700 « tribus répertoriées » vivent principalement dans des zones forestières menacées par les industries extractivistes (charbon, fer et autres minerais) où les résistances sont anciennes. Pour assurer leur pouvoir, ces marxistes-léninistes, qui ne sont pas opposés à l’industrie minière en tant que telle mais partisans de la placer sous le contrôle de la population, se sont insérés dans le tissu de l’économie informelle, c’est-à-dire dans les réseaux de la corruption qui, depuis les sommets des grandes compagnies jusqu’aux derniers petits sous-traitants de village, contrôlent les échanges. Là où ils arrivent à s’imposer, ils prélèvent leur dîme, qui servira à financer l’organisation, et imposent des priorités au profit des villageois. Pour ce faire, ils ont recours à des intermédiaires qu’ils choisissent de préférence chez les jeunes adivasis.
« Mais dès lors que des jeunes adivasis (…) fréquentent ces réseaux d’élite des hautes castes en voie d’ascension sociale (…) ils peuvent tourner le dos à leurs milieux familiaux modestes. Les distances qui les ont traditionnellement séparés de l’Etat et de ses émissaires sont alors abolies et ils peuvent se transformer en machos ambitieux qui imposent leur autorité autour d’eux en prenant du ventre. (…) Ainsi, il y a quelque chose d’ironique dans le fait que ce mouvement œuvrant pour le communisme ait involontairement rapproché l’Etat du quotidien des adivasis, accéléré le déploiement des valeurs capitalistes et des hiérarchies de castes parmi eux, affaiblissant par là même ses propres idéaux politiques. »
A ce phénomène de fond s’ajoute la persistance, au sein du mouvement, de différenciations de caste qui engendrent bien des frustrations, sansoublier le goût universel des gauchistes pour les ruptures sur des questions dogmatiques dissimulant des enjeux de pouvoir. En conséquence, dans l’histoire du mouvement, des scissions apparaissent régulièrement, dont certaines se transforment en gangs ennemis des naxalites, rackettant pour leur propre compte, et massacrant leurs ex-camarades au service du gouvernement. Tel sera le cas de Viskas, créature du mouvement qui lui a échappé et s’est retourné contre lui.
Somwari contre le patriarcat
« On m’avait appris que les adivasis étaient parmi les peuples les plus pauvres de la planète », raconte Alpa Shah, « pourtant, au cours des années passées dans ces communautés, ceux et celles qui sont devenus pour moi comme des parents m’ont fait connaître un monde de richesses infinies. Un monde où les femmes parcourent les forêts et les champs à leur guise, où les hommes font la cuisine et le ménage, où les enfants passent leurs journées à se balancer sur des lianes, à pousser des charrettes de foin et à se régaler de fruits sauvages. Un monde où l’autonomie individuelle et la créativité sont valorisées sans qu’on cherche à s’élever au détriment des autres. »
« Les adivasis avec qui j’ai vécu s’entraident pour construire leurs beaux villages en utilisant la terre, le fumier et le bois qui les entourent. (…) Leur nourriture –issue de la collecte de centaines de fleurs, de feuilles et de champignons différents, de la chasse et de vin distillé à partir de fleurs de mahua, susciterait l’admiration de tout chef étoilé du guide Michelin. Les adivasis, qui ne laissent derrière eux qu’une trace discrète de leur présence, avec leur empreinte écologique négligeable et leurs pratiques démocratiques, incarnent non pas le passé, mais l’avenir. »
Dans ces sociétés, les femmes sont bien plus autonomes par rapport à leurs partenaires, bien plus les égales de leurs maris que dans les familles de la bourgeoisie et des hautes castes indiennes, d’où sont issus la plupart des cadres du mouvement naxalite. Et il y règne aussi une liberté sexuelle fort éloignée du puritanisme hindou ou militant. D’où un grave hiatus quand les chefs naxalites (presque tous mâles) envoient leurs très jeunes militantes prêcher un féminisme qui inclue la destruction des réserves d’alcool, cet alcool que les femmes adivasis ont fabriqué et consommé lors des foires, pendant que leurs maris tenaient la maison, et d’où elles reviennent le plus souvent pompettes ! Si la consommation d’alcool, dans les castes subordonnées des villes accompagne et seconde la misère, et entretient aussi la violence des rapports patriarcaux, il n’en est rien dans les communautés traditionnelles adivasis. Le hiatus est grand aussi quand l’organisation prétend interdire les relations sexuelles hors mariage, à un peuple où les jeunes disposent d’une hutte réservée, le ghotul, où ils se réunissent pour chanter, danser et dormir ensemble. Un peuple où les femmes peuvent avoir plusieurs partenaires sans subir de sanctions sociales. Alors que dans l’organisation, un couple désireux d’avoir des rapports intimes doit demander à la direction la permission de se marier.
Le compagnon de Somwari ayant été dans un premier temps contraint par sa famille à un mariage arrangé, sa femme « légitime » a fini par obtenir qu’elle soit envoyée pour trois mois en prison. Somwari, après avoir été compagne de route de la rébellion naxalite, est devenue adepte d’une secte spirituelle hindoue. « …peut-être est-ce pour Somwari une tentative désespérée de rassembler tous les aspects de sa vie. L’ironie est que cette secte, dont la percée est indissociable de celle de l’extrême-gauche (les maoïstes), pourrait se révéler infiltrée par l’extrême-droite, l’hindutva. »
Au moment de la rédaction du livre, Gyanji, le chef érudit et charismatique, fait prisonnier, était régulièrement déplacé de prison en prison, dans l’attente d’un procès où l’attendaient 40 chefs d’inculpation. De ce qui précède, on pourrait conclure qu’il n’a fait que rêver les yeux ouverts – ou marcher les yeux fermés, en espérant, par ses sacrifices et ceux de ses compagnons, préparer la voie à une société reposant sur l’égalité et la solidarité. Ce serait ne pas rendre justice aux trésors de générosité, de combativité et d’empathie pour les plus faibles que des générations de naxalites ont accumulé en un demi-siècle. Tout au plus peut-on conclure que la doctrine marxiste-léniniste dans sa version maoïste, en faisant l’impasse sur l’expérience mortifère du maoïsme chinois, était, dans son rapport à la réalité, porteuse de contradictions et de malentendus délétères.
Mais rien ne saurait ternir pour nous l’enthousiasme d’un Gyanji citant au milieu d’une marche nocturne le passage sur les abeilles dans le Capital pour illustrer cette increvable capacité humaine à tenter, encore et toujours, d’imaginer un autre monde. Marcher, marcher encore…
Bonnes feuilles
[…]Ce jour-là, Gyanji me donna quelques éléments de réponse à une question qui m’avait toujours laissée perplexe : qu’est-ce qui conduisait des individus brillants comme lui à couper froidement tout lien avec leur passé pour quelque chose qui n’était qu’un rêve, voire une illusion ? Qu’est-ce qui leur donnait la force d’encaisser les pertes et de continuer à lutter, en engageant totalement leur vie dans une voie qui pourrait ne jamais se matérialiser et sans aucune perspective de reconnaissance personnelle ?
Clairement, l’indignation face à l’exploitation, les inégalités et les discriminations ne suffit pas à l’expliquer. La rage qui peut étreindre un certain nombre d’entre nous face à ces phénomènes nous plonge plus souvent dans l’abattement qu’elle ne nous donne l’espoir de pouvoir changer le monde. La conviction de détenir la bonne solution idéologique n’est pas non plus une explication suffisante. Comme le révélaient les doutes mêmes de Gyanji, il y avait eu de nombreux débats internes sur la façon d’analyser l’économie indienne et sur les stratégies à adopter. Dès lors, quel ressort intellectuel leur faisait ressentir le besoin de se battre pour une communauté humaine utopique, de consacrer leur vie entière à lutter ensemble dans un contexte si hostile ?
La notion de sacrifice à laquelle Gyanji avait fait allusion paraît déterminante pour entretenir le rêve d’une communauté humaine idéale. S’il a jadis été conçu comme un moyen d’apaiser et de se concilier les faveurs des dieux, des penseurs de la fin du xixe siècle ont fait du sacrifice un concept plus vaste que la distribution d’offrandes aux divinités. D’un principe essentiellement religieux il est devenu un moyen décisif d’investir un monde imaginaire considéré comme sacré, un au-delà, et de faire porter son influence sur le monde du quotidien qui, lui, est prosaïque, fugace et ordinaire [1].
Ainsi envisagée, l’idée de sacrifice peut prendre la forme d’une force créatrice exceptionnelle. Elle permet aux individus de transcender et de dépasser le monde ordinaire qui est le leur, de s’unir par l’imagination à un univers différent, extraordinaire, de façon à insuffler la vitalité de cet idéal dans la réalité présente. Les personnes qui s’offrent en sacrifice peuvent nouer entre elles des solidarités nouvelles fondées sur l’idée de ce monde extraordinaire à venir, ce qui en retour permet d’incarner dans la vie quotidienne la communauté humaine utopique qu’elles imaginent.
Les dirigeants naxalites comme Gyanji sont issus de familles relativement riches des castes dominantes et étaient précisément destinés à perpétuer les systèmes et les idées que condamnent les révolutionnaires. Leurs familles possèdent de vastes territoires et ont hérité d’une longue histoire d’exploitation et d’oppression de la main-d’œuvre des basses castes. Elles conçoivent l’éducation comme un moyen d’élévation personnelle qui permet aux jeunes générations d’occuper des postes dans les administrations publiques ou les grandes entreprises, de se faire construire des maisons et des appartements en ville pourvus de nombreux domestiques. Certaines envoient les enfants étudier aux États-Unis ou en Angleterre, souvent afin de décrocher des masters et travailler à New York ou à Londres, parfois afin de regagner l’Inde avec de nouvelles idées pour amasser des profits et se glisser confortablement dans les échelons supérieurs d’un pays profondément ségrégué. Malgré certaines exceptions, la majorité de ces familles se sont ralliées à un monde qui célèbre l’individualisme et l’accumulation matérielle et qui reproduit les inégalités. Pour les leaders naxalites chargés de ce fardeau transmis par leurs milieux privilégiés, il a été crucial de rompre avec leurs proches, d’ensevelir leurs histoires personnelles et de faire disparaître ceux qu’ils avaient été pour donner naissance à un autre monde.
D’un bout à l’autre de la planète, la plupart des actes de sacrifice passent par une violence à la fois matérielle et symbolique – mutilation physique, abattage d’animaux, consommation de nourriture – dans laquelle la chair mutilée, l’animal ou la nourriture symbolise les humains qui sont à l’origine de l’offrande. De tels rituels sont une représentation métaphorique de la destruction d’un univers quotidien prosaïque. Ils consistent à se tuer symboliquement pour participer à la création d’un univers moral immortel destiné à investir, transformer et absorber le monde présent.
En tant qu’élément-clé du sacrifice, cette « violence en retour » nie le monde quotidien pour permettre à ses participants d’atteindre une dimension qui transcende ce dernier puis le colonise par ces idées transcendantes [2]. Loin d’être inhérente aux personnes, cette violence témoigne d’une tentative de créer un monde différent de celui dans lequel se déroulent nos existences quotidiennes.
Les finalités surhumaines pour lesquelles se battent Gyanji et ses camarades – la création de communautés égalitaires et démocratiques ici et maintenant – sont si antagonistes avec les valeurs du monde environnant que le coût humain de leur réalisation est considérable. De fait, comme bien d’autres leaders que j’ai rencontrés, Gyanji est préparé à une mort violente. Pas au combat, puisque les confrontations sont rares dans la guérilla, mais en garde à vue. Plusieurs de ses camarades ont été arrêtés en ville, interrogés sous la torture et exécutés hors de tout cadre légal – pour être ensuite déclarés morts dans une « fausse embuscade ». Gyanji le sait : aux yeux de la police, dont l’objectif est de « décapiter le mouvement », c’est un leader bien trop important pour être laissé en vie. Mais quelle que soit la manière dont meurent les rebelles, comme dans toute entreprise révolutionnaire, la forme de sacrifice suprême est le don de la vie elle-même : le sacrifice humain. Quand les révolutionnaires se sacrifient et sacrifient le monde qui les entoure pour bâtir leur idéal, la mort et la destruction sont elles-mêmes régénératrices de vie et se muent en forces créatives.
Le contraire du sacrifice est le suicide. À propos d’un ami qui s’était pendu à un ventilateur, Gyanji avait commenté avec mépris : « Quel acte égoïste et individualiste ! Ça ne sert à personne. Ça ne crée rien, ça ne construit rien, ça ne contribue à rien. Il est plus difficile de lutter contre la pensée individualiste et égotiste que de lutter contre l’ennemi. » Gyanji semble voir le suicide comme une manière de quitter un monde moral sans avoir cherché à en créer un autre [3]. Comme la conséquence d’un état dans lequel on est livré à des passions et des désirs insatiables sans pouvoir les assouvir, faute d’un projet créatif capable de les façonner et de les porter.
C’est probablement du fait de cette centralité du sacrifice que les festivités les plus importantes du mouvement comportent des rituels aux martyrs : on les célèbre en novembre à l’occasion d’un festival dans les villages autour des bastions naxalites. Le Jour des martyrs commémore les individus qui ont sacrifié leur vie à l’édification d’un nouveau monde moral, devenant par là des corps célestes immortels qui ouvrent la voie, transmettent le rêve d’une société future et engagent les autres à son accomplissement. Le martyre sublime les émotions provoquées par la mort brutale des camarades dans la lutte : d’une faiblesse sentimentale elles deviennent une puissante force de création.
De plus, même si ces camarades ont eu des parcours de vie complexes et ambivalents, et même si le vrai nom du défunt n’est révélé publiquement qu’après son décès, le rituel aux martyrs mythifie cette existence à travers la mort et lui confère une perfection légendaire. Les histoires de martyrs ont toutes un thème commun : des femmes et des hommes courageux se sacrifiant pour le peuple, menant une vie simple parmi les pauvres, se ralliant à leurs combats. Chaque martyr est paré de générosité, de gentillesse et d’altruisme, considéré comme ayant toujours méprisé l’intérêt personnel, la classe ou la caste. On abstrait à travers lui l’idéal du parfait révolutionnaire, celui qui lutte pour la cause des opprimés et représente le monde utopique de l’avenir.
On comprend dès lors que le sang versé par ces milliers de martyrs du mouvement revête une telle importance pour des révolutionnaires comme Gyanji. Non seulement les camarades morts impliquent la perte de personnes qu’on a connues en tant qu’individus, mais ils sont aussi ce qui ancre le monde idéal à venir dans la réalité de tous les jours. Le poids des martyrs est un héritage ; il est ce qui incite les membres du mouvement à s’améliorer constamment, il cristallise une forme de perfection humaine.
Des martyrs vivants – est-ce ce que sont les personnes comme Gyanji, qui ont renoncé à leur vie, rompu avec leur passé pour créer un monde plus égalitaire et démocratique ? Suspendus entre les vivants et les morts, attendant leur heure, ils préfigurent le nouvel avenir et tentent d’en incarner le sujet idéal.
Plus je méditais sur la singularité de ces leaders naxalites, plus je me surprenais à repenser à ces dimanches après-midi à Nairobi, quand mon grand-père me traînait dans ces temples jaïns ornés de marbre, au milieu des moines, pour honorer les divinités. Nous allions parfois au temple digambara [4], où je gardais les yeux baissés car les moines, dans leur quête de libération, s’étaient dépouillés de tout, sans exception. Ils symbolisaient la sagesse au sein de cette société traditionaliste, mais il n’en était pas moins choquant, pour une enfant, d’être exposée à leur nudité. Quelques jours seulement avant d’entamer cette marche avec Gyanji, pendant le trajet en bus qui m’amenait en territoire naxalite dans le Bihar, j’avais aperçu une file de moines nus marchant au bord de la grande route. Ils ne mangeaient que ce qu’on leur offrait et ne portaient absolument rien.
Y avait-il une continuité entre la figure du révolutionnaire communiste et cette longue histoire indienne de libération par le renoncement ?
Il s’avéra que je ne m’étais pas trompée en établissant cette comparaison entre ascètes et révolutionnaires. Comme plusieurs autres leaders rencontrés, Gyanji avait suivi la voie hindouiste de renoncement à ce monde hiérarchique en quête de sa libération personnelle. À l’adolescence, il était devenu végétarien. Il avait rejeté tous les biens matériels, sauf la nourriture et les vêtements les plus basiques, et s’était détourné des filles, faisant vœu de célibat. Il passait son temps à lire des textes védiques [5] et à contempler le couchant sur les rives du Gange, espérant une illumination divine. Tel un yogi*, il attendait que lui soit révélé le moyen de s’échapper de ce monde et de ses cycles perpétuels de renaissance, espérant une libération qui lui aurait donné accès à un autre monde égalitaire – le nirvana.
La figure de l’ascète yogi joue un rôle particulier dans la cosmologie indienne [6]. S’ils sont peu nombreux, et si la plupart d’entre eux sont des hommes des hautes castes, toute personne, quels que soient sa caste ou son genre, peut devenir ascète [7]. À une extrémité du spectre, on trouve des moines qui vivent nus ou presque nus et portent le crâne rasé ou couvert de mèches entortillées et durcies. Ils ne vivent que de l’aumône et passent des heures à méditer dans une solitude totale [8]. À l’autre extrémité se trouvent les ascètes qui consomment de la chair humaine et des excréments, forniquent avec des prostituées, comme les aghoris de la ville de Bénarès qui prêchent une égalité radicale en refusant toute distinction entre le brahmane et l’intouchable [9]. Tous ces ascètes aspirent à une connaissance transcendante qui les libérera individuellement du temps et du cycle infini de la souffrance et de la renaissance pour leur faire accéder à un nouveau monde d’égalité [10].
Mais Gyanji m’expliqua que, sous l’influence de son professeur d’université et des mouvements politiques qui l’entouraient, il en était venu à considérer cette quête de libération personnelle comme égoïste. En visant l’égalité pour lui seul et en dehors du monde, l’ascète pérennise les hiérarchies mêmes du monde auquel il a renoncé [11]. C’est ainsi que Gyanji était passé de la voie du renoncement, visant à libérer l’individu dans un autre monde, à une recherche de libération au service de finalités communes dans ce monde-ci. Significativement, la première tâche qu’il accomplit en tant que naxalite fut de distribuer un tract annonçant la « mort de Dieu ».
Dans la société indienne, la rigidité de la hiérarchie sociale est allée de pair avec une longue tradition d’ascèse mise au service d’objectifs politiques. Gandhi, vêtu de son pagne blanc, en est l’exemple le plus connu. Malgré la diversité de leurs buts politiques, à l’instar de Gyanji, certains de ces ascètes historiques se sont détournés d’une quête de libération personnelle tendue vers un au-delà égalitaire pour remettre en cause les inégalités du monde présent. Ce faisant, ils ont subverti l’idéal des moines religieux consistant à éteindre l’avenir et à quitter le monde dans une quête de libération individuelle pour se consacrer à la création d’un monde libéré pour tous et toutes [12].
Dans le cas de Gyanji et de ses camarades, cette voie de libération a consisté à travailler avec les autres à l’égalité radicale ici et maintenant, à édifier un nouvel avenir dans le présent et à construire un monde parallèle plus égalitaire. Ce qui implique de lutter pour un monde meilleur pour la société dans son ensemble (et pas seulement pour quelques individus).
Ainsi, entre les maîtres de yoga indiens, les ascètes de la non-violence tels que Gandhi et les leaders naxalites des hautes castes renonçant à leur monde pour créer une nouvelle société libre par la lutte clandestine, le fossé n’est peut-être pas aussi grand que je l’avais imaginé au départ. N’appelle-t-on pas les naxalites « les gandhiens armés16 » ? La violence révolutionnaire est une vocation sacrée. Cette longue histoire indienne de renoncement à la hiérarchie sociale explique peut-être en partie pourquoi l’Inde contemporaine exporte des maîtres de yoga tout en continuant à produire des révolutionnaires communistes en armes.
D’un côté, les moines hindouistes, bouddhistes ou jaïns renoncent aux hiérarchies de la société pour se libérer individuellement des cycles infinis de la renaissance dans l’espoir d’accéder à un monde égalitaire. De l’autre, les rebelles naxalites rompent avec leur passé pour lutter au présent pour une communauté sans castes et sans classes, aspirant à libérer l’ensemble de la société en la guidant vers un avenir égalitaire. Les uns recherchent l’émancipation individuelle dans l’avenir, les autres se consacrent à l’idéal d’une libération collective au présent.
Mais ces voies impliquent toutes deux la conviction et l’engagement, la foi en une fin qui justifie les moyens – autant d’éléments aussi inébranlables qu’une doctrine religieuse. Les uns comme les autres sont prêts à tout sacrifier, y compris eux-mêmes, pour atteindre leurs idéaux. Prendre les armes n’est qu’un moyen parmi d’autres. Qu’on soit ou non d’accord avec ces méthodes révolutionnaires, on peut constater que les hiérarchies de la société indienne ont produit parmi les plus fervents égalitaristes du monde.