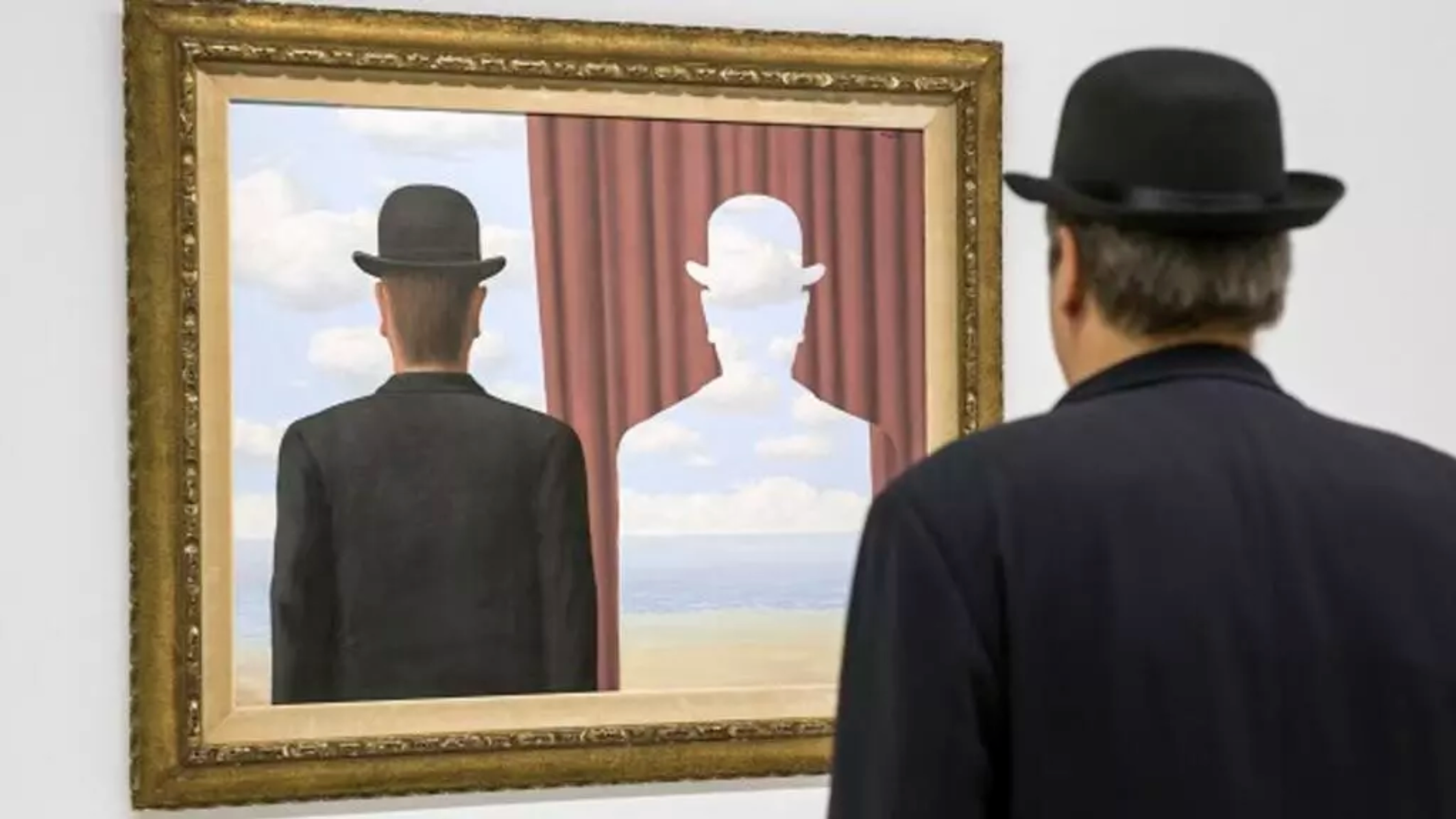Or, ce qu’il convient de mettre en évidence en ce sixième anniversaire, ce sont les constantes d’une entreprise militaire de destruction et d’une doctrine politique de déshumanisation, portées tout ensemble par les faits et les principes, et qui, en l’espace de 130 ans, ont marqué, d’une façon presque analogue, deux guerres coloniales dirigées contre le peuple algérien » (Lacheraf, 1965 : 203).
Les disponibilités des uns et des autres, ainsi que celle de la salle, ont concouru à ce que cette rencontre, fruit d’une volonté et d’un travail collectifs, ait lieu un 17 octobre.
Il nous a paru important d’évoquer cette triste date anniversaire pour rappeler au préalable d’où nous parlons, lorsque nous parlons de la Palestine.
Le 17 octobre 1961 est en effet le plus grand massacre d’Etat de la cinquième république française, la répression d’État la plus violente qu’ait jamais provoquée une manifestation de rue en Europe occidentale dans l’histoire contemporaine (House & MacMaster, 2006). Mais il est également, et paradoxalement, l’un des massacres qui a été le plus invisibilisé, dissimulé, notamment par la presse (Gaiti 1994 ; Kupferstein 2001 ; Maillot 2001).
Il aura fallu près de 40 ans, à l’occasion du procès de Maurice Papon, pour que le sujet commence à être vraiment abordé publiquement – et ce grâce au travail et à l’engagement de l’historien Jean-Luc Einaudi (2001). Ce massacre demeure néanmoins, encore aujourd’hui, reconnu seulement à mi-mot par les autorités françaises [1].
Entre 200 et 300 Algériens périrent lors de cette répression sauvage menée sous les ordres de Maurice Papon, et avec l’aval du gouvernement de l’époque. Près d’un tiers des Algériens – venus manifester contre le couvre-feu qui leur était imposé et en soutien de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie –, soit près de 10 000 sur 30 000 manifestants, furent raflés, conduits dans des centres d’enfermement en région parisienne.
Avant même le 17 octobre 1961, les Algériens de France faisaient l’objet de multiples répressions et on comptait, en particulier en région parisienne, déjà de nombreux morts tués par la police ; et ce même en temps de paix, comme lors du 14 juillet 1953 (Kupferstein, 2017) [2].
Alors que les manifestants subissaient la violence d’Etat en France, leurs proches en Algérie étaient confrontés à une répression encore plus rude. Cette guerre sans nom, qualifiée à l’époque « d’événements » ou de « luttes contre le terrorisme du FLN », avait déjà pour certains observateurs les traits d’une guerre génocidaire (El Farra 1956 ; Hodgkin 1958 ; de Beauvoir, 1962).
Cette guerre durant laquelle la France, membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU viola, moins d’une décennie après leurs adoptions, la déclaration universelle des droits de l’homme, la convention de Genève et celle sur la prévention du génocide (Robertson, 2020) [3] avait elle-même été précédée par une série de massacres perpétrés, en temps de paix, à Sétif, Guelma, Kherrata et dans l’ensemble du Nord Constantinois en mai et juin 1945, soit le jours et les semaines qui suivirent la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie.
C’est dire le courage des Algériens qui décidèrent de manifester le 17 octobre 1961.
Alors que la répression faisait rage et que l’on noyait des Algériens dans la Seine, à Paris même, le long de la Seine, au Musée de l’Homme exactement, étaient conservés les cranes de résistants algériens, témoins et victimes de la conquête de l’Algérie, qualifiée de guerre totale (Le Cour Grandmaison, 2005 ; Ruscio, 2024) ou de conquête génocidaire (Gallois, 2013 ; 2023).
Parmi ces cranes, découverts en 2012 par l’historien algérien Ali Farid Belkadi, et rapatriés en Algérie en 2020, on mentionnera ceux de deux résistants célèbres, Cheikh Bouziane et le Chérif Boubaghla. Le premier est le chef des révoltés qui ont tenu l’armée française en échec pendant deux mois en 1849, dans l’oasis des Zaâtchas (région de Biskra). Le second est quant à lui un ancien cavalier de l’émir Abdel-Kader. Après la reddition et la déportation de l’émir (1847), il poursuit la lutte dans le centre de l’Algérie, avec l’appui de la résistante Lalla Fatma N’soumer. Il est tué en 1854.
Entre les décapitations, entre 1849 et 1854, eut lieu un autre massacre emblématique : celui de Laghouat (1852) qui vit les 2/3 de sa population annihilée en quelques jours (Chettih 2011).
Les premières décennies de la conquête coloniale, celles dont le Cheikh Bouziane et le Chérif Boubaghla ont été les témoins, ont constitué une « catastrophe démographique » pour les Algériens. La population algérienne fut ainsi réduite de moitié, passant de 4 millions en 1830 à 2 millions en 1875. Près de 1.65 millions d’Algériens périrent du fait des guerres, des violences et famines – en particulier celles découlant du système des razzias (massacres suivis du pillage systématique des ressources) – et 350 000 furent réfugiés (Gallois, 2013, 2023).
L’invisibilisation des crimes coloniaux perpétrés par la France n’est pas sans conséquence sur notre présent : la destruction continue de la Palestine et le consentement au massacre de Gaza se nourrit, du moins ici en France, d’un déni continu du fait colonial et des crimes qu’il génère.
Le 18 octobre 2023, il y a deux ans de cela, le quotidien Le Monde publiait une tribune de Didier Fassin dans laquelle il s’inquiétait du double standard des autorités françaises au regard des victimes palestiniennes et des discours déshumanisants à propos des Palestiniens, « prélude aux pires violences ». Le texte était important et la comparaison avec le génocide des Herero et Nama était pertinente [4].
On constatera pour notre part, que l’effet du déni colonial est tellement prégnant en France, que ni le 18 octobre 2023, le lendemain d’un 17 octobre, ni tous les jours qui suivirent, ni Le Monde, ni Libération, ni aucun journal de la presse mainstream [5] n’ont publié de texte comparant la situation palestinienne à la situation algérienne – et qu’il a fallu un long détour par l’Afrique Australe pour que Didier Fassin, puisse alerter, certes avec quelques difficiles contrecoups, du génocide à venir en Palestine.
Et pourtant, la rapprochement Palestine-Algérie tombe évidemment sous le sens, et il apporte davantage de points de comparaison notamment s’agissant de la mécanique génocidaire, même si cela demeure inaudible pour les grands médias français, comme je le constate malheureusement depuis plusieurs années.
En effet, outre les traits socio-culturels que partagent les Palestiniens et les Algériens ; outre la durée de l’oppression coloniale – 132 ans pour les Algériens et déjà plus de 100 ans pour les Palestiniens (Khalidi, 2020) ; outre que cette oppression soit le fait de puissances dites démocratiques, appartenant au camp occidental – la France dans un cas, le Royaume Uni puis l’alliance Israël-USA dans l’autre ; il est en effet de multiples comparaisons que nous pouvons établir s’agissant des intentions et des réalités génocidaires.
Que l’on songe à l’animalisation de l’autochtone : la formule de Yoav Gallant, ministre de la Défense israélien (9 octobre 2023) – « Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence » est en effet du même registre que celle du Général Bugeaud appelant à enfumer les Algériens à outrance comme des renards (1845).
Que l’on pense à la violation même de zones de refuges pour les civils : les Palestiniens exterminés dans les écoles de l’UNRWA, les mosquées, les églises et les hôpitaux ; comme autrefois les Algériens étaient massacrés dans les mosquées (cas du massacre de djamaa Ketchoua en 1832), ou par enfumades, dans les grottes, lieux également de refuges, ainsi que de retraite spirituelle, dans la tradition prophétique (grottes de Thawr et de Hira), dans le Coran (sourate de la Caverne), dans la culture religieuse de l’Afrique du Nord (van Staëvel, 2010) et, plus largement, dans celle du pourtour méditerranéen.
Que l’on pense également aux formes mêmes de mise à mort : les Palestiniens ensevelis sous les décombres ; les Algériens emmurés dans les grottes du Dahra (1845) ; la famine organisée à Gaza ; la famine orchestrée par le système des razzias en Algérie ; l’usage d’armes spéciales de destruction massive comme les bombardements avec l’appui du système d’intelligence artificielle Habsora à Gaza ; et auparavant, en Algérie, l’usage de l’arme chimique sous sa forme primitive (enfumades) puis sous sa forme avancée et industrialisée lors de la guerre d’Algérie : 450 opérations de gazage recensées par l’historien Christophe Lafaye sur un total estimé entre 8 000 et 10 000.
Que l’on songe également à la dimension concentrationnaire : à l’établissement de « zones de transit humanitaire » à Gaza que l’on peut rapprocher des « camps de regroupement » installés par la France en Algérie pendant la guerre de Libération Nationale (Riceputi, 2025).
Que l’on évoque aussi ces deux projets fous du capitalisme colonial génocidaire et « écocidaire » : le projet de Riviera à Gaza que l’on peut rapprocher du celui, discuté en très haut lieu, de la mer intérieure en Algérie promu, par François Élie Roudaire et Ferdinand de Lesseps, au moment même où la population algérienne était réduite de moitié (1874-1882), puis remis à l’ordre du jour, en 1957, en pleine guerre d’Algérie, par l’Association de recherches techniques pour l’étude de la mer inférieure saharienne (A.R.T.E.M.I.S.) [6].
Que l’on pense enfin à la propagande génocidaire, celle entendue en Israël, mais également dans les médias en France, et que l’on en fasse son archéologie. On trouvera alors pléthore de justifications de ce type émanant de responsables français, s’agissant des Algériens (Le Cour Grandmaison, 2005 ; Chitour 2019 ; Khiati 2022). On se contentera ici d’une seule phrase glaçante : celle rédigée en 1923, 70 ans après le massacre de Laghouat, par Jean Melia, écrivain et chef de cabinet du gouverneur de l’Algérie :
« Il fallait ce digne et sublime holocauste pour prouver à toutes ces tribus guerrières de ce Sud algérien, les stoïques vertus de la patrie française, afin que les vaincus eux-mêmes en vinssent à admirer la vaillance de leurs vainqueurs (…) » (p. 64).
Il y aurait encore plusieurs autres rapprochements à faire.
Faute de temps, je m’arrêterai là. Je me bornerai pour ouvrir la discussion et interroger la responsabilité du monde de la recherche, de la recherche anthropologique en particulier, à citer le fondateur du Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Claude Lévi-Strauss, qui avait son bureau à l’étage : « Il serait injustifié et incorrect de dire que l’anthropologie a servi les intérêts du colonialisme ; elle a toutefois tiré parti de la situation et s’est développée dans son ombre » (Lévi-Strauss, 1975 : 23-24). Et on se demandera, si cette position opportuniste et confortable ne contribue pas à expliquer, du moins en partie, un certain silence, un relatif aveuglement, et une trop grande indifférence, à mon avis, de la discipline envers les génocides et autres crimes coloniaux.
Références
de Beauvoir, Simone préface à G. Halimi, 1962, Djamila Boupacha, Paris, Gallimard Paris.
Ben Hounet, Yazid, « Génocide en Palestine : Anatomie d’un débat français sabordé », Lundimatin, 13 décembre 2023 : https://lundi.am/Genocide-en-Palestine
Chettih, Mohammed, 2011, La bataille de Laghouat. Le génocide. Décembre 1852, (réédition en 2022, Elalmaia), Algérie
Chitour, Chems-Eddine, 2019, Histoire de l’Algérie : De la résilience à la quête de la modernité, Chihab Éditions, Alger.
Einaudi, Jean-Luc, 2001, Octobre 1961. Un massacre à Paris, Paris, Fayard.
El-Farra, Muhammad, 1956, ‘The Algerian Tragedy’, Africa Today, 3(4),
Gaïti Brigitte, 1994, « Les ratés de l’histoire. Une manifestation sans suites : le 17 octobre 1961 à Paris », Sociétés contemporaines N°20 : 11-37.
Gallois, William, 2013, ‘Genocide in nineteenth-century Algeria’. Journal of Genocide Research, 15(1), 69–88
Gallois, 2023, ‘The Genocidal French Conquest of Algeria, 1830–1847’. In : Blackhawk N, Kiernan B, Madley B, Taylor R, eds. The Cambridge World History of Genocide. Volume II. Genocide in the Indigenous, Early Modern and Imperial Worlds, from c.1535 to World War One. Cambridge University Press, pp. 361-382
Hodgkin, Thomas, 1958, ‘The Battle for the Maghreb’, The Political Quaterly 29(4), (1958)
House Jim & Neil MacMaster, 2006, Paris 1961. Algerians, State Terror, and Memory, Oxford, Oxford University Press.
Khalidi, Rashid, 2020, The Hundred Years’ War on Palestine : A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017, New York, Metropolitan Books.
Khiati, Mostefa, 2022, Génocides coloniaux. Enfumades, emmurements et gazage de grottes, ANEP, Alger.
Kupferstain, Daniel, 2001, 17 octobre 196, dissimulation d’un massacre , film documentaire.
Kupfertsein, Daniel, 2017, Les balles du 14 juillet 1953, Paris, Éditions de la Découverte.
Lacheraf, Mostefa, 1965, « chapitre 7. Constantes politiques et militaires dans les guerres coloniales d’Algérie (1830-1960) », in L’Algérie : nation et société, François Maspero, Paris.
Le Cour Grandmaison, Olivier, 2005, Coloniser, Exterminer - Sur la guerre et l’Etat colonial, Fayard, Paris..
Lévi-Strauss, Claude, 1975, “Anthropology : Preliminary Definition : Anthropology, Ethnology, Ethnography”, Diogenes, 23(90), 1-25
Maillot Agnès , 2001, La Presse française et le 17 octobre 1961, Irish Journal of French Studies, 1 : 25-35.
Melia, Jean, 1923, Laghouat ou les maisons entourés de jardins, Paris, Plon.
Riceputi, Fabrice, « Les camps de concentration, de l’Algérie à Gaza », Orient XXI, 17 juillet 2025 : https://orientxxi.info/magazine/les-camps-de-concentration-de-l-algerie-a-gaza,8389
Robertson, Geoffrey. KC, 2020, Crimes Against Humanity. The Struggle for Global Justice, Penguin Books.
Ruscio, Alain, 2024, La première guerre d’Algérie. Une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852, La Découverte, Paris
van Staëvel, Jean-Pierre, 2010, « La caverne, refuge de « l’ami de Dieu » : une forme particulière de l’érémitisme au temps des Almoravides et des Almohades (Maghreb extrême, XIe-XIIIe siècles) ». Cuadernos de Madīnat al-Zahrā’, Miscelanea de historia y cultura material de al-Andalus. Homenaje a Maryelle Bertrand, 7, pp .311-325.