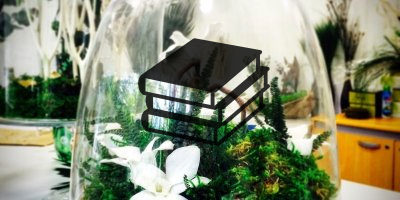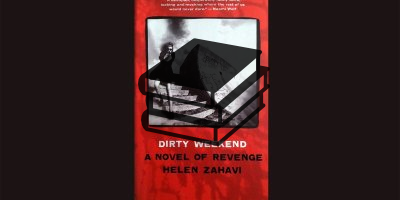Les rares initiés aux écrits de Giorgio Cesarano forment une communauté secrète. C’est sûrement parce que cet auteur a produit une pensée totale et sans compromis, profonde et dialectique, écrite dans une prose enflammée qui ne se laisse pas facilement pénétrer, qu’elle continue, bien que souterrainement, à fasciner près de cinquante ans plus tard. Tous les écrits théoriques publiés du vivant de l’auteur furent, selon ses propres aveux, rédigés « sous l’effet de l’urgence ». Cesarano a perçu avec une grande acuité que, dans les années 1970, une brève fenêtre s’ouvrait, qui pouvait très rapidement et sournoisement se refermer et dans laquelle il fallait violemment lutter contre les mystifications de « la politique ». Son suicide en 1975, alors qu’il avait 47 ans, peut se comprendre comme un refus de voir cette chance historique s’éteindre dans une fictive libération.
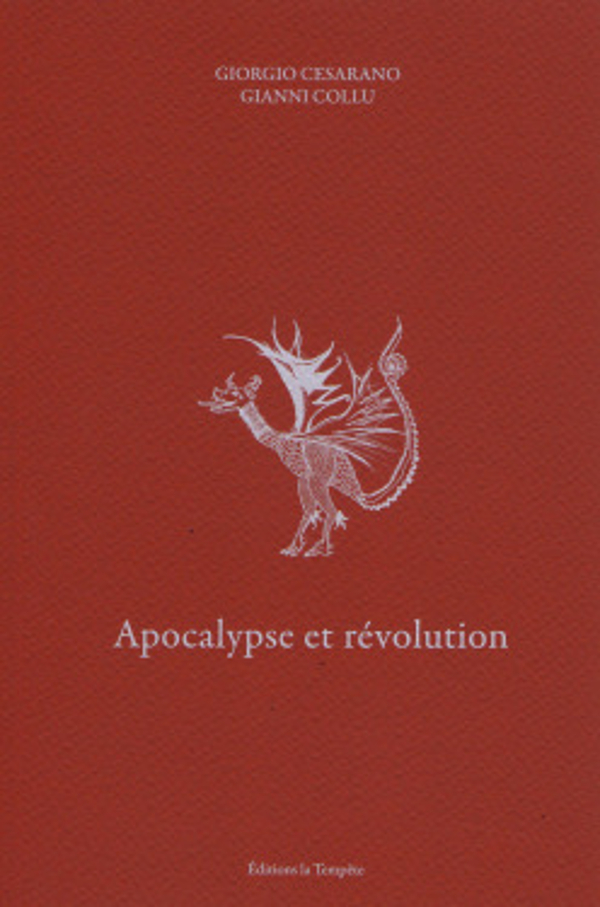
D’une envergure et d’une densité impressionnantes, la pensée de Cesarano compte parmi celles qui transforment irrémédiablement notre façon de voir et de vivre. Et les transforme non parce qu’elle nous apporte un complément d’information sur une thématique – comme tant de livres périssables s’en contentent – mais parce qu’elle rend lisibles les justes conflits que nous pressentions en nous-mêmes, sans savoir les nommer adéquatement. Lecteur avide, inspiré tant par la psychanalyse que l’anthropologie, par le marxisme que par la biologie, Cesarano produit une vision du monde désabusée et exigeante, à la hauteur non seulement de son propre temps mais aussi de notre présent. La théorie de la valeur, des formes de narcissismes contemporains, l’écologie, la critique de la psychiatrie (et celle de l’anti-psychiatrie), de la théologie, mais aussi l’amour, le couple, la passion, le désir et la transgression sont autant de thèmes que Cesarano aborde et dynamise dans la perspective d’une rupture avec la misère de la survie.
Les titres de ses ouvrages ont pris, à mesure que l’urgence s’approfondissait et que les horizons se bouchaient, une signification particulière. Comment en effet, alors que le mot d’apocalypse est maintenant dans toutes les bouches, et que toute solution réformiste semble définitivement irréaliste, ne pas être interpellés par un livre de 1972 qui posait déjà le conflit dans les termes d’apocalypse ou de révolution ? Par un auteur qui, dès 1974, proposait dans un Manuel de survie de se débarrasser des illusions de la fiction mutilante du Moi pour poser enfin sérieusement celle de notre présence au monde ?
Lorsque Cesarano écrit ces livres, le Club de Rome, vaste réunion d’experts interdisciplinaires issus des tendances les plus avancées du capitalisme, vient de publier Les limites à la croissance. Ce texte, inaugural de l’essor de l’écologie de politiciens qui se développera plus tard et dans laquelle le pire de ’68 se vautrera confortablement, entendait offrir une solution durable à la crise tant sociale qu’économique que traversait le développement du capital dans ces années-là. Financé par la Fiat, l’appel à une limitation de la croissance, à la frugalité, et à une meilleure gestion des ressources, apparut immédiatement à Cesarano comme une farce qui méritait la plus grande attention. Cette publication arrive de surcroît peu de temps après l’émergence du puissant mouvement révolutionnaire italien, auquel Cesarano, renonçant à sa vie d’avant et alors qu’il avait déjà quarante ans, s’était donné à corps perdu. C’est ainsi de l’intérieur de ces luttes, et aussi des nôtres, que Cesarano (nous) parle, qu’il (nous) met en garde contre l’acceptation de l’horreur dans sa prétendue contestation, et (nous) indique les enjeux d’une guerre à outrance contre le monde de la production.
Ce que cette parution du Club de Rome rendait finalement visible, c’était que le capital devrait se confronter à une crise sans précédant et qu’il n’a jamais résolue : la limitation des ressources de la biosphère. La puissance mortifère de l’économie scie la branche sur laquelle elle est assise mais entraîne dans sa chute l’humanité tout entière. Ce ne sont pas seulement les conditions de vie qui sont devenues impossibles à partir de ces années-là, mais à long terme les conditions de survie même de l’espèce. L’antagonisme dans un tel contexte ne peut-être que total et absolu, et tout type d’intermédiaire apparaît comme un mensonge criminel. Cependant, alors même que la logique abstraite du capital est responsable d’une telle situation, celui-ci tentera, par tous les moyens, de se faire passer pour la dernière utopie possible. Les scientifiques endosseront désormais les habits de prophètes à qui les êtres humains devront léguer aveuglement toute confiance. Face au rouleau compresseur d’une domination impersonnelle et destructrice, l’alternative devient fatale : ou bien l’apocalypse, ou bien la révolution.
Cette utopie-capital se construit dans les années 1970 alors que les machines tendaient à prendre une part considérable dans le travail productif, et qu’il fallait ouvrir de nouveaux terrains à l’extraction de plus-value. Le développement du capital fictif – fictif en ceci qu’il ne se base pas sur de la valeur présente mais à venir – s’accompagne alors d’une colonisation inédite des intériorités. Surmonter une crise, pour le capital, cela ne signifie pas seulement réorienter l’économie, mais aussi produire un homme nouveau adéquat à celle-ci, un homme qui soit capable de la soutenir. La crise économique induit une crise métaphysique, une crise de sens, que le capital cherchera à tout prix à colmater. L’investissement dans la « personne sociale », c’est-à-dire l’individu qui, par le mouvement dans lequel il prétend se libérer, se trouve séparé de ses désirs réels mais rassasié par l’industrie culturelle, intégralement soumis aux exigences de la société et parfaitement dépendant d’elle, fut l’une des armes les plus sournoises et efficaces du capitalisme des années 1970. Il est difficile, en lisant les lignes que Cesarano consacre à la « personne sociale », de ne pas penser à ces « réseaux », dans lesquels chacun, persuadé de l’originalité de sa story, affiche la misérable homogénéité des formes de vie du capital. Ce que Cesarano analyse, en reprenant les catégories de la linguistique, comme une domination de la langue sur la parole, c’est-à-dire du sens mort et désincarnés sur le sens vivant, traduit cette intronisation sans précédant des exigences du capital dans la vie des hommes.
Le capital fictif également, ne se fondant plus sur un travail qui est présent, mais sur le crédit et la spéculation, se doit, pour assurer sa domination, de réintégrer les discours théologiques. Le crédit est donc un crédit de sens. Toute crise économique engendre une crise métaphysique, une crise sur le sens de la vie. Celle-ci peut-être mis à profit par le capital afin de soumettre les individus à ses exigences, à son sens. Pour écraser toute affirmation, il doit se faire lui-même affirmatif. C’est ainsi que le discours de l’apocalypse, habilement manié par les nouveaux prophètes du Club de Rome et de l’écologie d’État, témoigne d’un investissement du vocabulaire religieux adéquat aux réorganisations nécessaires à l’économie capitaliste. La théologie ne s’est jamais séparée du discours légitimant une réorganisation de l’économie : elle permet de faire écran, en offrant un sens fictif à une peur produite, aux termes d’un véritable antagonisme révolutionnaire.
Cette prise en charge de la vie de l’individu – une fois réduit au rôle de « personne sociale » – qui se développe parallèlement au développement de la cybernétique et se justifie à travers un discours apocalyptique, acquiert, dans les temps troublés que nous traversons, une inquiétante actualité. La « société thérapeutique » – terme préférable à celui, usé jusqu’à la corde, de « biopolitique » – produit l’homme à son image et l’identifie à sa survie. Comme le résume Jacques Camatte, « le développement du capital est délinquance et démence. Maintenant tout est permis ; il n’y a plus de tabou, d’interdit. Mais, en vivant les diverses ’’perversions’’ les hommes et les femmes peuvent se perdre, se détruire et ne plus être ’’opératoires’’ pour le capital ; d’où la nécessité d’une communauté qui les réinsère toujours dans celle du capital (plus exactement cette dernière prend la dimension d’une communauté thérapeutique). Un ensemble de spécialistes-thérapeutes serviront de médiateurs pour cette réinsertion. » La crise de sens se résout dans une gestion et une prise en charge des moindres gestes et par un développement inégalé de la propagande. Mais il s’agit d’une propagande de la « créativité individuelle », du « développement personnel » : une propagande de l’Ego-entrepreneur. Cependant, la pensée de Cesarano n’en reste pas à ce constat sinistre. Grâce à l’archéologie et à la biologie, Cesarano perçoit dans les conflits contemporains des questions non résolues de l’histoire la plus longue. L’émergence du sens, survenue par la rupture de l’homme d’avec l’animal, a permit le développement des pouvoirs religieux et des chefferies. C’est par différentes prothèses, tant linguistiques, symboliques et religieuses, que le corps s’est peu à peu séparé de lui-même pour faire consister le monde comme chose qui lui fait face. Si les questions métaphysiques ont une histoire, elles se résoudront donc historiquement.
La violente introduction des prothèses abstraites, dont la domination capitaliste du corps est l’aboutissement appelle, selon les termes de Cesarano, une révolution dans laquelle il s’agit, non de changer les dirigeants au pouvoir, mais « une révolution biologique définissant de façon irrévocable le sort de l’espèce. La libération vis-à-vis de la mort immanente, coïncide avec la libération du corps de l’espèce vis-à-vis de la ’’machine’’ aliénée, qui s’est emparée de ses modes d’évolution et les transforme en pièges mortels ».
Cesarano fut un homme habité par la certitude, intime et profonde, que le sens ne se laisserait pas recouvrir, que la vie s’insurgerait fatalement contre ce qui, chaque jour davantage, la mutile et la nie. Il supposait que dans les années 1970, cette domination de l’intériorité n’en était qu’à une phase de « domination formelle », ce qui laissait effectivement un écart, une chance. On peut se poser légitimement la question de savoir si les délires transhumanistes et la « révolution » numérique n’ont pas définitivement achevé cette colonisation, et si donc nous n’en sommes pas désormais au stade de la « domination réelle » du capital sur le corps. La capacité à séparer les êtres, tant d’eux-même qu’entre eux, et à les relier uniquement à travers le miroir de leurs « masques » est parvenu à un degré de sophistication effrayant. On peut constater également que la réponse capitaliste à l’antique question du sens commence à se fissurer de part en part. Les insurrection qui ne manquerons pas d’advenir poserons de façon toujours plus cruciale des questions de vie et de mort, et même de la vie biologique contre la mort organisée. En ce sens, Cesarano devient un interlocuteur privilégié, et peut nous transmettre, plutôt que des espoirs toujours déçus, la certitude qu’une autre vie est possible, qu’elle se construit déjà à présent et qu’elle n’abdiquera pas infiniment.