La réforme du code du travail vise à rendre plus flexible le salariat, de manière à ce qu’il soit mieux adapté aux mécanismes de l’économie marchande. L’idée est simple : dans une société du travail régie par les mécanismes de l’économie marchande, ou bien la société s’adapte à ces mécanismes, ou bien elle fonctionne mal. Le chômage est un dysfonctionnement dû pour une part à la faible croissance structurelle des économies européennes, confrontées à la concurrence des économies émergentes (Amériques du Sud, Inde, Chine), et pour une autre part aux rigidités du code du travail. Pour résoudre le problème du chômage, il faut donc soutenir la compétitivité des entreprises françaises, puisque ce sont elles qui donnent du travail aux gens, et il faut notamment réformer le code du travail de sorte qu’il contribue à la compétitivité des entreprises, plutôt qu’il ne la bride. L’Etat est au service du capital, parce que c’est la manière d’aider les gens à vivre : les aider à trouver du travail, et donc un salaire.
Il n’est dès lors pas étonnant que la droite parlementaire puisse d’une part juger que cette réforme « va dans le bon sens », bien que ce soit encore trop timide, et d’autre part expliquer qu’il faut supprimer des dizaines de milliers de postes de fonctionnaire. En effet, la fonction publique n’est pas une entreprise compétitive ; les emplois de fonctionnaire sont, au regard des mécanismes du marché, des sortes d’emplois fictifs : ils creusent le déficit des finances publiques et menace la solvabilité de l’Etat, qui risque à terme la faillite. Seuls les emplois de l’économie marchande sont réels.
Pour que les gens trouvent du travail, s’insèrent dans la société, se rendent utiles et gagnent de quoi vivre, il faut donc faciliter les mécanismes de l’embauche, autrement dit il faut qu’une entreprise puisse embaucher et débaucher en fonction de ses besoins, qui sont eux-mêmes régis par les mécanismes du marché. Or le code du travail, parce qu’il introduit une autre logique, administrative, juridique, sociale, grippe la machine. Et au final, tout le monde y perd puisque, loin de défendre les droits des travailleurs, le code du travail les écarte du marché du travail en bridant l’économie. Un enfant le comprendrait instantanément : si tu veux que ton tricycle avance, lâche les freins. Hélas, dès qu’une réforme est conçue par l’Etat, aussi timide soit-elle, les « syndicats », les jeunes et un ensemble de forces « populistes » s’y opposent, n’ayant apparemment d’autre volonté que de laisser les choses en l’état, quitte à brider l’activité économique.
À cet argumentaire, celui de l’État, héraut du Capital, les forces syndicales objectent que le démantèlement des acquis sociaux n’a pas permis jusqu’à maintenant de résoudre le chômage, mais seulement de précariser toujours plus les travailleurs et de favoriser toujours plus le Capital. Rappelant que les « acquis sociaux » ont été des victoires politiques du salariat, acquises de hautes luttes, ils appellent à la mobilisation. Mais ont-ils un plan pour relancer l’économie et faire baisser le chômage ? Oui, une politique de relance, par le moyen de laquelle l’État donnerait un nouveau souffle à l’économie française dans le respect des droits des travailleurs.
L’intrigue étant exposée dans ses grandes lignes, interrogeons-nous : la mobilisation actuelle vise-t-elle uniquement à conserver le code du travail en l’état, de manière à défendre « les droits des travailleurs », ou bien vise-t-elle principalement à sortir du règne de l’économie marchande ? Autrement dit, est-ce que la mobilisation actuelle est une force radicalement hétérogène à la logique dominante ou est-ce qu’elle s’y résout pour l’essentiel ? Les révolutions commencent parfois, souvent, en un point qui, au départ, ne présente rien de véritablement hétérogène à l’ordre établi. Il peut s’agir de conserver un droit ancien, un « acquis social », de s’opposer à une réforme finalement ponctuelle, voire anecdotique au regard de la totalité logique qu’il s’agit d’anéantir. Car l’ennemi, ce n’est pas une réforme X, c’est bel et bien une totalité logique. Autrement dit, une révolution suppose qu’on identifie un antagonisme radical entre deux logiques : celle de la raison, celle de la folie. Autrement dit encore, il n’y a pas d’autre alternative : ou bien nous sommes « fous » aux yeux du Capital, de l’État, voire des syndicats, et alors une subjectivité révolutionnaire est attestée, ou bien nous le sommes pas, et alors nous partageons avec le Capital une même raison, une même logique, la question étant de résoudre un différend somme toute ponctuel.
Il faut donc, pour qu’il y ait révolution, que la mobilisation devienne « folle », je veux dire par là qu’elle doit sortir de la rationalité économique et, conséquemment, s’affirmer comme la « logique du fou », dès lors que la « raison » est celle du Capital. Pour y contribuer, fort modestement, je me propose de reproduire quelques pages d’un livre écrit par un Albert Jacquard il y a plus de vingt ans (1995) : J’accuse. L’économie triomphante (p. 65-68, Calmann-Lévy). Le minimum qu’on doive attendre de la mobilisation actuelle, en effet, c’est qu’elle soit à la hauteur de la « folie » de Jacquard, sans quoi autant rester chez soi, c’est plus raisonnable :
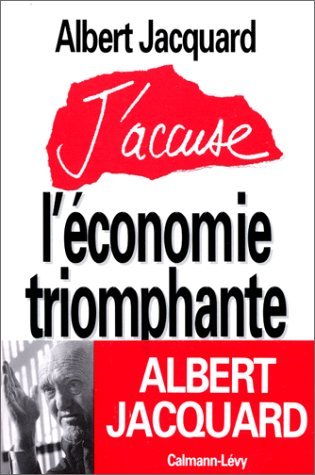
« Depuis le milieu du siècle, ces rendements [de l’agriculture] ont été multipliés au moins par quatre, alors qu’au sortir de la guerre ils étaient à peine supérieurs à ceux obtenus il y a un siècle. La fin des hostilités a en effet rendu disponibles les usines qui fabriquaient des explosifs ; elles ont pu, à peu de frais, se reconvertir et produire des engrais azotés. Le faible prix de ceux-ci a incité les agriculteurs à les utiliser sans retenue. Ils ont choisi les variétés capables de croître avec des doses élevées de ces engrais. Ces variétés, sélectionnés dans les stations d’amélioration en vue de maximiser leur capacité d’absorption de l’azote, présentent les défauts de toutes les plantes sélectionnées sur une caractéristique unique : elles sont fragiles ; il faut donc les protéger contre toutes les attaques de l’environnement, d’où la nécessité d’utiliser à haute dose des herbicides, des pesticides, des fongicides, et même des « raccourcisseurs » qui limitent la hauteur des tiges et réduisent le risque de verse. Les blés deviennent semblables à des athlètes tricheurs qui ne doivent leurs performances qu’au dopage. Une partie de ces produits s’accumule dans la terre ; ils sont entraînés par les pluies et polluent les ruisseaux, qui empoisonnent les rivières.
Répandre ces produits nécessite un matériel coûteux ; pour l’acquérir, les agriculteurs empruntent, s’endettent ; ceux qui ne cultivent qu’une petite surface ne peuvent faire face, abandonnent et viennent grossir la population des sans-travail des banlieues. Les grandes exploitations deviennent de véritables entreprises industrielles liées à des banques sur lesquelles elles n’ont pas de prise, comme les variations du prix du pétrole.
Les éléments nécessaires pour produire du blé étaient autrefois la terre, le soleil, et la sueur des bêtes et des hommes. Aujourd’hui, la terre ne compte guère, les animaux ont disparu, les hommes continuent à se fatiguer, différemment mais au moins autant qu’avant, et le reste des ingrédients est fourni par l’industrie. Certes, le rendement à l’hectare s’accroît régulièrement, mais ce terme n’a plus le même sens, puisque le rôle de la terre s’est amoindri. Il faut comparer la récolte non à la surface qui lui est consacrée, mais à l’ensemble des produits de toutes natures qu’il a fallu consommer pour l’obtenir (les intrants). Le bilan est alors beaucoup moins glorieux. Ce que met en évidence le prix de revient élevé des céréales produites. Encore ce prix ne tient pas compte de charges qui, en bonne logique, devraient lui être imputées : coût des pollutions induites qui détruisent peu à peu l’écosystème, coût du déplacement de populations qui avaient un toit au village et pour qui il faut construire des barres ou des tours dans les grands ensembles.
Pour diminuer ces prix de revient, l’exploitant recherche des variétés toujours plus capables de se gorger d’engrais ; la production augmente et dépasse de beaucoup la demande des populations capables de l’acheter à ce prix. Pour trouver de nouveaux débouchés, notre société donne les céréales à manger aux animaux, qui transforment, avec un rendement extrêmement faible, ces céréales en viande, viande que nous mangeons au détriment de notre santé.
Au terme de ce processus, peut-on vraiment chanter la gloire d’un mécanisme économique qui a permis de diviser par cent le nombre d’heures de travail nécessaires pour produire un quintal de blé ? Il est vrai que si cette perspective avait été présentée aux paysans du XIXe siècle, ils se seraient réjouis et auraient imaginé les nombreux jours de fête permis par ces progrès. Vivement les machines ! Aujourd’hui, cette utopie est devenue réalité, et il n’y a plus dans les villages ni paysans ni fêtes. Il reste quelques retraités moroses qui n’ont même pas la joie d’aller boire l’eau de la fontaine – chargée de nitrates, elle est déclarée non potable.
A chaque stade pourtant chacun a agi dans le sens d’une amélioration : les agronomes ont sélectionné avec compétence des hybrides nouveaux plus performants ; les chimistes ont fait appel aux techniques les plus fines pour mettre au point des produits plus efficaces ; les cultivateurs ont eu le courage d’accepter le jeu du progrès et de modifier les techniques ancestrales ; les représentants du gouvernement les ont félicités de leur audace et ont soutenu leurs efforts à grands coups de subventions. Chacun a fait ses calculs ; la conclusion était claire : pour améliorer la rentabilité, pour rester compétitif, il fallait agir ainsi. Le raisonnement de chacun était fondé ; mais l’addition de plusieurs logiques rigoureuses, chacune dans son cadre, peut aboutir globalement à une logique du fou. »
(Albert Jacquard ; J’accuse. L’économie triomphante, 1995).







