Ô guerre civile, incivile ! Ô tempora, ô mores ! Oh merde ! Il est élu.
Et pourtant, rien d’étonnant à cela. Seuls les naïfs et les privilégiés peuvent se permettre une telle indulgence, que l’on ferait mieux de laisser à la prétendue « gauche » qui gangrène la presse aux Etats-Unis. Pourquoi devrait-on se vautrer dans cette porcherie de l’auto-apitoiement et de l’horreur, comme s’il s’agissait d’une catastrophe soudaine et imprévisible ? Bien au contraire, c’est la conclusion logique de ce qui a débuté il y a bien longtemps, le résultat d’un travail inachevé, d’un conflit social qui prend de plus en plus d’ampleur. Nous sommes engagés dans une guerre civile, incivile, dont ceci n’est que la dernière offensive. La récente campagne électorale révèle la lutte entre ces deux idées imparfaites et incompatibles qui ont coexisté depuis les origines de notre nation : la sauvagerie du capitalisme marchand et l’idéalisme de la démocratie républicaine. Le 8 novembre 2016 n’est rien d’autre qu’un nouveau triomphe de la première, dans sa quête victorieuse de destruction de la société. Ceci est la transformation de la politique, politicienne ou pas, et ce qui va en sortir ne devrait surprendre aucun d’entre nous.
I : OH, SURPRISE !
« Je n’ai même pas envisagé l’éventualité qu’Hillary puisse perdre, parce que je ne connaissais pas une seule personne qui allait voter contre elle » - Shirley Wu, 26 ans, étudiante à l’Université de New York.
Qu’on en arrive là, que le satyre lubrique ait détrôné Hyperion Lincoln ? La surprise, cependant, est la spécialité de notre cher quatrième pouvoir, la Presse, qui recrute dans les banlieues pavillonnaires et les grandes villes, celles-là mêmes qui fourniront les étudiants de nos universités, ces colonies où l’on envoie nos enfants passer à grands frais quatre ans de vacances, loin de l’intellect et de la réalité. Ô, la frustration de ceux qui vivent parmi les ruines tangibles du progrès et de la prospérité, ces temples de l’industrie qui forment la « Rust Belt » ! Imaginez le ressentiment de ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, sans même parler de s’adonner aux joies de la consommation. Comme il doit être doux pour eux de trumper l’ordre établi, l’Establishment qui les a ignorés pendant tant d’années. Il n’est pas surprenant que l’on n’entende, depuis la nef journalistique, que l’outrage d’une classe horrifiée par les cris bestiaux d’une toute autre Amérique, moins bien connue celle-là. C’est seulement à la suite d’une telle coulée de boue que l’on peut lire ce genre de déclaration détachée, dont nous gratifie le New York Times :
Mme Clinton a remporté l’Amérique des grandes villes multiculturelles et des centres de la nouvelle économie, de la Silicon Valley aux Silicon Slopes de l’Utah, où de nombreux électeurs de tradition Républicaine ont rejeté M.Trump. Mais parallèlement, une Amérique urbaine composée de villes de taille plus modeste a apporté son soutien à M.Trump : des endroits comme Scranton (Pennsylvanie), Youngstown (Ohio) et Dubuque (Iowa), qui ont prospéré à l’ère industrielle et sont toujours connectés aux artères de la vieille économie américaine."
De la belle prose qui sert un parallélisme simpliste. Une opposition binaire entre le nouveau et l’ancien, entre gros et petit, hétérogène et homogène. Et cependant, le sujet reste lointain, abstrait et mal compris : cette Amérique qui nous a offert le triomphe du mardi 8 novembre. Pas étonnant, étant donné que dans les semaines précédant l’élection, ce même journal n’a pas remis en cause une seule fois les sondages sophistiqués qui claironnaient que Mme Clinton avait 85% de chances de gagner, ou que cet autre, innommable, aurait du mal à obtenir les suffrages de la communauté hispanique. Hubris ! Dans le quartier de Washington Heights, à New York, Rafael Gonzales, un ouvrier du bâtiment âgé de 66 ans, a poussé un cri de joie, ’’¡Sì muchacho !’’ quand cette Chose aux cheveux jaunes a remporté les élections, tandis qu’à l’autre bout de la ville, à l’Université de New York, et plus proche du Times en esprit, nous avons Shirley Wu. Je parie que Shirley ne monte pas souvent jusque Washington Heights, pas plus que les acteurs du quatrième pouvoir ne se rendent à Scranton - et c’est là qu’est le nœud du problème, la question de notre guerre civile incivile.

II. « DISCOURS DE CAMPAGNE »
« La torture, ça marche. Il n’y a que les imbéciles qui disent que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ils le méritent de toute façon, pour ce qu’ils font » — le prochain président des Etats-Unis.
L’ancien président de la commission du renseignement intérieur, Mike Rogers, un Républicain originaire du Michigan, a dit que ces remarques faisaient juste partie du « discours de campagne ». Qu’en est-il du mur entre le Mexique et les Etats-Unis ? Comme le dit Newt Gingrich, tout récemment ressuscité du Cabinet des Horreurs Républicain : « Sans doute qu’il (le président élu) ne s’attardera pas trop à essayer de forcer le Mexique à payer ce mur, mais c’était un super argument de campagne. » La Presse tient les mêmes propos ces jours-ci, comme si cela était rassurant. Qu’un « grand et beau » mur soit construit, ou pas, quelque chose de tout aussi horrible sera fait, et c’est la solution la plus inhumaine qui sera choisie par le gouvernement à venir. Voici ce à quoi a abouti le processus électoral, ou la propagande électorale, et rien ne sera jamais plus comme avant. Dépasser les bornes, ça a marché, le flot d’insultes et de dénigrement a mené à la victoire.
La politique est devenue pur spectacle, dénué de tout débat, de toute analyse ou proposition concernant le bien commun. Donald Punk s’assoit dessus. No future ! Pas d’avenir, seulement l’anéantissement de l’autre et le profit perpétuel, accumulé jusqu’à former une magnifique montagne de Moi ! La politique est devenue spectacle, et plus c’est scandaleux, mieux c’est, dans la mesure où ça peut attirer l’attention. Les Républicains n’ont pas réussi à reprendre le contrôle de ce mouvement entrumpé, forgé de toutes pièces, parce que leur Frankenstein les a évincés, leur a volé la scène, parce qu’il a été le plus vicieux et le plus cru. C’est eux qui l’ont créé, il représente leurs propres méthodes, poussées à leur extrême logique, tel une créature qui échappe au contrôle de son Créateur. Pendant quarante ans, le parti Républicain s’est efforcé d’inventer des méthodes de démagogue qui devaient lui assurer le soutien du public américain et lui permettre d’écraser toute opposition. Souvenez-vous de cet appel de Reagan à la classe ouvrière : « It’s Morning in America ! » - appel creux et triomphaliste, alors qu’il détruisait d’une main ferme l’activité industrielle aux Etats-Unis. Pensez au spot de campagne « Revolving Door » diffusé par son successeur, qui montrait une porte-tambour à l’entrée d’une prison pour illustrer le récidivisme. Discours vide que tout cela, riche en allusions et insinuations malveillantes faisant référence à des choses qu’on ne peut pas prononcer sans courir le risque de révéler le trumpe-l’oeil. De tels abus de langage se développent et trouvent leur force dans les ténèbres de la peur. Ils flattent et font enfler la logique absolutiste intégrée par les Américains de longue date, depuis leurs origines coloniales : la meilleure façon de justifier la violence c’est d’affirmer que les plus forts survivent et les plus faibles disparaissent. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Dans la lutte pour la vie, on est soit vainqueur, soit vaincu.

III. CELA ARRIVERA PRÈS DE CHEZ VOUS
“Mais il vit également qu’en Amérique, la lutte était obscurcie par le fait que, parmi les fascistes, les pires étaient ceux qui désavouaient le mot ‘fascisme’ pour prôner l’asservissement au Capitalisme, au nom de la Liberté Américaine Traditionnelle et Constitutionnelle."
— Cela ne peut arriver ici, Sinclair Lewis, 1935.
Au cours des soixante dernières années, le parti Républicain a lentement émergé d’un vide idéologique ; dès 1980, il dominait le paysage politique américain. Pendant la majeure partie du XXe siècle, la tendance était à l’interventionnisme et à la redistribution des richesses pour le bien commun. Si critiquable et paternaliste qu’il soit, ce discours proposait aux Américains un espoir tangible, la promesse d’"un poulet dans chaque casserole". Il reposait sur un argument politique solide. Les Républicains, en revanche, n’avaient rien à offrir, aucune base idéologique sur laquelle s’appuyer. “Le fait est, tout simplement, qu’il ne circule de nos jours que très peu d’idées conservatrices ou réactionnaires”, écrivait Lionnel Trilling en 1950, alors même qu’on assistait à l’émergence du mouvement conservateur, avec des personnalités comme Hayek, Rand, Weaver, Kirk, et bien entendu, Buckley Jr.

Les mêmes puissances capitalistes et industrielles qui avaient combattu Roosevelt et son New Deal par une propagande consciencieuse gagnèrent de plus en plus de sympathisants durant la période d’après-guerre. D’un côté, quel que soit le parti au pouvoir, l’État continuait à opérer sur un principe d’investissement dans le bien commun - ainsi, c’est à Eisenhower, un Républicain, que l’on doit le réseau autoroutier et le système des retraites, et plus tard, à Nixon, la création d’une agence nationale de protection de l’environnement. Entretemps, Johnson, un Démocrate, dévoilait les plans de sa “Great Society”. Mais par ailleurs, l’économie de guerre perdurait ; l’industrie martelait tous les boucliers jugés nécessaires pour protéger l’Amérique du péril rouge. Dans un tel contexte, la “gauche” s’essoufflait et la “droite” gagnait du terrain.
L’idéologie de la paranoïa, l’exercice limité du pouvoir populaire et le capitalisme débridé se trouvèrent de plus en plus à leur aise. Puis soudain, 1968, que l’on pourrait définir, dans le langage le plus châtié qu’il soit (digne, peut-être, du New York Times), comme “une période d’agitation sociale”. L’angoisse des citoyens, légitime ou non, offrit alors au parti Républicain moribond une brèche longtemps attendue. Noir et blanc, dans tous les sens des deux termes, semblaient plus difficiles à définir qu’auparavant. Percevant cette peur, la droite fit le saut de l’ange dans ce vide politique, armée des quatre piliers qui devaient devenir les fausses idoles du discours politique américain : le Travail, la Famille, Dieu et la Patrie. Du pur sentiment, voire du sentimentalisme, qui, comme l’a observé Jung, est une superstructure de la brutalité. Le Travail, c’est l’obéissance au diktat de la production sans fin ; la Famille, elle, évoque la vulnérabilité, l’impératif de protéger les siens ; Dieu, c’est le respect de l’habitude, que William James appelait “le volant d’inertie de la société” ; et la Patrie n’est rien d’autre qu’un prétexte pour exercer la violence d’une politique sécuritaire.
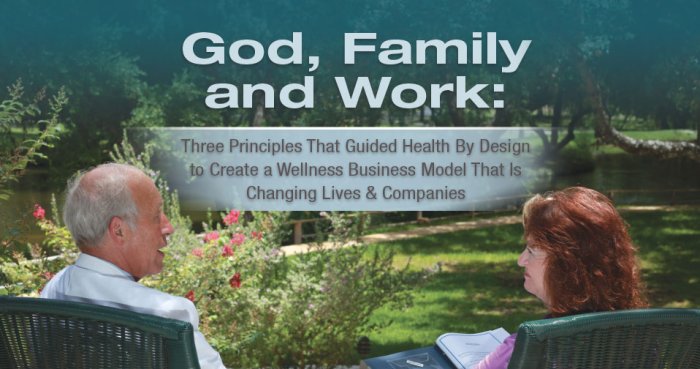
IV : Le progrès n’a pas d’avenir
« Je trouve qu’il incarne notre dernière chance de faire respecter l’ordre et la loi, et de préserver la culture dans laquelle j’ai grandi. » - Mike Wallace, militant. (Date et lieu inconnus)
« Pendez-moi cette connasse ! » – Un militant. (Raleigh, Caroline du Nord, meeting du 5 juin 2016)
« Qu’il aille se faire foutre, ce négro ! » – Un militant, parlant du 44e président. (Cleveland, 12 mars 2016)
Difficile de savoir s’il plaît vraiment à ceux qui ont voté pour lui. Nous nous trompons en croyant que les éjaculations adolescentes d’une poignée de militants constituent la substance des 60 265 858 voix qui ont fait élire cette Chose : leur vulgarité et leur colère sourde n’expliquent que partiellement un nombre de voix si conséquent en faveur du Taré de Mar-a-Lago. « Souvent, ce qu’il dit, c’est juste du bon sens, tombé du ciel. Et les deux partis n’ont plus de bon sens », croit savoir Tom Kirkpatrick, un militant de 51 ans qui travaillait dans une usine de blanchisserie et qui vit maintenant grâce à une pension d’invalidité. Si on laisse de côté la première partie de la phrase (il paraît difficile d’imaginer qu’émane de cette Chose quoi que ce soit de sensé ou de divin), reste l’impression d’un échec systémique, qui revient comme un leitmotiv dans la bouche des sympathisants. Cette impression traduit une prise de conscience plus profonde mais aussi plus confuse : le concept même de progrès a été, d’une certaine manière, remis en cause.
Dans son style toujours hyperbolique, le président élu table sur un futur glorieux. Il va se passer de grandes choses, vous verrez ! Comme si on pouvait se contenter de croire, comme si on n’avait plus tout notre discernement. La raison montre cependant que malgré les promesses les plus séduisantes, il y a des endroits où le soleil ne brillera jamais. On ne répare pas ce qui est cassé si, dès le départ, ce qui est cassé est défectueux ; qui peut remettre sur pied des institutions par essence déficientes ?
Il existe une tension entre le capitalisme et la démocratie, entre l’exploitation débridée et le principe d’auto-détermination au service de l’intérêt général. Les États-Unis seraient une république, mais conjointement un pays où seule une minorité pourrait prétendre à la prospérité. Peut-être n’est-ce pas si contradictoire : quelle différence y a-t-il entre un bourgeois qui répartit la richesse par le biais d’une loi et un autre qui le fait par vertu ? Ou qui prétend que les lois naturelles du marché permettent à la richesse de ruisseler jusqu’aux masses ? L’escroc du Queens déclarait : « désolé de vous le dire les amis, mais on a besoin des riches pour ré-enrichir l’Amérique », comme s’il avait ressenti le besoin de s’excuser pour avoir révélé une vérité douloureuse qu’on aurait préféré ignorer. L’argument du ruissellement, fourni avec son seau. Caliban chassant Ariel.

Peut-être la déficience essentielle du système n’est-elle pas à chercher dans la tension entre capitalisme et démocratie, mais plus profondément, dans la démocratie elle-même. Aristote et Rousseau avaient déjà mis en lumière le paradoxe qui consiste à définir la démocratie comme un moyen d’émancipation alors même que celle-ci nous appelle à déléguer le pouvoir à d’autres, donc à l’abandonner, par l’élection. Comment le processus électoral peut-il alors devenir autre chose qu’un redoutable outil de manipulation ?
Devant le spectacle de la télé réalité et des vidéos Youtube, devant la joie malsaine ressentie au moindre tweet qui jaillit de nos pouces, que peut-on appeler « liberté » dans notre société démocratique, quand celle-ci se réduit à la satisfaction onaniste au mieux puérile, au pire sadique, que nous procure la consommation ?
Instinctivement, le président élu l’a compris car sa personnalité mégalomane est au diapason de cette culture de l’humiliation, de la violence et de la rédemption qui est celle de l’Amérique. Le capitalisme est une pure régression masquée par de vaines promesses, faites dans un langage progressiste ; la démagogie du président élu n’est pas autre chose. Nous habitons la maison de nos ancêtres et nous avons déserté la moitié des pièces. Nous avons oublié d’où nous venons et ce que nous sommes devenus. Comment reconstruire quelque chose de nouveau sur les ruines décrépites des convictions et des idéaux ? Il y a de l’espoir – à condition de ne rien attendre des institutions sclérosées ou des délires absurdes de la droite réactionnaire, cramponnée au spectre d’un passé qu’elle a vêtu de ses propres frusques anachroniques. La prise de conscience de cette condition ne date pas de l’année 2016 : elle a un siècle, et gît quelque part dans la boue de la Somme, au milieu de milliers d’hommes morts pour ce qu’Ezra Pound appelait « une vielle chienne aux dents pourries, une civilisation bâclée ».
L’extrême-droite jubile : son heure est venue. « Cette victoire est une pierre supplémentaire dans l’émergence d’un nouveau monde qui a vocation à remplacer un ordre ancien. » Ainsi éructait Marine Le Pen à l’annonce des résultats. Le fascisme ne vient plus à pas furtifs, paré de sourires et de banalités. Aux États-Unis, le fascisme est enroulé dans un drapeau et il porte une croix.
Les organes de presse qui hier propageaient stupeur et désarroi tentent désormais de dissiper nos peurs : il s’entourera d’une équipe sérieuse et les affaires reprendront ; il sera modéré par nos institutions et contenu par la balance des pouvoirs ; il est trop inexpérimenté et trop désorganisé pour causer de réels problèmes ; dans quatre ans, il ne sera peut-être plus là.
Ne misez pas là-dessus : tous, nous serons trumpés. Lui s’en ira peut-être, mais le système qui a permis son ascension demeurera tant qu’on ne l’aura pas renversé, et avec lui cette cohorte d’idées rétrogrades qui nous accablent. Et il nous faudra alors les remplacer par quelque chose de plus éloquent et de plus épanouissant qu’une élection.





