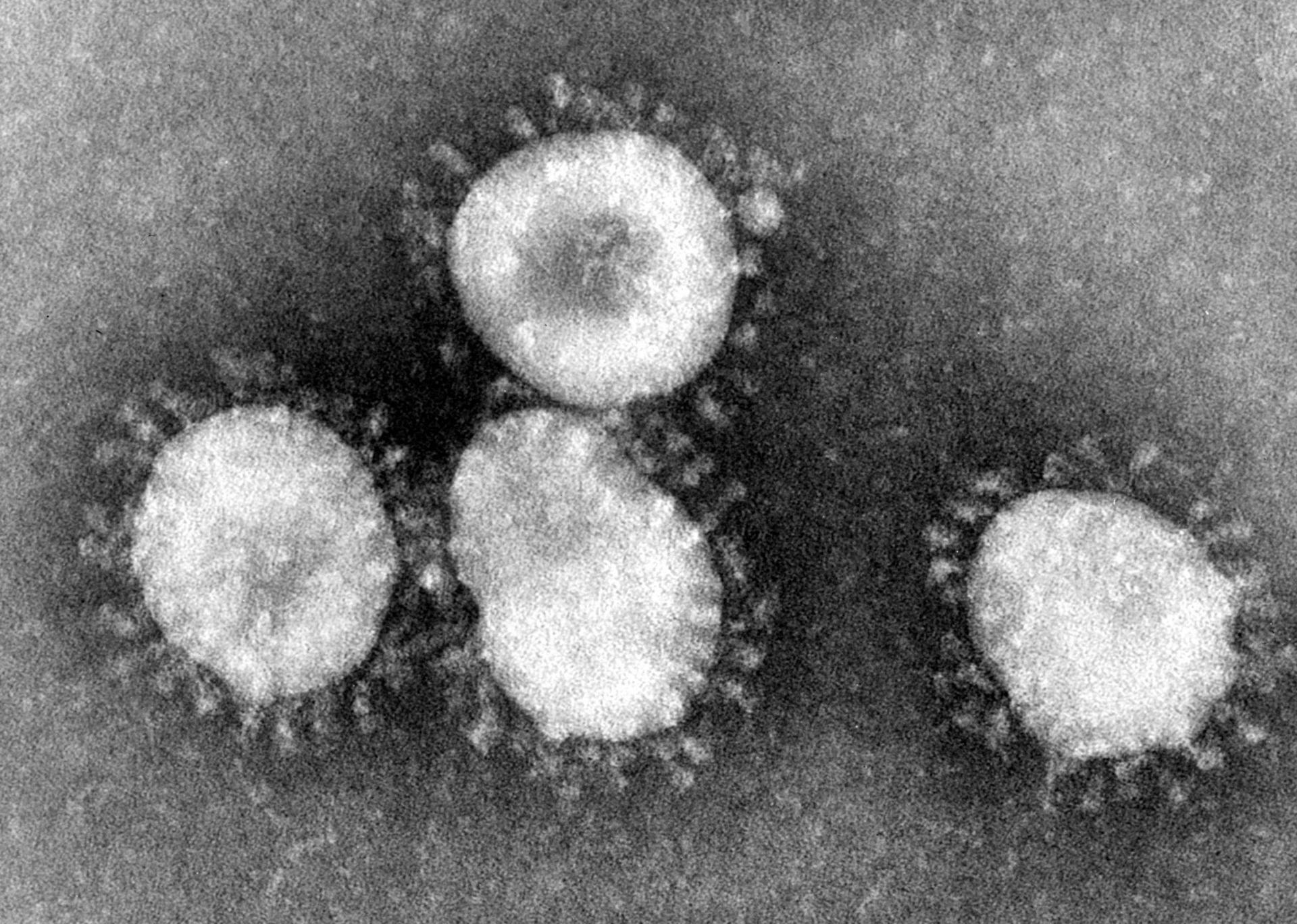Son premier livre, Alfred Métraux et le chamanisme (2004), est tiré d’un mémoire de master en Anthropologie, sorte de prélude théorique au grand saut dans l’inconnu qui devait suivre : Les Voleurs d’ombre. L’univers religieux des bergers de l’Ausangate (Andes centrales), second livre paru en 2010 aux éditions de la Société d’ethnologie, ouvrage cette fois tiré de sa thèse de doctorat en Anthropologie.
D’origine péruvienne par sa mère, Xavier était habité depuis sa plus tendre enfance par la question des relations entre les descendants des colons espagnols et les Indiens des hauts plateaux andins. Pour sa Thèse de doctorat, il choisit de franchir la barrière des classes, des races, de l’espace et du temps. Il apprit le quechua, gravit la montagne, partit vivre auprès des bergers des Andes, à une altitude où la nature n’est pas tant hostile que radicale. Il fut d’abord accueilli par le silence des espaces infinis, le cri des lamas, la profondeur des nuits glacées et l’indifférence déterminée des bergers. Il tint bon, jusqu’au jour où les bergers reconnurent en lui non pas un « blanc » venu remplir sa cruche d’un savoir qui lui servirait ensuite de capital symbolique pour bâtir une carrière académique, mais un ami, bientôt un frère. Xavier était ainsi. Il touchait à l’âme. Parce qu’il ne trichait pas :
« Le camion a quitté Sicuani à quatre heures du matin, dans le froid encore mordant de l’aube. Au fur et à mesure que l’on s’élève, l’air devient plus sec. La sensation de froid est atténuée par le soleil qui passe les premières crêtes et que l’on aperçoit par intermittence. Lorsqu’il neige en revanche, comme c’est bien souvent le cas, on s’enfonce dans une tiédeur ouatée, en observant les collines qui renvoient une pâleur irréelle. De Minas Chupa, où l’on arrive à neuf heures passées, on aperçoit, vers le nord-est, la vallée de Sallina, qui s’étire en contournant les monts Yana Urqu et Pupusayuq vers l’est. Pour l’atteindre, il faudra franchir la vaste plaine marécageuse que l’on a devant soi : je me suis maintes fois égaré dans ce dédale de flaques et mares, à l’eau basse et couverte de moutons de neige. La plaine est barrée en son milieu par les eaux conjuguées du Sallma Mayu et du Chuwa Mayu, qui forment ensemble le WakaWata. Il faut bien connaître le chemin, car il n’y a qu’un seul gué : je l’appris à mes dépends lorsque, par un matin de mars 2001, aveuglé par une violente tempête de neige, seul au milieu de cette plaine inhospitalière, je me perdis et, me décidant malgré tout à franchir la rivière (il n’y aurait pas de camion avant le lendemain !), je tombai, avec tout mon matériel, dans un trou du lit du fleuve, masqué par les eaux tourbillonnantes. Je m’y enfonçai jusqu’à mi-corps. Ce jour-là, me voyant épuisé, après plusieurs heures de marche où il m’avait fallu presser le pas pour combattre le froid qui m’envahissait, emporté par les rafales de vent et de neige qui soulevaient les pans de mon poncho, Braulio comprit, je crois, que j’étais sincèrement décidé à partager un temps la vie des bergers. Pour la première fois, quelques jours plus tard, il me conta de lui-même une histoire » (Les Voleurs d’ombre, p. 44).
Gravir la montagne, franchir à corps perdu les eaux glacées de la rivière, marcher des heures durant dans le vent, le brouillard et la neige, à l’aveugle, au senti, au risque de se perdre et de mourir, ceci dans le seul but de recueillir la parole d’un berger des Andes, Xavier était ainsi : un aventurier de la pensée. Pour de vrai. De ce voyage initiatique, il tira beaucoup plus qu’un livre, une éthique, celle de la rencontre avec l’autre homme.
C’est sans doute ce qui convainquit le CCFD de le charger de la supervision des projets de développement soutenus par l’institution dans le monde entier. De ses pérégrinations universelles, il tira un troisième livre paru au Seuil en 2017 : Blanche est la Terre. Récit. La blancheur en question est celle non de la peau, mais du cœur des hommes qui habitent en vérité notre planète, Terre des hommes que Xavier voyait dévastée par la logique marchande, mensongère et prédatrice du Capital. « Nous sommes tous haïtiens » aurait pu être son mot d’ordre, celui qui résumerait tant l’état des lieux que la source d’un salut à venir :
« Hélas, le cas d’Haïti, pour être archétypale et caricatural, n’en est pas moins exemplaire de cette ‘‘grande transformation’’ qui a vu le marché devenir l’élément organisateur des sociétés modernes. Débarrassé des contraintes que lui imposait la coexistence avec des sociétés locales, faites de compromis sociaux et d’un dialogue multiséculaire avec un environnement considéré comme bio-tope (c’est-à-dire lieu de vie), le marché est désormais déployé à une vaste échelle, sur le plan lisse et sans grumeau que la mondialisation a fabriqué pour lui » (Blanche est la terre, p. 155).
Revenu en France, sa mission auprès du CCFD accomplie, il entre à l’ENA, parce qu’il est convaincu qu’il faut s’emparer, autant que faire se peut, des leviers institutionnels. Cependant, loin de se rallier à la philosophie de l’institution, il la mine de l’intérieur. Il réfléchit assidûment à l’offensive néolibérale sur le salariat occidental et dresse le constat de ce qu’il appelle La Tropicalisation du monde (Puf, 2019), soit la manière dont le régime économique et social qui a prévalu dans les anciennes colonies est en train de revenir, tel un boomerang, sur les nations colonisatrices. Autrement dit, plutôt qu’un passé révolu, « L’expérience coloniale est préfiguratrice » (p. 63), ce dont il tire alors la leçon suivante : apprendre auprès des anciens colonisés la possibilité de réenchanter le monde. Il conclut :
« La contribution du Sud global à notre conscience politique se résume en somme à une formule simple : contre la marchandisation il nous faut apprendre à rétablir l’ob-vie, autrement dit l’évidence limpide de ce qui se trouve devant nous, sur le chemin : la dimension relationnelle de l’être humain et, plus largement, de tout être vivant. Reliés aux puissances d’agir que les Andins nomment animu, et d’elles dépendantes : c’est là ce que nous sommes » (La Tropicalisation du monde, p. 113).
De son passage à l’ENA, il tire néanmoins un art de la synthèse dont il fait usage dans Demain la planète. Quatre scénarios de déglobalisation (Puf, 2021), son cinquième livre paru, le dernier de son vivant. Et sous la forme policée du conseiller d’Etat qui maîtrise ses dossiers et décrypte les alternatives à venir surgit, encore et toujours, au détour d’un exercice de prospective, une parole de chaman, inspirée des bergers des Andes ou de Nietzsche :
« La valeur d’un objet, d’une action ou d’une connaissance, dépend de sa contribution plus ou moins grande à l’intensité de vie, entendue à la fois comme quantité de liens (établis, rendus possibles par l’objet, l’action ou la connaissance en question) et qualité de ces liens, proportionnelle à leur fécondité, à leur capacité à susciter à leur tour d’autres liens également fructueux » (Demain la planète, p. 103-104).
Son dernier livre, L’Etat de nature, a été adressé à son éditeur des Puf quelques mois avant son décès. Xavier me l’avait remis en mars de cette année. L’ouvrage part de plusieurs constats, notamment deux : le premier est relatif à l’Etat, réduit aujourd’hui à sa nudité la plus crue : « l’Etat d’exception » ; le second est relatif au Capital :
« Des décennies de néolibéralisme ont réduit la société à une sorte de poussière d’individus, ballotés par les exigences d’accumulation du capital rendues de plus en plus exorbitantes à l’heure où, pour diverses raisons aussi objectives et incontestables qu’un coucher de soleil, le dit taux d’accumulation (ou taux de profit) du capital ne cesse de se réduire. Le conserver au plus haut niveau possible, voilà toute l’affaire des capitalistes : la sous-rémunération chronique des facteurs de production (ressources naturelles, force de travail, équipements, savoir-faire individuels et collectifs, Etat) est désormais le moyen le plus sûr de rémunérer les détenteurs de capitaux au taux le plus élevé » (L’Etat de nature, inédit).
De ce double constat résulte, en forme de réaction, ce que Xavier appelle un « désir de fascisme ». C’est l’alternative, l’avenir qu’il faut conjurer : néolibéralisme triomphant et/ou réaction fascisante. Mais laissons aux Puf le soin de publier le manuscrit avant que de parler du chemin que fraie l’auteur dans cet ultime écrit politique, écologique et philosophique.
J’ai rencontré Xavier en classes préparatoires littéraires dans un lycée de la banlieue parisienne, c’était il y a trente ans ; nous avions dix-huit ans. Nous sommes devenus des amis, des intimes. Xavier était exubérant, comédien, rieur, j’étais timide, discret, peu disert. Il aimait ma réserve, j’aimais sa générosité. Il était catholique d’origine péruvienne, j’étais athée d’origine juive ; il fut réservé sur mon départ pour Israël, comme je fus réservé sur sa conversion à l’écologie. Nous avions nos débats, nos désaccords, sur le sionisme comme sur la valorisation de la nature. Mais nous éprouvions l’essentiel de ce qui construit une amitié : nous savions identifier la grandeur qui gisait dans nos failles respectives.
Xavier était d’un enthousiasme et d’un optimisme qui confinaient parfois, aux yeux d’hommes et de femmes plus stratèges, plus calculateurs, à de la naïveté. Il était pourtant tout sauf naïf, il était sincère. Et il portait en lui la gravité d’un homme qui refusait d’aborder quiconque avec calcul. C’était ce qu’avaient décelé en lui les bergers des Andes, ses frères de pensée et de cœur.
Il incarnait à mes yeux le mot de Spinoza selon lequel la mort est une chose extérieure, une rencontre fortuite. Car rien, chez lui, ne laissait prise à la mort. Pas même sa profonde fragilité d’âme, qui était tout entière tournée vers la vie. La cruelle maladie elle-même n’a pu entamer sa joie de vivre et de partager, jusqu’à son dernier souffle.
Aujourd’hui Xavier n’est plus, mort de cette mort qu’il a racontée dans Blanche est la Terre, au sujet du père d’un ami de l’ethnie Korekore rencontré lors de son séjour au Zimbabwe durant ses jeunes années de coopération au sortir de Sciens-Po. Mon affliction, je lui dois donc de la porter à la hauteur de sa pensée de la mort, telle qu’il l’a éprouvée, et telle que ses deux enfants, Emile et Héloïse, leur mère, son ex-femme Laure, ses parents, son frère et sa sœur, ses amis, l’ont reçue en partage au jour de ses adieux :
« Son agonie ne sera pas longue. Nous y assistons avec la certitude de l’inéluctable, comme on observe une flamme qui s’éteint sur la bougie devenue flaque de cire. Ce n’est plus qu’une affaire de minutes. L’œdème pulmonaire s’étend comme une marée montante. Dans l’assemblée, pas un bruit, les êtres sont frappés de stupeur. La respiration se fait plus incertaine, puis cesse tout à fait. A cet instant les femmes lancent à l’unisson des hululements stridents et déchirants, auxquels d’autres femmes, situées à l’extérieur du bâtiment, répondent aussitôt. Un concert de cris synchrones et réguliers ; d’organique, la mort est devenue sociale et symbolique. Il n’a fallu pour cela qu’une fraction de seconde : dans cette clameur, je pressens la force des symboles qui immédiatement se saisissent de la mort et rituellement la transforment en un événement de vie. Les pleurs sont vigoureux, la mise en scène est armée de la force incoercible d’une affirmation positive. Le métabolisme social reprend ses droits, passée la sidération face au mystère du gisant. Cette reprise en main est une forme de renaissance » (Blanche est la Terre, p. 74-75).
Donc, mon cher Xavier, mon vieil ami, mon camarade, concluons, comme nous avions coutume de le faire, malgré la mort et les larmes, par ces mots qui te racontent si bien, et qui seuls pourront me dénouer la gorge : Hasta la victoria siempre !
Ivan Segré