Née en 1934 à Paris de parents polonais immigrés en 1929, traquée avec sa famille pendant la guerre par la police de Vichy et la Gestapo, Sarah Kofman fut cachée de fin 1942 à août 1944, après l’arrestation de son père, le rabbin Bereck Kofman raflé en juillet 1942 et assassiné à Auschwitz.
Rue Ordener Rue Labat, récit sans grands mots et d’une grande pudeur, publié en 1994 aux éditions Galilée, est l’unique texte autobiographique de la philosophe qui se suicidât en octobre de la même année, quelques mois après la parution de ce livre.
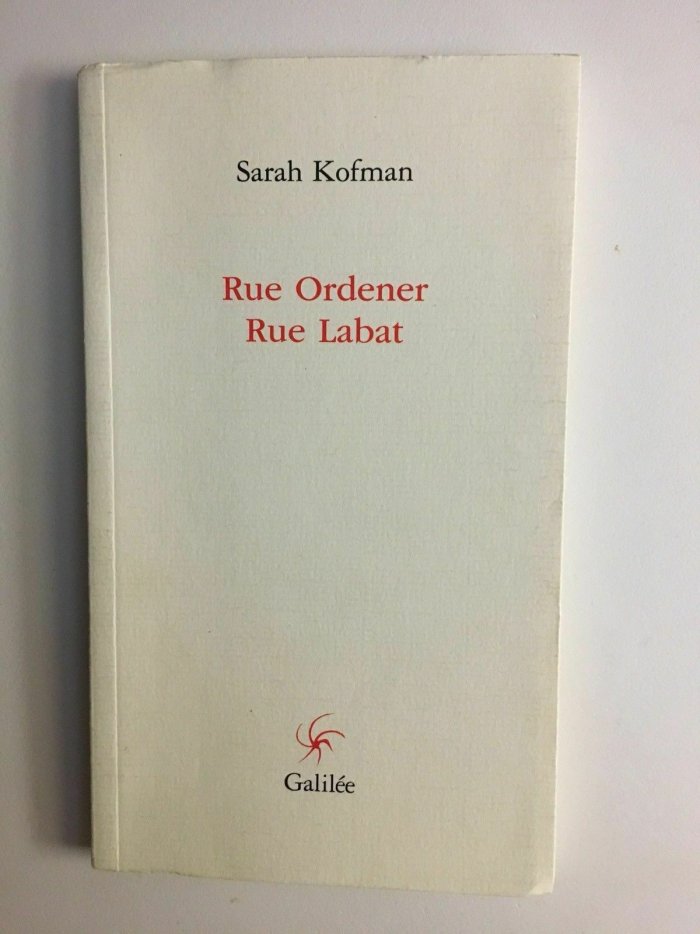
Tout commence avec le stylo paternel, qui l’a accompagnée et l’a poussée à écrire, à écrire encore et à construire « une vie comme texte ».
« De lui, il me reste seulement le stylo. Je l’ai pris un jour dans le sac de ma mère où elle le gardait avec d’autres souvenirs de mon père. Un stylo comme l’on n’en fait plus, et qu’il fallait remplir avec de l’encre. Je m’en suis servie pendant toute ma scolarité. Il m’a « lâchée » avant que je puisse me décider à l’abandonner. Je le possède toujours, rafistolé avec du scotch, il est devant mes yeux sur ma table de travail et il me contraint à écrire, écrire.
Mes nombreux livres ont peut-être été des voies de traverse obligées pour parvenir à raconter “ça”. »
Parvenir à raconter “ça”. A l’origine, il y a quelques souvenirs heureux d’avant-guerre, la célébration des fêtes juives, le tabac que son père aimait tant ; puis Paris sous le régime de Vichy, l’étoile jaune, l’épreuve du malheur extrême, la terreur, les rafles, la disparition du père qui se sacrifie avec l’espoir de sauver sa femme et ses enfants, sa dernière carte – perdue – envoyée de Drancy, le récit de sa mort insoutenable à Auschwitz, les frères et sœurs dispersés, la vie d’une petite fille obligée de se cacher.
« Pendant la guerre, quand le tabac fut rationné, je ramassais pour lui des mégots sur les trottoirs et j’aimais aller lui acheter rue Jean Robert le papier « zigzag » dans lequel il roulait ses cigarettes.
Plus tard, dans un rêve, je me représentai mon père sous la figure d’un ivrogne qui traversait la rue en zigzaguant. »
Ça ? Traquées, cachées, ne pouvant plus revenir dans leur appartement de la rue Ordener, Sarah et sa mère trouvent finalement refuge chez « la dame de la rue Labat », une ancienne voisine qui couve la petite fille, l’encourage dans ses études, l’arrache à sa mère et à sa culture juive, supplantant sa mère dans son cœur au grand désespoir de celle-ci. Disparition du père vécue comme un abandon, terreur et arrachements, déchirures de l’identité entre deux figures maternelles rivales, la philosophe spécialiste de Nietzsche et de Freud réussit à dire sans pathos les survivances de la petite fille, de la souffrance et de la culpabilité.
Les souvenirs semblent survenir de manière alternativement suivie et erratique sous la plume de Sarah Kofman, comme des éclats lumineux (l’apparition d’un inconnu qui vient les prévenir de l’imminence d’une rafle, la bienveillance des institutrices, dont la très généreuse madame Fagnard) ou comme des explosions noires – remontées de la mémoire composant un récit à vif sans mise à distance, à l’inverse d’un autre roman autobiographique, familial et cher à mon cœur, L’amour sans visage d’Hélène Waysbord (Christian Bourgois, 2012) ou de La traversée des fleuves de Georges-Arthur Goldschmidt (Seuil, 1999).
La petite fille oublie les traumatismes du monde dans les cadeaux éminemment précieux de livres et la fréquentation des textes, dessinant un rapport vital aux textes et à l’écriture, ce qui fit dire à Jean-Luc Nancy que l’écriture était pour Sarah Kofman ce qui attestait de son existence.
« Elle [madame Fagnard] savait, au nombre de livres que j’empruntais à la bibliothèque, que lire était ma passion. J’avais dû lui raconter, je crois, qu’en lisant Merlin l’enchanteur, j’avais été tellement absorbée que, me balançant sur une chaise, j’étais tombée dans le feu de la cheminée sans m’en apercevoir, et avais tranquillement continué ma lecture. »






