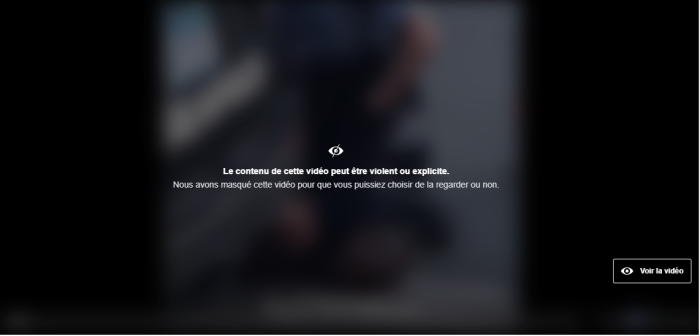
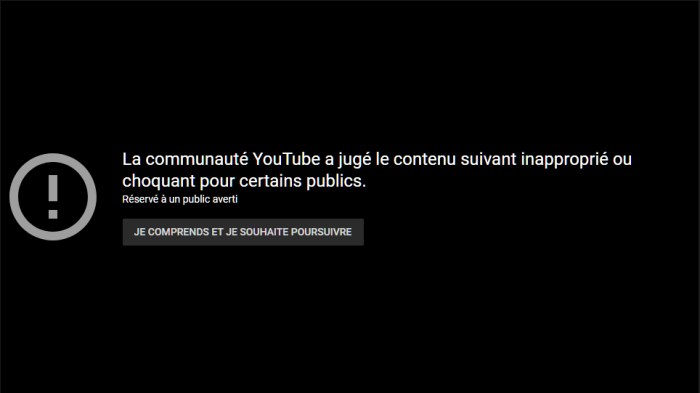
Au fur et à mesure que les flics prenaient la rue, les images de bavures pullulaient sur l’internet, plus les têtes policières s’emparaient de l’espace public plus la figure policière dominait en ligne. Mis à part l’espace privé – et encore pas pour tout le monde – tous les espaces de vie durant le confinement, réels ou virtuels, furent saturés par l’image d’une police toute-puissante. Les réseaux sociaux, les médias dominants, mais aussi militants, se firent alors la chambre d’échos de cette double violence symbolique et physique. Enfermés, inactifs, sur tous les écrans résonnent à travers nos nerfs optiques la brutalité inhumaine des condés : dans nos yeux, nos ordis et nos rêves. La muselière qui s’abat comme un fouet sur un pauvre fou échappé de l’asile et la portière qui s’ouvre sur le passage d’une moto, les gestes létaux de la flicaille s’installent dans notre imaginaire et nous stupéfient, pris comme nous le sommes dans notre solitude et notre incapacité.


L’armée robotique, intouchable, imperturbable des lignes immobiles de CRS ou l’irruption fracassante des BRAV – que nous avons vécu, mis en images ou vus – vient rabattre dans notre for intérieur les esquisses de révoltes incontrôlés, de détente des muscles et de gestes inconsidérés. L’impunité de la figure policière qui hante internet, nous hante et brise provisoirement notre rébellion. Héritiers d’une impasse de la pensée critique nous continuons de sous-estimé la force des images, et créons nous-même les images oppressantes de l’invulnérabilité de la police.



Pourtant, nous le savons par l’histoire, aucune force n’est imbattable – pensons au pouvoir royale investi du divin : qui oserait à l’époque s’en prendre au représentant de Dieu sur terre – et nous le savons par l’expérience, la police est parfois vulnérable. Contrairement aux dires de l’idéologie sécuritaire, il y a toujours une faille dans le dispositif, toujours une erreur ou un passage, jamais la militarisation de l’existence, malgré ses stupides prétentions, ne saura être totale.



Seulement parfois la peur nous gagne et l’irrationnel l’emporte sur la raison, la figure policière investi de magique nous aliène plus que jamais, le tout-policier nous envoute, il nous tenant sage et muet. Je me réfugie, je fui et les mécanismes d’autodéfense psychique s’activent, je ne veux plus rien voir ni entendre. Pendant ce temps, on tabasse en dehors, on tabasse dans nos quartiers, on tabasse, pour rien, pour la race, pour le plaisir, pour le pouvoir.
Et la fierté des dominants s’étale de son dégoutant bon-droit. J’étouffe. Partout leurs mesquines histoires pendant le confinement, leurs petits faux problèmes, leur monde « d’après » encore plus dégueulasse et injuste que celui « d’avant ». On étouffe. Leurs nouvelles et confortables justifications de la répression quotidienne. Leur indifférence intenable des opprimé.e.s, leur laisser aller dans le racisme le plus banal et le plus vil. On étouffe dans les quartiers, on étouffe dans les villes, on étouffe de la botte policière tenu sur le cou de George Floyd, sur les cous des noirs, sur les cous des militant.e.s, sur les cous de nos camarades. Il n’arrive pas à respirer, je n’arrive pas à respirer, nous retenons tous notre respiration.



Mais Finalement George Floyd ne respirera plus jamais, les policiers tuent en plein droit et en pleine lumière, en plein live. Le cou d’un inconnu est écrasé à Minneapolis et les coups pleuvent sur des ami.e.s à Paris. Toujours humanistes, les policiers frappent, mutilent et tuent... pour sauver des vies. Alors l’angoisse reprend le dessus, notre respiration s’emballe, d’anciennes marques se révèlent, des mauvais souvenirs reviennent : on me passe les menottes – je porte mes mains à mon cou –. Et s’il avait serré plus fort ? S’il avait continué ? Je serais peut-être mort moi aussi, comme Floyd exactement comme Floyd. Sauf qu’il m’a lâché et envoyé rouler ma tête contre le capot de leur voiture. « Sauver », pourquoi ? Parce que je suis blanc ? Peut-être, quoique de nos jours ce qu’ils appellent les blocs « black » on tendances à faire partie des cibles privilégiés des racistes armés, gardiens de la paix.


Souvenirs aussi du nouveau TGI de Clichy, immense labyrinthe ultra-moderne à l’esthétique fasciste où l’on applique les lois scélérates, bâtiment assiégé par des dizaines de milliers de manifestants le Mardi 2 Juin 2020. Le bâtiment visible depuis tout Paris n’est que le haut de l’iceberg de la répression, dessous ce cache la partie noire du monde pacifié, dans ses sous-sols : le « dépôt ». Véritables oubliettes propres, sous le tribunal vitré et lumineux de la justice resplendissante, se déploie une gigantesque prison aseptisé et inhumaine. Aller « au dépôt » – en attendant une comparution immédiate par exemple – c’est se payer une visite dans l’envers du monde moderne, dans un univers pénitentiaire, où les humains sont traités comme des bêtes : abandonnés dans des cellules individuelles pendant un temps indéterminé pouvant aller jusqu’à 48h, tout le monde y hurle de rage et frappe ses barreaux de détresse. Les policiers y sont les seigneurs et diables, les prisonniers, dénudés de leurs droits, sans défenses. Le dépôt est un bon exemple de ce que peut-être la prison, les CRA ou les asiles de fous. J’y ai vu la réalité de ce monde raciste ou quatre-vingt pour cent des détenus sont des personnes racisés qui subissent ce traitement punitif régulièrement : gardav, dépôt, prison.


Escorté par deux policiers on m’amène devant un bureau ou je dois signer mon entrée au dépôt, je demande un avocat et un médecin, les deux ne sont pas signaler sur ma fiche, je refuse de rentrer en cellule mais le flic me menace et dit à ses collègue d’un air menaçant : « eh les gars le ’black bloc’ veut pas signer ». En passant chercher ma couverture j’assiste à une scène glaçante : deux gros flics blancs crient des ordres, dans une langue qu’il ne peut pas comprendre, à un migrant à moitié nu, tremblant comme une feuille. Des larmes coulent sur ses joues sales. Dans cet « autre » monde, assurément dystopique, pour ceux qui y vivent ou ceux qui y passent, crier le slogan : « flic, violeur, assassin » ne passe pas pour une exagération ou un simple mot d’ordre mais pour un rituel cathartique, une nécessité vitale.


On voudrait crier à plein poumon, mais le souffle nous manque, nous ne respirons plus, nous sommes subitement seul.e.s. A l’autre bout du monde, un homme noir est mort, qui s’en souviendra dans cette époque obscure ? Il rejoindra le long cortège funèbre des opprimé.e.s oubliés, et l’image de son assassinat impuni viendra grossir les armes symboliques de la police. Nous resterons là, avec nos images et nos regrets, notre rage et notre douleur se recouvrira de ruines.


Heureusement les soulèvements nous soulagent. Ils font exploser la rage et on balance la douleur par-dessus bord, on partage la souffrance avec les camarades et avec les bourreaux, on la met devant les indifférents, on la transforme et en commun. Aussi les soulèvements donnent raison à ceux ce sont soulevés avant, contre le tri médiatique, contre l’oubli, contre le renoncement, les soulevés se soutiennent psychiquement les uns et les autres, ils assurent la continuité d’une puissance.
Ainsi en 2019, après la mort impuni de Rémi Fraisse, les mutilations et les blessés des mouvements sociaux et des expulsions des zads, la défaite à Notre-Dame-des-Landes, survient le mouvement des Gilets-Jaunes. En 2020, après la répression du mouvement contre la réforme des retraites, le massacre des Gilets-Jaunes, la mort inacceptable de George Floyd, le Black Lives Matter movement.
Dans chaque nouveau soulèvement ce qui se joue c’est la santé mentale des militant.e.s, leur capacité à lutter dans un temps long – nécessaire à des transformations importantes comme la destitution de l’institution policière –, la sécurité des populations de tout temps désarmés face à la police ou de leurs nouvelles cibles. Ici, le soulèvement en cours, s’il est une réaction épidermique contre les violences policières, si c’est un mouvement pour l’émancipation des minorités ethniques, si c’est un mouvement antiraciste, quoi qu’il arrive, il lutte pour toutes les victimes de violences policières, et elles sont très nombreuses. Il lutte en réalité, aussi pour les « Jeunes des banlieues », pour les militant.e.s de « l’ultra-gauche » et les Gilets-Jaunes criminalisés comme pour les syndicalistes réprimés.


Plus le mouvement Black Lives Matter se propage, plus les images de ces actions se diffusent, les images de barricades devant la Maison Blanche et d’incendie arrivent en Europe.
Les images des soulèvements nous soignent, ce n’est plus notre impuissance qui tourne en boucle sur les réseaux-sociaux, mais notre puissance. Le monde n’est plus connecté sur des images de policiers français jetant une personne racisé dans la seine en lui balançant des insultes datant de la guerre d’Algérie, mais sur des afro-américains faisant cramer les voitures de l’Etat raciste américain. Non plus sur des présentations publicitaires de drones policiers par la mairie proto-fasciste de Nice, mais des manifestants à cheval qui lève le poing ; un commissariat qui brûle, un engin de chantier utiliser comme bélier, un héroïque manifestant boxeur, des manifestations monstres dans toutes les grandes villes occidentales … autant d’images qui nous rendent notre puissance d’action, qui effraient les dirigeants et qui font circuler notre intelligence collective.


Nous savons qu’une lutte des représentations accompagne notre lutte, mais beaucoup de confusion règne à ce sujet. Disons simplement, que pour chaque création d’une image de drone policier, il faut une image de drone abattue avec un rouleau de papier toilette ; pour chaque tabassage, un caillassage etc. Une règle audiovisuelle qui suppose aussi qu’avant de faire des images il faut créer la situation nécessaire, et voyez le résultat satisfaisant : quand une seule voiture brûle et que tous les médias en utilisent l’image, la répression individuelle est très forte (comme pour le quai de Valmy), quand des centaines de voitures brûlent, on est déjà plus tranquille.



Et alors surprise, des populations s’embrasent quand on s’y attend le moins : manifestations interdites, covid19, mesures sanitaires totalitaires, chantage affectif permanent, et voilà que des dizaines de milliers de jeunes, dans toutes les grandes villes de France, décident de ne pas se laisser faire plus longtemps et de faire changer la peur de camp.
Les soulèvements nous guérissent, nous y retrouvons nos frères et nos sœurs, nos camarades, nous pouvons enfin retrouver du souffle et crier à plein poumons, dégager les bottes policières qui nous contraignent. Montrer notre force à l’institution policière et ses défenseurs, menacer d’un contre-pouvoir populaire le pouvoir étatique. Nous respirons à nouveau. Et dans ces cortèges si agréablement mixtes socialement, les images font des étincelles dialectiques : l’image d’athéniens attaquant une ambassade américaine au Molotov rappelle des éléments historiques et les imaginaires s’ouvrent des possibles du passé. Il y a dans ces révoltes mondiales plus de liens avec les années 70 – période où les mouvements féministes, antiracistes et anticapitalistes étaient encore plus puissants – avec les images des Black Panthères et de leurs alliés qu’avec les images télévisuelles de la « révolte des banlieues » de 2005. Avec ce soulèvement et les images qu’il crée, les images dominantes sont loin maintenant et nous pouvons espérer qu’elles entrainent dans leur disparition, les multiples fantasmes exotiques – et en partie raciste – de l’alliance supposé du mouvement révolutionnaire avec les banlieues.
Nous respirons mieux. Mais un soulèvement n’est pas une révolution et l’expérience nous l’apprend aussi, le souffle s’épuise à ne respirer que pendant les soulèvements et tenir le reste du temps en apnée. La question est toujours la même : comment devenir solide, comment tenir dans le temps, comment s’organiser, comment ne plus manquer d’air ?
Si pour le moment la situation n’est pas maitriser par les gouvernants, que les médias se taisent et que le gouvernement réfléchi, le mouvement réactionnaire adviendra tôt ou tard dans les prochaines semaines. Rappelons-nous – pour ceux qui l’ont connu, ou partageons le à ceux qui ne l’ont pas connu – le mois de décembre des Gilets-Jaunes : la situation émeutière a connu un pic, puis n’a fait que chuter de plus en plus pour s’asphyxier sous une répression sanguinaire. Nous pouvons parier que le gouvernement tentera la même stratégie stupide avec des populations d’autant plus facilement criminalisable que l’Etat est raciste.


Aujourd’hui que nous sommes soulagés, posons-nous les bonnes questions, par exemple : 1) comment conserver une mixité sociale que seul un mouvement spontané pouvait permettre ? 2) comment conserver la lutte dans un champ anti-impérialiste et internationaliste ? 3) comment garder le contrôle de la rue et la pression sur les forces de l’ordre 4) comment ancrer le mouvement dans le temps et l’espace ?
Si les réponses à ces questions doivent se faire avec l’aide de notre imaginaire individuel et collectif, il est à peu près certain qu’il faille puiser dans les expériences historiques et forcément méconnues du Black Panthère Party américain. Il y a déjà là : l’évidence d’une fondation politique par quartiers, une organisation synthétique allant de la garde d’enfants au détournement d’avion et les « patrouilles de surveillance de la police » :
« En janvier 1967, le parti ouvre officiellement son premier bureau à Oakland. Il entreprend quelques mois après sa création une campagne de patrouilles visant à surveiller les agissements de la police de la ville. L’action est censée répondre au septième point de son programme : « Nous exigeons la fin immédiate des brutalités policières et des assassinats de Noirs ». Les Black Panthers s’inspirent d’actions équivalentes menées l’été précédent dans le quartier de Watts en Californie. Des « Patrouilles d’alerte des citoyens noirs » (Negro Citizen Alert Patrols) s’étaient organisées en équipant des véhicules de scanners destinés à écouter et suivre les voitures de la police de Los Angeles. Munies de livres de droit et de magnétophones, les patrouilles s’assuraient de la légalité de chacune des interventions des forces de l’ordre. L’opération avait cependant dû être interrompue après que la police eut détruit les appareils d’enregistrement et dispersé les patrouilles par la force.
Les Black Panthers ajoutent un élément à la panoplie initiale du groupe de Los Angeles, en armant les participants des rondes de surveillance de la ville d’Oakland. L’objectif du groupe est toutefois de rester dans le strict cadre de la légalité. Il s’appuie sur le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique et la législation de l’État de Californie pour justifier le port d’armes non dissimulées de ses membres. Ces derniers reçoivent une formation sur les droits constitutionnels fondamentaux en matière d’arrestation et de port d’armes. »
Signé X






