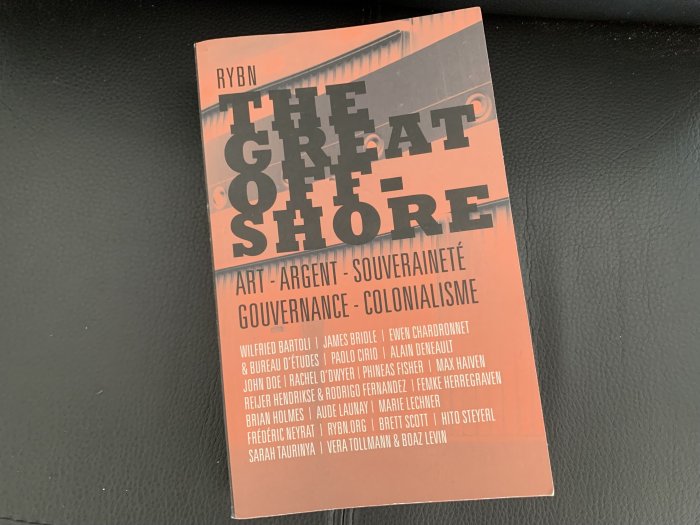J’ai visité l’utopie de l’argent : ce n’est pas seulement l’utopie de ceux qui ont de l’argent, c’est l’utopie de l’argent lui-même.
Niché dans les routes sinueuses d’une zone industrielle, à côté du tarmac de l’un des aéroports les plus fréquentés d’Asie, à deux pas de la garnison de la police de l’air et des frontières, le Freeport de Singapour [1] s’est isolé de ses voisins derrière des rangées de barbelés. C’est un entrepôt de luxe, spécialement conçu et hautement sécurisé, dans lequel les ultra-riches encryptent leurs œuvres d’art [2].
Sur invitation seulement, vous pourrez parler aux gardes par un interphone, franchir plusieurs portiques de sécurité ultramodernes et pénétrer dans l’enceinte du bâtiment rouge et noir. Vous passerez ensuite par une batterie de postes de contrôle plus rigoureux que dans n’importe quel aéroport. Vous remettrez votre passeport par un tiroir à un garde invisible dans un bureau situé de l’autre côté de la glace sans tain. Un personnel courtois vous donnera l’ordre de vider vos poches dans une petite boîte et d’en placer leur contenu, ainsi que vos sacs, dans une machine à rayons X, tandis que votre corps passera par le scanner corporel L3.
La sécurité n’est que l’objectif secondaire de toute cette infrastructure, m’a expliqué le gardien, sincère, tandis qu’il me conduisait dans l’immense atrium du Freeport, enchevetré dans une énorme sculpture commandée spécialement à Ron Arad (qui porte le titre sinistre de la Cage sans frontières [3]) et entouré de portes blindées identiques, donnant sur des suites destinées aux visites privées. Les designers et architectes ont travaillé en collaboration aussi étroite que possible avec les principales compagnies d’assurance des œuvres d’art pour garantir que le bâtiment, situé à quelques mètres à peine du tarmac de l’aéroport, offre un environnement presque sans risque. Mais, me confie mon guide, la raison qui a présidé au contrôle extrême des visiteurs est la même que celle qui a présidé à la « starchitecture » du bâtiment et à la sculpture gigantesque de l’atrium : le théâtre. Il s’agit moins de faire comprendre aux riches clients que leurs trésors sont en sécurité, que de leur faire comprendre qu’ils sont eux-mêmes des sujets dignes d’estime parce qu’ils possèdent des objets dignes d’une telle attention.

Un nombre inestimable de trésors culturels se trouve à l’intérieur. « Nous ne savons pas ce qu’il y a dans les coffres, et nous ne voulons pas le savoir », me dit le gardien. La tâche du Freeport, m’explique-t-il, c’est d’offrir aux clients un environnement éternel et artificiel (de dimensions variables, en fonction des besoins) où la température est maintenue à 20 degrés et l’humidité relative à 55 % (sauf demande contraire). Ce que les clients choisissent d’encrypter dans le Freeport, c’est leur affaire : si, en théorie, les objets stockés dans l’entrepôt de luxe sont situés sur le sol singapourien, leurs propriétaires ne paient pas d’impôt tant que ces objets n’entrent pas dans Singapour proprement dit – tout se passe comme s’ils se trouvaient toujours sur le tarmac, auquel le Freeport a un accès direct et privilégié depuis ses portes arrière. Des générateurs de secours sont prêts dans le cas peu probable d’une panne d’électricité et un système d’extinction d’incendie sans eau permet d’aspirer l’oxygène d’une pièce et de le remplacer par de l’azote pour assurer que le magot qui se trouve à l’intérieur ne subisse aucun dommage.
La chaîne de responsabilité est pour le moins nébuleuse. Le Freeport, l’entreprise qui a construit et qui exploite l’entrepôt, loue des locaux à des clients comme Christie’s et d’autres compagnies spécialisées du monde opaque et délicat de la vente, du stockage et de la manipulation d’œuvres d’art. Les musées, collectionneurs ou galeries (ou les sociétés écrans créées par l’une ou l’autre de ces entités) peuvent faire appel à ces entreprises pour abriter une œuvre d’art. L’investisseur peut louer son propre coffre, mais il est plus probable qu’il sous-traite la location à une compagnie spécialisée dans la protection des objets, qui ne pose pas ou peu de questions. Personne ne sait ce qu’il y a dans la crypte. Les titres de propriété, comme les propriétaires eux-mêmes, peuvent se trouver n’importe où dans le monde. Ce qui est certain, c’est que le Freeport existe à Singapour pour tirer parti de l’emplacement unique de la cité-État capitaliste quasi autoritaire : des lois notoirement strictes ; une société militarisée ; une population de langue maternelle anglaise très éduquée ; un système de droit de propriété transparent, conforme aux traités commerciaux internationaux ; plus important encore, une proximité immédiate avec les marchés de l’art chinois en plein essor [4].
Une utopie de l’argent... ?
Les freeports comme celui de Singapour ne sont qu’une partie de l’archipel secret d’espaces utopiques qui existent dans l’atmosphère du capitalisme tardif où les inégalités s’accélèrent et paraissent sans limites. Tandis que l’écart se creuse entre les riches et les pauvres dans presque tous les pays du monde, le nombre de millionnaires [HNWI] [5], dont beaucoup sont issus des BRICS et des pays du Sud [6], augmente également. Ces derniers sont avides de tirer profit de leurs richesses, qui proviennent pour la plupart de la spéculation financière (ou sont amplifiées ou blanchies par celle-ci), pour construire une utopie privée dispersée dans le monde, inaccessible au plus grand nombre. Le Freeport est un fragment d’une utopie mondiale pour les ultra-riches qui comprend aussi les localités de villégiature exclusives, les yachts, les propriétés fastueuses dans les métropoles mondiales, les voyages « no-limits [7] », le tourisme spatial [8] et même les bunkers de luxe [9].
Ce qui est en jeu ici, c’est le pouvoir de l’extrême argent de re-façonner le monde, de créer un réseau de « bons-lieux / non-lieux » utopiques cachés en pleine lumière. Cette tendance est un processus de déterritorialisation / reterritorialisation : un monde de plus en plus marchandisé, monétisé et financiarisé ; un monde désespérément inéluctable et rigide pour la plupart d’entre nous, fluide et protéiforme pour le capital et les capitalistes. Si, sous le capitalisme, l’argent est le pouvoir de commander le travail d’autrui, alors les espaces utopiques comme les freeports représentent l’apogée de la capacité du capital à déraciner la richesse du monde. Le potentiel de coopération vivant et mort des acteurs humains et non humains – sous la forme d’énergies exploitables et de produits consolidés – se concentre dans un certain nombre de processus et d’architectures pour la jouissance exclusive de quelques-uns. Si la coopération et la politique sont, en un sens, le produit de la capacité humaine de dialogue et d’échange, la consolidation extrême de la richesse financiarisée représente un moment de déconnexion presque impossible, où, au sens propre et au sens figuré, le propriétaire d’un titre de valeur mobilière sort de la condition humaine pour entrer dans le nouveau monde de l’homo monetaris, en dehors de la politique.
Pour comprendre l’utopisme de l’argent, nous devons remonter au concept d’« utopie ». Beaucoup [10] considèrent que l’Utopie de Thomas More contient le cœur de l’émancipation radicale [11] , qu’elle constitue le premier voyage de l’imagination moderne [12] pour voir comment la société pourrait être organisée autrement. C’est vrai. Mais nous devons nous rappeler aussi que l’utopie de More était un patriarcat autoritaire et une colonie de peuplement [13], qui s’inscrivait dans une logique d’usurpation violente et racialiste [14]. L’Utopie prend en effet la forme du témoignage et des opinions d’un explorateur européen du « Nouveau Monde », et elle a été écrite par un éminent juriste anglais au moment où sa nation réfléchissait à la manière d’affronter sa rivale, l’Espagne, tandis que celle-ci remplissait ses caisses en asservissant les peuples autochtones de l’actuelle l’Amérique latine et en les faisant travailler jusqu’à la mort pour arracher des richesses minérales incalculables à la terre. Thomas More, un conservateur sur le plan social, devenu par la suite (et fatidiquement) chancelier de Henri VIII, était manifestement très préoccupé, dans l’Utopie, par l’influence destructrice de l’argent sur la société et par sa capacité à bouleverser ce qu’il concevait comme un ordre féodal imparfait mais fondamentalement légitime.

Même si elle a été écrite avec ironie, ou comme une expérience de pensée amusante, l’Utopie de Thomas More présente un monde où un souverain éclairé, Utopos, s’est emparé d’un lopin de terre stratégique, l’a probablement nettoyé de sa population autochtone, et y a établi des lois permettant aux patriarches des cités-États de gouverner pratiquement sans argent. Il faut donc tenir compte de l’acte de violence originel [15] d’Utopos, ainsi que de sa loi (préfigurant le Deuxième Traité du gouvernement civil de John Locke, qui a joué un rôle essentiel dans la légitimation philosophique du colonialisme [16]) qui permet à ses sujets de s’emparer de la terre de leurs voisins « barbares » s’ils la jugent sous-exploitée. Il s’agit ici du fait que la logique de l’utopisme européen est toujours liée à l’imagination coloniale – celle de supplanter les autres ; d’arriver sur des rivages lointains ; de trouver un territoire dont on peut ignorer et soumettre les populations, les lois ou le réseau de relation d’origine ; et d’y créer une sorte de monde parfait.
More serait peut-être horrifié par les excès des millionnaires contemporains, qui dépassent même la débauche de luxe de la cour des Tudor, mais le fait est que le monde exclusif et décentralisé que ces millionnaires sont en train de créer pour eux-mêmes aujourd’hui dérive de cette logique coloniale-utopique. Si les Utopiens d’origine ont pu être contraints de voler une île, ceux d’aujourd’hui s’installent et colonisent non seulement les îles privées mais aussi toutes sortes d’espaces et d’institutions sociales, créant un archipel d’utopies miniaturisées comme les freeports. Il s’agit de zones de jeu ultra sécurisées qui, d’un côté, dépendent des infrastructures matérielles et immatérielles fournies par le reste de l’humanité (et des « ressources » du monde naturel, et du travail des êtres humains, de la ville et de l’État), mais qui, de l’autre, supplantent et exproprient sans avoir aucune responsabilité envers ce monde, aucune obligation même d’interagir avec lui. Un milliardaire peut voyager en hélicoptère de son penthouse londonien jusqu’à l’aéroport, arriver à Singapour dans son jet privé, se rendre du tarmac au Freeport pour examiner ses richesses, et repartir pour sa localité de villégiature de luxe sans jamais rencontrer la moindre perturbation dans son utopie stratosphérique.
Je ne voudrais pas que l’on prenne ce qui précède pour une critique morale – le système dans son ensemble est déjà bien assez amoral, quel que soit le comportement démoniaque-angélique de ses agents et de ses bénéficiaires. Ce qui est plus intéressant, c’est que la financiarisation [17], par laquelle j’entends une série de transformations intervenues dans le capitalisme depuis les années 1970 (une période que nous pourrions qualifier aussi de « néolibéralisme » ou dex « subsomption réelle du travail au capital »), nous incite à repenser la politique de l’utopie et ce que nous pourrions appeler l’utopisme actuellement existant [18] d’aujourd’hui. Le monde utopique construit par et pour les millionnaires est la manifestation de l’argent capitaliste [19] sous sa forme utopique et financiarisée. Renforcée par le néolibéralisme et l’austérité, c’est une forme qui exige un horizon de parfaite liquidité, et qui s’en approche sans cesse : la capacité de marchandiser, de monétiser ou de financiariser presque tout processus vivant permet au pouvoir disciplinaire de l’argent [20] de s’étendre à toute la planète et de s’intensifier dans chaque espace.
...Ou l’utopie de l’argent ?
Au-delà de la vanité et de la bassesse des bénéficiaires et des agents de la financiarisation, des questions de structure plus profondes se posent. Peut-on aborder le Freeport non seulement comme un exemple des sortes d’utopies que l’extrême argent permet d’acheter, mais aussi comme l’utopie propre de l’argent ? J’entends par là l’horizon utopique immanent à l’argent lui-même, un horizon de liquéfaction presque complète, où, même sous ses formes les plus improbables ou les plus indisciplinées (comme l’art), la richesse du monde se traduit par une forme monétisée ou spéculative. S’engager dans ce sens serait courir le risque du péché marxiste majeur d’anthropomorphiser le capital ; mais ces métaphores peuvent être aussi génératives. Ici, l’utopisme apparaît moins comme un désir que comme une limite parabolique, dont l’existence fait partie intégrante du système dans son ensemble et dont l’analyse est susceptible d’éclairer certains nouveaux contours de ce système.
Nous pourrions noter pour commencer que le Freeport représente le point extrême d’une certaine politique culturelle – ou d’une politique économique – de la vie privée et de la notion du privé. La principale marchandise qu’offre le Freeport, plus encore que la sécurité, c’est la vie privée, laquelle inclut la discrétion et le silence. Comme l’ont montré des auteurs comme Karl Polanyi, Michael Perelman [21] et Nancy Fraser [22], la notion de propriété privée et son corollaire, la sphère privée, ont été la clé de l’architecture juridique et de la légitimation morale du développement capitaliste. La vie privée, en tant que concept, est intimement liée à la réorganisation de l’espace social et urbain qui a accompagné les révolutions bourgeoises et le développement de l’individualisme possessif, un processus intimement lié à l’expansion du colonialisme de peuplement [23]. Le partage de la sphère sociale en une série d’espaces privés reflète, et contribue à renforcer, le contenu juridique de la propriété privée – le concept qui veut que l’activité économique de l’homme (nous conserverons ce nom genré pour faire comprendre ce que visaient les architectes et défenseurs riches, blancs et masculins de cet appareil juridique) soit le prolongement direct de sa liberté et de sa souveraineté personnelles. Comme un État-nation, l’homme privé peut faire ce qu’il veut de ses biens et de son domaine, et cela a des effets catastrophiques pour les femmes, les enfants, les domestiques, les apprentis et (surtout) les personnes réduites en esclavage, qui sont tous considérés à un moment donné comme relevant de la propriété juridique.
Les notions de vie privée et de propriété privée ont été des noyaux immuables de l’expansion capitaliste et impérialiste depuis leurs origines. La vie privée et la propriété privée sont considérées comme si vertueuses, de fait, qu’il faut les imposer au monde entier, à la pointe de la baïonnette si besoin (ou – ce qui est pire, d’une certaine manière – par la philanthropie [24]). Dans de nombreux territoires, les missionnaires et marchands, ces troupes de choc du colonialisme de peuplement, ont exprimé leur horreur à l’égard des formes autochtones de respect collectif de la terre [25] et de l’impudeur supposée d’une vie vécue en commun. Ils ont cherché très tôt à les éliminer et mené une guerre génocidaire contre la vie autochtone. Pendant ce temps, l’expansion du colonialisme et de l’impérialisme a dépendu de l’octroi aux (à certains) hommes européens de droits de propriété privée sur la terre et d’une protection de la vie privée contre l’ingérence de l’État, tandis que les « infractions » autochtones et non européennes aux droits de propriété, comme la prise par la Chine des stocks d’opium européens (dont le commerce avait été la raison d’être* de la fondation du Singapour moderne par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales), ont servi de prétexte à l’intervention militaire. De manière plus générale, l’enclosure des communs [26] (au sens propre, les terres européennes que les paysans avaient utilisées pour leur subsistance et, au sens figuré, toutes les « ressources » communes que sont les forêts, les rivières et l’espace urbain), qui avait été la scène primitive du capitalisme [27], a contribué finalement à imposer et défendre les droits de propriété privée pour les élites sociales.
L’alignement de la vie privée sur la propriété privée est, en un sens, le noyau d’un utopisme armé qui crée des zones sécurisées ou des structures d’exclusivité, des zones ou des structures qui supplantent, exploitent et, en définitive, transforment les mondes qui les entourent en dystopies. Dans le Freeport, la logique utopique de la propriété privée est poussée à l’extrême. La vie privée et la propriété privée s’alignent dans un espace sur mesure. L’art n’y existe pas pour être vu mais, précisément, pour ne pas être vu, pour ne pas être visible, pour être invisible du public, comme un témoignage du pouvoir de l’argent. Le problème n’est pas seulement que les millionnaires parviennent à posséder exclusivement et à séquestrer certains des trésors culturels les plus resplendissants du monde – ça, c’est une vielle histoire. Le problème, c’est la façon dont le Freeport incarne, représente et contribue à reproduire un archipel d’utopies armées propres au capitalisme financiarisé. Le déchaînement et l’ascension de l’argent capitaliste pour devenir l’arbitre universel de la vie et de la mort permettent la création de tels espaces, tout autant qu’ils en dépendent..
Encrypter l’argent, encrypter l’art
Le Freeport a ainsi des choses importantes à nous apprendre sur la production et la circulation de la valeur à l’époque de la financiarisation. La valeur psychique des objets d’art rassemblés dans le Freeport dépend, en un sens, de leur cryptage dans le coffre. Dans la mesure où ces objets ne sont pas seulement des objets de valeur culturelle mais aussi des vecteurs de prestige (ou, dans le vocabulaire de Bourdieu, de distinction) et de spéculation (achetés comme un investissement), leur occultation dans la réserve contribue à assurer cette valeur. Pour le collectionneur averti, la valeur symbolique de la possession d’œuvres d’art ne réside plus seulement dans l’étalage ostentatoire (accrocher des œuvres chez soi) ou dans les largesses non moins ostentatoires (donner une œuvre à un musée ou l’y faire exposer) ; elle dérive en partie du fait que l’œuvre est occultée. Le collectionneur averti, le collectionneur de premier ordre n’est pas nécessairement celui qui est perçu comme l’acheteur lors de la vente aux enchères, mais celui dont la rumeur dit seulement qu’il est l’argent derrière l’enchère ; ce n’est pas l’initié du monde de l’art qui cherche la publicité, mais l’éminence grise*, l’ultra-VIP que l’on remarque à peine, le Léviathan dont on ne reconnaît l’existence qu’aux effets qu’il laisse dans son sillage sur le marché. La boîte noire du Freeport devient un espace de « secret ouvert », connu de tous. Le cryptage de l’art en son sein amplifie les formes de distinction propres à une classe dirigeante contemporaine qui existe dans son propre archipel d’utopies privées ostentatoires.

Il ne faut pas écarter, évidemment, les bénéfices monétaires bien réels de la séquestration des œuvres d’art dans un lieu comme le Freeport. Les Panama Papers [28] et d’autres fuites récentes ont révélé une chose qui a été reconnue par les initiés du marché de l’art [29] : l’art, et en particulier l’art contemporain conventionnel, est un excellent véhicule pour l’évasion fiscale [30] et le blanchiment d’argent [31], entre autres arts occultes de la finance [32]. Le secret notoire du milieu de l’art, la plasticité de l’évaluation des objets d’art et l’incertitude des retours sur investissement dans l’art sont autant d’éléments qui contribuent à faire de l’art lui-même une crypte pour l’argent : c’est-à-dire un coffre qui permet de cacher le capital, mais aussi un code qui signifie l’argent dans une sorte de langage privé, uniquement accessible à ceux qui en détiennent les clés.
La déception que nous pourrions éprouver face au vol du « grand art » appartenant à la sphère publique devrait rester secondaire par rapport à notre fureur face à la forme d’utopie de l’argent que représente le Freeport. Ce n’est pas seulement une utopie où les millionnaires créent pour eux-mêmes des zones exclusives de jeu et de sécurité tandis que, pour nous tous, le monde du travail et de la précarité prend des proportions cauchemardesques. C’est aussi que le Freeport se présente comme un monument à la marchandisation, à la monétisation et à la financiarisation de tout ce qui existe dans ce monde. S’il convient d’éviter une nostalgie mal placée pour l’autonomie supposée de l’art par rapport à l’argent, nous devons voir la transformation de l’art en actif purement spéculatif comme un indice de l’ampleur du pouvoir capitaliste. À tort ou à raison, nous avons appris à placer nos espoirs dans le travail vivant, dans nos capacités collectives à coopérer de manière autonome et dans la liberté tant vantée de l’art – sa capacité à échapper à la capture par l’argent. La capacité du capital à encrypter l’art dans la tombe du Freeport a des conséquences lugubres.
Dans son avant-propos à l’ouvrage que Nicolas Abraham et Mari Torok ont consacré à Freud, Le Verbier de l’homme aux loups. Cryptonomie, Derrida déconstruit le concept de « crypte » et note qu’elle représente une architecture permettant de stocker une chose dans un état liminaire, à la fois vivante et morte. Mais le processus de cryptage encrypte aussi le crypteur. L’étude d’Abraham et Torok a pour sujet le cas décrit par Freud de l’Homme aux loups, dont la souffrance et le comportement pathologique auraient découlé de traumatismes familiaux survenus dans l’enfance. L’Homme aux loups, d’après Abraham et Torok, a encrypté dans son inconscient les images idolâtrées du père et de la sœur et construit sa subjectivité autour d’elles. Ces figures étaient mortes mais aussi vivantes dans une architecture spécialisée, scellée à l’intérieur de son inconscient. En raison de ce cryptage, il présentait un comportement pathologique, en évitant notamment certains mots ou expressions, et faisait preuve d’une grande ingéniosité pour les substitutions subtiles et les détours linguistiques. Le rôle de l’analyste est donc un travail de décryptage, de déchiffrage du code du discours du patient. Sinon, ce dernier reste pris dans la crypte qu’il a lui-même créée. Dans la lecture plus large de Derrida, la crypte est une structure ou un archétype plus général, un lieu où nous stockons ce que nous voulons garder à la fois vivant et mort, et qui par conséquent nous encrypte.
C’est peut-être le sens caché du fait curieux que, comme je l’ai découvert, au Freeport, l’ouverture de chaque crypte d’art ne peut se faire que par deux codes numériques saisis en même temps, dont l’un n’est connu que des gardiens, l’autre, que du client. Mais ce qui est plus préoccupant pour notre enquête, c’est le fait que le Freeport permet à l’art et à l’argent de s’encrypter l’un l’autre. Caché dans une stase éternelle et sans risque, mort et pourtant vivant, l’art devient une crypte pour l’argent : un pur actif, un condensé de la logique de la propriété privée elle-même, un véhicule hermétique de spéculation. Les œuvres d’art peuvent être échangées des millions de fois depuis des endroits éloignés sans jamais bouger d’un centimètre du coffre hyper sécurisé – seul le titre de propriété change de « main ».
En tant qu’architecture, en ce sens, le Freeport s’apparente à ses frères moins bien aménagés du monde des entrepôts logistiques, qui contiennent des actifs ou des marchandises [33], et notamment une proportion appréciable des stocks mondiaux des céréales, des métaux et des produits chimiques, dont la propriété est manipulée ailleurs sur des marchés spéculatifs. Cela fait partie de l’infrastructure de l’utopie de l’argent, qui rappelle les magasins bien remplis de la colonie patriarcale, prospère et efficace, rêvée par Thomas More. Les objets stockés à l’intérieur de ces cryptes sont à la fois morts et vivants ; vivants au sens où ils continuent d’agir dans le monde financiarisé utopique, comme des actifs spéculatifs et des objets de distinction ; morts au sens où ils sont finalement retirés ou semi-retirés de la circulation, dans le monde dystopique que nous sommes, pour la plupart, forcés d’habiter et de reproduire.
Si, dans le Freeport, l’argent encrypte l’art, de telle manière qu’il est à la fois mort (comme une marchandise purement liquide), enfermé dans une tombe pour disparaître à jamais, et vivant (fonctionnant toujours comme cette chose spéciale, cette anti-marchandise qu’est l’art), le contraire est vrai aussi : l’art encrypte l’argent. Par convention, l’art est un actif notoirement non liquide [34] : il est difficile d’assurer qu’un acheteur sera prêt et disponible – le goût étant idiosyncratique – et qu’il paiera le prix escompté. Il est relativement difficile et risqué aussi de transporter les œuvres d’art, et cela va souvent à l’encontre des réglementations étatiques, compte tenu en particulier de ce que les États-nations ont investi dans les œuvres d’art (littéralement et symboliquement) en tant que vecteurs du patrimoine national, dans leur tentative de suturer le trait d’union – qui fuit de partout – entre la nation (entité culturelle et sociale) et l’État (entité juridique et économique). Dans les décennies précédentes, avec le boom du marché de l’art du milieu des années 2000 et l’arrivée sur la scène d’une classe croissante de millionnaires impatients d’entrer dans le jeu sans disposer de beaucoup de relations ou d’expérience, le marché de l’art a mis au point divers mécanismes [35] pour augmenter la liquidité des beaux-arts [36]. Tandis que le monde de l’ombre des galeries privées, des sociétés de vente aux enchères et des collectionneurs d’élite continue de faire la loi, des événements tels que les foires d’art carnavalesques sont apparus pour faciliter l’achat d’art aux riches néophytes et aux non-initiés. De nouvelles plateformes numériques destinées à la vente, à l’évaluation, au suivi et à la prédiction des prix de l’art ont vu le jour et les indices du marché de l’art comme le Mei Moses [37] sont devenus plus fiables. L’essor timide et un peu douteux des fonds d’investissement dans l’art [38] (qui sont essentiellement des fonds de pension à des fins purement spéculatives) est à la fois un moyen et une fin pour la liquidité croissante de l’art. Les freeports comme celui de Singapour [39] constituent une partie essentielle de cet écosystème financier, qui a même obtenu l’approbation des grandes banques d’investissement et des conseillers financiers des ultra-riches.
Un musée secret du capitalisme communisé
On connaît bien le trope d’un rêve utopique qui se transforme en cauchemar totalitaire, notamment par la propagande anticommuniste qui a défini la scène idéologique occidentale de l’après-guerre. Ce que l’on néglige souvent, en revanche, c’est que le système capitaliste qui a produit cette propagande a donné naissance à un totalitarisme utopique [40], à savoir celui de l’argent lui-même, lequel, sous la financiarisation néolibérale, domine et influence la vie quotidienne et l’idéologie politique d’une manière qui dépasse les rêves les plus fiévreux de tout dictateur. Nous sommes parvenus, en effet, à un point que certains auteurs identifient comme le « communisme du capital [41] », qui implique la conjugaison d’un certain nombre de tendances.
Il y a d’abord le fait que, même s’il est composé de multiples entreprises concurrentes, l’appareil financier a la structure générale d’une sorte de Comité central (avec ses méchantes rivalités) qui orchestre brutalement l’« économie planifiée » capitaliste. Malgré leur caractère isolé, les actions individuelles des membres de cette classe ont des effets systémiques : la somme de million d’actes de concurrence de gestion des risques produit des risques systémiques [42], imprévisibles et souvent catastrophiques. Cela nous amène à un deuxième aspect du communisme du capital : le fait que l’État lui-même a été enrôlé pour soutenir l’ordre financier – sous la forme de renflouements, bien sûr, mais aussi, plus généralement, en fournissant une infrastructure juridique lucrative. Alors que le vrai communisme envisage la nationalisation des banques comme un vecteur de contrôle rationnel de l’économie au service des humains, le communisme du capital décrète une sorte de bancarisation de l’État-nation, qui en fait un vecteur pour l’accélération irrationnelle de l’accumulation capitaliste.
Le troisième aspect du communisme du capital, c’est la capture capitaliste du social et du commun. Alors que le vrai communisme est orienté vers l’horizon d’une abolition du travail exploité en tant que tel (à distinguer du « travail ») – au nom de l’épanouissement des relations humaines autonomes et de la prospérité sociale –, sous le communisme du capital, les relations humaines et la vie sociale sont organisées et exploitées pour produire de la valeur. L’expansion forte et rapide des secteurs des services et des technologies de la communication, sous le régime du capitalisme de la communication [43] ou de la production biopolitique [44], indique que le tissu de la vie sociale est devenu un lieu-clé de l’accumulation [45]. Nous sommes tous, en effet, de plus en plus responsables de l’instrumentalisation, de la monétisation et de la financiarisation d’un nombre toujours croissant d’aspects de notre vie. La privatisation et la marchandisation des services sociaux (comme la santé, le logement, les soins et l’éducation) nous rendent chacun responsable d’emprunter ou de spéculer sur les produits de première nécessité. Avec la prétendue « économie du partage », nous sommes tenus de devenir micro-entrepreneurs, de découvrir des manières de monétiser tous les fragments de temps ou toutes les ressources, au nom de notre propre survie. Alors que le vrai communisme envisageait la réintégration de l’économie dans la société, le communisme du capital enveloppe la société dans le marché.

Le Freeport est l’une des architectures de ce communisme du capital, une sorte de palais de la culture encryptée. Les trésors du monde y sont réunis sous un même toit d’une manière qui dépasse les rêves des régimes politiques modernes eux-mêmes, qu’il s’agisse du Louvre de Napoléon et de ses trésors pillés ou des fantasmes d’Hitler d’un musée de la race des seigneurs, implanté au cœur de Germania (la ville utopique qui devait remplacer Berlin, contaminée du point de vue de la race). Le Freeport est un musée de l’utopisme de l’argent ; son commissaire, c’est le marché lui-même, qui orchestre l’ensemble des acquisitions et aliénations à travers des centaines ou des milliers d’actes de spéculation, émanant de collectionneurs dispersés ou de leurs agents. Le fait que personne ne puisse jamais voir toute la collection – les gardiens eux-mêmes ne savent pas ce qui se trouve dans la crypte – parachève cette structure : c’est un musée secret dédié à la gloire de l’argent et aux circuits de valeur culturelle qu’il fomente. C’est une institution pour le communisme du capital : une sorte de projet collectiviste à la gloire d’un système abstrait fondé sur l’accumulation individuelle.
Pour la plupart, nous ne mettrons jamais les pieds dans le Freeport ou ne visiterons jamais aucun des espaces utopiques de l’argent, sinon en tant que serviteurs. Nous sommes piégés dans la dystopie périphérique du risque et de la violence économique qui en est la condition préalable et le corollaire nécessaire, luttant pour éviter les pires des catastrophes que déchaîne l’utopie de l’argent, tout en produisant la richesse dont elle dépend.