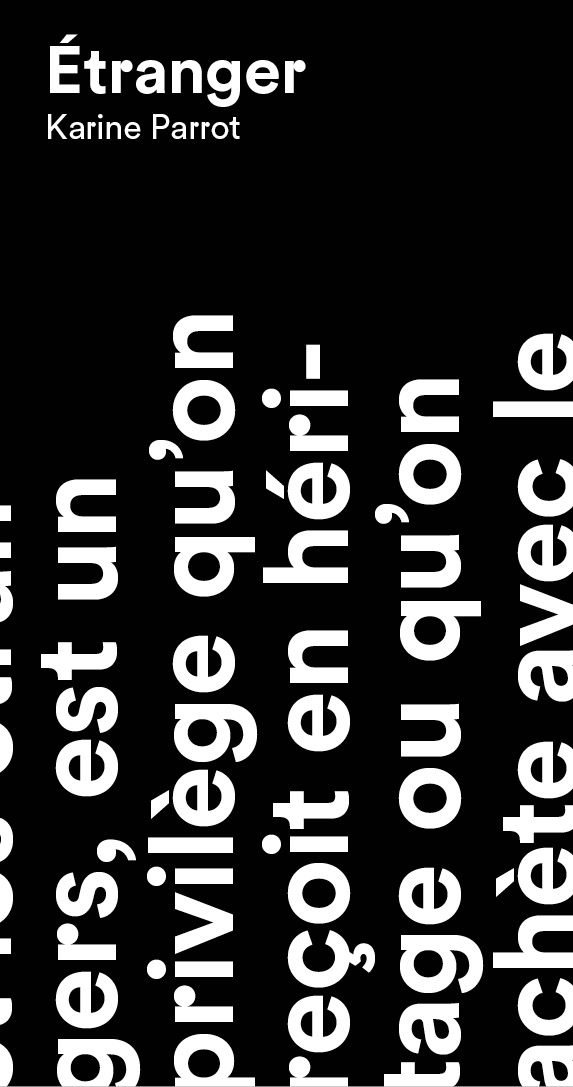Barbare, métèque, esclave, aubain... Pendant longtemps, il n’a pas existé de définition univoque de l’étranger. Il se définissait en creux, par défaut, comme celui qui n’appartient pas à la communauté et il existait donc autant de figures de l’étranger que de manières inventées par les humains de former communauté. Ce flou entourant la notion d’étranger a aujourd’hui disparu. L’État-nation s’est approprié le concept pour en dessiner les contours au scalpel : l’étranger est celui qui n’a pas la nationalité de l’État sur le territoire duquel il se trouve. Désormais attribuée de manière certaine par l’effet du droit, la nationalité sépare irrémédiablement le national et l’étranger pour soumettre ce dernier à un régime spécial, arbitraire, plus ou moins sévère et cruel suivant les besoins de l’économie et les considérations politiques du moment. Pourquoi certaines personnes ont-elles, à leur naissance, le droit de vivre en France, là où d’autres sont enfermées, expulsées ou brutalement refoulées à la frontière ? Pourquoi certaines personnes peuvent-elles travailler librement, là où d’autres sont assignées à la clandestinité et à la subordination extrême ? Comment, dans une société qui proclame l’égalité des droits entre tous les êtres humains, l’État parvient-il à les distinguer, à les catégoriser, pour faire de certains d’entre eux des indésirables ou des subalternes ? Lorsqu’on se penche sur la condition des personnes étrangères en France, on observe un droit ségrégationniste – largement admis – et un racisme systémique de l’État et de ses institutions démenti avec un cynisme de moins en moins feutré.
Je voudrais montrer d’abord que la catégorie d’étranger – opposée à celle du national – n’a rien de naturel. En revenant sur la fabrique de la nationalité française à la fin du xixe siècle, on comprend qu’elle n’est pas un attribut de la personne humaine et que la qualité d’étranger a toujours été déterminée par l’État à des fins utilitaristes. Depuis que l’étranger moderne a ainsi été construit, identifié et étiqueté, l’État français organise son exploitation en cherchant toujours à privilégier l’immigration blanche face à l’immigration « exotique », jugée fainéante et menaçante. Satisfaire le marché du travail et organiser la ségrégation des candidat·es suivant leur origine, voilà les deux axes inconditionnels de la politique migratoire française. Lorsque le besoin de main-d’œuvre « peu qualifiée » baisse dans la dernière partie du XXe siècle, la France puis l’Europe tout entière cherchent à entraver l’arrivée de nouveaux « migrants », notamment grâce à des systèmes juridiques et policiers toujours plus sophistiqués. Ces dispositifs de « gestion des flux » obligent les personnes qui veulent gagner l’Europe à mettre leur vie en jeu et – c’est un phénomène nouveau – elles sont des milliers à mourir chaque année sur les routes de l’exil. Depuis les années 1990, la politique migratoire décidée par les dirigeants des pays européens a ainsi directement causé la mort aux frontières de plus de 55 000 personnes.
Si tout cela est possible, s’il existe des milliers d’agents étatiques pour mettre quotidiennement en œuvre ces politiques inégalitaires et féroces, c’est qu’elles sont largement habillées par le droit. Le droit est un outil terriblement efficace : il confère à cet édifice macabre sa légitimité, tandis que l’enchevêtrement des textes et l’abstraction des catégories juridiques tiennent le réel à distance. Pour combattre ce partage du monde entre les privilégiés et les autres, une brève généalogie des figures de l’étranger est sans doute un accessoire utile.
(...)
Les valeurs de la République
En matière de naturalisation, la condition d’« assimilation à la communauté française », prévue par la loi depuis 1945 et jamais remise en cause depuis, sert de fondement aux pratiques institutionnelles les plus ouvertement racistes. Sous le règne Sarkozy, dans certaines préfectures, il est arrivé que des femmes portant le hijab soient priées de le retirer en vue de l’entretien individuel d’assimilation, le refus valant défaut d’assimilation. Plus généralement, les personnes de culture ou de religion musulmanes (ou supposées telles) sont systématiquement soupçonnées d’être mal assimilées. Les questions posées lors des entretiens individuels en témoignent. Il y a celles proprement débiles :
« Qui est Michel Platini ? »
« Où se situe le Mont-Saint-Michel ? »
Puis surgissent celles ouvertement orientées et racistes :
« Que pensez-vous de l’interdiction de porter le voile à l’école ? »,
« Accepteriez-vous que votre conjoint(e) se fasse soigner par un médecin de sexe opposé ? »,
« Votre fille est-elle libre de s’habiller comme elle le souhaite ? »
En fait, moins la personne étrangère correspond à l’image que l’agent·e se fait du « bon Français », plus l’entretien d’assimilation tourne à l’interrogatoire policier :
« Que faites-vous le week-end ? Quels sont vos loisirs ? »,
« Vivez-vous dans un milieu en majorité français ou étranger ? »
« Vous et votre conjoint avez-vous le permis de conduire ? Qui conduit la voiture ? Qui fait les courses ? ».
Toutes ces questions figurent sur une liste fournie aux agent·es des préfectures chargé·es notamment de vérifier, depuis 2011, que les candidat·es à la nationalité française « adhèrent aux principes et valeurs essentielles de la République ». Que l’État exige des personnes qui souhaitent vivre en France qu’elles respectent les lois de la République n’est pas choquant en soi, mais progressivement, depuis le début des années 2000, les étrangers se voient sommés d’adhérer aux « valeurs républicaines ». Mais quelles sont ces valeurs ? S’il s’agit de la fraternité ou du principe d’égalité, ils sont quotidiennement foulés aux pieds par l’État et ses agent·es. N’est-il pas de notoriété publique que, dans la rue, les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes sont vingt fois plus contrôlés par la police que le reste de la population ? Et surtout rien n’est fait pour que cela change. Quant à l’égalité homme-femme qui sert d’insupportable motivation à des retraits ou des refus de nationalité française – madame « a adopté une pratique radicale de sa religion incompatible avec le principe d’égalité des sexes » ou a refusé de serrer la main d’un élu lors de la cérémonie d’accueil dans la nationalité française –, chacun·e sait la valeur que lui accordent en pratique les hommes blancs de plus 50 ans qui forment la classe dirigeante. « Qui va garder les enfants ? » s’était enquis Laurent Fabius (actuel président du Conseil constitutionnel) à l’annonce de la candidature de Ségolène Royal à la primaire socialiste de 2006. On se souvient aussi, à l’Assemblée nationale, des huées et des remarques machistes fusant depuis les rangs de l’UMP lorsque la ministre du Logement avait pris la parole vêtue d’une robe à fleurs. En réalité, ces valeurs de la République sont un outil parmi d’autres pour humilier et trier les personnes étrangères, pour les forcer à courber à l’échine.
Pour en finir avec les naturalisations, il faut souligner qu’au-delà des motivations racistes naturellement induites par la condition légale d’assimilation, la grande majorité des refus sont motivés par « l’absence de ressources stables et suffisantes » des aspirant·es. Alors même que cette condition de richesse ne figure nulle part dans la loi, l’administration et le Conseil d’État ont décrété que pour être naturalisé français, il fallait justifier d’une bonne « insertion professionnelle ». Cela permet d’exclure beaucoup de vieux travailleurs immigrés arrivés dans les années 1960 et qui, pour avoir travaillé sans être déclarés ou pour des salaires de misère, vivent aujourd’hui avec le minimum vieillesse. Cela exclut aussi les personnes inaptes au travail qui vivent avec l’allocation adulte handicapé ; cela exclut d’une manière générale les chômeurs, les précaires, les artistes, celles et ceux qui enchaînent les CDD, les contractuel·le·s de la fonction publique qui n’ont pas accès au statut de fonctionnaire précisément car elles et ils ne sont pas français… Bref, le bon Français est blanc et de culture catholique, il est aussi un salarié docile et en bonne santé. Il faut se plonger dans la lecture des décisions préfectorales de refus pour comprendre le dispositif d’humiliation à l’œuvre. Un tel n’a « pas été en mesure de donner une définition acceptable de la laïcité et de la démocratie » lors de son entretien en préfecture ; une autre « ne travaille que 30 heures par semaine, ce qui ne lui donne pas une autonomie matérielle suffisante », une autre encore « n’a pas su expliquer pour quelle raison elle souhaitait devenir française »…
Pourtant, c’est très simple, si certaines personnes qui vivent en France souhaitent devenir françaises, c’est pour se soustraire définitivement aux exigences d’une administration brutale et structurellement raciste, pour vivre sans redouter d’être un jour chassées pour avoir perdu leur travail ou un conjoint français. Comment admettre que certain·es reçoivent automatiquement en héritage cette nationalité française de leur parent, tandis qu’elle reste inaccessible à d’autres qui vivent ici depuis des décennies au motif qu’elles et ils sont trop pauvres ou trop musulmans ? Depuis les années 1980 et le choix des dirigeants européens de juguler au plus près l’immigration, la nationalité est devenue un instrument clef du bouclage des frontières : seuls les nationaux de certains États – riches – sont dispensés de visa et autorisés à gagner l’Europe, les autres sont triés sur le volet depuis leur pays d’origine et majoritairement contraints de risquer leur vie et celle de leurs enfants sur des embarcations de fortune.
(...)
De la séquestration arbitraire aux centres de rétention
L’administration qui s’emploie à hiérarchiser entre eux les Européens dans les années 1950 s’acharne, à partir des années 1960, à juguler l’immigration en provenance d’Afrique et en particulier l’immigration algérienne et son « accélération anarchique ». Aux stratagèmes élaborés un temps contre l’arrivée des « Français musulmans d’Algérie » succèdent des dispositifs plus musclés contre celles et ceux qui, avec l’indépendance, sont devenus officiellement étrangers. Pour préserver les droits et les intérêts économiques des colons en Algérie, les accords d’Évian maintiennent le régime de libre circulation entre les deux rives de la Méditerranée, si bien que le gouvernement français doit instaurer des « contrôles sanitaires » contre l’arrivée des Algériens à leur débarquement à Marseille. Les hommes soupçonnés de venir grossir les rangs des chômeurs sont jugés « inaptes » puis « bloqués », c’est-à-dire enfermés, un ou deux jours, dans un hangar du port, le temps d’organiser leur renvoi vers l’Algérie par le premier bateau disponible. Outre les non-admis de la pseudo-procédure sanitaire, le hangar récupère, à partir de 1964, les Algériens contrôlés sur le territoire sans ressources ou sans emploi – « les oisifs » – qui ont vocation à être rapatriés sur décision préfectorale mais aussi les Algériens visés par une décision d’expulsion.
Un contrôle de l’immigration familiale se met également en place sur la base de simples circulaires et le centre de rétention informel se dote alors d’un dortoir pour les femmes et les enfants venus rejoindre un travailleur algérien dont le logement est déclaré insuffisant. Pour l’année 1965, Ed Naylor recense 10 000 personnes ainsi séquestrées avant d’être expulsées vers l’Algérie. Si ce nombre diminue les années suivantes, le centre continue à enfermer massivement pendant toute la seconde moitié des années 1960 et les détenus algériens sont finalement rejoints par des Tunisiens, des Marocains, des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens et des Mauritaniens. Entre 1963 et 1975, près de 50 000 personnes sont ainsi séquestrées par la police sans aucune base légale.
En 1975, le scandale de la « prison clandestine de la police française » éclate dans la presse grâce à des avocats militants et d’anciens détenus qui portent plainte contre X. Le centre n’est pas fermé pour autant. La haute administration louvoie et bricole pour habiller juridiquement le dispositif avant qu’une loi de février 1981 ne finisse par légaliser la pratique consistant à enfermer les personnes étrangères le temps de préparer leur expulsion. Et c’est exactement suivant ce processus qu’une partie des lois visant les personnes étrangères sont adoptées depuis lors : les technocrates et les policiers décident seuls, ils mettent en place les dispositifs de contrôle et de répression qu’ils jugent nécessaires sans se soucier de leur légalité puis, si besoin, dans un second temps, le législateur est appelé pour donner son aval et légitimer la pratique. Contre les étrangers, et contre les pauvres en général, la loi fonctionne ainsi comme une voiture-balai des pratiques administratives et policières illégales.
Depuis l’origine, les théoriciens de l’État moderne aiment à répéter qu’il est souverain pour décider du sort des étrangers présents sur son territoire et, de fait, jusque dans les années 1970, les personnes étrangères en France sont officiellement soumises au pouvoir discrétionnaire de l’État : pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non un droit au séjour et un permis de travail, pouvoir discrétionnaire de rafler, de contrôler, de séquestrer, d’expulser et, pendant la guerre d’Algérie, d’assassiner. Mais, pendant cette dernière partie du xxe siècle, l’idée d’une administration qui puisse agir impunément, en dehors de tout cadre légal, est devenue intenable même s’agissant des plus pauvres et des plus subalternes que sont les travailleurs immigrés. D’abord, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) : même sans force obligatoire, le texte porte un coup symbolique aux traitements hyper-différenciés que les États réservent aux étrangers et aux femmes. En France, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 acquiert une valeur constitutionnelle (1971) et l’État finit par ratifier la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui contient des règles assez précises contre l’arbitraire d’État (1974), invocables directement par les individus devant la Cour européenne des droits de l’Homme (1981). Les droits et les libertés individuelles élémentaires, comme la liberté d’aller et venir ou les droits de la défense, finissent par être considérés comme des règles dont toutes les personnes – quelle que soit leur nationalité – peuvent se prévaloir, en particulier contre l’État.
Dans ce contexte, la machine d’État ne renonce aucunement à administrer les étrangers de manière arbitraire mais, lorsqu’une pratique administrative ou policière apparaît en contradiction trop flagrante avec les textes en vigueur, sous la pression des intéressés et des associations de défense des droits, les bureaucrates sont parfois contraints d’appeler le législateur à la rescousse. Après plusieurs années de fonctionnement hors la loi, les « zones d’attente », dans lesquelles la police enferme certains étrangers à leur arrivée sur le territoire, ont ainsi dû être officialisées et légalisées en 1992. À Paris, et en particulier dans le quartier de Barbès, les étrangers ont été raflés et contrôlés en masse, en toute illégalité, pendant deux décennies, avant qu’une loi de 1981 instaure un régime de contrôle d’identité suffisamment permissif pour autoriser tous types de contrôles et, en particulier, les contrôles au faciès. Pendant trente ans, la garde à vue, outil emblématique de l’enquête pénale, a été utilisée de manière illégale contre ces étrangers contrôlés dans la rue, pour organiser leur éventuel transfert en centre de rétention administrative (CRA) – sans qu’aucune enquête pénale ne soit jamais ouverte. En l’espèce, il aura fallu une intervention fortuite de la Cour de justice de l’Union européenne en 2011 pour que cesse ce détournement flagrant de la procédure pénale et qu’une loi nouvelle légalise la pratique. Toujours est-il que, pendant trente ans, au nom de la lutte contre l’immigration clandestine, la police a pu ouvertement détourner, dévoyer, des dizaines de milliers de gardes à vue avec l’assentiment des juges théoriquement chargés de contrôler le dispositif. C’est simplement qu’à l’endroit des personnes étrangères les plus démunies, les institutions étatiques – le pouvoir exécutif, les juges, les policiers – ne se considèrent pas liées par les règles de droit.
Bien sûr, la légalisation des pratiques administratives et policières qui visent les personnes étrangères n’est pas sans effet pervers. D’abord, une fois reçu l’aval du législateur, la pratique peut se déployer au grand jour et elle prend souvent de l’ampleur – ce sont désormais près de 50 000 personnes qui sont enfermées chaque année en rétention administrative. Cela étant, on pourrait penser qu’en retour, une fois encadrées, balisées, les procédures correspondantes garantissent aux personnes ciblées une protection contre l’arbitraire et la violence d’État. Ainsi, en matière de rétention, la personne étrangère qui arrive au centre peut théoriquement saisir un juge administratif contre la décision d’expulsion, elle est alors systématiquement présentée dans les 48 heures à un juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, chargé de prolonger (ou pas) l’enfermement décidé par le préfet, tandis que la police est censée notifier à l’intéressé une liste de droits (à voir un médecin, un avocat…). Seulement, dans les faits, l’accès à l’aide juridictionnelle est compliqué, les avocats commis d’office n’ont pas le temps d’étudier les dossiers de leurs clients, les interprètes sont joints par téléphone, les délais pour saisir les juridictions sont trop courts et les juges – débordés de travail et rebutés par ce contentieux dévalorisé – sont extrêmement contraints dans leurs missions. La loi leur interdit de soulever certaines irrégularités de procédure et ils statuent de plus en plus souvent, à l’abri des regards, dans des tribunaux spéciaux faits d’Algecos accolés aux zones d’attente et aux centres de rétention, dans les zones aéroportuaires. Cette justice au rabais, expéditive et déshumanisante, n’offre aucune garantie aux personnes étrangères, le droit fonctionne de manière à les priver de leurs droits.