« Tu vas pisser du sang. Tu vas en chier. Tu vas souiller ton froc. Tu vas toucher le fond un nombre incalculable de fois. Tu vas voir 36 chandelles en éclatant l’ampoule de ton gros orteil sur un caillou pointu. Tu vas parler aux arbres […]. Tu vas engloutir des litres de Coca. Tu vas rêver de bouillon de légumes et de pastilles de sel. […] Tu vas tomber tête la première sur une allée forestière toute plate en t’éclatant une rotule déjà mal en point. Tu vas bouffer des tonnes de chips. Tu vas les gerber. Tu vas abandonner, le cœur et le corps brisés… et une demi-heure ou trois semaines après ta dernière agonie, tu chercheras une nouvelle course. Comment peut-on être aussi con ? Peut-être qu’au-delà de toutes ces emmerdes, de toutes ces souffrances, l’ultra a quelque chose de magique… [1] »
Voici comment Clare Gallagher, coureuse américaine aux dizaines de milliers d’abonnés Instagram, militante écologique, diplômée de la prestigieuse université de Princeton et nouvelle égérie de Patagonia – la multinationale spécialisée dans le sport dit outdoor –, décrit son expérience de la course très longue distance en milieu naturel : l’ultra-trail.

Quand vous lisez ou visionnez du contenu sur l’ultra-trail, jamais vous n’entendez parler de compétition, très rarement de classement ou de podium, et encore moins d’adversaires ou de records à battre.
La communion avec la nature, la convivialité, la connaissance de soi, le dépassement de ses limites, l’humilité, l’aventure, prendre du plaisir, sont les termes le plus communément utilisés par les participants. Quant aux principaux organisateurs de ces événements sportifs, leur champ lexical tourne autour de « valeurs » et d’« engagements » : écoresponsabilité, solidarité, authenticité, respect, entraide. Certains parlent même d’éthique et d’universalité.
L’ultra-trail serait donc une pratique sportive exclusivement basée sur le goût de l’effort et de la nature, tout en défendant une écologie responsable.
Pourtant, cette discipline questionne, tant les contradictions sont nombreuses : elle se veut ouverte à toutes et à tous, mais le prix du matériel et d’inscription aux compétitions est rédhibitoire. Elle prône une expérience intérieure apaisée et une écoute de son corps, mais les traumatismes physiques et psychologiques touchent bon nombre de ses pratiquants. Elle prétend se désintéresser de tout exploit individuel, mais valorise l’obtention du maillot « finisher » et les « élites » de la discipline. Elle serait une pratique sportive hautement écologique, mais quid de l’impact environnemental de 10 000 coureurs et de ses 100 000 spectateurs venus des cinq continents dans une vallée montagneuse ?
Course à l’échalote
En France, d’après une enquête menée par la Fédération Française d’Athlétisme, 8,5 millions de personnes pratiqueraient la course à pied. À titre de comparaison, ils étaient 6 millions en 2000, et seulement une poignée d’initiés dans les années 1980 [2]. Ce succès peut s’expliquer en partie par la configuration de notre société, toujours plus sédentarisée, où les transports motorisés sont privilégiés et où près d’une personne sur deux serait en surpoids.
L’enquête énonce d’ailleurs que « les trois principales motivations invoquées par les coureurs à pied sont : améliorer sa condition physique (58 %), être en bonne santé (58 %), perdre du poids (35 %) ».
Le trail – qui se traduit littéralement par sentier – rentre dans la catégorie course à pied. Si sa définition reste floue, tout le monde s’accorde à dire qu’elle doit s’exercer dans un environnement naturel – forêt, plaine, montagne – et sur une longue distance – au moins 5 km. Le succès de cette discipline est vertigineux : en France, on compte 150 trails organisés en 2001 pour 2 500 en 2015, et il y aurait aujourd’hui autour de 4 500 compétitions rassemblant environ 1 million de coureurs.
L’ultra-trail, c’est simplement le versant extrême et viril du gentil petit trail. La distance à parcourir doit être supérieure à celle d’un marathon (42,195 km), même si de nombreux observateurs estiment que pour mériter l’appellation « ultra », c’est 80 km minimum. Sans oublier le dénivelé positif (« D+ » pour les intimes), qui est la différence d’altitude entre le début et la fin de la course, autrement dit les montées.
Mais qui est à l’origine de l’ultra-trail ? De quelle graine a germé l’idée de faire payer des gens pour enfiler un dossard et courir en troupeau dans la nature ? Il semblerait que le pionnier de cette pratique soit le Californien Gordy Ainsleigh. Habitué de la Western States Ride, une course à cheval de 100 miles, il raconte que lors de l’édition de 1974, son cheval s’étant estropié et n’ayant plus de monture à disposition, il a courageusement décidé d’y participer à pied. Il terminera la course dans le temps normalement imparti aux cavaliers. Trois ans plus tard, ce sont 14 personnes qui s’élanceront à sa suite. La première compétition d’ultra-trail était née.

Si le succès de l’ultra-trail est en partie alimenté par les marques de matériel outdoor, qui ont su surfer avec brio sur la vague écologique (nous y reviendrons), d’autres avancent que l’engouement pour cette pratique sportive serait lié au fait que l’espèce humaine serait tout simplement née… pour courir.
Born to Run, livre fétiche du traileur, vendu à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde, raconte ainsi l’enquête d’un journaliste à la recherche d’une tribu indienne mexicaine, les Tarahumaras, qui courent depuis la nuit des temps sur des centaines de kilomètres, à une vitesse rapide et constante et le tout sur des terrains accidentés. Leur secret ? Ils courent pieds nus. Dans la préface à la traduction française du livre [3], la star planétaire de la discipline, Kilian Jornet, explique que nous courons simplement pour « être heureux », mais aussi car c’est « le plus vieil instinct de l’homme ».
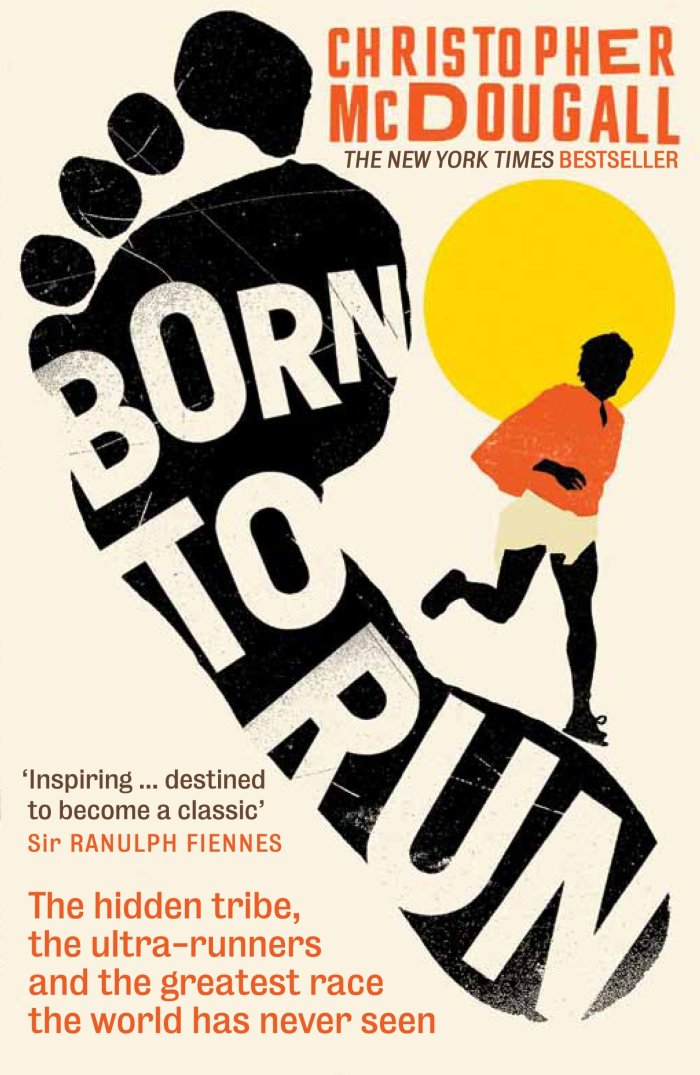
Au-delà de cette analyse anthropologique discutable, chez les traileurs, l’affect le plus visible au premier abord lors d’une course, ce n’est ni la joie ni le bonheur, mais bien la souffrance. En plein effort, tous les traileurs se sont posés au moins une fois la question « mais qu’est-ce que je fous là ? ».
Dérive compétitive
On a d’ailleurs tendance à associer la plupart des sports à la notion de souffrance.
En cette période de Jeux olympiques, quand on observe sur son écran une gymnaste ou un coureur de 100 mètres haies, on peut imaginer combien il a été difficile d’être parmi les meilleurs de sa génération : des milliers d’heures d’entraînement intense, additionnées à une pression mentale quasi constante (car l’échec est rarement admis ou envisagé). Sans oublier les sacrifices sociaux qu’induisent six à huit heures d’entraînement quotidien depuis l’adolescence. Cet univers, c’est celui bien connu de la compétition, qui structure une bonne partie de notre société, et l’ultra-trail n’échappe pas à cette règle. Il a même les deux pieds dedans.
Prenons pour exemple la bataille à laquelle se livrent les organisateurs des ultra-trails pour attirer des clients. Pour se différencier, plusieurs d’entre eux jouent sur la corde quelque peu narcissique des participants avides « d’exploits », en leur proposant des parcours toujours plus éprouvants où ils pourront « souiller leur froc », comme dirait Clare Gallagher.
Car parcourir 80 km en montagne en plein mois d’août ne suffit plus...

Sur les 25 700 courses de trail qui existent à travers le monde, voici à quoi ressemblent les plus ardues :
La Diagonale des fous, 164 km de distance et 9 917 m de dénivelé dans le climat tropical de l’île de la Réunion.
Le Tor des Géants, 330 km et 24 000 m de dénivelé positif dans les Alpes.
La 555+, dans le désert d’Égypte, avec une distance totale de 564 km.
La Yuckon Arctic Ultra : 700 km dont 6 000 m de dénivelé avec des températures pouvant descendre jusqu’à moins 15 °C.
La Badwater Ultramarathon avec ses 218 km de distance et ses 6 000 m de dénivelé, qui s’effectue en plein mois de juillet dans la vallée de la Mort aux États-Unis. On dit que le bitume atteindrait les 100 °C et ferait fondre les semelles.
Mais la compétition marchande ne s’arrête pas là.
Pour participer à certaines de ces courses très prisées, il faut adhérer à une plateforme Web appelée ITRA (international trail running association), dont les valeurs sont : authenticité, humilité, respect et égalité. Le traileur y inscrira des points en finissant d’autres courses. Pour prendre l’exemple de la célèbre UTMB® (Ultra-Trail du Mont-Blanc), pour être éligible à l’inscription, il faut au minimum 6 points. La méthode de calcul des points se base principalement sur une unité de mesure appelée le « kilomètre-effort », qui va prendre en compte à la fois les kilomètres parcourus durant la course et le dénivelé (D+). Un marathon de 42 km avec 2 000 m de dénivelé positif équivaut à 62 km-effort. Les courses sont classifiées de XS à XXL, chacune d’entre elles donnant accès à un certain nombre de points.
Il existe également un indice ITRA (allant de 0 à 1 000) qui mesure la performance de chacun et propose un classement mondial des coureurs.
Mais, curieusement, cette organisation digne d’une ligue professionnelle comporte en réalité une majorité d’amateurs. Seules quelques stars, appelées « élites » dans le milieu, bénéficient de sponsors qui leur permettent de vivre de leur passion.

Quel est donc le profil de l’ultra-traileur moyen ?
La première chose à savoir, c’est qu’il n’est plus tout jeune.
Le Forum Médical Suisse (Swiss Medical Forum), une revue médicale destinée aux professionnels de la santé, a analysé plus de 700 articles scientifiques sur l’ultra-trail [4] : il en ressort que dans les deux plus grandes courses de plus de 100 miles en Amérique du Nord, la moyenne d’âge est de 44,5 ans (en comparaison, la moyenne d’âge de l’UTMB® est de 42 ans). Les participants sont composés à 80 % d’hommes, mariés à 70 %, qui ont à 43 % un diplôme de type « licence » (bac + 3), voire plus élevé (37 %) [5]. Et selon une enquête menée en 2013 auprès de plus de 2 000 pratiquants par le Think Tank Trail (TTT), la moitié des traileurs appartiennent à des catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+) – dirigeants, cadres supérieurs et moyens, professions libérales. Un cinquième d’entre eux ont des revenus dépassant les 50 000 € par an.
Dans une tribune du journal Le Monde datée de 2017, un anthropologue et un sociologue tentaient d’analyser les ressorts de cet engouement : « L’ultra-trail reflète les valeurs phares d’une société qui enjoint à l’individu de posséder des qualités de réactivité, d’autonomie et d’adaptabilité, d’évaluer et d’optimiser ses ressources physiques et cognitives pour produire la meilleure performance. De fait, ces attentes entrent particulièrement bien en résonance avec les dispositions mentales et corporelles de coureurs principalement issus des classes moyennes diplômées. »
Les mots manager ou entrepreneur ne sont étonnamment pas cités dans cette tribune, mais Thibault Bardon, un universitaire et spécialiste du management s’est intéressé à ce profil spécifique. Il a mené une étude récente] auprès de 33 managers pour définir le lien entre cette pratique sportive intense et l’environnement professionnel de ses pratiquants, cela afin de déterminer leurs principales motivations, qu’il compte au nombre de cinq.
Il note tout d’abord une volonté d’améliorer la communication externe, en sponsorisant des événements pour l’image de l’entreprise, et de renforcer la cohésion interne, en courant avec les salariés — certains utilisant même la course comme argument de recrutement en privilégiant les profils sportifs. Cette pratique serait aussi un vecteur de performance personnelle. En pratiquant intensivement la course, les dirigeants se disent qu’ils seront de meilleurs managers (plus relax, plus concentrés, plus endurants, etc.). Ce sport serait troisièmement une soupape de décompression, pour évacuer le stress et la pression constante subie au travail, ainsi qu’un remède, pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en se réalisant dans autre chose que son métier. Enfin, la prouesse sportive devient un marqueur identitaire important qui profite à leur carrière, en projetant une image de leader pugnace et persévérant. Ajoutez à cela le regard que les salariés ont sur leur manager qui, en plus de diriger la boîte, réalise des « exploits », ce qui participe, comme l’explique Thibaut Bardon, « à la mythologie du dirigeant superman ».
Pour comprendre comment cette discipline peut générer autant de bénéfices personnels, il est indispensable de se pencher sur les conditions de préparation de ces « exploits ». Ainsi que sur leurs conséquences physiques et mentales.
Ultra-dévotion
Pour éviter d’abandonner un ultra-trail en pleine course (ce que certains vivent comme un traumatisme), l’investissement personnel est colossal.
À la façon d’un manager, il faut préalablement définir un « objectif et [des] conditions de réussite ». Pour donner un ordre d’idées de l’implication nécessaire à une course de 100 km accompagnée de quelques milliers de mètres de dénivelé, et en partant du principe que vous disposez d’une bonne condition physique (c’est-à-dire que vous avez récemment réalisé un marathon en moins de 4 h 30), le temps de préparation variera entre… 9 et 12 mois.
Durant cette période, vous réaliserez 4 entraînements par semaine et au moins 3 courses d’une distance de 50 à 70 km. Ce à quoi vous ajouterez chaque mois une marche longue de 4 à 6 heures – pour apprendre à repousser votre seuil de fatigue. Sans oublier les séances d’étirements et de musculation légère et un régime alimentaire adéquat. Certains augmenteront leurs chances de réussite avec des entraînements nocturnes et des week-ends de course en montagne pour habituer leur corps à l’altitude.
Sachez qu’il existe des programmes qui s’étalent sur plusieurs années (certains coaches estiment qu’en partant de zéro, 3 à 5 ans de préparation sont à envisager).
Malgré ce programme très contraignant, beaucoup de coureurs longue distance vous le diront, la course, ce n’est pas que souffrance et compromis. Aux bénéfices sur la santé mentale et physique qu’un entraînement régulier peut offrir, ainsi qu’à la gratification sociale que certains tirent en arborant fièrement leur maillot finisher, s’ajoutent ceux plus chimiques que sont la sécrétion d’endorphine et celle de dopamine.
Une partie des traileurs rechercheraient même un état quasi transcendantal, appelé le runner’s high. Cet état d’euphorie provoquerait une sensation d’exaltation intense qui fait disparaître les tensions, la douleur, la peur et la notion du temps. Pour les plus « curieux » d’entre vous, il existe de nombreuses vidéos sur YouTube qui expliquent comment l’atteindre.
Mais réaliser des entraînements intensifs et des compétitions éprouvantes, en faisant fi des alertes physiques produites par l’organisme, provoque inévitablement un grand nombre de blessures et de traumatismes.
Les pépins physiques sont multiples [6] : tendinite d’Achille, aponévrosite plantaire (inflammation du talon), métatarsalgie (inflammation des orteils), syndrome rotulien (douleur en dessous de la rotule), tendinite du releveur (inflammation du releveur du pied), périostite tibiale (inflammation du tibia), névrose de Morton (inflammation due au pincement du nerf situé entre les 3e et 4e orteils), entorse de la cheville, fracture de fatigue… Sans compter les problèmes gastro-intestinaux qui sont l’une des premières causes d’abandon (certains coaches conseillent même de s’entraîner le ventre plein pour éviter cette déconvenue le jour J).
Et si les cas de dopage sont rares, certains médecins s’inquiètent des pratiques d’automédication. L’utilisation d’anti-inflammatoires, antivomitifs, antidiarrhéiques serait fréquente chez les coureurs amateurs [7].
Au niveau psychologique, on trouve également la bigorexie (ou addiction au sport), une maladie qui touche une quantité non négligeable de traileurs.
Une étude menée lors de l’UTMB®en 2011 montre que sur un échantillon de 1 775 inscrits, 7 % des coureurs étaient considérés comme dépendants, et 60 % semblaient présenter des risques de dépendance [8]. Cette maladie, reconnue depuis 2011 par l’OMS, est définie par le psychiatre Eric Sportich comme un « besoin irrépressible obsessionnel de pratiquer une activité physique intensive et régulière pour obtenir des gratifications immédiates, les neuromédiateurs (la dopamine, endorphine) ». Il précise que cette addiction est considérée comme « une addiction positive, car la valeur du sport est bien vue dans la société, et sans substance. Il n’en reste pas moins qu’elle a les mêmes effets qu’une addiction sous substance avec les mêmes conséquences néfastes ».
Dans une enquête de France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, la psychologue du sport Virginie Lemaire explique quant à elle que « le sport à outrance […] peut isoler, car cela empêche la personne de profiter de la vie autrement et peut également détruire ses liens sociaux ».
La Société Française de Médecine du Sport (SFMS) met à disposition un questionnaire pour dépister les signes d’un surentraînement. Si, sur les 54 questions, la personne répond oui à 20 d’entre elles, elle sera considérée « à risque [9] ».
Homo economicus natura
Dépendant, addict, avec un portefeuille bien garni, le traileur devient donc une cible commerciale de premier choix, aiguisant l’appétit des entreprises…
Le marché de l’ultra-trail représente 15 % du marché du « running » (environ 2 milliards d’euros). Ses pratiquants dépensent trois fois plus qu’un coureur du dimanche. « Ce sont des gens qui ont de l’argent, avec un côté un peu Geek+, qui veulent avoir la dernière montre ou la dernière lampe frontale qui sort », indique un responsable marketing d’un fabricant français de matériel outdoor [10].
De plus, pour participer à un ultra-trail, une longue liste d’équipements obligatoires est demandée aux coureurs. Un partenariat win-win pourrait-on dire, entre les fournisseurs de matériel outdoor et les organisateurs de trails. Le site de l’UTMB® et son partenaire officiel Columbia vous proposent de vous faciliter les choses en vous permettant d’acheter directement via leur plateforme e-commerce. Du sac à dos à 66 € aux gants à 72 €, en passant par des barres énergétiques à 14 €, ce ne sont pas moins de 16 équipements qu’il faudra acquérir pour concourir. Ce à quoi vous ajouterez du matériel non obligatoire, mais essentiel, chaussures, bâtons, crèmes et autres accessoires comme de coûteuses montres GPS ou des lunettes de soleil. Équipement auquel il faut encore additionner le prix de l’inscription (280 €) ou l’hôtel (à un mois de la compétition, les 3 nuits dans un trois-étoiles de Chamonix coûtent en moyenne 500 € par personne).
Sur la course reine de 170 km de l’UTMB®, comptez à peu près 18 € le kilomètre. Si cela vous paraît excessif, sachez qu’il se prépare un ultra-trail en Écosse [11] dont le seul ticket d’entrée s’élève à 18 500 € et inclut majordomes, bassins d’hydrothérapie et nourriture fournie par des chefs étoilés. Mais là, on a changé de catégorie.
Pour vendre leur matériel, les entreprises spécialisées dans le secteur de l’outdoor n’hésitent pas à surexploiter le mouvement d’« écologisation » du sport.
Le cas de la marque Patagonia est doublement intéressant, car il arrive à tirer avantage de la crise écologique tout en réveillant chez le consommateur le militant qui sommeille en lui. L’équipementier américain, qui a multiplié par quatre son chiffre d’affaires ces dix dernières années, déclare que ce succès est lié à son engagement en faveur de la planète : « La nouvelle génération de consommateurs ne se contente plus de porter une marque, elle veut une marque qui représente quelque chose. Cela nous a donné un solide coup de pouce » explique le directeur des ventes pour l’Europe, Gianluca Pandolfo, que l’on est tenté de croire sur parole : l’entreprise dépasse aujourd’hui le milliard de dollars de chiffre d’affaires.

- Page d’accueil du site internet de la marque Patagonia
Leur site e-commerce affiche la couleur : à l’heure où j’effectue mes recherches, leur page d’accueil fait défiler en fond une vidéo d’activistes pour le climat. Il y a également, sur les quatre onglets principaux, une rubrique « activisme » accolée à l’onglet « e-boutique ».
La marque finance aussi de nombreux projets de protection de l’environnement et reverse 1 % de son chiffre d’affaires à l’association 1 % for the Planet, et l’équipe managériale de la zone Europe a même participé à une action du mouvement Extinction Rebellion.
En revanche, savoir comment est alimenté en marchandise leur gigantesque réseau mondial de distribution (5 075 points de vente d’après leur site) et pourquoi l’entreprise américaine délocalise des usines de production au Sri Lanka ou au Vietnam — pour l’instant — reste un mystère.
En qualité d’organisateur, l’UTMB® met également les bouchées doubles pour montrer son investissement en faveur de la défense de la planète. L’organisateur, conscient des impacts environnementaux de sa pratique (dispersion des déchets, piétinement de la végétation, dérangement de faune sauvage et domestique, érosion des sols), compense comme il peut et dispose de partenariats avec des associations environnementales (WWF), d’une charte écologique, d’un comité environnement, d’ambassadeurs écologiques, de 15 engagements écoresponsables ou de dossards environnement (à 2 000 €) qui financent des associations caritatives et moult labels écologiques [12].
Une stratégie payante, puisqu’en 2017 l’événement a réuni 8 000 participants venus des cinq continents (en courant ?) avec 90 nationalités représentées et plus de 17 000 accompagnants, générant ainsi 7 500 000 € de chiffre d’affaires. Notons au passage que l’organisateur s’est appuyé sur l’aide de 2 000 bénévoles [13].
Une telle manne financière attire les convoitises.
Un trail « urbain » a récemment été créé pour attirer l’importante population des villes.
L’Ecotrail de Paris, « une course en nature qui s’invite en ville » comme l’indique son site Internet, propose de « vivre une expérience authentique » (moyennant 98 € pour le 80 km) en fonction de votre niveau : une épreuve de randonnée nordique, une de randonnée tout court, puis cinq courses différentes de trail (10, 18, 30, 45 et 80 km).

Je me suis rendu à la 14e édition de cette course critiquée par quelques puristes, car trop éloignée de l’esprit « nature » du trail (le parcours fait passer les coureurs sur des ponts au-dessus de l’autoroute et une partie non négligeable du parcours s’effectue en plein Paris).
Il est 9 heures du matin et il règne une ambiance morose : le temps est gris, les coureurs sont concentrés sur la course à venir et beaucoup s’isolent pour s’échauffer. La valeur de « convivialité » affichée par l’organisateur ne saute pas aux yeux.
Le speaker attise l’esprit de compétition en rappelant les temps barrières (temps en dessous desquels il faut passer des étapes de la course sous peine d’être éliminé) et nous liste les « élites » présentes aujourd’hui. Ses demandes répétées d’applaudissements restent lettre morte.
L’heure de lancer la première « tranche » de coureurs approche, et il est demandé aux coureurs élites de se positionner sur la ligne de départ. Aussitôt le top départ donné, les coureurs activent simultanément leurs montres connectées pour « monitorer » leur performance.

- Départ de la 14e édition éco-trail Paris.
J’en profite pour aller discuter avec quelques traileurs qui attendent patiemment leur tour.
Un géophysicien à la retraite m’explique qu’il s’est fixé comme seul objectif de finir la course. À la question « pourquoi courez-vous ? », il me répond légèrement déconcerté que « c’est pour se mesurer aux autres », mais aussi « se prouver qu’à [son] âge, on peut encore courir longtemps ». Soit.
Je m’assois près d’un coureur isolé. Ingénieur en informatique de 46 ans particulièrement sympathique. Il m’explique que cette course est pour lui « un challenge » à relever. Il s’entraîne 11 heures par semaine et quand je lui demande comment il fait pour trouver tout ce temps libre en plus de son métier il me répond : « Je fais beaucoup de télétravail, ce qui facilite un peu les choses. La vie de famille, c’est plus dur à concilier. Je me lève à 5 heures du matin. »
Sa montre imposante attire mon attention. « Je m’en sers pour analyser la qualité de mon sommeil, me dit-il. Mais ça analyse aussi mon niveau d’hydratation, mon rythme cardiaque, l’énergie que je brûle, etc. La montre est également connectée à l’application Strava (très populaire chez les coureurs, elle permet de « suivre, partager, rivaliser et analyser » les performances de course), et ça me permet de voir l’état de forme des autres, c’est supermotivant. »
Je remarque au loin une personne avec une chasuble rouge portant la mention « éco acteur ». Ce bénévole (ils sont 700), présent sur place depuis 7 h 30, me décrit son rôle qui consiste peu ou prou à installer des poubelles et ramasser les déchets derrière les coureurs. Il m’explique qu’il y en a moins que les années précédentes, mais que c’est uniquement lié au fait qu’il y a moins de monde cette année.
« Et vous considérez que c’est un événement écologique ?
— Oui, à peu près. Mais y a quand même pas mal de gens qui sont venus en bagnole, donc bon… »
Au dos de sa chasuble, on peut lire l’inscription Sport Planète, qui est fédéré par la MAIF, principal sponsor de l’événement. Cette entreprise, qui assure 3,6 millions de véhicules en France, essaye de verdir son image en s’associant à la pratique du trail. Lors d’une vidéo promotionnelle expliquant les raisons de ce partenariat, une intervenante de la MAIF explique sans conviction que leur but est « d’éveiller les consciences, de décloisonner pour fédérer, de favoriser les synergies et permettre à chaque acteur du sport d’être contributeur du changement pour un réel mieux commun ». Comprenne qui pourra.
L’assureur détient même le statut « d’entreprise à mission » que la loi PACTE (promulguée en mai 2019) définit comme « permettant à une entreprise de déclarer sa raison d’être à travers plusieurs objectifs sociaux et environnementaux ».
La raison d’être d’un assureur, ou la priorité d’une entreprise de vêtements outdoor, ne serait donc plus de réaliser du profit dans un monde basé sur un fonctionnement capitaliste, mais uniquement de sauver la planète et ses habitants.

Des voix s’élèvent
Dans la vallée du Mont-Blanc, un collectif intitulé l’Ultra-Sieste réunit un groupe de personnes qui, depuis quelques années, se rejoignent près de la ligne de départ de l’UTMB® pour sensibiliser le public sur les problèmes que pose l’ultra-trail. Ils organisent également des conférences autour de cette thématique.
Un participant de l’Ultra-Sieste, et guide de haute montagne de profession, m’explique que pour lui, l’ultra-trail est « une souffrance organisée ». « Si tu voyais dans quel état physique arrivent les derniers, après deux nuits passées dans la montagne… Il y a une adoration de la souffrance. » Le plus gênant, pour lui, c’est l’hypocrisie des discours qui entourent l’événement : « Les participants ont un discours environnemental, ils se disent amoureux de la montagne, sauf qu’ils ne voient rien de la nature. En montagne, généralement, faut regarder où tu mets les pieds, surtout quand tu cours ! Si tu veux vraiment profiter de la montagne, tu t’arrêtes. »
Le sociologue du sport Jean-Marie Brohm, intervenant lors d’une conférence de l’Ultra-Sieste, analyse les choses d’un point de vue plus philosophique : « La valeur du sport c’est flirter avec la mort, réelle ou symbolique : “tuer, écraser, l’autre, le rival”, tuer la nature, la maîtriser, la conquérir et in fine se tuer soi-même. Car le dépassement de soi-même c’est la course indéfinie à quoi ? Contre la dénégation de sa propre mort. Le système sportif a ceci de particulier : il concerne la chose la moins maîtrisable : le corps. Donc il s’agit de prouver que l’on est encore capable à 50 ans de courir le marathon des sables, où que sais-je encore. C’est la raison pour laquelle de plus en plus de personnes d’un certain âge se remettent à faire du sport. Il faut que l’on reste éternellement jeune, car le sport est une idéologie de la jeunesse. Il s’agit de trouver d’autres formes de pratique sportive, qui ne soient pas violentes, destructrices, et en particulier qui ne soient pas le fondement d’un système politique où il s’agit de faire galoper tout le monde, car le rêve de toute société en crise, c’est de faire galoper tout le monde. Toute société en crise consiste à offrir du sport, transpirer, se remuer, se bouger, ça évitera de réfléchir. Qu’est-ce que ça veut dire de passer tous ses week-ends à aller gravir des sentiers escarpés ? S’entraîner trois fois par semaine minimum ? »
Concluons par l’intervention d’un autre conférencier, Fabien Ollier, enseignant d’EPS, philosophe et directeur de publication de la revue Quel Sport ?, qui introduit son intervention au sujet de la compétition en citant Henri Laborit – célèbre médecin, chirurgien et neurobiologiste à qui l’on doit notamment l’un des premiers traitements neuroleptiques : « J’ai toujours dit que le système nerveux ne servait qu’à une chose, c’était à agir. Lorsque j’observe des gens courir autour du pâté de maisons à la fin de leur journée, je pense qu’effectivement cette action leur est très favorable. Car le reste du temps, ils demeurent probablement immobiles devant leur écran d’ordinateur. Pour eux, ce jogging n’est pas gratuit. D’ailleurs, on n’agit jamais par hasard. On agit pour contrôler son environnement. Par la course à pied, ces personnes tentent de conserver une certaine mobilité dans une vie où elles sont condamnées à rester le cul sur leur chaise. En ce sens, le sport est une sorte d’ersatz d’une vie plus naturelle. Mais le problème survient lorsque, de cette finalité tronquée, naît la compétition. Comme s’il s’agissait d’une suite logique ! Alors ça, je ne l’admets pas ! Pour moi, toute compétition est ordurière. Elle est à l’origine de tous les malheurs de l’homme : la compétition économique où il faut vendre un peu plus de marchandises, la compétition à l’école ou dans la vie où il faut être le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et le sport ne fait souvent qu’entretenir cette obsession malsaine. Dans notre monde, la compétition, c’est la trivialité la plus dégueulasse, la plus bête. […] Est-ce que vous savez d’où vient l’esprit de compétition ? Comment cela se passe dans votre cerveau lorsque vous avez envie de vous mesurer à un autre ? Eh bien, c’est la recherche de la dominance, c’est la possession des choses et des êtres qui vous anime. Dans un espace vide, nous ne serions en compétition avec personne. Il n’y a aucun instinct là-dessous. Seulement l’apprentissage d’une lutte pour s’approprier des gratifications. Si cela vous paraît naturel, c’est parce que l’on a introduit dans votre crâne des automatismes de pensées et des concepts que vous n’oserez jamais changer d’une virgule parce que ce serait trop douloureux pour vous. Mais ne vous vexez pas. Tout le monde est contaminé par cette connerie […]. »
Alors décontaminons-nous.
Thomas Jusquiame






