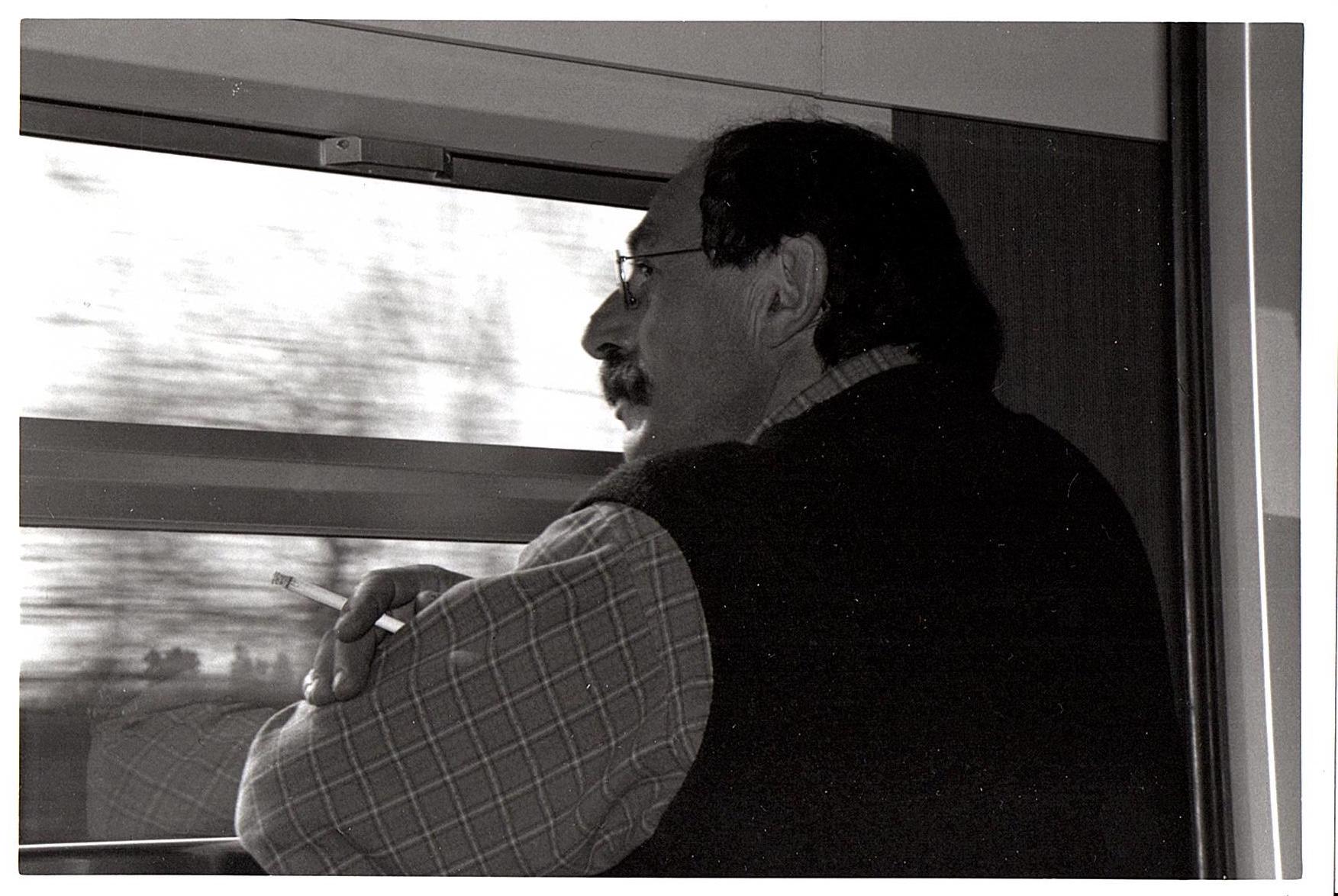Qui est cette « Boss Lady » ?
Factuellement : Théodora, Lili Théodora Mbangayo Mujinga, née en 2003 à Lucerne dans une famille congolaise réfugiée, a grandi entre Grèce, Congo, La Réunion, Bretagne, banlieue parisienne – la trajectoire classique des exilées assignées au nomadisme par la géopolitique plus que par le “digital nomad lifestyle”.
Elle a d’abord tenté la voie de la bonne élève républicaine (prépa ENS, conseils de jeunes, etc.) avant de bifurquer vers la musique. Musicalement, elle mélange rap, pop, bouyon antillais, amapiano, drum’n’bass et chanson, ce que la presse dominante s’empresse d’appeler « modernité créolisée » ou « musique de toutes les diasporas » [2].
Son tube « Kongolese sous BBL » (bouyon dopé à TikTok) devient en 2024 le premier morceau bouyon certifié single d’or en France, interprété par une artiste non antillaise. Depuis, elle enchaîne festivals (Vieilles Charrues, Cabaret Vert, Yardland) et Zéniths, encensée comme « phénomène pop de l’été » par Le Monde [3].
Courrier International la vend comme la star qui raconte « le quotidien d’une femme noire et queer » en France [4]. Elle-même se présente comme « Boss Lady », produit de la mixité, et revendique une musique pour « toutes les diasporas ». Bref : socialisation diasporique, passage par l’appareil scolaire, puis capture rapide par les majors et les plateformes (Universal, playlists, TikTok, Netflix, GP Explorer & co). On est au cœur de l’industrie culturelle au sens le plus classique du terme.
Diasporas, BBL et hyperféminité
Les défenseurs de Théodora nous expliqueront que « Kongolese sous BBL » est un hymne à la beauté des femmes noires, à l’hyperféminité assumée, à la fierté de corps longtemps stigmatisés [5]. Les paroles jouent explicitement sur le fantasme BBL (chirurgie) et sur l’idée de se lever déjà « belle », d’être « trop sexy », etc. On est là dans une logique que la littérature sur le pop féminisme décrit depuis des années : la réappropriation symbolique de codes de beauté dominants, vendue comme empowerment individuel, mais qui reconduit les mêmes normes corporelles sous un packaging cool, queer, intersectionnel et Instagram-compatible.
Le problème n’est pas que des femmes noires jouent avec l’hyperféminité – ça, ça peut être une arme, une ironie, un retournement. Le problème, c’est où ça se passe :
- dans une industrie qui repose sur la rentabilité, la segmentation de marché, le ciblage des publics, et transforme toute esthétique en niche monnayable [6] ; la « création » y est prise dans la loi de la valeur autant que n’importe quel secteur productif [7]
- dans un régime de féminisme néolibéral où l’injonction n’est plus « libérons-nous ensemble » mais « optimise ton self-branding, deviens la meilleure version de toi-même, monétise ta résilience ».
Dans ce cadre, le BBL n’est plus seulement un symptôme de la violence patriarcale-raciste sur les corps des femmes (et singulièrement des femmes noires) ; il devient une marchandise narrative : un motif de storytelling, un angle de clip, un hook TikTok. La chanson peut très bien jouer sur le second degré, l’auto-dérision, la revendication, mais la machine qui la porte ne connaît qu’un langage : streams, vues, tickets vendus.
Autrement dit : oui, il y a là une représentation plus complexe que la bimbo blanche standard. Non, ce n’est pas en soi une rupture politique avec le système qui produit et consomme ces images.
De la « Boss Lady » à la fempreneur : l’avatar musical du féminisme néolibéral
Le surnom « Boss Lady », sa mise en scène de l’ascension sociale par le talent, le travail, la souffrance et finalement la réussite – Zéniths, mode, collaborations prestigieuses – l’inscrit dans la figure aujourd’hui bien identifiée de la fempreneur : artiste / marque / entrepreneuse de soi. [8]
Les travaux sur les influenceuses et la « féminisation » du travail culturel en régime de plateformes montrent comment ce modèle repose sur :
- 1. l’auto-exploitation permanente (contenus, présence, intimité livrable),
- la conversion de toute expérience – y compris le racisme, la précarité, la dépression – en capital
symbolique monnayable, - une rhétorique d’empowerment qui masque la continuité des rapports de classe et de race.
Théodora coche à peu près toutes les cases :
- discours sur le poids de l’« excellence » imposée aux enfants d’immigrées, notamment les femmes
noires, - abandon de la prépa pour la musique, figure de la rupture courageuse,
- utilisation publique de références critiques (bell hooks, Césaire) dans Le Monde, histoire de prouver qu’on a lu mieux que Paulo Coelho [9].
Rien de scandaleux en soi – on a vu pire comme trajectoire. Mais politiquement, ça reste pris dans le moule : le racisme structurel n’est pas pensé comme rapport de production à détruire, mais comme ensemble d’obstacles individuels à dépasser ; la solution n’est pas l’organisation collective, mais la success story : devenez toutes des Boss Ladies, et l’oppression se dissoudra dans le champagne du carré VIP. Pour le dire crûment : on est loin de la perspective d’un féminisme matérialiste ou communiste, et très proche de ce que la critique appelle postféminisme néolibéral – celui qui aime les slogans, la visibilité, l’empowerment esthétique, mais pas trop la remise en cause des rapports sociaux.
La culture de masse adore ses anomalies contrôlées
L’autre élément : la presse dominante présente Théodora comme une « anomalie » dans la pop française, un « coup de pied dans la fourmilière » [10], une artiste qui « bouscule les codes » de genre, de race, de style. Là encore, rien de nouveau : comme le rappellent une partie des analyses marxistes de la culture, l’industrie culturelle intègre volontiers des formes « déviantes » ou marginales pour se régénérer, élargir son marché, produire l’impression de diversité tout en gardant le contrôle des moyens de production, de distribution et de financement [11].
Le bouyon antillais lui-même, au cœur de « Kongolese sous BBL », n’est pas arrivé là par miracle : il y a eu, dès le succès du morceau, des débats sur le fait qu’une artiste non antillaise, signée chez une grosse structure et portée par TikTok, devienne la première à obtenir un single d’or dans ce style très localisé – pendant que toute une scène antillaise, souvent ultra-précarisée, reste en marge [12]. Ce n’est pas « la faute » de Théodora en tant qu’individu ; c’est la logique de la machine : on prend un genre issu d’une périphérie (ici les Antilles), on le reconditionne via une figure plus bankable pour le centre hexagonal, on transforme ça en « révolution pop » alors que c’est surtout une opération d’actualisation de catalogue pour l’industrie.
Résultat : la chanson devient à la fois un espace de jeu symbolique pour une artiste noire diasporique, et un outil d’extension du marché pour majors, plateformes, festivals. Les deux dimensions coexistent, mais ce n’est pas la première qui dirige la seconde.
Alors faut-il aimer ou détester Théodora ?
Pas de réponse simple, du genre : « c’est une traîtresse pop au service du capital » ou « c’est la nouvelle icône révolutionnaire afro-queer ».
Ce qu’on peut dire, c’est qu’il y a une vraie intelligence formelle dans le mélange de styles, dans l’usage de l’ironie, dans la capacité à transformer des matériaux diasporiques (langues, imaginaires, esthétiques corporelles) en objets pop efficaces.
Il y a une subjectivité réelle derrière la marque. Son histoire d’exil, de racisme, de pression à l’excellence, sa position de femme noire et queer dans une France blanche, ne sont pas des fictions marketing sorties d’un powerpoint chez Universal. Elles trouvent des échos chez beaucoup de gens.
Mais cette subjectivité est intégralement capturée par l’industrie culturelle formats courts optimisés pour TikTok, design sonore calibré pour les plateformes, esthétique hyperféminine parfaitement compatible avec la logique du « pop féminisme » que le capitalisme adore : beaucoup de « girl power », zéro remise en cause des rapports sociaux de production.
Son succès ne menace pas le système, il le lubrifie Il apporte de la diversité au catalogue, de la couleur à la programmation, un vernis de progressisme à une industrie qui continue de surexploiter artistes, techniciennes, publics, et de concentrer propriétés et droits.
En résumé : Théodora ne sauvera personne, mais ce n’est pas son boulot. Son boulot, c’est de fabriquer des chansons efficaces dans et pour l’industrie culturelle. À nous de ne pas confondre ce travail-là avec la construction d’une autonomie politique. Et oui, tu as le droit de bouger la tête sur « Kongolese sous BBL » en lisant Marx ou Federici. Simplement, n’oublie jamais qui encaisse les droits d’auteur à la fin du mois.