Les raids anti-migrants des petits groupes néofascistes italiens ne sont désormais pas grand chose de plus que du folklore comparés à l’action gouvernementale, qui s’est donné pour but d’en réaliser personnellement les contenus à l’intérieur d’un cadre parfaitement capitaliste et souverainement démocratique. Toute la vieille rhétorique du vieux néofascisme – les héros, les valeurs éternelles, la communauté organique, la mystique antimoderne, etc. – attendrirait presque, devant ce fascisme ultra-capitaliste, par son aspect totalement outdated. Et cela vaut aussi pour la rhétorique antifasciste, évidemment.
Des États-Unis à la France, du Brésil à la Pologne et de l’Italie à l’Angleterre, il s’est formé ces dernières années une internationale férocement contre-révolutionnaire qui dispose d’un agenda, d’une vision et d’un langage communs, c’est-à-dire d’une stratégie globale. Toutes les choses qui font défaut à la gauche moribonde mais qui, il faut le dire, ont aussi souvent du mal à être perçues comme quelque chose de nécessaire par les mouvements antisystèmes : de là, une des raisons pour lesquelles le capitalisme fasciste semble partout rencontrer un vent favorable.
L’aspect le plus intéressant du livre de Rasmussen ne consiste cependant pas dans la démonstration de cette évidence qu’est l’installation d’un certain « fascisme tardif » mais, d’une part, dans l’analyse de cette affirmation gouvernementale de l’extrême-droite comme élément essentiel d’un processus de contre-révolution mondiale, c’est-à-dire comme réaction au cycle de lutte de 2010-2011 – d’Occupy aux Printemps Arabes et des Indignados aux luttes des afroaméricains – et, d’autre part, dans le fait de ne pas séparer la question du fascisme de celle de la démocratie.
La question, en particulier, à laquelle je crois que ce livre contribue à donner des réponses est la suivante : comment est-il arrivé que la puissance des mouvements et des insurrections qui ont parcouru le globe au début des années 2010 paraît avoir été d’abord débordé puis en partie à vrai dire soumise à la vague noire qui partout nous submerge ?
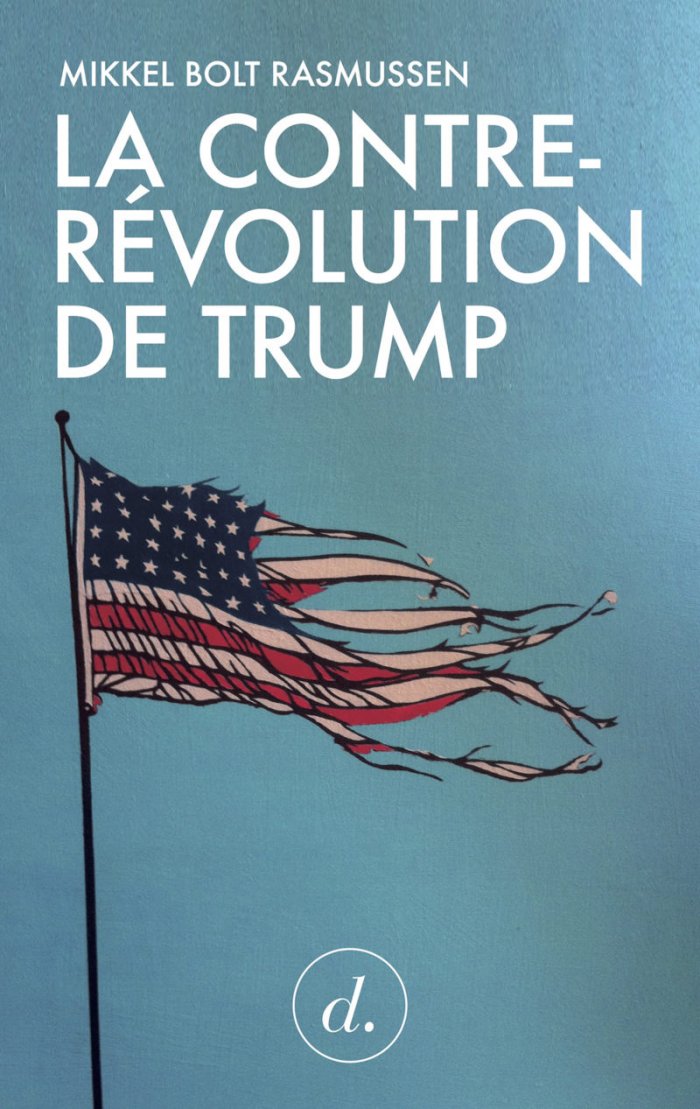
Le fait que l’auteur, en plus d’être un militant communiste, soit un historien de l’art n’est pas étranger à sa capacité d’interpréter la nouvelle esthétisation de la politique comme part essentielle de l’affirmation du fascisme social que le monde met en place. Reportons-nous en particulier au chapitre Politique de l’image, où il arrive à cette conclusion : « L’image n’est plus seulement un medium, elle est devenue la matière même de la politique contemporaine » (p. 53). C’est une erreur typique de la gauche, en revanche, de regarder la grossièreté apparente de l’opération médiatico-esthétique de l’extrême-droite pop – si Trump utilise les modèles de divertissement télévisés, Salvini utilise lui ceux de la conversation au bar ou des ultras du football – avec les yeux du moraliste, en croyant être plus intelligents, plus raffinés, plus civilisés et en fin de compte plus « beaux » que tous les Trump, Salvini, Orban ou Bolsonaro, au lieu de penser la politisation radicale de l’esthétique comme l’arme indispensable dans la configuration de l’actuelle conflictualité historique.
Dans une lettre que Karl Korsch a écrit à Brecht, il disait qu’au fond, le Blitzkrieg nazi n’était pas autre chose que de l’énergie de gauche concentrée puis libérée autrement : cette énergie qui dans les années 1920 paraissait encore se diffuser et pousser vers une Europe des Conseils, dix années plus tard avait été retournée et se retrouvait ainsi à être utilisée par ses adversaires, qui lanceront la classe ouvrière mondiale dans une « bataille de matériaux » gigantesque et fratricide qui ne pouvait avoir d’autre terme que l’anéantissement matériel et spirituel de la classe ouvrière en tant que telle, d’où la défaite de chaque perspective révolutionnaire au XXe siècle. Au moment de la débâcle, Benjamin a dû consigner, à son grand désespoir, que les fascistes semblaient comprendre mieux que la gauche révolutionnaire les lois qui régissent les émotions et les sentiments populaires, affects qui aujourd’hui encore sont traités par toutes les nuances de la gauche avec suffisance, quand ce n’est pas avec mépris, et on leur préfère toujours les arguments « rationnels », de « bon sens », « progressistes », « civiques », c’est-à-dire tout ce qui non seulement ne convainc désormais personne parmi les classes populaires, mais qui, au contraire, génère l’effet inverse, celui de se faire détester encore plus.
C’est ainsi que se produit Trump qui « pourtant récupère partiellement l’analyse d’Occupy concernant la crise financière et le sauvetage des banques » (p. 43), qu’en Italie la haine populaire envers la « caste » est capturée et jetée dans la guerre contre les migrants, les roms et les « tiques » ([zecche] c’est ainsi que sont surnommés en Italie les activistes des centres sociaux), tout cela avec comme arrière-plan le mépris évident que tous éprouvent à l’encontre des institutions de l’Union Européenne destinées à être, faute de mieux, transfigurées par le « souverainisme ». Au Brésil la corruption de la gauche, sa foi dans l’économie, sa prétention à savoir gouverner le capitalisme mieux que les autres, sa défiance chronique envers les mouvements autonomes et, ça va sans dire, sa vocation antirévolutionnaire, ont livré le pays à un bourreau du calibre de Bolsonaro. On pourrait décliner des exemples du genre pour beaucoup d’autres pays. Les mouvements, de leur côté, ont manqué le kairos pour transformer leur puissance propre en force révolutionnaire et une bonne partie de cette force se retourne maintenant contre eux. Nous pouvons donc en tirer une sorte de loi politique qui nous concerne aussi personnellement : dans les périodes de grand changement, chaque erreur d’interprétation, chaque erreur de sous-évaluation, chaque manque de courage, chaque hésitation dans le déroulement d’un événement potentiellement révolutionnaire, se paie d’un accroissement de la puissance de l’ennemi, du fascisme. Le corollaire de cette loi est qu’il faut en finir avec tous les affects gauchistes qui nous habitent.
Un autre élément important que Rasmussen porte à notre attention est de montrer comment Trump, face à et contre la jeunesse métropolitaine d’Occupy et les afroaméricains de Black Lives Matter, a su mobiliser les ouvriers et les employés blancs qui vivent en dehors ou aux marges de la métropoles et qui ont subi les coups les plus durs de la part de la crise économique débutée en 2008. De cette façon « Trump porte ainsi une contestation de la contestation, dont l’objectif est de repousser violemment la possibilité de changer le système de fond en comble » (p. 41). C’est aussi de cette façon que dans beaucoup de pays la rage justifiée contre la métropole a été soumise et utilisée par ceux-là même qui contrôlent les métropoles depuis toujours. Nous ne pouvons plus permettre que cela se produise encore et c’est pourquoi un autre corollaire est qu’il faut en finir avec cette illusion que cultive la gauche sur la réappropriation de la métropole ou sur sa gestion alternative : la métropole est irréformable, inhabitable et prise dans un devenir-fasciste désormais évident pour qui veut bien voir la réalité. Quand l’on pense à la France des Gilets Jaunes et à leur vocation contre-métropolitaine, c’est en fait un vrai chef-d’oeuvre que d’avoir réussi à éviter une manœuvre similaire à celles de Trump ou de Salvini, même si l’on ne peut pas encore dire le dernier mot : encore une fois, même en ce qui concerne les Gilets Jaunes, la règle du politique veut que si l’on ne porte pas l’attaque en profondeur, c’est le fascisme qui aura toutes les chances d’utiliser la force accumulée par le mouvement. Si Rasmussen raconte comment l’effet Trump a réussi à se produire avant que la critique du racisme structurel de la part de Black Lives Matter ne se conjugue à la contestation du mode de production capitaliste en général, en France il faudrait alors miser sur la combinaison entre contestation sociale, esprit anti-métropolitain et critique écologique, avant que les pouvoirs puissent couper les communications entre ces différentes tendances qui, effectivement, peuvent autant devenir un complexe révolutionnaire ample et doté d’une grande force de frappe qu’être détourné séparément en autant de puissances contre-révolutionnaires.
On ne peut donc se permettre aucun optimisme, et au contraire, comme le disait sagement Benjamin, « organiser le pessimisme » est dans ces moments la seule devise politique raisonnable qui soit. Une nouvelle avant-garde qui conjugue l’ivresse extatique de la révolte et la discipline révolutionnaire doit naître et nous permettre de « sortir ». Le seul art qui compte est celui de la sortie nous disait en effet Marc’O il y a quelques jours, dans un parfait style surréaliste (sur la nécessité d’une nouvelle avant-garde on peut se reporter à un autre récent texte de M. B. Rasmussen, Après le grand refus, sorti non sans raison en même temps que le livre sur Trump). Et je crois que cette fois ce sera une avant-garde qui tourne le dos à l’avenir et dirige son regard vers le bas.
Ce qui est aussi particulièrement important dans le livre de Rasmussen c’est la discussion sur la catégorie de fascisme et son actualité. Balayant tous les faux débats qui vont des déclarations selon lesquelles « le fascisme est revenu » à celles qui affirment qu’il « n’y a aucun Hitler ou Mussolini, aucune chemise brune ou noire qui justifie un tel diagnostic », l’auteur traite le fascisme comme n’importe quel courant idéologique, et par conséquent, au même titre que le socialisme, l’anarchisme ou le libéralisme ont une histoire qui les a modifiés à travers le temps, en plus de présenter des spécificités locales et des façons différentes d’être réprésenté, le fascisme n’est pas non plus réductible à un modèle unique, même pas d’ailleurs pendant l’entre-deux-guerres. C’est pourquoi à la svastika et aux faisceaux de licteur se sont substitués aujourd’hui la casquette de baseball de Trump et les sweats de Salvini, et à la différence des portraits du Chef jadis exhibés dans les bâtiments publics et les défilés, leurs mots et leurs visages sont présents sur les écrans 24h/24. La seule constante historique fasciste paraît être inscrite dans l’appel à une communauté imaginaire, originaire-naturelle, qui s’identifie à la nation et donc au Chef qui la représente, soit en substance un ethno-nationalisme autoritaire qui exprime la volonté, hier comme aujourd’hui, de s’opposer par tous les moyens à l’émergence d’un mouvement révolutionnaire qui en finirait avec le capitalisme.
Au-delà de tout cela et de la profondeur d’analyse sur l’Amérique trumpienne, Rasmussen nous livre une réflexion cruciale sur la question de la démocratie : « Le fascisme n’est pas le contraire de la démocratie : il émerge, croit et triomphe en son sein même, lorsqu’une crise exige de restaurer l’ordre et d’empêcher la formation d’une alternative révolutionnaire. Le fascisme n’est pas une anomalie, mais une possibilité inhérente à tous les régimes démocratiques » (p.134). Voilà pourquoi toutes les tentatives d’y opposer un front démocratique antifasciste, des libéraux aux anarchistes, sont vouées à la défaite. D’autre part Giorgio Agamben avait déjà noté il y a quelques années que les lois d’exception promulguées par la démocratie qui nous est contemporaine sont encore plus liberticides que celles du fascisme historique, et ce sont les mêmes Trump et Salvini qui n’hésitent pas à se définir comme de fervents défenseurs du système démocratique (grâce auquel, entre autres, ils ont été élus, comme déjà Hitler au temps de la république de Weimar). Et s’il est vrai, comme l’écrivait Mario Tronti, que c’est la démocratie qui a vaincu et anéanti la classe ouvrière, on ne peut comprendre comment il est encore possible aujourd’hui de croire qu’une quelconque démocratie puisse sauver la terre de la catastrophe en cours. C’est pour cela que Rasmussen conclut que la seule alternative au fascisme est celle qui vise une destitution de la démocratie indissoluble de celle du capitalisme.
« Sortir, sortir et encore sortir ! » est notre seul mot d’ordre.






