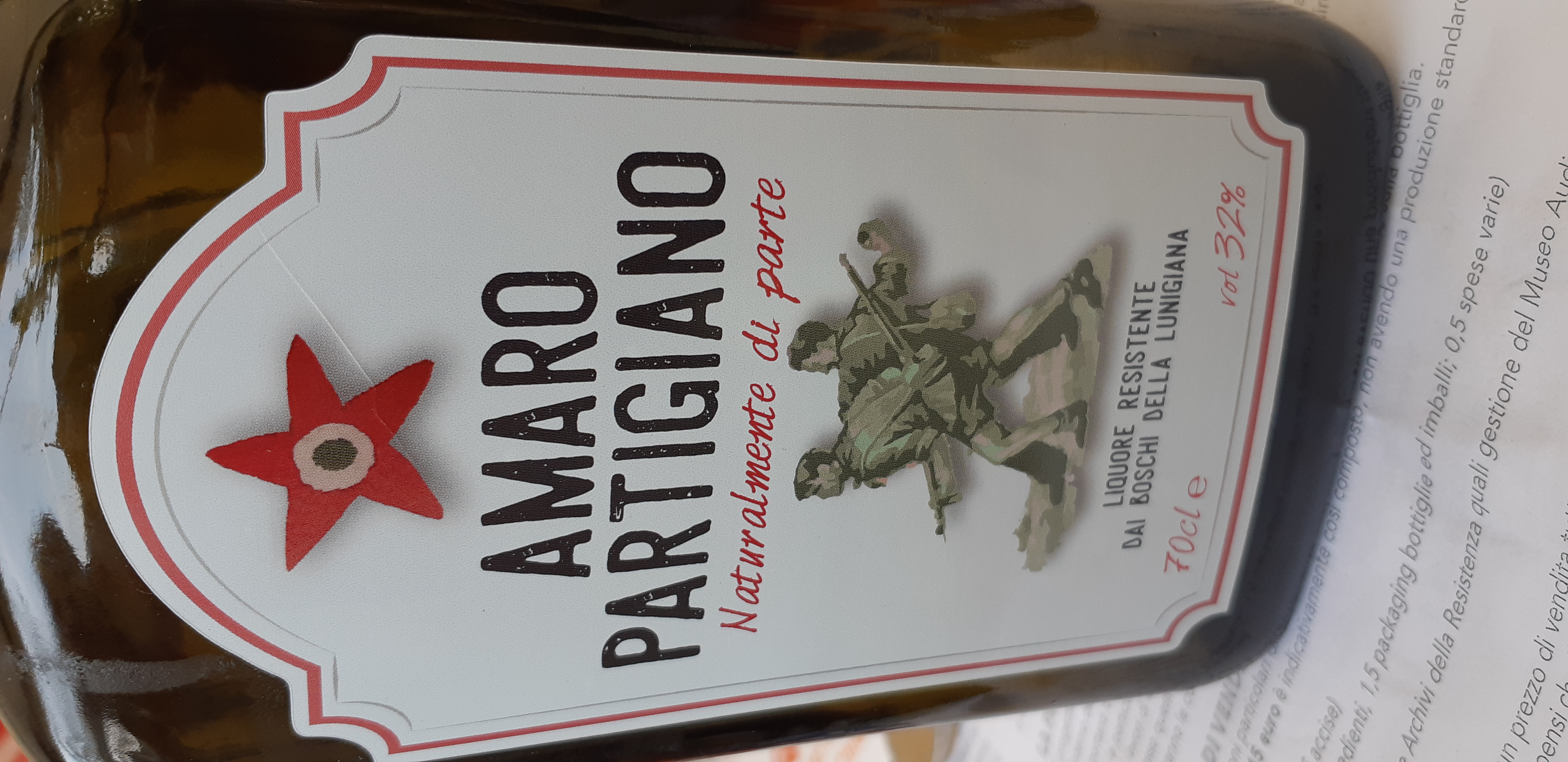Jour 1
5h37 - Bethléem s’éveille aux incantations du muezzin, aux cloches de Sainte-Catherine, le mainate /martin triste (Acridotheres tristis) et la tourterelle maillée (Spilopelia senegalensis) sont dans les choeurs, au jardin. Le voyage par les collines et les peines, le long des murs, entouré de la bienveillance des habitants de ces terres en sursis, nous emmène aujourd’hui vers le sud, à Hébron. Chaleur, lumière et ombres à l’étape.
Jour 2
Du souk d’Hébron et de la vieille ville, vous trouverez des photos romantiques à foison. La réalité de la colonisation s’impose ici dans sa nudité et sa violence. De nombreuses rues et ruelles sont fermées par les sionistes des colonies qui se sont implantés par la force (à partir de 1993). Ils vivent aux étages supérieurs et déversent leurs déchets dans les rues encore accessibles. D’où la présence de grillages, de barbelés en tous genres et dans toutes les directions. Ces barrières hostiles surveillées par des miradors inquisiteurs (un soldat dans sa tour blindée me voit et me fait un signe de la main !) évoquent un passé pas si lointain dont les colons ne semblent pas se souvenir. Enfermement, camp, déportation, annexion. Une dialectique de l’expansion et de l’oppression. Hébron est une ville assiégée qui assombrit les regards. Ici, les oiseaux sont de mauvais augure.
Jour 3
Le tombeau d’Abraham, dans la grande mosquée d’Hébron, est une tragédie minérale qui illustre l’enjeu mortifère de ce territoire. Pour la maîtrise de son accès, des dizaines de morts jalonnent les marches du dernier siècle. Il ne s’est pas trouvé un dieu, fut-il juif, chrétien ou musulman pour arrêter ce massacre. Aussi, aujourd’hui, les juifs ont accès d’un côté de ce mausolée et les musulmans de l’autre, l’ensemble divisé par des vitres blindées. Cette catastrophe en dévotion est contrôlée par un double check-point, où des jeunes soldates, maquillées, mitraillettes à l’épaule, nous dévisagent, impavides. Dans ce monde, peu de lieux aussi hostiles à une méditation bienveillante, à la prière, portent avec une telle force l’envers de la quête spirituelle. Atterrant est le mot qui me vient.
Jour 4
Aucun mur ne touche le ciel, fût-il à deux millions d’euros le kilomètre. Il en est prévu 708. Cela ressemble à l’hybridation moyenâgeuse d’un château fort, tourelles rondes, meurtrières, angles multiples, et d’une prison ultramoderne, caméras couleurs et thermiques à 360 degrés, vitres blindées. Le gris est de rigueur.… L’ensemble traverse les rues, les cimetières, les propriétés et serpente par monts et par vaux en donnant cette sensation étrange que les deux populations sont enfermées. La récurrence du barbelé, « the devil’s rope », laisse une impression inquiétante d’aliénation. « Faites du houmous, pas des murs » est-il écrit. Dans la chaleur déclinante du retour à Bethléem, un Souïmanga de Palestine (Cinnirys osea) butine les fleurs dans le jardin en face. Cet oiseau léger et brillant (un « colibri » de l’Ancien Monde) est l’emblème de la Palestine.
Jour 5
Descente sous le niveau de la mer. Jéricho se situe à - 254 m. Cette oasis habitée depuis plus de 10.000 ans se transforme en étuve durant l’été. La route qui y mène est jalonnée de checkpoints, de colonies plus ou moins fortifiées (barbelés, tours, militaires) interdites aux Palestiniens qui risquent leur vie à toute approche. Inversement, à l’entrée des villes en zone A (voir sur la carte de Palestine), des panneaux rouges et blancs signalent : « In this area, Israeli are in danger ». La réalité contredit cette affirmation. Ce matin, une incursion de l’armée israélienne dans Jéricho nous a retardés, et la veille, le frère et la belle-sœur de notre amie Haya ont été temporairement arrêtés. Le quotidien des Palestiniens est peuplé de menaces et de vexations. Leur bienveillance n’en est pas affectée, mais dans les regards, tant d’ombre et de mélancolie.
Dans les ruines du palais d’Hicham, un Guêpier d’Orient (Merops orientalis) se cache sous les acacias, une Huppe fasciée (Upupa epops), emblème d’Israël, s’éloigne en dressant sa couronne de plumes.
Jour 6
Nous quittons Jéricho après y avoir passé la nuit. La veille, un ami de notre hôte était sur la route de Ramallah, trafic à l’arrêt. Un jeune colon israélien - armé - avait fermé une barrière. Aucun argument, aucune raison sinon une mesure vexatoire gratuite. Sur plus de 230 colonies, près de 800.000 colons sont installés en Palestine occupée, par la force. Le matin de notre départ, notre hôte nous demande provisoirement de ne pas sortir car l’armée israélienne fait une incursion. C’est le quotidien des habitants de cette terre.
Dialectique mythologique, vexations, humiliations, culpabilisation des victimes, les ressorts de la colonisation.
« Nous avons vu mentir, avilir, tuer, déporter, torturer, et, à chaque fois il n’était pas possible de persuader ceux qui le faisaient de ne pas le faire, parce qu’ils étaient sûr d’eux et qu’on ne persuade pas une abstraction, c’est-à-dire le représentant d’une idéologie ».
A. Camus, Ni victimes, ni bourreaux, 1975
Jour 7
Nous circulons dans un espace qui semble constitué de murs, de barrières, de barbelés, de postes de contrôle, où la vidéosurveillance est omniprésente. Il est nécessaire de rappeler qu’en Cisjordanie (Westbank), 3 zones définissent le niveau d’occupation. Dans les faits, les Israéliens (armée, colons) font ce qu’ils veulent. Cela ne nous empêche pas de rencontrer de nombreuses personnes qui continuent de créer et de vivre. Nous sommes accueillis avec bienveillance, une intensité qui dit l’urgence. Des musiciens, des artistes, des écrivains, des journalistes sont là pour nous partager le quotidien sous occupation.
Hier à Jérusalem. Traversée du checkpoint à pied. Immenses couloirs, béton, métal, caméras. Suspicion froide des gardes armées (des femmes, le plus souvent). Dans la vieille ville, tout change. Toutes les communautés se croisent dans une effervescence de marché, foule bigarrée en costumes traditionnels juifs, musulmans, chrétiens se mélangeant. Improbable paradoxe. Nous n’aurons pas accès à l’esplanade car c’est vendredi. Le cœur de la vieille ville semble immarcescible. Nous y aurons rencontré Assad, digne francophile de 89 ans, heureux de nous entendre dans une langue qu’il a apprise chez les salésiens de Jérusalem. Échanges variés sur la situation, mais aborder le sujet de Gaza n’est pas opportun, des larmes mouillent son regard bleu bienveillant, éteignant notre conversation.
Jour 8
Vendredi, à la mosquée, samedi à la synagogue, dimanche à l’église. La paix de l’aube, le calme des éléments, la lumière nacrée. On touche du doigt un monde parfait. Qui pourrait l’être. Le marché, hier après-midi dégageait une vibration sociale et colorée de mille fruits, légumes et harangues souriantes. La vie, ici comme là-bas.
La résistance, la dignité, la nécessité cathartique font du mur un tableau couvert d’humour et de poésie. Des artistes locaux et d’ailleurs, des enfants, des militants, des aimables facétieux y déploient leurs talents.
Sur ce mur, il est écrit : « les murs sont fait pour être escaladés ». Sur ce mur il est écrit : « Je ne peux pas croire ce que tu dis car je vois ce que tu fais ». On y lit aussi : « La guerre, c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage, l’ignorance c’est la force ». Des colombes, des ânes et des anges se promènent autour des trompe-l’œil, un cupidon donne l’adresse d’une entreprise qui loue des grues pour le démontage. La force de l’esprit - l’humour comme politesse du désespoir - en marche pour dissoudre l’abject béton bête et brut.
Quelques corneilles mantelées (Corvus cornis) flânent et surveillent comme autour des gibets.
Jour 9
Dans le camp de réfugiés d’Aida qui fait partie de l’agglomération de Bethléem, l’État israélien donne l’accès à l’eau une fois par semaine. Les toits des immeubles sont chargés d’innombrables citernes de stockage. Ce qui était un camp de toiles en 1948 est devenu une cité aux ruelles étroites, organiques. Une solidarité doublée d’une forte résistance à l’Etat colonial habite ces lieux où vivent les descendants des victimes de la Nakba. Un ami artiste y a son atelier partagé. Avec des moyens dérisoires dans cet espace ouvert à tous vents, la créativité des occupants, jeunes hommes et femmes, domine le mur sur lequel, au loin, il est écrit : HOPE.
Hier matin, en longeant ces palissades de la honte, une immense porte s’ouvre et livre le passage à deux véhicules militaires. Armée, blindée, une patrouille israélienne pénètre en zone occupée. Avec un ami, nous observons la scène. Immédiatement, un soldat, au pied de la tour de guet nous interpelle. Très agressif, ce jeune homme casqué nous fait comprendre, arme à la main, qu’il s’agit de dégager au plus vite. Mon ami et moi obtempérons mais un noeud de colère me serre le ventre. Les véhicules s’en vont faire leur ronde en « territoire hostile ».
« Un geste de trop, un mot de trop, un pas trop lent, un grincement de dent sont alors interprétés comme une menace qui exige une réplique. ».
Y. Ternon, L’innocence des victimes, 2001
Pendant ce temps, le ministre israélien de l’intérieur, piétinant tous les accords intercommunautaires, va « prier » sur l’esplanade des mosquées.
Jour 10
Dans toutes les rues du Monde, des personnes comme Jack, insoumises, promènent leur différence irréductible. Il arrête sa trottinette électrique bariolée, équipée d’un improbable panneau solaire, et entame la conversation. En anglais et français, il porte un discours d’humour caustique sur ses engagements : « le communisme, c’est pas génial mais tout de même beaucoup mieux que les religions... ». Il est joyeux et la radio attachée au guidon de la trottinette diffuse sa musique favorite. Dans ce quartier est installée l’Université de Bethléem. Le campus arboré fait envie et appelle à la tranquillité. Le contraste est saisissant. Le mur et les colonies sont pourtant bien là, posés sur l’horizon proche. Avec mon compagnon de voyage, nous allons y visiter l’ Institut pour la Biodiversité. Ici, contre la réalité, le professeur M. Q. déploie son énergie pluridisciplinaire et solaire. Les oiseaux, les arbres, le potager, la production de biogaz, les collections du musée d’histoire naturelle ont une place privilégiée. Au mur il est écrit : L’EDUCATION, C’EST LA RESISTANCE. La résistance passe aussi par la beauté des oliviers, du vent, et la tendresse des légumes. A notre admiration pour ce travail remarquable, le professeur répond que sans cela, il serait devenu fou dans ce monde orwellien. Dans le minibus qui nous transportera à Ramallah le lendemain, un jeune homme qui s’occupe d’une ONG vouée à l’aide aux enfants nous dira : « Avant, je réfléchissais à d’autres pays pour émigrer, maintenant, je cherche une autre planète… ».
Jour 11
Je vous écris d’une réserve indienne entourée de barbelés. Et vous êtes si loin, de l’autre côté du mur, où tout peut s’oublier.
Le peuple jeune que je rencontre et croise sur cette terre sans nom (les Israéliens l’appellent Judée-Samarie) connaît le monde, voyage, lit, chante. Mes pas, dans cette culture ancienne habitée de raffinement et de poésie, d’une politesse dont devrait
s’inspirer l’Occident à l’arrogance grossière, me conduisent à Ramallah, au pied de la
tombe de Mahmoud Darwich. Cet immense poète a mené la lutte avec les mots. La poésie est une arme, les chefs de guerre israéliens le savent très bien. M. Darwich a été emprisonné fréquemment, et à Gaza, en novembre 2024, Reefat Al Areer a été assassiné avec toute sa famille par les soldats de l’occupant. Il était poète.
Tous les artistes rencontrés ici créent autour des seuls sujets de la colonisation, la violence et la guerre à Gaza. Une œuvre très explicite montre de la terre et des os :
« Cette terre est un peuple », de Iz Al-Jabari. L’éducation et l’art sont au cœur de la résistance.
Jour 12
Dans un pays où coulait le lait et le miel, autour de Bethléem, on produit de la bière et du vin, plutôt agréables. Mais où trouver de l’eau ? Comme écrit précédemment, la gestion de l’eau est aux mains des Israéliens qui gèrent selon les circonstances, la distribution.
Évidemment stratégique, l’enjeu de l’eau, que l’état israélien a capturé à son profit, oblige les Palestiniens à développer des techniques de stockage, de pompage et de transport, sous un climat méditerranéen aride. L’accaparement du plateau du Golan qui alimente le Jourdain est une des conséquences de cette stratégie de colonisation. Les toits, en Cisjordanie, portent d’innombrables citernes connectées à des pompes bruyantes et une forêt de tuyaux. L’état israélien vend aux Palestiniens une ressource qui leur appartenait.
Le système colonial ne déroge jamais à ses règles d’asservissement. Mais les jardins ici sont luxuriants et les marchés débordent de fruits et légumes produits localement.
L’art - potager - naît de la contrainte et la terre est guérisseuse.
Jour 13
Mon séjour touche à sa fin, l’aube dans la brume comme un voile que le soleil déchire sans peine, promet un jour écrasé de chaleur. L’illusion de sérénité à Bethléem produit ce mélange dérangeant de perceptions contradictoires, comme cette gazelle des montagnes (Gazella gazella), prisonnière élégante au même titre que les vestiges antiques qu’elle fréquente, expropriés par Israël, restaurés à grands frais et surveillés par une garnison cernée des inévitables barrages et barbelés. Le village palestinien en contre-bas est ignoré et la route qui menait au site est obstruée. Pour visiter ce lieu à la fois parc national et patrimoine archéologique, je dois franchir trois obstacles, sous la surveillance des caméras et des gardes perchés dans les miradors. Je pénètre à pied et rejoins le bâtiment de la billetterie. Une foule de juifs orthodoxes en costumes traditionnels occupe l’espace.
Un homme jeune, avenant, est à la caisse. Il est très prévenant et me propose une casquette pour le soleil et de l’eau pour la visite. Il doit faire près de 40 degrés. Je paie mon entrée et je vois, glissé dans sa ceinture, un revolver de gros calibre. Cool mais vigilant. La visite du mausolée d’Hérode (Herodion) garantit une vue imprenable sur le désert et les villages autour de Bethléem et Jérusalem.
Dans ce pays où il est impossible d’échapper aux obstacles qui organisent le ghetto cisjordanien, nous visitons l’après-midi les Bains de Salomon à proximité de Bethléem.
Nous assistons à une prestation orale et gestuelle d’une actrice palestinienne qui nous entraîne dans la problématique de l’eau devant d’immenses bassins à moitié vides. Un Martin-chasseur de Smyrne (Halcyon smyrnensis) plonge dans l’eau sale où flottent des déchets en tous genres. Un élément du mur se dresse à l’horizon derrière la pinède.
Jour 14
Il fallait voir Battir, ce village classé par l’UNESCO qui doit ressembler à ce qu’était la Palestine avant 1948, avec ses jardins en terrasse, son eau claire et les vergers d’oliviers.
Je passerai un moment improbable de partage avec une famille qui m’ouvre ses bras et sa table, comme si le seul fait d’être venu jusque là méritait un accueil si bienveillant. On y produit les meilleures aubergines du monde, au dire de ses habitants. La ligne verte est à trois kilomètres et les colons, dont on se demande quels scrupules les retiennent encore, ont l’oeil sur cet Eden en sursis. Ici, on entend les oiseaux, ici, le Souïmanga et la Huppe se partagent le ciel et les jardins.
Jour 15
Départ. Le bus nous emmène vers Jérusalem. Au check-point, nous devons descendre et faire la file pendant qu’un soldat examine fouille le véhicule. Nous présentons une pièce d’identité à un soldat qui n’a pas vingt ans, son fusil-mitrailleur posé sur le parapet qui le protège. Dans le train qui m’emmène à l’aéroport, un jeune Israélien dévot récite ses psaumes debout au fond du wagon en se balançant et, derrière moi, un homme jeune en civil est assis nonchalamment sur la banquette, une mitraillette à l’épaule.
Au mur de l’aéroport, une immense photo représente de dos des soldats israéliens se soutenant et dressant le drapeau national, une citation triviale de la photo mythique des GI’s sur la colline d’Iwo Jima en 1944. Le nationalisme propose à son habitude une vision révisionniste et simpliste du monde.
Aujourd’hui, je fais mon baluchon et je tiens serrée la bienveillance reçue. Mon cœur est à Gaza.
Pour les enfants de Gaza
Pour les enfants de Gaza
Dix-huit mille cinq cents fois
Je veux donner ma voix
On ne l’entend pas
Dix-huit mille cinq cents fois
Je veux dire des mots qui ne sortent pas
Dix-huit mille cinq cents fois
Je dois respirer pour détendre ma gorge serrée
Dix-huit mille cinq cents fois
C’est impossible à dire
Dix-huit mille cinq cents fois
C’est impossible à compter
C’est impossible à penser
Dix-huit mille cinq cents fois
18.500 xxxxxxxxx…
Bethléem 11 août 2025
Dans le train suivant l’Yonne
Je regarde passer les vaches, je regarde passer les arbres et la rivière vient à ma rencontre. Les enfants de Bethléem passent en courant, les soldats traversent le bus, le marchand de pain arrive aussi, monte le raidillon à six heures du matin arc-bouté à sa charrette, le marchand de glace l’après-midi, un monde à notre rencontre qui passe comme je vole par les montagnes enflammées, les mers tremblantes, les vapeurs colorées, voiles, nuages et lune.
Nous remontons la rivière, nous remontons le temps mais les enfants coulent dans le fleuve d’indifférence, de silence.
Le boucher est passé sans émoi, sans passion, parmi la chair déchirée par les canons du viol, pour ces enfants sans regards, sans pensées et sans bras. Ils flottent en haut des décombres, entre les bourdons-tueurs et les fragments d’obus, poussières d’amour en fugace artifice.
Tuer des poètes, tuer des enfants, des restes pendus aux fils, du linge taché, explosé.
Des enfants déchirés, comme du papier à musique, partitions inachevées et jetées, des feuilles d’un poème brûlé avant la fin. Je vois passer l’Histoire en sang.
Je vois des morceaux d’enfants glisser sur les murs, je sens notre humanité passer, suintement rouge au fond du fossé, reflété par le miroir du ciel.
« Tuer des enfants, c’est effacer l’avenir ».
Y. Ternon, L’innocence des victimes, 2001
Ladislas - Août 2025
A Mathilde et Michele