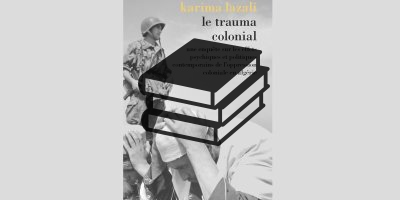Le complément du 2 mars y ajoute les « agriculteurs salariés, éleveurs salariés, maraîchers, horticulteurs salariés » et « viticulteurs, arboriculteurs salariés » (le JO ne kiffe pas trop l’écriture inclusive, apparemment), tout ça pour ne pas dire des saisonnièr·e·s qui toucheront des cacahuètes en guise de salaires, seront logé·e·s dans des conditions indignes pour la plupart et renvoyé·e·s chez elleux sans au revoir ni merci quand on en n’aura plus besoin (ou si par malheur ielles tombent malades ou se blessent au travail).
Ramasser des fraises, faire les vendanges ou tailler la vigne, entre autres occupations, sont des activités non délocalisables. Des bagnoles, on peut les monter n’importe où, du moment qu’on détient les capitaux nécessaires à acheter du terrain et à installer des chaînes de montage. Mais un certain nombre d’autres travaux réclament une présence humaine sur place, quel ennui ! L’agriculture, comme on vient de le voir, mais aussi le bâtiment, l’hôtellerie-restauration, les emplois de service (nettoyage, manutention, logistique, etc.) et bien sûr ceux du care (dans les hôpitaux, les soins à domicile, les maisons de retraite, et on en passe). (Il y a aussi des choses que l’on pourrait faire ailleurs, et qui se font souvent ailleurs, comme la confection de vêtements au Bangladesh [1], mais que l’on s’arrange aussi parfois pour faire « ici », mais là, ce sera plutôt dans des ateliers clandestins, non autorisés par arrêté publié au JO…) Toute la question (pour les capitalistes) est dès lors d’organiser la « délocalisation sur place », soit de produire une main-d’œuvre moins chère et dépourvue de protections sociale et juridique, donc moins à même de protester contre sa condition. Ce que décrit Daniel Veron en termes plus précis et pertinents. Il parle en effet des « mécanismes de production d’une inclusion différentielle [2], laquelle s’avère décisive dans l’exploitation de la force de travail migrante ».
Cela passe d’abord par des procédures d’expulsion. Ce dernier mot nous renvoie spontanément, en France, à la sinistre « OQTF », Obligation de quitter le territoire français, qui pèse comme une épée de Damoclès sur la vie de nombreux·ses travailleurs·ses sans papiers. Ou aux non moins sinistres CRA, Centres de rétention administrative. Mais la première des expulsions est celle qui pousse, voire qui oblige les personnes à quitter leur pays pour aller chercher ailleurs « une vie meilleure », ainsi qu’ielles le disent à Daniel Veron. J’aurais peut-être dû le préciser avant : le livre dont je rends compte aujourd’hui est celui d’un sociologue qui ne s’est pas contenté d’écouter des personnes migrantes raconter leur parcours et leurs luttes – ce qui serait déjà très bien, tant elles sont la plupart du temps invisibilisées et silenciées – mais qui a aussi pratiqué activement l’« observation participante », particulièrement en militant au cours de différents mouvements de sans-papiers entre 2008 et 2013 dans la région parisienne puis, entre 2019 et 2021, avec la CGT 93 dans les « permanences dédiées aux travailleurs et travailleuses sans papiers » ainsi qu’aux grèves lancées par ce syndicat. Il a aussi fait « des terrains », comme on dit dans le jargon, en Argentine et au Canada, où il a également suivi les mouvements des migrant·e·s bolivien·ne·s en Argentine ainsi que ceux des Mexicain·e·s, principalement, au Canada. Le premier chapitre du livre, quant à lui, déploie une solide analyse de
l’évolution des formes de mobilisation de la main-d’œuvre migrante – depuis les premières réglementations de la migration chinoise dans l’Ouest canadien jusqu’aux configurations les plus récentes de la « gouvernance » internationale des migrations – et [tâche] d’en saisir les continuités et les ruptures au gré des transformations de l’appareil productif.
Il s’agit là d’une radiographie des lois et pratiques administratives des pays d’« accueil »et des idéologies qui les accompagnent. Le deuxième chapitre est basé sur les récits de migration des personnes rencontrées. Il s’agit « de saisir que les dynamiques de l’exil, c’est-à-dire les logiques d’expulsion, sont la condition de l’appropriation de la force de travail dans les pays de destination ». Les chapitres suivants, également étayés sur de nombreux extraits de paroles de migrant·e·s, s’intéressent à deux modalités de captation de leur force de travail, soit la « face clandestine du travail migrant clandestin », ou comment les sans-papiers s’insèrent sur le marché du travail et, d’autre part, la face légale d’importation d’une main-d’œuvre étrangère, à travers le recours au travail dit « détaché ».
Le titre du premier chapitre me paraît tout à fait explicite : « Les politiques migratoires ou la production d’une main-d’œuvre surexploitée ». Je souligne, car il me semble essentiel de comprendre cette dimension de production de la main-d’œuvre. On nous a trop souvent bassiné avec la « question de l’immigration », ou avec le « problème immigré », comme s’ils étaient tombés du ciel, voire, selon des observateurs qui se veulent plus progressistes, comme s’ils étaient une regrettable conséquence du « sous-développement » [3] ou de l’incurie des élites du tiers-monde. Daniel Veron montre très bien comment des politiques xénophobes et/ou racistes ont permis de hiérarchiser les travailleurs et les travailleuses en fonction de leur origine, de leur couleur de peau et de leur genre, de diviser la classe ouvrière, en somme, afin 1) de disposer d’une force de travail plus docile et moins chère, 2) de remettre en cause les droits économiques et sociaux conquis par les luttes syndicales dans les pays « développés » (appuyées après-guerre, ajouterai-je, sur la présence d’un bloc soviétique contre lequel la meilleure arme fut d’acheter le mouvement ouvrier finissant) et 3) « par-dessus le marché », si je puis dire, se payer le luxe, en période de crise et de précarisation des classes moyennes, de détourner les colères suscitées par les restrictions du niveau de vie, de la protection sociale et la casse des services publics contre les étrangers – enfin pas tous, on aura compris, les méchants seulement, ceusses qui ne sont pas comme nous, quoi.
Après cette première approche qui fixe le cadre légal et politique de l’organisation de la migration (et qui donne, il faut le souligner au passage, une excellente synthèse historique des politiques françaises des années 1930 à aujourd’hui), Daniel Veron s’intéresse donc à « L’exil, condition de l’appropriation du travail migrant » (titre du chapitre 2). Il s’appuie ici sur de nombreux récits de personnes migrantes, desquels ressort cette notion d’« expulsion », terme utilisé dans le même sens que Saskia Sassen dans son livre titré Expulsions [4], précisément, c’est-à-dire l’expulsion des pauvres de leurs maisons, de leurs terres, etc. Veron parle aussi de « destruction des conditions de l’autochtonie ». Harsha Walia (voir la note 1) le dit aussi dans Frontières et domination : les migrations sont intrinsèquement liées à l’avancée inexorable du capital qui dévaste tout sur son passage. Les enclosures dont parlait Marx croissent et se multiplient, créant toujours plus de travailleurs et de travailleuses « libres » de toute attache. Daniel Veron cite d’ailleurs à ce sujet Abdelmalek Sayad, qui écrivait ceci [5] :
Le rapport entre le monde développé et le monde sous-développé semble reproduire, mutatis mutandis, le rapport initial, déjà ancien et peut-être universel, entre ville et campagne : le monde développé, monde de l’immigration et monde de l’urbain, se nourrirait du tiers-monde, monde de la ruralité (ou, plus exactement, de moindre industrialisation et de moindre urbanisation, même s’il est en proie à une déruralisation intense et anarchique) et monde de l’émigration au long cours.
On verra en lisant les entretiens qu’a menés Daniel Veron que les motivations du départ des personnes qu’il a rencontrées sont diverses, mais que toutes tiennent d’une manière ou d’une autre à l’attraction puissante qu’exercent les sociétés « développées » sur des jeunes (que sont les migrant·e·s dans leur grande majorité) dont l’avenir chez elles ou eux est plus ou moins bouché – « qui ne rêve pas d’une vie meilleure ? ». Il ne s’agit pas seulement d’une question de pauvreté matérielle, même si c’est souvent le cas, mais aussi de ce qu’ont rêvé les jeunes en tout temps et tous lieux, soit d’échapper au carcan familial (patriarcal), de découvrir le monde et aussi, bien sûr, de réussir à gagner assez d’argent pour être en mesure d’aider la famille restée au pays.
Les deux derniers chapitres détaillent comment, par quels procédés plus ou moins sophistiqués les pays « importateurs » de main-d’œuvre se débrouillent pour, paradoxalement, l’« immobiliser » – la mobiliser au travail tout en l’empêchant d’exister autrement. C’est ce qu’Alain Morice a appelé « le travail sans le travailleur » [6]. Daniel Veron en donne de nombreux exemples à travers, toujours, des entretiens avec des travailleuses et des travailleurs migrant·e·s.
Tout en vous engageant vivement à lire ce livre [7], je me permets d’apporter une petite contribution supplémentaire, à travers un exemple supplémentaire d’arnaque à l’emploi qui pousse au bout cette logique du travail sans travailleur. Je l’ai trouvé dans la Revue du Crieur n°22 (avril 2023) [8]. Des chercheurs regroupés dans le collectif Arosa Sun, qui travaillent sur les transformations du monde du travail au croisement de la sociologie de l’espace et des migrations, y ont publié un article intitulé « Pays-Bas, un empire logistique au cœur de l’Europe. Enquête sur la flexibilisation des travailleurs migrants » [9]. Ce qui est très impressionnant dans cet exemple, c’est que s’y conjuguent deux réalités que l’on pourrait croire aux antipodes l’une de l’autre. D’un côté, le monde enchanté, « dématérialisé » de la (sur)consommation en ligne – de jolis objets apparaissent sur un écran, il suffit de cliquer pour les acheter et les recevoir quelques jours après chez soi. De l’autre, les gigantesques entrepôts de marchandises débarqués des porte-containers en provenance des grandes usines globales du Sud-Est asiatique. Ces marchandises que commandent, via Internet, chaque jour, chaque heure, chaque minute les consommateurs de l’Europe entière, commandes qui doivent donc être « traitées » par une myriade de « petites mains ». Les travailleuses et travailleurs sont recrutés dans les pays de l’Est ou du Sud par petites annonces, qui leur proposent tout à la fois emploi bien payé et logement. Une fois sur place, ielles déchantent. Les « logements » sont souvent des mobil-homes, voire des campings. Et les emplois, gérés par des agences d’intérim, sont loin d’être de « vrais » emplois (même si de « vrais » emplois, genre manutentionnaire chez Amazon, ne sont déjà pas très désirables). Tout d’abord, il faut savoir que les migrant·e·s qui travaillent pour ces entreprises logistiques n’ont quasiment aucune existence sociale aux Pays-Bas. Tout juste sont-ils enregistrés avec un numéro qui permet de percevoir un salaire. Mais rien d’autre (ni prestations ni droits sociaux). Ensuite, ils doivent rester dans leurs baraquements à attendre qu’un chef les appelle pour aller travailler.
Dans la logistique, expliquent les chercheurs, la vulnérabilisation de la main-d’œuvre est un préalable à sa mise au travail [10]. Bol.com [un des géants de la logistique] exige que le « stock » de travailleurs disponibles soit toujours surdimensionné par rapport au travail réel prévu. Quand la prévision de rentabilité descend, l’entreprise [d’intérim] procède à des licenciements – lesquels imposent aux travailleurs de rentrer au pays, puisque c’est leur employeur qui s’occupe également de leur logement. C’est ce que les travailleurs appellent la « chasse aux sorcières ». Les employeurs, de leur côté, parlent d’une gestion « au plus juste ».
Et il y a plus encore :
Bol.com s’est dotée en 2014 d’un logiciel de gestion des ressources humaines extrêmement performant, baptisé ISABEL. Il permet à la société-mère de garder un contrôle centralisé et en temps réel de chaque ouvrier et de chacune des entreprises sous-traitées. C’est l’algorithme qui calcule et prévoit le nombre d’ouvriers qui doivent être « mis en stock » dans les campings et autres logements patronaux, et de ceux qui doivent donc être fournis toutes les semaines par les entreprises de recrutement dans les pays d’origine.
Surtout, le logiciel ISABEL gère globalement les ressources humaines de tout ce dense maillage d’entreprises en sorte d’assurer la disponibilité de la main-d’œuvre, en intégrant dans son algorithme les variables individuelles de chaque travailleur : sa nationalité, son statut d’emploi, ses conditions de logement, ses compétences, sa productivité, son respect de la discipline (ponctualité, absentéisme), etc. Grâce à ses informations, l’algorithme organise les plannings, attribue les heures de travail à chaque travailleur individuel, décide des licenciements ou menace avec des warnings.
Brave New World, comme disait l’autre…
franz himmelbauer pour Antiopées, le 3 mars 2024.