- J.D.D. : Luca Salza, tu es professeur d’italien à l’université et tu as une formation en philosophie. Tes premiers livres ont une empreinte fortement italienne, qui témoigne d’un attachement à tes origines et à la tradition littéraire. Tu as écrit notamment sur Giordano Bruno, Lucrèce, un livre sur Naples à l’époque du Baroque et des Lumières, ta ville natale. Mais depuis quelque temps tu sembles déserter un peu ton champ disciplinaire, et te pencher sur l’actualité. Après un livre politique, La fin du monde, paru en italien et en français [1], tu viens de diriger un livre sur Kafka. Ce livre Kafka, out of joint découle directement des articles de la revue trans-européenne K que tu as créée avec Pierandrea Amato. Peux-tu nous dire deux mots de cette revue ?
- L.S. : La revue K est une revue électronique intégralement en libre accès et de type monographique [2]. Elle s’articule autour d’une figure littéraire (Antigone, Médée, Pinocchio) ou d’un personnage historique (Kafka, Spartacus, Marilyn Monroe, Giordano Bruno, Lucrèce, Rosa Parks, Malevitch, Chaplin). Pour nous il s’agit dans tous les cas de « personnages conceptuels ». On reprend cette notion de Deleuze et Guattari. Les philosophes (on peut penser au Socrate de Platon, au Momus d’Alberti…), les écrivains (on peut penser au Bartleby de Melville, au colonel Chabert de Balzac…) créent ces personnages pour faire avancer leurs propres idées. Nous abordons ces divers personnages comme le devenir ou les sujets d’une question théorique. Cette question est le fondement philosophique de la revue. C’est la question de la destitution. Les numéros sur Antigone ou Kafka, dans cette optique, sont l’expression du même questionnement : nous travaillons sur les pièces de théâtre qui d’Euripide jusqu’à Brecht traitent d’Antigone ou sur la vie et l’expérience d’écriture de Kafka, car nous voulons parler, à travers eux, du « pouvoir destituant ». Nous ne voulons pas travailler sur Kafka ou sur la réception critique d’Antigone ou de Médée (même si parfois nous avons recours aux spécialistes, comme il nous est arrivé de le faire avec Eva Cantarella ou Florence Dupont), mais nous voulons travailler avec eux, en nous posant les mêmes questions que soulèvent les textes qu’ils écrivent.
- Le nom de la revue, K, fait-il référence directement à Kafka ?
- K, le titre de la revue, est une lettre. Une lettre comme une autre. La revue aurait pu s’appeler Z ou A aussi. On ne voulait justement exprimer aucun contenu, aucune idée précise dans le titre de la revue. Une lettre — la base, l’atome, pour reprendre Lucrèce — d’un discours entièrement à bâtir. En ce sens K est une lettre pour une autre, qui ne dit presque rien. Évidemment la lettre K peut aussi être entendue, dès le début, comme une référence à Kafka.
Dans une société de l’hyper-surveillance, où nous sommes constamment sous les lumières du pouvoir, cette lettre simple, sans histoires, implique la nécessité de se défendre, comme l’écrivain pragois, en dissipant son identité dans l’anonymat, c’est la tentative de répondre par l’absence à la mobilisation permanente à laquelle nous sommes appelés. C’est, en somme, une manière de faire face à la catastrophe dans laquelle nous sommes, en écrivant, en continuant à écrire.
- Tu dis que « nous sommes dans la catastrophe ». Que faut-il entendre par là ? La catastrophe dont tu nous parles est-elle naturelle ou humaine ?
- Dans une note de son journal, Kafka écrit : « Celui qui, vivant, ne vient pas à bout de la vie, a besoin d’une main pour écarter un peu le désespoir qui lui cause son destin, mais de l’autre main, il peut écrire ce qu’il voit sous les décombres ». C’est l’image d’un champ de bataille ou d’une ville ravagés par la « guerre de matériels ». Avec Franco Fortini, je partage l’idée que le désespoir de Kafka n’est pas purement métaphysique ou existentiel, qu’il est un contrecoup de la situation historique, notamment de la Grande Guerre que Kafka, contrairement aux jeunes gens de sa génération, ne fait pas, mais subit quand même. Kafka est un écrivain de guerre. Il n’écrit pas sur la guerre, mais il écrit sous sa pression, dans son horizon : il la sent à ses côtés et il la vit. Il en sort plus ou moins indemne et il essaie alors d’en témoigner. Que peut-il en dire ? Rien, ou pas grand-chose : « Je me tais la plupart du temps, je n’ai rien à dire, au milieu de ces gens, la guerre ne me suggère pas la moindre idée digne d’être exprimée », écrit-il. Son écriture devient un carottage du sol. Y a-t-il quelque chose sous les ruines ? L’écriture de Kafka, fragmentaire, incomplète, in-finie et infiniment insaisissable est le constat de ce désastre ; ou plutôt, elle est la « prophétie » (au sens que Bourdieu donne à ce terme) de cette catastrophe. L’écrivain devient un « voyant », car il voit quelque chose en fouillant sous terre tout ce que l’histoire a laissé par terre. Il traverse les terres dévastées comme s’il était ahuri par les dommages causés par les explosions et par toute la violence du monde, à la recherche de quelques restes. L’écriture de Kafka est la traversée de ce monde détruit.
Notre intérêt pour Kafka naît sur ce terrain. Kafka comprend tout de suite que la guerre en cours est un tournant majeur de l’histoire humaine, car les désastres qu’elle engendre lui confirment l’idée selon laquelle le monde ancien n’est plus : la littérature, l’art, la culture ont explosé sur les champs de bataille. Aussi pouvons-nous dire avec lui que la catastrophe, notre catastrophe, est essentiellement historique.
La catastrophe n’est plus un événement naturel. La catastrophe n’est pas ou n’est plus un « désastre brusque et effroyable », comme l’indique le Dictionnaire historique de la langue française (remarquons au passage que le mot assume cette signification, dérivée de son emploi dans la dramaturgie antique, comme fin ou dénouement de l’intrigue, seulement à partir de 1690, en plein essor du capitalisme !). La catastrophe est, en reprenant des thèmes de Benjamin, la « règle », et non pas une « exception », non pas un « événement imprévu et brusque ». La catastrophe est l’histoire humaine même. Le XXe siècle est un « âge des catastrophes » (Hobsbawm) puisque les ruines de l’histoire touchent véritablement le ciel. Kafka voit cette catastrophe générale et généralisée. Nous l’étudions justement parce qu’il nous offre une théorie et une pratique (une écriture) de cette situation, qui est une situation post-historique.
- Qu’apporte de plus le support papier par rapport à la revue électronique ?
- Nous sommes des humanistes, nous aimons le papier. Nous sentions le besoin de sortir de la « nuée » d’internet. La revue électronique ne suffit pas, nous voulions un objet pour nous rassembler et pour essayer de trouver un lieu où rassembler les gens autour de notre projet. Cet objet c’est le livre, un livre. Ce lieu c’est une librairie ou une salle autogérée…
Les livres que nous publions dans notre collection chez Mimesis (« Samsa. Écritures pour le destituant », la référence à Kafka est ici indéniable !) sont toujours liés au travail que nous faisons dans la revue. Le premier numéro de notre revue portait sur Kafka. C’était en 2018. Aujourd’hui, en 2023, nous publions ce livre Kafka out of joint. Nous concevons cette collection papier comme une sorte de contrecoup théorique, aussi politique, des numéros en ligne. La collection papier « Samsa » ambitionne d’approfondir, de continuer le travail de la revue, même de trouver d’autres chemins. En effet, dans ce volume on a publié des textes importants inédits. Je pense aux essais de Michael Lowy, de Seloua Luste Boulbina, de Gianluca Solla, de Roman Dominguez, de Stéphane Hervé. On a fait ensuite un travail de sélection sur les travaux déjà publiés, non pas pour choisir les meilleurs textes, mais parce que le projet du livre est un peu différent de celui du numéro de la revue. Dans la revue, nous nous sommes concentrés plutôt sur la question de l’écriture chez Kafka alors que dans le livre nous insistons davantage sur les questions politiques.
- Envisagez-vous, Pierandrea Amato et toi, de publier d’autres numéros de la revue K en livre ?
- Ce livre sur Kafka est le deuxième de la collection. Nous avons déjà publié un livre sur Lucrèce : La destitution de la nature. Sur Lucrèce [3]. Alain Naze a fait une belle recension de ce livre [4]. Le prochain livre sera un livre collectif sur la question du « pouvoir destituant ».
- Le titre Kafka out of joint a une résonance anglaise. L’expression anglaise out of joint évoque l’idée de déboîtement, de dérèglement, de perturbation. Le titre lui-même m’inspire deux interprétations : 1) Ou le dérèglement est l’opération faite par les herméneutes/interprètes de Kafka (Marthe Robert, Max Brod…) qui ont fait éclater l’écriture de l’auteur, en l’installant dans les chemins qui ne mènent nulle part : ceux du mysticisme, de la transcendance et du psychologique ? 2) Ou les portraits dressés par les herméneutes ont manqué justement le côté « chaotique » de Kafka. En ce sens, ton titre serait plutôt une allusion aux analyses de Derrida sur Hamlet, qui entendait faire parler autrement l’œuvre de Marx en la croisant avec celle de Shakespeare. Il s’agirait ainsi de mettre l’accent sur la dimension intemporelle, intempestive de l’œuvre de Kafka, un auteur qui peut nous aider à interroger n’importe quelle actualité. Ce serait justement parce que Kafka « sort de ses gonds », de son époque, qu’il peut traverser les siècles et être notre contemporain, un siècle après sa mort. Une de ces lectures te semble juste ?
- La deuxième lecture ! que tu présentes déjà de manière exhaustive. Effectivement la phrase « out of joint » est une citation de Shakespeare. Faire sortir Kafka de ses gonds signifie essayer de le conduire hors de son temps, hors de son œuvre, hors de sa culture, hors de sa langue. Avec Brossat nous voyageons jusqu’en Palestine ! « Kafka out of joint » est pour nous le refus inconditionnel et inconditionné de la part de Kafka d’une frontière, d’une patrie (des lettres). Sa Prague est n’importe quelle ville-monde qui échappe à sa propre nation, à sa propre histoire, à une tradition, à une langue. Kafka devient alors entre nos mains le nom de la catastrophe sublime de ceux qui en habitant leur propre maison habitent toujours ailleurs ; loin, très loin. Si aujourd’hui nous devions imaginer un écrivain plus que tout autre allergique à toute forme de nationalisme, de patriotisme, d’identification à une culture et à une terre, voire à une langue, nous penserions à Kafka. Son écriture de la disparition, l’auto-dissolution de soi dans le tourbillon des mots et des absences, nous permet d’imaginer qu’être clandestin, mineur, réfugié, encerclé, est la position la plus appropriée pour habiter la catastrophe en trouvant des mots, des babils, des situations, des silences, pour la reconnaître et s’y opposer.
- Ce qui frappe, c’est l’hétérogénéité des textes utilisés, ce ne sont pas que des articles. Il y a un par exemple d’Alain Brossat un essai-fiction, un entretien avec la philosophe Judith Butler. Ton propre article est une écriture en fragments, « disloquée » (à l’image d’une fuite). Qu’est-ce qui a déterminé ce choix ? As-tu imposé une ligne de conduite aux contributeurs ?
- Je n’impose rien à personne ! On a élaboré un texte collectif, une sorte de plateforme théorique autour de laquelle on a appelé des amis, des amis d’amis à participer à ce projet de livre. Le cœur pulsant du livre est la tentative d’offrir une lecture déterritorialisée et déterritorialisante des écrits de Kafka. Tu as raison de souligner l’hétérogénéité des styles et des genres présents dans le recueil. Nous ne voulions pas organiser un livre forcément homogène avec des articles universitaires « classiques ». Le livre se compose alors comme une sorte de montage entre des pièces, des écritures différentes, autour de cette même problématique. Je pourrais entrer dans les détails de chaque texte, mais ce serait trop long. Le texte d’Alain Brossat que tu cites est par exemple un texte étonnant. Alain Brossat, philosophe de la politique, a écrit un papier proprement littéraire, très beau, délicat, en répétant le geste de Kafka. Il affronte une question décisive, à savoir le rapport de Kafka avec le sionisme. Selon un grand nombre de commentateurs, Kafka aurait trouvé la communauté qu’il cherche depuis toujours, il aurait identifié cette communauté. Ce serait le sionisme. On sait qu’il ne réalisera pas son voyage vers la Méditerranée. Or, Brossat imagine un texte où Kafka émigre effectivement en Palestine. Et il nous montre ce qui se serait passé. Kafka reste étranger à toute communauté.
- Quelle est la problématique que vous vouliez développer dans ce livre ?
- J’ai dit trop rapidement que ce livre veut offrir une lecture déterritorialisée et déterritorialisante des écrits de Kafka. J’essaie maintenant d’être plus clair. Comme l’ont montré Deleuze et Guattari, chez Kafka tout est politique, tout est collectif, depuis le conflit entre pères et fils, qui n’est pas œdipien, mais représente le germe d’un programme politique, jusqu’à ses énonciations : son style indubitablement individuel passe à l’énonciation collective parce que la littérature en vient à assumer cette fonction, devenant potentiellement révolutionnaire. La machine littéraire anticipe la machine révolutionnaire à venir puisqu’elle seule peut remplir les conditions d’une énonciation collective, cette littérature devient l’affaire du peuple.
Aussi les textes de Kafka posent-ils les jalons d’une révolution, d’une communauté à venir, d’une communauté qui n’existe pas encore. Existera-t-elle un jour ? Ce volume collectif voudrait démontrer surtout une chose : Kafka dessine une communauté qui ne se matérialise jamais entièrement. Une communauté négative, la communauté des déserteurs, des sans-patries, des migrants, de celles et ceux qui souffrent, de celles et ceux qui n’ont pas de communauté. Une communauté impossible. À ce propos Bataille, notamment, parlait d’une communauté de ceux et celles qui n’ont pas de communauté. C’est-à-dire de ceux et celles qui inventent une communauté pour qu’elle puisse, comme un éclair, disparaître, s’évanouir, et pourtant survivre — dans l’écriture selon Kafka (ou bien dans les images, pour quelqu’un comme Pasolini) — à son propre naufrage.
- Tu dis dans l’introduction du livre : « son écriture refuse en effet, à l’extrême, une frontière, un indice symbolique, un canon, une patrie (des lettres). » Y a-t-il un rapport avec son geste de brûler son œuvre ? Tu dis aussi : « si aujourd’hui nous devions imaginer un écrivain plus que tout autre allergique à toute forme de nationalisme, de patriotisme, d’identification à une culture et à une terre, voire à une langue, nous penserions à Kafka ». Que conteste Kafka ? La société, le pouvoir, l’existence ? Autrement dit, de quoi Kafka est-il le nom ?
- En effet, l’écriture de Kafka nous montre comment il est possible de configurer une politique, une politique sans sujet, un refus radical, une puissance de destitution « réduisant à l’insignifiant tout pouvoir déjà organisé, suspendant toute possibilité de réorganisation ». La politique de la littérature, selon Kafka, est ce pouvoir de contestation : « contestation du pouvoir établi, contestation de ce qui est (et du fait d’être), contestation du langage et des formes de langage littéraire, enfin contestation d’elle-même comme pouvoir » (Blanchot).
Ce pouvoir de contestation est un pouvoir destituant car les personnages de Kafka ne s’opposent à rien. Ils sont confrontés à des mécanismes de pouvoir puissants, ils n’y font pas face. Josef K. dans Le Procès subit diverses formes de vexation, il ne se pose jamais dans une posture résistante. Ce qui ne veut pas dire que Kafka défend l’état actuel des choses. Ses personnages ne résistent pas, ils n’entrent pas dans une relation dialectique avec les différents pouvoirs, ils tentent plutôt de se tenir à l’écart, c’est-à-dire de préserver une forme de liberté, d’autonomie. Ils demeurent alors dans le désœuvrement le plus complet. Ils ne disent même pas « non ». Il n’est jamais question chez Kafka d’une puissance d’affirmation, ou d’une forme d’opposition. Je parlerai plutôt d’une désertion « pure ».
- « Je suis le seul à déserter de temps en temps ». Tu cites cette phrase de Kafka en exergue de l’article que tu as écrit dans le recueil. Que représente cette phrase pour toi ? Comment la comprends-tu ?
- Je pensais précisément à cette phrase quand je répondais à la question précédente. Kafka est un déserteur : sans concessions, profondément radical, il nous dit que pour vivre, pour tenter de vivre, pour créer, pour tenter de créer, il faut déserter, il faut tout abandonner. Que faire dans la catastrophe ? La désertion est précisément la seule manière de se tenir dans la catastrophe. Une pratique de la catastrophe. La désertion de Kafka est « pure » dans le sens qu’elle est « absolue ». Kafka ne concède rien au monde dans lequel il vit. Toute sa recherche consiste à trouver des issues possibles, des sorties de secours, pour « abandonner » le monde. Évidemment, on ne peut pas déserter toujours, aussi devons-nous « décrocher » de temps en temps, devons-nous nous éloigner de nos obligations, des injonctions du pouvoir, devons-nous lâcher prise. Kafka nous apprend à vivre, à créer dans ce mouvement d’abandon. Dans la désertion, il y a l’odeur et les paysages des déserts. Kafka erre dans les déserts. Une fois là-bas, Kafka sait qu’il doit lutter à la fois pour faire de ce dehors un autre monde et pour faire de cette errance le principe, l’origine d’une liberté nouvelle. Il lutte pour soi-même et pour cet autre monde. Pensons un moment au protagoniste du Château. Pendant tout le livre, il semble vouloir obtenir sa place dans les enceintes de la ville. En réalité, K., l’arpenteur, ne veut à aucun moment s’installer dans la communauté du village, il continue de vaguer sous le Château. K. est l’homme des seuils. Il dit à Olga qu’« il y a des portes qui donnent accès ailleurs, des barrières qu’on peut franchir si on est assez adroit ». Dans les dernières pages du roman, il parvient même à entrer dans les salles du Château non pas pour y habiter, mais pour dénoncer sa situation. Cela est important. Son errance solitaire le soustrait au destin de vaincus et de soumis des autres habitants du village, de tous « ceux qui sont nés quelque part » et y restent toute leur vie.
- Tu as une conception assez étrange de la désertion. On dirait que tu donnes une valeur positive à la désertion, alors que d’ordinaire elle a une valeur négative puisqu’elle désigne un manquement envers l’État et la Nation. N’as-tu pas peur qu’on te reproche ce dévoiement !
- Le déserteur est proprement inhumain. Un homme/une femme devient littéralement un « monstre » quand il/elle se soustrait aux mobilisations en cours, aux appels de la Patrie et de la Nation, quand il/elle abandonne la collectivité. L’enjeu de la désertion est là, comme le sens étymologique nous le signale aussi. « Désertion », du latin « desertare », dérivé de « desertus », participe passé de « deserere », « abandonner ».
Durant une guerre, cet abandon est tout à fait impardonnable. Le déserteur perd son nom, sa famille, son genre (pensons à l’histoire de Paul Grappe), son travail, ses amis : en se cachant, en fuyant ailleurs il finit par sortir de l’humanité. C’est la raison pour laquelle on peut le tuer « comme un chien ». Permets-moi de citer une page admirable de Jean Giono racontant la marche vers l’exécution d’un déserteur. Aux yeux des officiers, ce déserteur est le vrai ennemi, bien plus dangereux que les ennemis d’en face, il n’est plus un homme : « Ainsi, quand au terme de son effort on apporte au pacifique le poteau, la corde et le bandeau pour les yeux, il est seul. Voilà un soldat qu’on n’a pas l’habitude de combattre. Pour les douze soldats de métier qui sont en face de lui, ils vont le fusiller avec plaisir parce qu’il est effrayant et qu’il leur fait peur : on ne peut pas savoir d’où viennent les ordres auxquels cet homme seul obéit ; on ne peut même pas être certain qu’il obéit à des ordres (…). On s’occupe de lui comme d’une chose extrêmement importante et grave. Et ça se sent tout de suite que c’est en effet important et grave, car, ainsi immobile, attaché, et peut-être même déjà les yeux cachés, il est effrayant ; et les soldats de métier se rendent bien compte tout de suite par un instinct militaire qu’il n’y a pas d’ennemis plus dangereux pour eux que cet homme seul, prisonnier et muet. Plus dangereux que les soldats de métier du parti adverse. Ceux-là sont dans les jeux ; il y a des règles et il ne s’agit que de bien connaître son métier ou ses patrons. Mais celui-là menace d’en dehors du jeu, des règles et des patrons. Ils ne seraient pas éloignés de croire qu’il est une sorte de monstre. Sa liberté aussi les effraye ; c’est pourquoi ils vont le tuer avec plaisir » (Recherche de la pureté, 1939). Le déserteur fait peur, car il se situe en dehors des règles, de la guerre, des chefs, de soi-même. Il se tient toujours dans un entre-deux, toujours à la limite, entre mondes différents et incompatibles, il dépasse ainsi la logique ami/ennemi et même les limites entre l’humain et le « monstrueux ».
- Un homme/une femme qui déserte, qui fuit sans cesse et qui en même temps construit, est-il/est-elle celui/celle qui cherche à se libérer de toute communauté ou prépare-t-il/t-elle au contraire son entrée dans une autre sorte de communauté ? L’image du désert est-elle synonyme d’échec à migrer ? Le désert est-ce une métaphore du nihilisme ?
- La désertion est forcément un geste solitaire. Giono le montre assez bien. On peut penser aussi à la figure du déserteur chez Lussu, Giovanni Marrasi, qui ne parle même pas en italien, pour signifier sa solitude extrême par rapport à ses compagnons de malheur. On est forcément seul quand on quitte son monde et on s’éloigne dans le désert, comme le fait Marrasi qui devient un petit point noir qui essaie de fuir péniblement entre les deux tranchées en guerre. Chez Kafka, selon moi, on retrouve cette même volonté de se tenir à l’écart, de rester seul. Quelle est son attitude face à la guerre ? Quand l’Allemagne déclare la guerre à la Russie, le 2 août 1914, Kafka écrit dans son journal qu’il s’en va à la piscine. Voilà la portée de sa désertion : cette affirmation exprime son refus radical, son éloignement de l’histoire, son abandon. Il y a des personnages que Kafka crée qui expriment très bien cette volonté de refus radical du monde. Je pense par exemple au « virtuose de la faim » qui arrive à disparaître totalement pour rester éloigné du monde. Cet artiste est évidemment seul, personne ne se rend compte de sa mort. Mais le problème pour Kafka est aussi de penser une « fuite générale ». Le « saut qualitatif » d’une expérience individuelle à une aventure collective, pour ne pas dire politique, n’est absolument pas évident. Or, je pense que l’importance de la littérature se trouve précisément là : la machine littéraire prend le relais d’une machine révolutionnaire puisque seule la littérature, cette littérature de la désertion, de la « faim », peut remplir les conditions d’une énonciation collective, peut, en somme, créer un peuple.
- On a bien compris que Kafka ne parlait pas au nom d’une communauté comme la communauté juive. Il dit lui-même dans son journal (8 janvier 1914) : « Qu’ai-je de commun avec les Juifs ? C’est à peine si j’ai quelque chose de commun avec moi-même et je devrais me tenir bien tranquille dans un coin, content de pouvoir respirer », mais peut-on vraiment renoncer à son identité ?
- La citation nous rappelle le refus que Kafka exprime envers toute communauté constituée. Mais je ne sais pas s’il renonce vraiment à son identité juive. Il la traverse, la contamine avec d’autres cultures, tout en y restant enraciné. Dans notre livre nous nous demandons, d’une part, ce qu’est cette culture. D’autre part, nous nous demandons s’il est légitime de superposer cette culture juive si particulière de la Mitteleuropa au projet sioniste.
Pour répondre à la première question, je renvoie au texte de Michael Löwy. Il s’interroge sur la genèse du Procès. Selon lui, on peut penser que Kafka écrit ce roman, car il est frappé par des procès injustifiés contre des Juifs qui témoignent de l’antisémitisme. À partir de 1910, suite à sa rencontre avec le théâtre yiddish et son amitié avec l’acteur Itzhak Löwy, Kafka s’est pris d’un intérêt grandissant pour le judaïsme, la culture yiddish et le sionisme — et qui se traduit, entre autres, par l’envoi de ses écrits à des publications juives comme Selbstwehr (la revue des sionistes pragois) ou Der Jude (la revue de Martin Buber). Cependant, Kafka a compris ces procès non seulement en tant que juif, mais aussi en tant qu’esprit universel : il découvre dans l’expérience juive la quintessence de l’expérience humaine à l’époque moderne. Dans Le Procès, le héros, Joseph K., n’a pas de nationalité ou religion déterminée : le choix même d’une simple initiale à la place du nom du personnage renforce son identité universelle : il est le représentant par excellence de toutes les victimes de la machine légale de l’État. On pourrait dire que la culture juive a de l’intérêt pour Kafka, car il y a cette possibilité de devenir universelle, commune à tous ceux, à toutes celles qui se trouvent dans une situation de précarité, de souffrance et veulent en sortir. En cela, on peut expliquer le rapport entre la culture juive — apatride, anationale, c’est-à-dire contre les patries, contre les nations, contre les États — et les cultures politiques révolutionnaires du XIX et XXe siècles.
Pour répondre à la deuxième question je renvoie à l’entretien avec Judith Butler. Il est bien connu qu’après la mort de Kafka, son ami Max Brod a rassemblé et protégé ses manuscrits, avant de fuir vers Israël pour éviter l’extermination nazie (il meurt à Tel-Aviv en 1968). Après cela, les manuscrits ont été confiés à la secrétaire de Brod, Esther Hoffe ; Brod lui avait en effet demandé de faire don des œuvres de Kafka à des archives publiques. Une partie d’entre elles a fini dans les Archives littéraires allemandes de Marbach. Plus tard, les Archives ont essayé d’acheter aux filles d’Ester Hoffe les derniers manuscrits que Max Brod avait laissés à leur mère. À partir de 2007, cette demande a déclenché une série d’actions légales impliquant les Archives de littérature allemande, la Bibliothèque nationale d’Israël et les filles de Hoffe, chaque partie prétendant à l’héritage de Kafka — un héritage bien particulier et aporétique, rendu impossible par Kafka lui-même, puisqu’il avait confié à Brod ses propres manuscrits en lui demandant de les détruire.
En juin 2015, après quatre-vingt-dix ans de vicissitudes, de relocalisations et de ventes, trois juges du Tribunal de district de Tel-Aviv décident que les manuscrits de Kafka sont la propriété de la Bibliothèque nationale d’Israël.
Les juges écrivent dans leur verdict : « En ce qui concerne Kafka, la mise en vente publique au meilleur offrant de ses écrits personnels — dont il avait ordonné la destruction — de la part de la secrétaire de son ami et de ses filles peut-elle être en accord avec la justice ? La réponse à cette question s’avère claire ». Dans un contexte de controverse entre des acteurs privés et une institution culturelle allemande, les juges israéliens ont finalement transformé la “mauvaise gestion” de Hoffe et son enrichissement en une justification de la nationalisation de Kafka.
Ici intervient Judith Butler. En 2011 — alors que le procès était en cours, et son issue encore inconnue — elle écrit un essai « Who owns Kafka ? », publié dans la London Review of Books. Qui possède Kafka ? À qui appartient-il ? Que signifie la transformation en héritage national israélien des écrits d’un auteur qui semble avoir constamment essayé de produire une poétique diasporique, connotée par la non-appartenance et l’absence de racines ? Comment la nationalisation des œuvres de Kafka par Israël coexiste-t-elle avec l’ambivalence de cet auteur envers le projet politique sioniste ? Quels sont les objectifs et les suites politiques de la transformation de ses écrits en propriété d’État ? Butler revient sur ces questions dans l’entretien que nous avons eu avec elle, inédit en français.
- Le recours à l’animalité est fréquent chez Kafka, on pense à La Métamorphose, est-elle une diminution de l’homme ?
- Il est indéniable que pour Kafka la question du rabaissement du statut de l’homme est une question centrale obsédant son existence même. Cette diminution est si aiguë qu’elle transforme l’humain en animal. Insectes, singes, chiens… l’homme chez Kafka entre dans différentes métamorphoses. Il ne s’agit nullement de métaphores, ce ne sont pas des images, mais c’est la réalité de nos vies dans nos sociétés où l’on devient vraiment des animaux : « Spectacle de va-et-vient de fourmis qu’offre le public massé devant et dans les tranchées » (Kafka). Sous les bombes, au milieu d’un orage d’acier, dans l’air empesté par les gaz que peut-on faire ? Se faire tout petit, creuser un trou, essayer de vivre sous terre, se cacher le mieux possible. La taupe — comme le signale Miglino — est un des animaux dont il est le plus question dans les pages de Kafka. Déjà en 1904, dans une lettre à Max Brod, il identifie les hommes à ce petit mammifère : « Telle la taupe, nous nous frayons une voie souterraine et nous sortons tous noircis, avec un pelage de velours, de nos monticules de sable écroulés, nos pauvres petites pattes rouges tendues en un geste de tendre pitié ». Kafka raconte ensuite à son ami qu’un jour, lors d’une promenade, son chien a attaqué une taupe qui essayait de traverser la route et « qui, désespérément et en vain, cherchait un trou dans le sol dur de la route. Mais comme le chien abattait de nouveau sa patte sur elle, elle s’est mise à crier. Ks, kss, a-t-elle fait. Et alors il m’a semblé… Non, il ne m’a rien semblé du tout. Ce n’était qu’une illusion, parce que ce jour-là ma tête tombait si lourdement que, je le constatai le soir avec surprise, mon menton s’était enfoncé dans ma poitrine ». Kafka devient une taupe, car il sent ce que c’est que d’être une taupe. Il ne rit plus quand il entend le cri de la taupe, il souffre avec elle (Elias Canetti). La taupe réapparaît dans les pages du Journal de Kafka, quand il parle du retour de son beau-frère du front et de la rencontre de ce dernier avec une taupe au moment de l’explosion de sa tranchée. Les soldats deviennent des taupes puisqu’ils souffrent, ne parlent pas, ils vivent dans des dédales de galeries souterraines, les cavernes ou les tranchées. La taupe est également le protagoniste et le narrateur d’un des derniers récits écrits par Kafka, le Terrier. Rédigé pendant l’hiver 1923-1924, selon le témoignage de Dora Diamant, la compagne de l’écrivain à cette époque, il aurait été écrit d’une seule traite, au cours d’une nuit, en décembre 1923. L’histoire est racontée à la première personne par un narrateur dont on sait très peu de choses, c’est une créature qui possède des caractéristiques à la fois humaines et animales (une taupe et un architecte). Le titre en langue originale, qui a été établi par Max Brod qui publiera ce texte, remanié, après la mort de l’auteur, est « Der Bau », quand on le traduit par « le Terrier » on perd quelque chose, comme l’indique Jean-Pierre Lefebvre. « Der Bau » en allemand désigne d’abord « une construction » et l’opération même de la construction. Le narrateur est, en effet, un constructeur : au début du texte, il annonce l’achèvement de sa tanière, un système extrêmement élaboré de tunnels, de longs couloirs labyrinthiques, de ronds-points, d’une place centrale, de grands tunnels et d’une forteresse. La seule connexion avec le monde extérieur, la porte de sortie, est cachée et recouverte. Le narrateur, seul habitant de la tanière, vit heureux sa vie solitaire, occupé, comme il l’est, jour après jour, aux petites réparations nécessaires et aux diverses améliorations de son terrier. Et pourtant, malgré tous ces expédients, il vit dans la terreur constante d’être attaqué par un ennemi mystérieux et invisible qui semble vouloir envahir son refuge. Pour tenter d’éviter une telle intrusion, il commence à construire divers passages qui ne mènent qu’à des impasses. Il transforme de plus en plus la tanière en un labyrinthe en zigzag, toujours à la recherche de nouvelles idées pour agrandir sa maison dans la complexité et la rendre de plus en plus sûre. Un jour, il commence à entendre un son mystérieux, qu’il décrit comme un « sifflement ». Il pense, d’abord, qu’il s’agit de petits animaux qui se cachent autour de sa construction. Il fait des recherches en construisant d’autres tunnels pour retrouver la source de ce bruit, mais le sifflement ne s’arrête pas si bien que la recherche du protagoniste devient de plus en plus obsessionnelle.
À la fin, il pense qu’il doit y avoir une seule créature terriblement hostile près de son repaire : elle aurait la ferme intention de le tuer. Tiraillé entre la peur et la résignation, il attend en position défensive l’arrivée de l’ennemi. L’histoire est brusquement interrompue par une phrase : « tout est resté sans changement, le ».
- Dans cette nouvelle, ce qui t’intéresse, c’est la dimension politique ?
- Dans ce récit, il n’y a apparemment aucune référence à la guerre à peine finie. Or, comme le signale Miglino, l’histoire de Kafka est aussi la reprise du reportage de guerre de Bernhard Kellermann intitulé Krieg unter der Erde (La guerre sous terre). Les relations entre le récit de Kafka et le reportage de Kellermann sont déjà évidentes à partir de la reprise du vocabulaire technique, sans parler de la métaphore animale et de l’absolutisation de la figure de l’ennemi. C’est seulement après un événement comme la Première Guerre mondiale que la rencontre de l’autre se présente sous le signe de l’inimitié absolue. L’autre est celui que je ne vois pas, il est pourtant à mes portes et il veut me dévorer. On peut quand même se demander pourquoi Kafka ne mentionne aucune arme, aucun engin employé par cet ennemi, contrairement au reportage dont il s’inspire. En effet, le Terrier reprend les détails et la structure du reportage de Kellermann, tout en supprimant toute référence directe à la guerre. L’ennemi, après la guerre, ne peut qu’être un « ennemi intérieur », c’est la raison pour laquelle le texte de Kafka n’entend pas représenter la guerre. De cette guerre ne reste qu’un long monologue avec soi-même. À la suite de ce qu’écrit Freud en 1919, la Grande Guerre produit chez ceux qui ont survécu physiquement aux champs de bataille une sorte d’angoisse dans laquelle ce dont ils ont peur n’est pas la violence extérieure, mais plutôt « l’ennemi intérieur ». Parmi ces angoisses des revenants, il y a certainement la peur d’être enterré vivant, comme en témoigne la petite taupe du récit. Kafka ne parle pas directement de la guerre non pas parce qu’il ne l’a pas faite, mais parce qu’il pense que l’événement qui divise l’histoire moderne en deux ne peut pas être représenté. Le Terrier ne veut pas dire la guerre, il essaie plutôt de traduire en un texte narratif (ou mieux : en un fragment narratif) les moments essentiels du discours collectif né de la guerre elle-même. Le Terrier ne parle pas d’un traumatisme, mais il est la répétition potentiellement infinie de ce traumatisme. Il ressort de l’histoire que la guerre ne peut être « objet », thème d’une construction littéraire traditionnelle, mais qu’elle est un événement épochal produisant de nouveaux discours, changeant radicalement la dimension historique des textes qui en découlent.
Au fait, le Terrier, tout comme Dans la colonie pénitentiaire, est une méditation sur l’écriture dans le désastre. La machine de torture Dans la colonie pénitentiaire est également une machine esthétique, elle produit des ornements. Dans cette perspective, on peut lire la destruction de l’appareil de torture aussi comme la fin de la tradition romantique et bourgeoise. Grâce à cette nouvelle, Kafka démolit l’idée selon laquelle l’écriture est un moyen d’atteindre la vérité et affirme même que l’écrivain, sacrifiant sa propre existence à la littérature, ne se consacre qu’à la torture et à la mort insensée. C’est comme si la guerre donnait une nouvelle conscience aux méditations intarissables de Kafka sur l’écriture, sur l’existence. Presque dix ans après, Kafka, qui n’a jamais cessé de s’interroger sur l’acte d’écriture, revient, avec le Terrier, sur les rapports entre la littérature et la guerre. La taupe n’arrive pas à s’en sortir. D’autres fois, Kafka laisse penser qu’il existe la possibilité d’un « bond hors des rangs des meurtriers ».
- Ton livre est justement placé sous le signe de la désertion, de la fugue, du hasard, du clinamen. J’ai le sentiment que cette question de la fugue, du hasard te hante depuis longtemps. La « désertion » ne travaille pas que Kafka, ne la retrouve-t-on pas sous diverses formes dans la philosophie ? N’y a-t-il pas une histoire souterraine de la désertion qui remonterait de Kafka, à Lucrèce, en passant par Giordano Bruno ?
- La philosophie, selon moi, a un rapport difficile avec la désertion dans la mesure où elle a partie liée avec les pouvoirs, avec l’histoire majeure. Le voyage de Platon à Syracuse, les enseignements d’Aristote restent ineffaçables. Toutefois il y a des philosophes, souterrains, absolument minoritaires, qui ont eu la force de se détourner des États, de leurs classes dirigeantes. Ils sont demeurés cachés. Diogène préfère brûler au soleil, avec ses spectres, plutôt que de pactiser avec le pouvoir en place, comme Kafka l’écrit à Milena Jesenská dans une lettre datée probablement de novembre 1920. La question que pose Diogène (et Kafka avec lui) est celle du refus inconditionnel, ininterrompu. Est déserteur celui qui demeure dans l’abandon : le déserteur est celui qui perd son appartenance et son identité (il y a un devenir animal chez Diogène et chez Gregor Samsa). Le déserteur se jette hors du monde, erre pour toujours dans les déserts. En effet, le problème de la désertion est la mise en question de l’individu même, du self, du sujet. Si l’on ne sort pas de soi, on n’abandonne pas le monde, les pouvoirs, l’histoire, on ne se rapproche pas du désert, de la vérité du désert, on ne va pas toujours plus loin. Vers où ?
« — Où va monsieur ?
— Je n’en sais rien, loin d’ici seulement ! Loin d’ici et toujours loin d’ici, seule façon d’atteindre mon but.
— Tu connais donc ton but ? dit cet homme.
— Oui, répliquai-je, puisque je te l’ai dit ; loin d’ici, voilà mon but ! ».
C’est un fragment narratif de Kafka, intitulé Le Départ. Le but se situe loin, loin, dans les déserts les plus lointaines, sans aucune possibilité d’un nouveau séjour. La désertion est cette « migration infinie ».
Diogène nous fait voir qu’une autre conduite de vie est possible. Sa vie entend échapper à toute capture, à toute emprise. C’est pourquoi la désertion est un mouvement interminable.
Je ne sais pas s’il est légitime d’instituer une histoire, même souterraine, de la désertion. Lucrèce et Giordano Bruno luttent certainement toute leur vie, comme Diogène, pour échapper au pouvoir. Giordano Bruno meurt, car il refuse, contrairement à ce que fera Galilée, d’avouer ses prétendues erreurs devant le Tribunal de l’Inquisition. Il se soustrait ainsi à son autorité, il ne la reconnaît pas, comme Diogène qui ne reconnaît pas le pouvoir d’Alexandre le Grand. Cela étant, ils ne constituent pas une histoire : le récit, la continuité d’un récit se situent toujours du côté du pouvoir. L’histoire est toujours l’histoire des vainqueurs. Lucrèce, qui finit ses jours, selon la malveillante tradition philosophique, fou, Bruno, qui meurt grillé sur la place Campo de’ Fiori à Rome, sont des vaincus, comme Diogène et les autres déserteurs (Leopardi, Blanqui, Bakounine, Nietzsche…). Les vaincus peuvent tout au plus enfoncer des clous dans le socle des statues des grands penseurs. Ils tentent d’affirmer des possibilités inexplorées de l’histoire (vivre sans État, par exemple). Leurs gestes n’entendent pas du tout créer une histoire monumentale, ils se situent dans la discontinuité. Ils font plutôt exploser de temps en temps la continuité de l’histoire. La désertion, en somme, constitue le sujet d’une contre-histoire ou histoire à contre-courant.
En ce qui concerne Bruno ou Lucrèce, leur « audace déserteuse » relève de leur vision du monde. Ils postulent un univers infini, peuplé d’innombrables mondes. Penser l’infini oblige à abandonner toute assise. Il ne peut y avoir aucun fondement dans un monde sans limites, il n’y a aucun centre. Le « sans fond » de l’espace infini est un principe proprement an-archique. C’est un monde multiple, absolument chaotique, où il n’y a plus aucune hiérarchie entre le « haut » et le « bas », aucun primat anthropologique, comme le montre Bruno très précisément :
« Rien ne tient, mais tourne et roule
tout ce qui dans le ciel et sous le ciel se voit.
Toute chose court, tantôt vers le haut, tantôt vers le bas,
que son temps soit long ou bref,
qu’elle soit pesante ou légère ;
et peut-être tout va du même pas
et vers le même point.
Tant qu’il n’est arrivé, court le tout.
Tant le seau tourne l’eau sens dessus dessous,
qu’une même partie, la voilà partie
tantôt de haut en bas, tantôt de bas en haut,
et la même pagaille
à tous assigne le même sort ».Que peut faire l’homme dans cette « pagaille », dans cette « affreuse embrouille » ? Évidemment se perdre. Il doit se perdre, il ne doit revendiquer aucune identité, il doit tout abandonner, il doit accepter l’instabilité et l’infinité des choses de nature. Au nom de cette instabilité et de cette infinité, il doit s’engager dans un processus de transformations incessant. Il doit partir au loin. L’espace de son voyage est maintenant infini. Il peut viser les étoiles et les planètes les plus lointaines. Loin, loin… On peut imaginer cette désertion cosmique en pensant à la séquence finale d’Elephant man (1980) de David Lynch quand le protagoniste en abandonnant peu à peu son corps se laisse emporter sous une pluie (lucrétienne) d’étoiles, au plus profond des choses de la nature, tandis qu’une voix hors-champ (celle de sa mère défunte) dit : « Jamais, oh jamais, rien ne mourra jamais. L’eau coule, le vent souffle, le nuage fuit, le cœur bat… Rien ne meurt ! ».
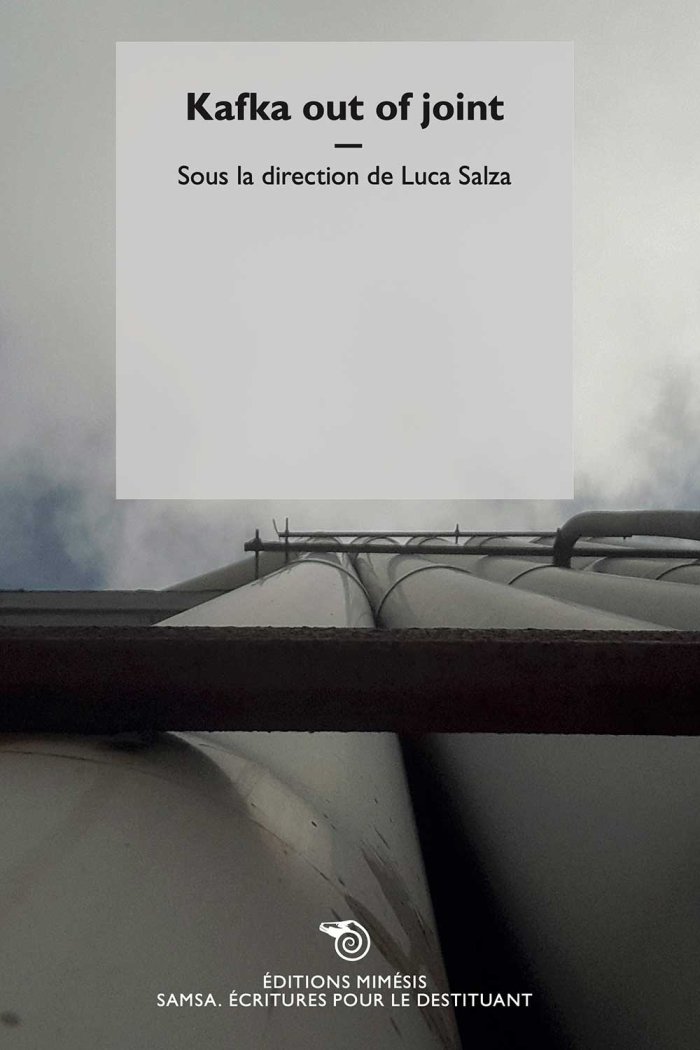
{}






