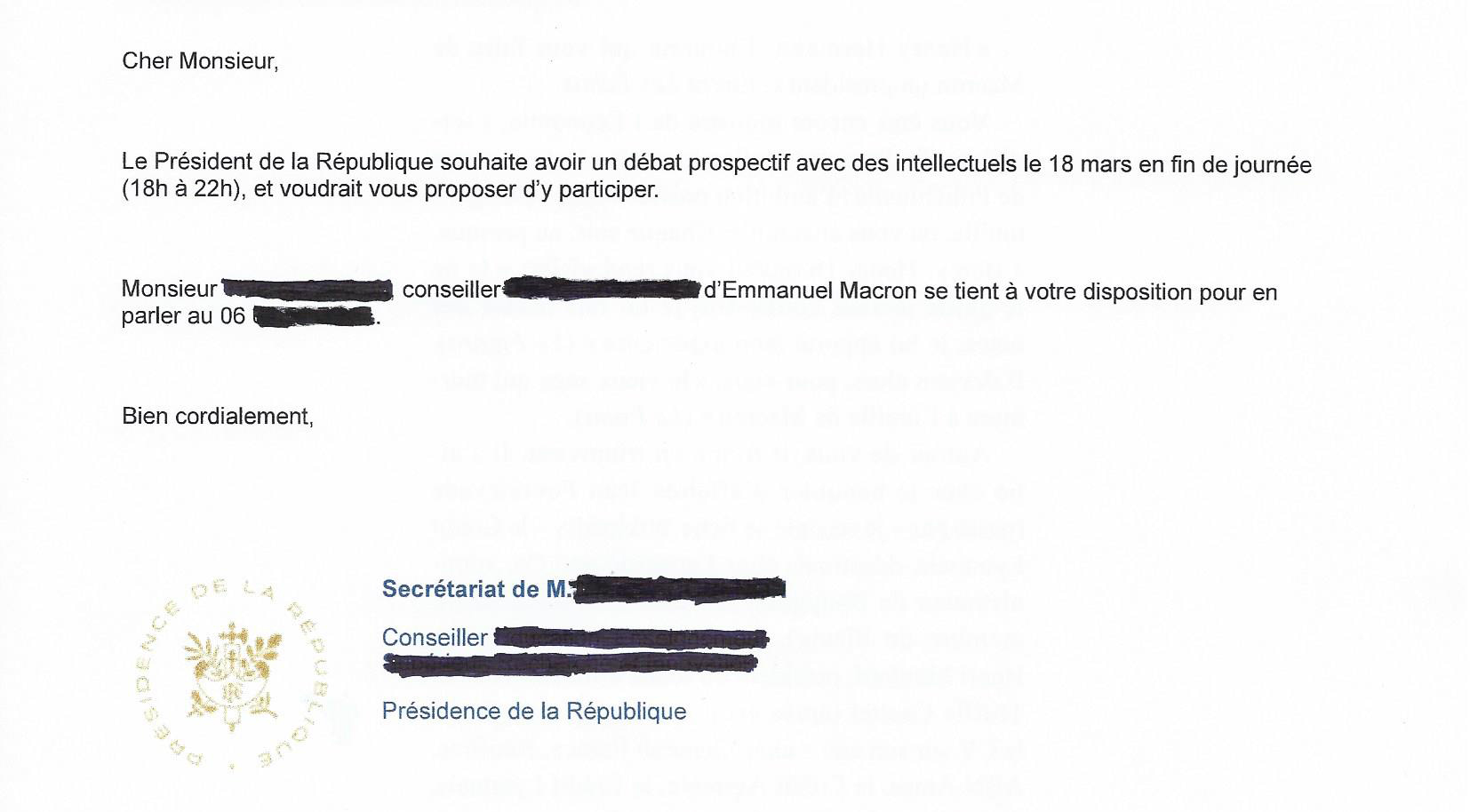Les faits
Au cours du mois d’avril 2025, la presse locale relayée par la presse nationale rapportait une série d’épisodes d’incendies de voitures de gardiens de prisons, d’attaques contre leurs domiciles, de coups de feux tirés sur des portes de prisons. D’Agen à Lyon, de Toulouse à Toulon, de Grenoble à Lille, de Nanterre à Luynes, aux quatre coins de la France des groupes d’individus s’étaient attaqués non seulement à des prisons mais aussi à des agents de la Pénitentiaire, en poste ou en formation. Sur les lieux des attaques, les assaillants avaient tagué un sigle, DDPF, pour Défense des Droits des Prisonniers Français. Un sigle repris par un compte Telegram, rapidement fermé par les autorités, dans lequel on dénonçait les violences quotidiennes exercées par les surveillants sur les prisonniers. « Ce canal est un mouvement dédié à dénoncer les atteintes à nos droits fondamentaux auxquels le ministre Gérald Darmanin compte porter atteinte ». « Contactez-nous par message privé pour rejoindre le mouvement DDPF. Rejoignez le mouvement » [1].
Les interprétations
Après avoir envisagé des actions de l’ultragauche ou des ingérences étrangères (des services secrets russes ou algériens), policiers et procureurs ont conclu que l’hypothèse la plus vraisemblable était la piste du narcotrafic. Ainsi, par une opération à l’échelle nationale, le 28 avril, la police interpellait 30 personnes, parmi lesquelles 21 étaient mises en examen le 2 mai, dont 7 qui étaient déjà détenus. Résumant les conclusions des enquêteurs, Le Monde daté du 4 mai titrait : « Derrière les attaques de prisons, l’ombre de la DZ Mafia et du narcotrafic ». Le journal français de référence reprenait donc les conclusions et les éléments de langage des ministères de l’Intérieur et de la Justice : Mafia, groupes criminels organisés. Tout en relevant que parmi les 21 suspects déférés à la Justice, dont deux femmes et deux mineurs, « pour beaucoup, ils présentent des profils d’exécutants, des petites mains du trafic de drogue ». Aussi, les interpelés vivaient dans la région où ils avaient commis leurs attaques. Le chef présumé du réseau, commanditaire et organisateur des attentats à partir de sa cellule de prison d’Avignon, serait un certain Imran A., âgé de 23 ans.
La vague d’attaques contre les prisons et les agents pénitentiaires auraient donc été commandité par des chefs de la Mafia, des barons de la drogue emprisonnés, et exécutées par des hommes de main, des sicaires, parfois recrutés sur les réseaux sociaux contre la promesse de quelques centaines d’euros. Une stratégie mafieuse visant à intimider l’administration pénitentiaire alors que le Ministère de la Justice s’apprête à mettre en place des prisons spéciales, ultra-sécurisées, destinées à regrouper les narcotrafiquants les plus dangereux.
Les interprétations des policiers, des juges et des journalistes mainstream sont convergentes. Comme pour la Mafia italienne, les Cartels colombiens ou mexicains, aussi en France l’économie souterraine des psychotropes interdits serait contrôlée et dirigée par des chefs, une coupole centralisée, un deus ex machina qui du haut de son organisation pyramidale tire les fils de toutes ses ramifications criminelles.
Narcotrafic
Le terme est parfaitement galvaudé. Il renvoie à un imaginaire peuplé de Pablo Escobar ou d’el Chapo Guzman et popularisé par les séries Netflix sur les narco. Des grands criminels qui se la coulent douce dans des villas tropicales ou dans des lofts à Dubaï. Beaucoup de cinéma, en effet. Si l’économie des drogues illégales ne diffère guère de l’économie capitaliste légale, la réalité de la production, du commerce et de la consommation des dites drogues est beaucoup plus complexe [2]. Si les gros exportateurs et importateurs sont évidemment des millionnaires (avec un capital risque élevé …) et si la vente en demi-gros permet à un certain nombre de personnes d’en vivre aisément, pour la masse des producteurs, transformateurs, livreurs et distributeurs au détail ce n’est qu’un gagne-pain. Un travail souvent pénible et toujours risqué. Les études de sociologues et anthropologues ont bien montré que la masse de paysans cultivant le cannabis au Maroc, la coca en Colombie ou le pavot en Afghanistan, sont des travailleurs agricoles pauvres, ne produisant ces plantes prohibées qu’en vertu d’un meilleur rapport comparé à d’autres cultures possibles dans leurs régions. Quant aux milliers et milliers de personnes qui assurent au jour le jour toutes les tâches du commerce au détail, on pourrait parler d’ouvriers tâcherons. Il y a ceux qui s’occupent du transport, du conditionnement, de la garde de la marchandise. Puis ceux qui, du matin au soir, du lundi au dimanche, par beau temps ou sous la pluie, tiennent un point de deal, et ceux qui font des livraisons à domicile. Outre les contraintes climatiques à tenir le mur de l’immeuble à longueur de journée, tous ces travailleurs du petit commerce de proximité de produits illégaux sont quotidiennement exposés à la répression. Tous les points fixes et durables de deal sont rapidement repérés par la police, qui y effectue des descentes régulières. Ils subissent au quotidien des fouilles, des brimades, des humiliations, parfois des garde-à-vue et finissent par être arrêtés et emprisonnés.
Il faudrait redimensionner le narcotrafic, trop souvent présenté comme un marché colossal aux profits gigantesques. Comparons le comparable. Les services de l’Etat font l’estimation que le chiffre d’affaires annuel des drogues illégales en France serait de l’ordre de 3 milliards d’euros. Soit autant que la Coca Cola, drogue légale et plus préjudiciable pour la santé que certaines drogues illégales. Autant que la Française des jeux, autre drogue légale redoutable pour la santé, aussi financière, des pauvres gens qui s’adonnent au rêve du gain. Un chiffre d’affaires bien inférieur à celui du tabac (20 milliards) et surtout du vin (90 milliards). Autrement dit, à la fin d’une journée de travail il y a beaucoup plus d’argent dans la caisse d’un bar-tabac-pmu que dans les poches des tenanciers d’un « four » de cité.
Cependant, la comparaison la plus pertinente serait avec le chiffre d’affaires des grandes entreprises pharmaceutiques, qui produisent et commercialisent les drogues légales. Le cas le plus emblématique est certainement celui de l’entreprise américaine Purdue Pharma, propriété de la famille Sackler. Au sommet de son ascension, en 2017, elle avait atteint un chiffre d’affaires annuel de 35 milliards de dollars. Engrangés notamment grâce à la vente d’opioïdes, dont l’OxiContin, en principe destiné aux malades de cancer en phase terminale. Sa forte promotion marketing a fait exploser les prescriptions médicales pour toute sorte de douleurs, provoquant aux USA, entre 1999 et 2022, quelques 700.000 morts par overdose. Poursuivie par des milliers de plaintes au pénal, en janvier 2025 la famille Sackler a conclu un accord avec le tribunal pour le versement de 7,4 milliards de dollars d’indemnisations aux familles des victimes.
Guerre aux narcos ou guerre aux negros ?
Jusqu’aux années 1960, la consommation et le commerce du cannabis, de la coca, de l’opium et autres plantes psychotropes, faisaient partie des cultures locales, traditionnelles, coutumières, ancestrales. Comme pour le vin et l’alcool en Occident, cannabis, coca, opium, champignons psilocybes, peyotl, ayahuasca, betel, iboga, quât, amanite muscaire etc., étaient considérés comme des « aidants » dans la vie, comme des « chasseurs de soucis » (Freud), comme des médecines du corps et de son âme. Malgré la conscience des possibles dangers de la consommation de psychotropes, aux quatre coins du monde les populations s’étaient adaptées, avaient appris à vivre avec les drogues. La prohibition des drogues de l’Autre avait commencé par un édit de la Sainte Inquisition de Mexico en 1621, interdisant le peyotl et autres « plantes magiques ». Elle avait fait l’objet de décrets impériaux en Chine aux XVIIIe-XIXe siècle contre l’opium, sans grandes conséquences. Après lesdites « guerres de l’opium » (1839-1856), opposant les puissances occidentales à la Chine pour le contrôle du marché oriental, les Etats-Unis et la Chine lancèrent, au cheval de la première guerre mondiale, les lois de prohibition du commerce illégale de l’alcool (aux USA) et de l’opium (en Chine). Une prohibition du seul commerce considéré illégal, bien entendu, car aussi bien de l’alcool que de l’opium on en avait besoin dans les pharmacies.
En fait, jusqu’aux années 1970, à part les guerres commerciales, la prohibition de la consommation et des consommateurs ne faisait pas partie des priorités répressives des Etats. Les consommateurs problématiques se voyaient regardés avec une certaine bienveillance, parfois assistés par des associations charitables ou par des amis et parents. C’est à partir de la loi promulguée par le président américain Richard Nixon, le 31 décembre 1970, suivi aussitôt par les autres Nations occidentales, que la grande répression s’abat non seulement sur les commerçants mais aussi sur les consommateurs de « drogue ».
Pourquoi ? En déclarant « la drogue » comme le principal ennemi de la Nation et déclenchant la guerre aux trafiquants et aux consommateurs, le gouvernement américain déclarait la guerre à la fois aux minorités raciales (Noirs et Hispaniques) et à la génération hippie. Les uns et les autres considérés dangereux par l’esprit WASP, suprémaciste, viriliste. Avec toutes les conséquences effroyables de cette guerre. Depuis 50 ans, la « guerre à la drogue » a provoqué des centaines de milliers de morts de par le monde, en Amérique latine en particulier, dans des affrontements entre policiers, militaires, trafiquants et bandes rivales, sans compter les innocents tués au passage. Plus, beaucoup plus que les morts par overdose d’héroïne ou d’autres drogues illicites. Sans pour autant mettre fin au commerce ni tarir la demande, car, au contraire, la consommation de psychotropes illicites a explosé dans les dernières décennies.
La « guerre à la drogue » a aussi provoqué depuis 50 ans l’explosion des condamnations des « trafiquants ». Parfois des condamnations à mort sans procès ni sommation, comme dans les Philippines de Duterte ou dans les favelas de Rio, ou des condamnations par un tribunal à la peine capitale, comme en Chine, en Iran, en Arabie Saoudite, aux USA et ailleurs [3]. Mais surtout des incarcérations massives, par millions, presque incalculables. De qui ? D’affreux criminels mafieux responsables de meurtre et d’atrocités, outre que de trafic de drogue ? Bien sûr, mais ce n’est qu’une petite minorité des condamnés à la prison. La grande majorité ne sont que des travailleurs à risque dans cette économie souterraine, délinquants peut-être, mais pas criminels. Condamnés à des peines lourdes, souvent très lourdes par rapport à leurs délits.
Quelle est le profil des condamnés pour trafic de drogue ? L’étude menée par Michelle Alexander sur la population carcérale aux Etats-Unis a conclu que la guerre à la drogue est une guerre raciale et une guerre sociale [4]. Sur les 31 millions de personnes emprisonnées aux Etats-Unis, des années 1980 à la première décennie des années 2000, les afro-américains et les hispaniques représentent la grande majorité des condamnés. Qu’en est-il France, où les condamnés pour trafic de drogue constituent environ 20% des prisonniers ? En dépit de statistiques ethniques disponibles (interdites en France), les origines géographiques des prisonniers sont parlantes. Dans leur grande majorité ils sont issus des cités de Sevran, Aulnay, Nanterre, Champigny, Bagneux, Créteil, pour l’Île de France. Pour Marseille, Grenoble, Toulouse, Lyon c’est la même chose, à savoir qu’ils proviennent de cités habitées fondamentalement par des Noirs et des Arabes.
Qui défend des indéfendables ?
A la lumière de ces plates évidences, certes en contraste avec tant de phantasmes sur le monstre moderne appelé narcotrafic, nous pouvons réexaminer le phénomène des attaques contre l’administration pénitentiaire. Il apparaît que ceux qui s’en prennent aux matons sont des copains solidaires des personnes incarcérées. Porteurs d’un message simple : nos amis en prison ne sont pas seuls, des gens à l’extérieur les soutiennent et essayent de les aider.
Alors, comment expliquer le silence des réseaux sociaux qui normalement prennent position contre les violences d’Etat ? Pourquoi ni les sites de l’ultragauche, ni les comités contre les violences policières, ni les avocats et associations qui défendent les droits des prisonniers (OIP, LDH) ne sont-ils pas intervenus ? Parce que les dealers seraient indéfendables ? Parce que le vin est bon (bu modérément …) et le cannabis, la cocaïne et l’héroïne seraient du poison ?
C’est que même les proches des victimes des violences policières et d’Etat n’osent pas questionner le préjugé des flics : « défavorablement connu par les services de police pour trafic de stupéfiants », ce qui justifie à leurs yeux la répression la plus brutale, jusqu’au meurtre. Parce que dealer est considéré comme honteux, indéfendable. A partir du principe inculqué dans la tête des gens que « la drogue c’est de la merde, les dealers des vendeurs de poisons, sans scrupules, qui empoisonnent la jeunesse ». Bref, des criminels, contre lesquels on donne carte blanche aux forces de police pour les arrêter, coûte que coûte.
Défendre les « drogués », les « dealers », surtout quand ils se révoltent et font face aux pouvoirs étatiques, paraît encore aujourd’hui un combat inconcevable, tant la stigmatisation et la criminalisation ont imposé une pensée dominante et non questionnable. Les gens solidaires qui ont essayé de lancer un mouvement de défense des droits de leurs amis ou semblables reclus dans les prisons, ont osé ce défi. Sous un logo qui en dit long = DDPF (Défense des Droits des Prisonniers Français). Comme un appel un peu naïf à l’état de droit, au respect des prisonniers, soulignant que ces prisonniers sont Français, non étrangers. Il faut comprendre le message : comme le Comité Adama et autres collectifs de défense contre les violences policières, ils demandent à être traités comme des citoyens français, à part entière. Pas comme des personnes discriminées, racisées, infériorisées, criminalisées. Une question d’abord de dignité, de respect, simplement.
Finalement, comment ne pas voir dans cette vague d’attaques contre les gardiens de prison des actions d’auto-défense, auto-organisées par des groupes locaux, en lien avec leurs amis emprisonnés. Des actions claires, exemplaires, reproductibles autour de toutes les prisons. Disons-le, des actions politiques. Avec l’intention, comme ils le disaient dans leur premier communiqué, de créer un mouvement pour la défense des prisonniers.
Alessandro Stella