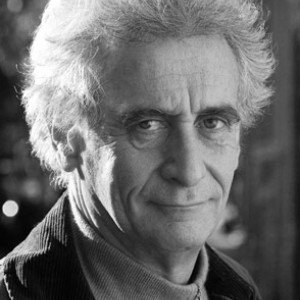Et cela, alors que pas une seule fois, me semble-t-il, on n’y rencontre les lettres lgbtqi, ce pilier désormais durement planté au creux de la pensée critique dominante : ce livre bouscule tant qu’on n’est pas obligé de connaître l’identité revendiquée de l’auteure pour entrer dans la peau de sa protagoniste transgenre (quant à moi, il a fallu qu’à la moitié de la lecture, j’aille errer sur Internet, pour m’apercevoir que Camila Sosa Villada n’était pas née femme). Les Vilaines ne portent en elles pas un gramme de dolorisme militant, elles ne nous épargnent pas la rude couche de crasse noire qui couvre les vies des trans de Cordòba, cette crasse où se mêlent les sanies des misères psychiques et économiques, et la glue du regard des autres, mais ces vilaines-là sont aussi d’une beauté qui coupe le souffle, tant elles en ont. Le lyrisme de Sosa Villada réussit le miracle de paraître constamment naturel, comme émanant du cœur de la narratrice, de sorte qu’on ne se pose jamais la très chiante et oiseuse question du « vécu » de l’auteure.
Dans Les Vilaines (quel titre délicieux !), réalisme et merveilleux s’allient avec tant d’aisance qu’on ne songe pas une seconde au sempiternel « réalisme magique » - on n’est ni chez Garcia Marquez, ni chez Fellini : mais on croit aux Hommes Sans Têtes, à la tante Incarna, « cette déesse aux pieds de boue et aux mains de boxeur » dont les seins sont gonflés à l’huile de moteur d’avion, à Eclats des Yeux, l’enfant trouvé qui en fera jaillir du lait, on croit à Maria, la muette qui deviendra oiseau. On croit à Sandra la folle.
« Les trans avancent sur leurs talons qui ressemblent aux pieds pourris des tables inutilisables » et de chacune nous partageons l’état d’âme : « elle était brisée comme un verre et t’écorchait avec les contours de ses propres blessures ». Car, ce qui fait son identité, justement, c’est qu’elle n’en a pas : « Quitter tous lieux. C’est ça, à la fin, être trans. »
Lisez les trois extraits qui suivent, sur Sandra la Folle, sur les Hommes Sans Têtes et sur l’Envie de mettre le feu à tout, et voyez si vous ne vous retrouvez pas comme ces amants enlacés de Pompéi, après la coulée de lave. SQ
Sandra la folle
Comme elle avait ces antécédents, il était assez commode d’attribuer tout ce que faisait Sandra à sa folie. Mais celles d’entre nous qui connaissaient un peu mieux le suicide ont immédiatement compris, par la discrétion avec laquelle elle s’était laissée tomber dans les bras de la mort, que c’est la tristesse qui en avait été la cause. Pour ne pas souffrir, elle avait avalé une poignée de cachets de toutes les couleurs et s’était couchée dans son lit, coiffée et maquillée avec soin, dans une robe discrète et printanière de jeune fille d’un autre temps. Elle avait laissé de l’eau et de la nourriture pour sa petite chienne Coco, et elle avait laissé la porte de sa chambre entrouverte afin que la chienne puisse quitter sa chambre lorsqu’elle n’aurait plus de nourriture, plus d’eau, ni de maîtresse.
Mais c’est faux de dire, comme on a voulu le faire croire, que Sandra s’est suicidée par peur d’El Pacú et de ses sbires. Ce n’est pas vrai non plus qu’elle l’a fait en pleine crise psychotique. Elle avait fait plusieurs de ces crises, comme la fois où elle avait fini les seins à l’air, à pousser des cris devant la place España, au milieu des voitures qui klaxonnaient et l’insultaient tandis qu’elle leur criait dessus, les seins à l’air : « Putain de folle, comme ta mère ! » Nous attendions que le feu passe au rouge pour aller la récupérer. Cette fois-là, elle nous a griffées, elle nous a donné des coups de pied et nous a mordues, puis nous avons réussi à la traîner jusqu’au trottoir, nous l’avons rhabillée et essayé de la calmer, mais en vain. Nous avons fini par l’emmener à l’hôpital psychiatrique, où elle a réussi à être la patiente la plus populaire de l’établissement, comme chaque fois qu’elle a été internée, par la suite.
Sandra espérait aussi que cette porte entrouverte permettrait que l’on trouve son corps dans le superbe état dans lequel elle l’avait laissé. Mais, comme à son habitude, elle n’a pas eu de chance : lorsqu’on l’a retrouvée, son corps avait eu le temps de gonfler, il était livide et sentait déjà mauvais. Il n’y avait pas de lettre d’adieu, mais sur le réfrigérateur, collée à l’aide d’un aimant, elle avait laissé un petit mot dans lequel elle demandait que tous ses meubles aillent à Tante Néné, qui avait fini par s’assumer comme trans à un âge déjà très avancé, et qui n’avait pas un sou.
Telle a été la triste fin de notre sœur Sandra, la folle, la suicidaire, la piètre trafiquante de drogue, la plus indécise, la plus pute, celle qui tachait toujours sa peau quand elle s’épilait à la cire, celle qui ne disait jamais au revoir, celle qui a été tondue en prison, celle qui nous fournissait du Rohypnol, celle qui se vantait d’avoir rendu ses services au gouverneur de la province, la douce et triste Sandra.
Les Hommes Sans Tête
Nous ne connaissions à Tante Encarna qu’un seul amour : une romance longue et tranquille avec un homme sans tête. À l’époque, beaucoup de réfugiés avaient débarqué dans la ville, fuyant les guerres qu’on livrait alors en Afrique. Ils étaient arrivés dans notre pays avec le sable du désert encore collé à leurs chaussures et on disait d’eux qu’ils avaient perdu la tête au combat. Les femmes en sont devenues folles car leur tendresse, leur sensualité et leur disposition au jeu étaient légendaires. Ils avaient connu beaucoup de pénuries durant la guerre, presque les mêmes que les trans dans la rue, ce qui avait fait d’eux à la fois des objets de désir et des héros de guerre. Les Hommes Sans Tête avaient suivi des cours accélérés d’espagnol pour pouvoir parler notre langue, c’est ainsi que nous avions appris qu’ils avaient perdu la tête, que désormais ils pensaient avec tout le corps et ne se souvenaient que de ce qu’ils avaient ressenti dans leur peau.
Pour tous nos maux, la guérison passait par le repos. Pour n’importe quelle maladie du corps et de l’âme, Tante Encarna nous prescrivait du repos. C’était le plus beau cadeau qu’on avait reçu dans la vie : pouvoir se reposer tandis qu’Encarna veillait.
Nous tournions autour d’elle. Chez Encarna, il y avait toujours quelque chose à manger et comme à l’époque nous avions souvent faim, elle nous accueillait à bras ouverts, avec du pain sur la table. Moi, le jour, je menais une vie d’étudiante médiocre, et j’étais très pauvre, maintenant je peux le dire, j’avais souvent faim. Le fait de s’alimenter exclusivement de pain déforme le corps, ça le rend triste. L’absence de couleur dans les aliments les rend tristes et déprimants. Mais chez Tante Encarna, les placards étaient toujours remplis ; s’il te manquait quelque chose, elle te le donnait : farine, sucre, huile, yerba maté, tout ce qui ne pouvait manquer dans aucune maison. Elle nous disait aussi qu’il ne pouvait pas manquer dans notre chambre une image de la Vierge del Valle, qui est brune et rebelle, et tellement puissante qu’elle est capable de conjurer le destin.
Les Hommes Sans Tête ont débarqué avec leur surprenante douceur, mais les femmes qui les attendaient les jambes ouvertes et le sexe en fleur ont été tendrement déçues car ils ont préféré les trans de la région. Nous ne savions pas pourquoi ils nous avaient choisies, mais il y en a eu beaucoup parmi nous qui se sont mariées et ont ni par vieillir auprès de leur amant décapité. Manifestement, s’ils tombaient amoureux des trans, c’est parce qu’il était plus facile de partager leurs traumatismes avec nous, de les laisser grimper le long des murs ou au contraire, à l’occasion, de les enfermer à double tour. Mais les femmes ont ressenti leur indifférence comme une offense, elles ont commencé à faire des commentaires désobligeants et mal intentionnés à propos de nos hôtes, qui, au fond, étaient dans cet état parce qu’ils s’étaient battus pour un monde meilleur. Elles disaient que faire l’amour avec un de ces hommes, c’était comme aller à la plage, après, durant des jours et jours, on n’arrivait plus à se débarrasser du sable qui s’était glissé dans le cul. Mais on s’en chait, de ce qu’elles disaient.
Cette relation déjà ancienne était une bénédiction rare dans la vie des trans. Car il n’aimait pas seulement Encarna, mais tout ce qui l’entourait, y compris nous, ses lles putatives. Voir Tante Encarna dans les bras de cet homme nous donnait l’espoir d’être un jour, qui sait, caressées de la même façon. L’Homme Sans Tête enchan- tait toutes nos réunions. Une fois, il nous a même invitées à dîner dans son appartement. Nous y sommes toutes allées ensemble, pas seulement pour ne pas vexer Tante Encarna, qui était plus rancunière qu’un saint faiseur de miracles et plus farouche que les dieux grecs, mais aussi parce que nous voulions voir de nos propres yeux son hospitalité discrète, ses aquarelles, son chien féroce dormant au pied du lit, sa bibliothèque inépuisable, dont nous ne pourrions jamais lire les livres même si nous avions le temps, car ils étaient écrits dans une langue que nous ne comprenions pas.
Tante Encarna l’avait connu au Hangar 18, la boîte gay la plus dépravée qu’on ait eue en ville, l’antre le plus sacrilège et dionysiaque dans lequel se retrouvaient les sorcières, les tantouzes et les lesbiennes de l’époque. La relation entre Encarna et son Homme Sans Tête avait commencé comme un arrangement commercial des plus prospères, car quand ils se sont rencontrés, Tante Encarna était dans la plénitude productive de son corps. Les clients ne l’abîmaient pas du tout. Elle pouvait très bien coucher avec dix hommes en une nuit, ce qui arrivait assez souvent, et se réveiller le lendemain fraîche et pleine d’énergie comme un vent d’été, serrant dans ses bras son Homme Sans Tête, qui vivait très confortablement dans un appartement particulier grâce à son allocation de vétéran de guerre. Les Hommes Sans Tête venaient de régions incompréhensibles pour nous, qui avions une piètre culture, nous ne parvenions pas à comprendre pourquoi les conflits sanglants qui les avaient expulsés jusqu’à notre ville avaient eu lieu, mais ils étaient tout ce qu’une trans pouvait attendre de la providence. Mais ils étaient de moins en moins nombreux, car beaucoup d’entre eux finissaient dans des hôpitaux psychiatriques ou décidaient finalement de s’installer dans des villages situés au bord de la mer. Les rares Hommes Sans Tête qui sont restés à Córdoba ont vite noué des liens solides, et cet horizon de fuite a disparu à tout jamais.
Moi, je l’aimais particulièrement, car une nuit il nous avait sauvées, María la Muette et moi, des griffes de deux policiers, tout près de la grande maison rose. L’un des flics avait déjà commencé à devenir violent, il me tenait pliée en deux contre une voiture, c’est qu’on leur avait dit que deux trans faisaient du vol à l’étalage dans la supérette du quartier. L’Homme Sans Tête est alors apparu comme s’il était le prolongement de l’ombre qui l’occultait, il s’est approché avec son amabilité naturelle, a parlé deux minutes avec les policiers, à l’écart, et ils nous ont laissé partir. La parole d’un homme décapité avait plus de valeur que la nôtre.
L’ envie perpétuelle de mettre le feu à tout
C’est comme ça que nous courions les clients, obligées à supporter la chaleur, à sentir qu’il n’y avait rien de pire que d’être une pédale étouffant dans un monde que les mecs échauffaient, un monde où tout se règle à coups de pied et de poing. Avec le désir secret de les tuer tous, d’en finir une fois pour toutes avec le monde, juste histoire de voir si par la même occasion on arrivait à mettre fin à cette rage que la maltraitance perpétuelle avait accumulée en nous.
La chaleur trans était identique. La couche de maquillage qui devenait toute collante, un masque de boue chaude bouchant tous les pores pour que notre âme ne s’échappe pas par ces orifices chaque fois qu’on nous frappait. Le visage tout entier devenait un masque, le plus beau des masques, avec des traits trans plus réels encore que nos propres traits, conçus pour un autre monde, un monde meilleur, où l’on peut être pleinement ce masque-là.
Il venait peut-être de là, le vice qui était le nôtre de leur piquer quelques billets dans leur portefeuille. Pas grand-chose : vingt pesos, cinquante, presque rien. Pas de quoi mettre en péril les finances d’un ménage. Ce n’est rien qu’un geste. Je suis jeune et je crois qu’il est légitime de le faire. Que cet argent m’appartient car je suis désavantagée sur la scène où le client et moi nous trouvons, à ce moment-là. Après, chez eux, ils remarqueront sans doute qu’il leur manque cet argent que je vais dépenser dans un de ces petits plaisirs qui rendent plus heureux quand on est pauvre. J’allais beaucoup au cinéma, à l’époque. Parfois, j’achetais un livre. Parfois, j’avais de quoi m’acheter une nuisette.
En attendant, nous étions des Indiennes maquillées pour aller à la guerre, des fauves prêtes à chasser, la nuit, ceux qui sont assez imprudents pour s’aventurer dans la gueule du Parc. Et nous étions toujours fâchées, rudes, même pour la tendresse, imprévisibles, folles, rancunières, fielleuses. Et puis, il y avait cette envie perpétuelle de mettre le feu à tout : à nos parents, à nos amis comme à nos ennemis, aux maisons de la classe moyenne avec leur confort et leurs routines, aux jeunes de bonne famille qui avaient toujours la même tête, aux vieilles grenouilles de bénitier qui nous méprisaient tant, à nos masques qui coulaient, à notre propre rage peinte sur la peau, la rage contre ce monde qui ne voulait rien entendre, qui se payait sa bonne santé sur notre dos, et allait jusqu’à nous sucer la vie avec tout cet argent qu’ils avaient et que nous n’avions pas.
J’ai appris ça auprès des autres trans, c’était un savoir qu’on se transmettait. Il ne pouvait en être autrement, vu le prix misérable attribué à notre corps et au talent qui était le nôtre pour exercer le métier. Ce n’était pas un pourboire, car on ne consentait pas à nous le donner. Et pourtant c’était légitime, en guise de rétribution pour cette violence invisible qui caractérisait toute transaction avec un client. Car notre existence entière était un délit. J’étais une voleuse d’un mètre soixante, qui glissait sa main dans les portefeuilles à la vitesse de l’éclair, quand les clients s’endormaient ou allaient aux toilettes. Il faut agir vite : si on y pense trop, le client sort des toilettes, il te chope la main dans son portefeuille et il te frappe. En revanche, si on ne prend pas trop le temps de réfléchir, si on agit, le temps s’avère suffisant. J’y arrive assez bien, jusqu’au jour où un client m’envoie un message sur mon portable : « Tu m’as volé de l’argent dans mon portefeuille ? »
« Je suis une pute, pas une voleuse », voilà ce que je réponds. Je ne sais pas très bien ce que je veux dire par là. Lui, en tout cas, ne revient plus et c’est bien dommage, car il était beau. Mais il le méritait, comme les autres. Pour qu’ils sachent que nous valons plus que ce que leurs cerveaux hétérosexuels peuvent imaginer.
Telle était la rage qu’ils avaient inoculée en chacune de nous. Prendre la ville d’assaut : tel était notre désir profond. En finir une bonne fois pour toutes avec tout ce monde hors de notre monde, du monde légitime. Empoisonner leur nourriture, détruire leurs jardins aux pelouses bien tondues, porter à ébullition l’eau de leurs piscines, détruire de nos mains leurs camionnettes de merde, arracher de leurs cous ces chaînes en or, prendre leurs beaux visages de personnes bien nourries et les râper contre le pavé jusqu’à ce que leurs os soient à nu.
La nuit de mon anniversaire, c’est la nuit la plus chaude de l’année. Je décide de ne pas travailler, mais d’aller quand même dire bonjour à mes camarades. En chemin, un client me fait une proposition ravissante, alors j’accepte. Quand je finis avec lui, je vais les retrouver à l’endroit habituel et elles sont là, en effet, mais entourées par un groupe d’étudiants d’université qui fêtent le diplôme décroché par l’un d’eux. Que des jolis garçons grimés comme des travestis, dans un de ces 4x4 obscènes achetés par leurs parents grâce à la sueur des pauvres. Ils sont tous ivres, ils font la fête et nous lancent les pires insultes qui soient. En passant, ils nous arrosent avec de la bière, ils accélèrent, font le tour du Parc et reviennent, disposés à nous humilier.
Je me demande ce qui se serait passé si, au lieu d’enfouir la rage au plus profond de notre âme trans, nous nous étions organisées. Mais qu’est-ce qui est arrivé, au lieu de ça ? Où nous a menées le fait de ravaler notre venin ? À mourir jeunes. Car, sauf dans ces soudains et rageurs élans fratricides, nous, les trans, nous ne faisions pas de mal à une mouche.