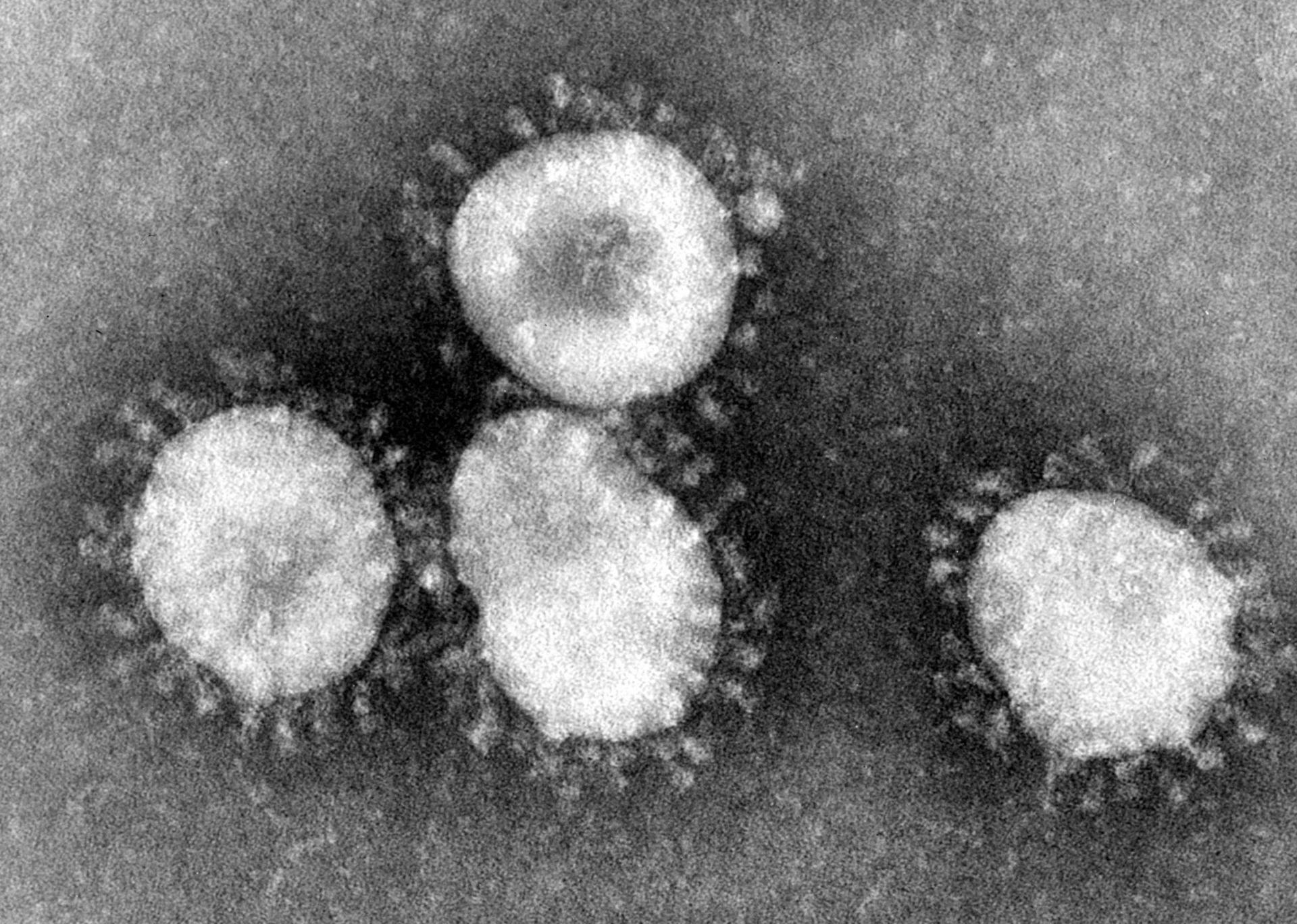Peu connu en France, mais auréolé d’un indéniable prestige dans la mouvance contestataire espagnole, Agustín García Calvo (1926-2012) est un philologue, linguiste, poète dramaturge, penseur radical et maître de plusieurs générations d’incrédules et de rebelles. Il fut professeur de philologie latine à l’université de Madrid. En 1965, il appuya la révolte étudiante et fut expulsé de l’université par décret du régime franquiste. En 1969, pour éviter la prison, il s’exila à Paris, dans le Quartier Latin, où il fonda en 1970 la Commune Antinationaliste de Zamora qui avait l’intention de combattre pour « la disparition de l’État espagnol et de l’État en général ». Après la mort de Franco, il occupa de nouveau sa chaire de Madrid jusqu’en 1997. Contrairement à tant d’autres rebelles des années soixante-dix, il resta fidèle à l’élan de contestation radicale des années 60-70, et cela avec une conséquence et une profondeur chaque fois plus grandes au fil des années, infatigablement prodiguées dans des livres, pamphlets, conférences, collaborations dans des quotidiens, poèmes et chansons (mises en musique, en autres, par Chicho Sanchez Ferlosio et Amancio Prada). À partir de 1997, il encouragea la « guerre contre la réalité » dans la Tertulia Política de l’Athénée de Madrid, causerie qui réunissait de façon hebdomadaire plus d’une centaine de participants. En mai 2011, il s’est uni au mouvement des Indignés qui occupèrent la Puerta del Sol à Madrid, essayant de maintenir le sens originaire du mouvement — la rébellion contre l’État et le capital — contre les tentations, tristement majoritaires, de céder à la politique de l’ordre dominant et à ses procédés, aux votes, aux projets de réformes et aux revendications dirigées vers le haut [2].

Contre le Temps et le Pouvoir
- Quelle est ton opinion ou ton attitude vis-à-vis de l’écologisme ?
- Quand les nouveaux mouvements écologistes ont surgi – nouveaux puisqu’il y a toute la tradition naturaliste-végétarienne du xixe siècle – mon attitude a été dès le départ ambiguë, et elle continue de l’être. D’un côté, une sympathie (la reconnaissance des mêmes répugnances face à la tromperie du Progrès et la même horreur ou tristesse face à la destruction et au gaspillage de la vie en général, pour rien). De l’autre, ce que je commençais déjà à formuler et qui dès lors m’est apparu de plus en plus clairement : défendre et exalter positivement n’importe quelle chose que l’on aime – que l’on nomme cela Vie, Nature, Liberté ou même Amour – est une tactique erronée, puisque cette défense ou exaltation contribue à réduire ces choses à des idées d’elles-mêmes, à les soumettre à l’abstraction dominante et par conséquent au Pouvoir, qui n’agit qu’au moyen de l’idéation.
Une application pratique de cela a eu lieu ces dernières décennies, par des processus de conservation, toujours plus promus et vantés par l’État et le Capital, et non plus seulement avec les vieilles réserves d’indiens d’Amérique du Nord, mais aussi avec les réserves naturelles, les parcs nationaux protégés, la nature, enfin, emprisonnée pour sa protection et par là même intégrée dans l’ordre total de l’abstrait et du dominant. Processus parallèle à celui de la conservation culturelle de quelques placettes ou églises romanes face aux atteintes de l’urbanisme, en complément de la destruction par la construction, du faire ce qui est déjà fait, que nous voyons à l’œuvre par exemple dans les blocs d’immeubles.
Il semble découler de ces raisonnements et expériences qu’il n’y a d’autre défense que l’attaque. Par exemple, il n’y a d’autre défense de la vie que l’attaque de la mort, d’autre défense de ce qui est palpable et naturel que l’attaque de l’abstraction et des idées, qui en sont la prison, ou, comme j’aimerais un jour le dire à la fin d’une chanson, « la déclaration de ton amour est seulement le non de ta haine ».
- Tu as dit une fois que « le rêve de spontanéité se heurte souvent à la réalité de l’automatisme ». Pourrais-tu distinguer un peu les activités spontanées des automatiques ?
- Par l’étude du langage, il me semble découvrir qu’il faut distinguer trois choses. L’une d’elles est le plan de ce qui est conscient, volontaire, délibéré, celui qui est à portée de main, à proprement parler, des âmes individuelles et des instances du pouvoir public organisé. Face à lui, uniquement déterminé négativement, il y a ce qui n’est pas conscient, qui n’est pas volontaire, pas délibéré, ce qui, pour employer une métaphore commune, est en bas, par opposition à ces instances ou facultés supérieures de l’individu ou des pouvoirs. Mais, entre l’un et l’autre, se situe une troisième chose, la région que j’appelle subconscient, en employant le terme plus précisément que Freud, c’est-à-dire le lieu où aboutit ce qui a été en haut, ce qui a été conscient, délibéré, ordonné et qui, pour des raisons de censure ou simplement techniques, a dû se ré-enfouir dans le non-conscient, être oublié de la conscience, pour, à partir de là, agir et fonctionner avec autant, voire plus d’efficacité.
C’est en ce lieu que naissent les activités que nous devons appeler, plus précisément, automatiques, qui s’opposent aussi bien aux activités volontaires qu’à celles venues d’en bas, d’on ne sait où, et que l’on aurait la tentation d’appeler instinctives ou naturelles.
La première création de cette poche subconsciente, et par conséquent des activités automatiques, est le langage, dont le système et les règles restent enfouis dans la subconscience dès lors que l’enfant apprend peu à peu à parler et qu’au fur et à mesure qu’il se rend compte de cela, cesse de le savoir pour bien parler, et l’oublie de sa conscience.
Il est clair que les instances supérieures, ma volonté ou celle de l’État et du Capital, ne peuvent rien manipuler directement de ce qui vient véritablement d’en bas, d’on ne sait où, de ce qui n’est pas conscient : ils ne peuvent même pas manipuler le subconscient linguistique, la langue, à l’exception de ses instances les plus superficielles, qui sont celles du vocabulaire. Par contre, ils peuvent, en mettant à profit ce modèle premier et en l’utilisant désormais pour des activités industrielles, créer d’en haut de nouveaux automatismes, qui sont évidemment utiles à l’Obéissance et au succès de l’imposition de l’Achat. Je croirai en des idées imposées avec d’autant plus d’assurance que je ne me rendrai compte ni qu’elles sont imposées ni qu’elles sont des idées, je répondrai aux ordres d’obéissance ou d’achat d’autant mieux que je croirai que l’élan qui me porte à elles me vient des profondeurs de moi-même et que ce sont mes propres goûts ou décisions : j’y croirai d’autant plus que j’ignore ce qui est subconscient et automatique et que je le confonds avec ce qui est instinctif et naturel ou ce qui est volontaire et délibéré.
- Dès lors que l’on pense aux grands problèmes de l’époque actuelle surgit le doute sur l’attitude à adopter : suivre le vieil axiome « le contraire est bénéfique », ou cet autre « l’unique espoir est le désespoir »...
- En principe, on peut se fier aux lignes de la rébellion tracées par l’organisation même de l’ennemi, puisqu’en général, Eux, ceux d’en haut, guidés par la nécessité de la haine et de la mort, réussissent à ordonner et à déclarer exactement le contraire de ce qu’était le désir de vie, ou pour le dire avec moins de prétention, le désir d’« autre chose » qu’il pourrait y avoir chez les gens, ceux d’en bas. De ce fait, Leurs idées et Leur organisation peuvent jusqu’à un certain point servir de guide pour la négation, pour la rébellion, pour la tentative de destruction de cette « destruction par la construction » que nous voyons aujourd’hui de toutes parts.
Cependant, c’est une tactique erronée que d’imiter en bas les procédés d’idéation, d’organisation ou d’imposition qui Leur sont propres et qu’on doit Leur laisser. Il faut aussi considérer qu’Eux, comme le commenta Jésus-Christ, ne savent pas ce qu’ils font, et par là même acceptent l’obéissance aveugle et l’imposition de la mort et du mensonge. Disons qu’Ils ne sont pas parfaits, et que par conséquent leurs idées ne peuvent pas non plus être prises comme un critère ferme et clair auquel simplement il faudrait s’opposer.
Je crois que cette lutte s’en tient, non pas au désespoir – lequel, si l’on l’accepte comme attitude, se convertirait immédiatement en une posture idéologique de plus, en quelque chose de positif et qui, au demeurant, n’a aucun fondement, puisqu’on ne sait pas non plus si l’Ordre est parfait et fermé, bien qu’Il veuille s’imposer comme une évidence – mais s’en tient à une certaine dextérité, à un certain calcul dans le choix des thèmes d’attaque, dans lequel on peut se tromper chaque jour pour peut-être reconnaître l’erreur le lendemain, et changer de cible.
- Mais existe-t-il une claire différence entre Eux et Nous ? Une personne ne peut-elle pas jouer deux rôles alternativement ? Par ailleurs, il semblerait qu’en politique il y ait le rôle des gouvernants et celui des gouvernés, et que quand une personne ou un groupe doit jouer le premier rôle il se heurte toujours à un scénario qui ne peut être modifié, comme le démontre le PSOE [Parti Socialiste Ouvrier Espagnol].
- Quand je dis « Eux », je ne pense nullement à des personnages concrets malintentionnés et machiavéliques (au contraire, la croyance en d’importants personnages dans les hauteurs qui régissent les processus de la Politique ou de la Banque est une des falsifications que l’on tente d’imposer avec le plus grand acharnement aux Masses par les moyens de formations de masses, avec leur attirail de portraits télévisuels, de figures illustres et leur tintamarre de noms propres), mais je pense plutôt à des entités abstraites, idéales, comme « État » et « Capital », qui sont les véritables agents de la machine, puisque Dirigeants de la Banque et Ministres de l’État ne sont que des représentants et serviteurs, plus ou moins fidèles, de ces Entités (d’autant plus fidèles qu’ils sont au plus haut et que leur poste exige « plus de responsabilités », de sorte que le plus haut des cadres exécutifs de la pyramide est celui qui le plus parfaitement ne sait pas ce qu’il fait, afin qu’il ne puisse ainsi faire autre chose que ce qui est déjà fait). Et comme « Masse » et « Chef » sont des entités corrélatives et de ce fait identiques, il est clair que Nous, en tant qu’organisés en Masse, sommes Eux, et il est vrai que chaque soldat porte dans son sac le bâton de Maréchal, comme disait l’autre, autrement dit que le Pouvoir est aussi reproduit dans les Instances Supérieures de chaque Individu, son idéation et sa volonté qui le constituent comme Personne, c’est-à-dire comme nombre parmi la Masse. Qu’il y ait, à part ou par en dessous de Moi et de l’État, d’autres choses ‒ dominées et exploitées par Moi et par l’État ‒, c’est ce que nous ne savons pas, mais assurément il n’est pas non plus démontré qu’il n’y ait pas de telles choses.
- Que penses-tu du vieux dicton « il n’y a pas de meilleure vie que celle du pauvre ayant du pain à satiété » ?
- L’éloge de la pauvreté est de tradition ancienne. On en a toujours fait la louange, non pas précisément par simple hypocrisie des riches, mais parce que l’on reconnaît la relation entre la servitude et les besoins, et que l’on pensait que, moins l’on avait de nécessités, plus libre on était et plus grandes étaient les possibilités de vie. Cette attitude a conduit avec le Progrès de l’État et du Capital à travailler surtout à la création de nécessités, ce à quoi aujourd’hui se vouent essentiellement les organes aussi bien politiques que commerciaux. On est parvenu ainsi à ce qu’il n’y ait plus de pauvres au sens du dicton, puisque les pauvres, eux aussi, sont plus ou moins assaillis d’autant de nécessités que les riches, ce qui les empêchent de jouir des avantages de leur condition. Quant aux plus riches, dans ce stade avancé du Progrès, ils sont plus éloignés de la jouissance que ne l’étaient, d’après ce que nous pouvons imaginer, les vieux bourgeois d’il y a un siècle et demi, ou un siècle : leur jouissance des choses est troquée par l’Achat de ces choses qui correspondent à leur statut (un yacht, un avion privé, un safari en Afrique) et, parallèlement, les relativement pauvres sont privés de cette liberté que l’adage attribuait aux pauvres d’antan.
- La haute technologie et la vieille sagesse populaire s’éloignent toujours un peu plus. La technologie « de pointe » est accaparée par certains, tandis que tous les autres ne peuvent en utiliser que des élaborations simples. Cela est perçu avec inquiétude, mais il s’agit peut-être là d’un indicateur...
- Pour ma part, il y a longtemps, face à l’horreur et la vacuité du développement technique, des machines, de l’informatique et autres, je tendais à adopter une attitude de refus en bloc de ces avancées de notre Progrès. Et j’en faisais appel aux coutumes, aux inventions élémentaires, des paysans de ma terre, des artisans qu’il restait et en général à cette sagesse populaire dont tu parles. Mais je me suis rendu compte peu à peu qu’il se pouvait que, sur cela aussi, il convienne d’être plus précis et précautionneux : bien qu’il soit vrai que les promesses du Progrès de nos grands-parents, selon lesquelles la machine, puis l’automate, viendraient nous libérer du travail et nous restituer ainsi un temps libre, aient été, dès leur début, falsifiées et manipulées par le Pouvoir, comme le montre le fait manifeste que ces avancées n’ont libéré personne du travail, mais l’ont, au contraire, augmenté et ont fait du temps libre un temps aussi esclave, vide et laborieux que le travail lui-même, cependant, en reprenant ce que je disais avant sur le fait qu’Ils ne sont pas parfaits, il vaut mieux reconnaître que certaines choses, ou quelque chose de ces avancées, peuvent dans une certaine mesure servir, à l’encontre de leurs intentions, à ce que leurs hypocrites promesses faisaient espérer. C’est pourquoi je ne me sens pas encouragé à imiter d’une façon indistincte cette révolution contre les machines qui apparaissait déjà lucidement décrite dans le roman Erewhon de Samuel Butler, mais plutôt, à distinguer un Progrès progressé (machines qui ne sont pas nées pour satisfaire des demandes palpables préalables, mais de l’exploitation de l’idée de progrès pour la création de nouvelles nécessités) d’un Progrès tout court, et à reconnaître qu’il y a des instruments comme la télévision ou l’automobile ou la plupart des babioles informatiques, qui, par leurs structures même en tant que fruits d’un Progrès qui s’est érigé lui-même en idée et en fatalité, ne peuvent servir qu’à ce qu’ils servent et méritent par conséquent une critique sans réserve et la destruction qui les laisserait réduits, comme dans le Musée d’Erewhon, à des pièces destinées à nous rappeler les extrémités de la folie et de l’erreur. Alors que de nombreux autres instruments comme, en premier lieu, le train qui fut le prototype et le promoteur du Progrès de nos grands-parents, et certainement les métiers à tisser mécaniques, voire même les laves-linges (plutôt communautaires que celui de la maîtresse de maison) et, avec plus de réserve, des choses comme le télégramme, le téléphone, voire même la radio, parmi tant d’autres, se trouvent utilisés dans de telles conditions que l’on ne peut mésestimer leur possible utilité véritable, et qu’il vaut donc la peine d’essayer de les reprendre des mains (mains toujours abstraites) qui les manipulent et occasionnellement les destituent en vertu d’intérêts étrangers à ceux de l’utilité (comme c’est le cas du train, destitué par l’automobile).
Ce qui importe donc est de réussir à reconnaître, au beau milieu de la confusion imposée d’en haut, ce qui est le plus pratique, le plus utile, le plus agréable dans chaque cas particulier, face à ce qui est « nécessaire », uniquement par une nécessité imposée d’en haut, que l’on aime et qui plaît uniquement parce qu’Ils ont besoin de vendre et qu’Ils savent comment l’on crée les goûts et les volontés personnelles. Cette distinction, aussi difficile et douteuse soit-elle, qui nous condamne à jamais à cette dextérité et à ce calcul quotidien, toujours à refaire, dont nous parlions auparavant, est, finalement, la façon la plus efficace d’éviter de se tromper et d’adopter face au Progrès des postures trop simples et radicales qui, par là même, seraient faciles à classifier et finiraient par être utiles à la confusion et à la soumission aux idées du Pouvoir constitué qui, étant constitué, est destiné à un futur préalablement tracé, à un temps vide, auquel Il essaie de condamner également les gens d’ici, en bas. - Pourrais-tu définir un peu ce « temps vide » ?
- À de nombreuses reprises, j’ai décrit la production du temps vide en commençant par la chaîne du Travail où, en chargeant l’ouvrier d’établir la reproduction d’une pièce préalablement idéée, qu’on lui impose comme modèle et par conséquent comme futur de son activité, on obtient, depuis le moment de l’imposition du modèle jusqu’à sa réalisation, un tronçon de temps dans lequel, sauf accident, il ne peut rien se faire ni rien arriver (c’est-à-dire, rien d’autre que ce qui s’est déjà fait et qui est déjà arrivé), un temps vide qui, en dépit de sa prétention à être « quelque chose qui passe », est premièrement Futur, l’unique forme de réduction du temps à une idée de lui-même, réduction à du Temps. Ce temps idéé et vide est l’unique temps que l’État et le Capital peuvent manipuler. On voit ainsi que ce t qui surgit de la chaîne du Travail, où la force de travail, ou possible vie du travailleur salarié, est vendue, convertie en temps (avec une fidélité un peu extrême au schéma de Marx), est le même t qui apparaît dans les formules de l’intérêt de la Banque, donnant ainsi à l’argent la vie que les hommes ont perdue, le convertissant en Capital, de sorte qu’avec le progrès, dans la forme la plus parfaite du Capital, l’argent n’est rien d’autre que ce Temps (toujours vide, toujours futur, du crédit bancaire, qui n’est que pure foi) qui est à la fois la seule chose que l’on produit dans l’usine ou dans les bureaux : du Temps, et ce avec quoi l’on paie le travailleur ou l’employé de bureau : du Temps. Littéralement, « on gagne du temps » (puisque le t des formules de la vitesse de la Physique est également le même t, et qu’il faut l’Accélération, comme progrès de la Vitesse, pour maintenir la tromperie et occulter l’évidence que rien ne se passe et que rien ne se fait), et on comprend dès lors comment le « temps libre » par lequel le système récompense ses fonctionnaires ne peut être hétérogène à celui du travail lui-même ou à celui de la Banque, mais est bien le même temps vide, qu’il s’agit désormais de remplir (pour échapper à cette apparition psychologique du Chaos qu’est le bâillement de l’ennui) au moyen de la consommation et des distractions (en effet, « passe-temps » se dit bien pour cela, quand ce n’est pas « tuer le temps » qui, à proprement parler, voulait dire tuer le vide et le futur pour voir si ressuscitait, vaine tentative, quelque chose du vivre qui ne fut pas le temps), des distractions qui, comme complément du même Système (la sphère de la consommation) ne pourront qu’être la même chose que le Travail et, avec le Progrès, prendront des formes de plus en plus similaires. Le quart d’heure que la secrétaire consacre à la machine à sous, quasi identique à l’ordinateur qu’elle manipule au bureau, ou les deux jours et demi de week-end du fonctionnaire qui, entre s’adonner à la voiture, à la visite du chalet en construction à la montagne, le suivi du tirage du loto annoncé à la radio de cette même voiture et le retour dans l’embouteillage des faubourgs de la métropole, finissent par être plus chargés de travail, d’obligation, de prévision et de calcul de futur, que les quatre jours et demi passés au bureau. Mais mieux vaut tout faire plutôt que de sentir directement s’ouvrir les mâchoires du vide, du Futur auquel on se sent condamner. Et qu’enfin, à part gagner du temps et passer le temps, il puisse rester, comme vous dites, quelques possibilités de perdre le Temps, c’est-à-dire de vivre (si toutefois l’on savait ce que voulait dire ce mot), c’est ce que nous poursuivons peut-être en le désirant du plus profond, par ici en bas, puisque nous ne voyons pas de raison (excepté Leurs Intérêts) à déclarer cela impossible, mais il est imprudent de tenter de le savoir ou de le dire. Non : sentir, parler et raisonner ne sont pas là pour proclamer le possible, mais pour découvrir et chanter ce qui le rend impossible.
Traduit de l’espagnol par Manuel Martinez, avec la collaboration de Marjolaine François.