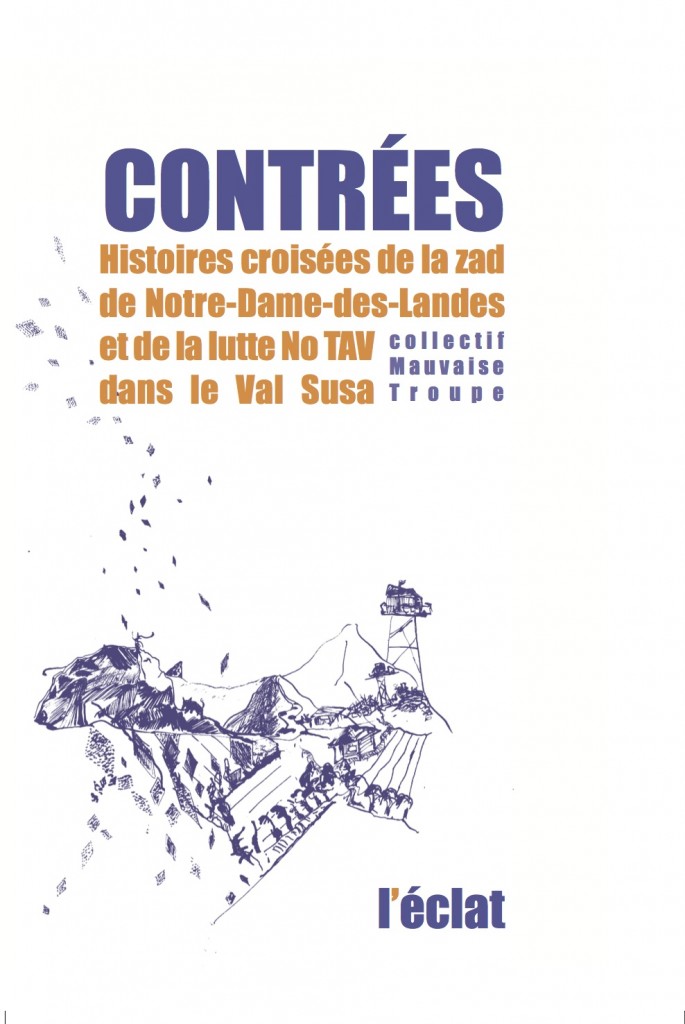
Faire Mouvement
Je crois que notre mouvement est devenu célèbre, outre la protestation, parce qu’on a dit : faisons aussi des choses, je veux dire, mettons-nous en travers. Si faire des recours, utiliser toutes les lois qui existent pour essayer de les arrêter, ça ne suffit pas, je me mets aussi en travers, j’arrête les camions, etc. C’est ça qu’on essaie d’exporter, si de la protestation on passe à la rébellion c’est un signal fort, même si ce n’est pas encore la révolution !" Guido, 70 ans, retraité
Conflit et violence
Que cache la chemise de Xavier Broseta, le directeur des ressources humaines d’Air France, devenue la frusque française la plus médiatique de l’année 2015 ? Que les DRH ne cherchent pas dans leurs plans sociaux à soigner leurs salariés, personne ne pouvait prétendre l’ignorer. Que ces derniers fassent montre d’un sursaut de dignité en chahutant leurs dirigeants au beau milieu du comité central d’entreprise fut en revanche une belle surprise. Mais ce qui demeure sans doute le plus stupéfiant et le plus éclairant dans ce déchirement vestimentaire, c’est l’insignifiance et l’innocuité des gestes contre lesquels des croisades médiatico-politiques peuvent désormais être menées. On range ainsi le coup de sang des « salariés voyous », pourtant si loin des décapitations de la Révolution française ou de la watrinade(1) du xixe siècle, au côté de la Terreur de 1793, et on se scandalise de l’image de la France salie dans le monde entier(2). L’outrance des comparaisons révèle autant l’hypersensibilité d’une époque qui a fait du confort sa valeur cardinale, que la tentative d’invalider la possibilité même d’un conflit en le désignant comme inadmissible excès de violence. L’opération est d’abord langagière : de nouvelles synonymies apparaissent, semblant d’abord absurdes et s’intégrant pourtant, à l’usure, dans la doxa. Une grève se change en prise d’otage des usagers, une manifestation agitée se fait saccage, tandis que le sabotage redevient terrorisme comme au temps de l’Occupation. Le scandale est performatif et repousse à terme les limites de l’acceptable. Car au-delà des mots rebattus, se mènent parallèlement des opérations répressives, judiciaires, rendant passibles lesdits « responsables », individuellement, de peines très lourdes. Dans ce cadre, chaque condamnation de la « violence » n’est pas seulement une réaction aux événements, mais un acte de préemption sur le futur, qui vient baliser le champ du possible pour les luttes à venir. Et le prémunir contre les gestes d’insoumission et de désespoir que l’on nous somme déjà de cantonner dans une sphère virtuelle(3) ou en tout cas inoffensive.

Ces opérations ont pour fin la reconfiguration du réel, afin d’en soustraire toute praticabilité d’un champ de bataille, toute manifestation d’un affrontement. En resserrant les normes, en abaissant les seuils de ce qui est admis, on voudrait circonscrire les différends fondamentaux dans le domaine discursif de la négociation, dans le cadre de la législation en vigueur. Il est certes autorisé d’y prendre parfois un ton insurgé et d’y menacer d’une explosion sociale, mais seulement pour la conjurer. Et quand ponctuellement la ligne du politiquement acceptable est franchie, qu’une sous-préfecture est saccagée, qu’un directeur est séquestré ou que des bonbonnes de gaz menacent de faire sauter l’usine, on s’efforce de résorber la fièvre des travailleurs excédés dans le « dialogue social ». La violence est alors ravalée au rang de simple moyen en vue de peser sur une négociation, elle n’est plus que la manifestation – certes un peu excessive – d’une recherche de compromis, enterrant ainsi toute possibilité d’affrontement durable, c’est-à-dire la constitution d’une ligne de partage claire entre visions inconciliables de l’existence.
En face, « on ne discute pas avec les violents » est l’ultima ratio des promoteurs de l’aéroport et du TAV, l’argument censé balayer sans appel le plaidoyer le mieux étayé contre l’absurdité de ces deux infrastructures. Dans un sens, il faut leur donner raison : il semble en effet qu’entre eux et nous, la discussion se révèle vaine et les désaccords trop profonds pour trouver un terrain d’entente. Et on voit bien que sans l’ouverture d’une ligne de front qui est venue rendre palpable la discorde, les oppositions auraient depuis longtemps été recouvertes sous une épaisse couche de tarmac ou de poussière de montagne. Cette ligne, qui est un des fondements du politique, n’est pas sans exiger périodiquement l’assomption d’un conflit ouvert dans lequel l’emploi de la force peut rarement être évité.

Le terme de « violence » tient dans ce contexte une place particulière. Si pour le Littré il désigne justement « la qualité de ce qui agit avec force », pour l’État son emploi est toujours empreint d’une haute portée politique. Il entend effectivement le réserver à ceux qui agissent avec force, mais lui sont extérieurs, voire ennemis, ces révoltés auteurs de « débordements » illégitimes et illégaux. Car c’est bien l’État, et lui seul, qui possède ce fameux « monopole de la violence légitime » qui garantit, paradoxalement, aux forces de police l’exemption de l’emploi du terme de violence à leur endroit… jusqu’à permettre les mutilations et le meurtre. Ainsi la dénonciation des « violences policières » fait-elle quasiment effet de pléonasme et se heurte à un mur, un bloc solide, qui fonde et soutient l’ensemble du pouvoir étatique et son autorité. À l’inverse, sans lien effectif entre l’acte et la dénomination, déchirer une chemise ou simplement traiter un policier de « pecorella » (« petit mouton ») relèvera de la violence, comme cela sera reproché à un No TAV dans un absurde procès accompagné d’une abondante campagne de presse. Cette capture du terme a eu pour effet l’abandon presque total d’une possible acception positive. Comme si le mot avait été enterré avec la déroute des mouvements révolutionnaires des années 1970, qui assumaient la « violence politique » ou « révolutionnaire » à longueur de tracts et d’actions plus ou moins armées. Cet enterrement crée un vide à la fois dans la désignation et dans la compréhension de certaines pratiques, et laisse ouvert le boulevard qu’empruntent les opérations de communication hystériques après chaque accès de fièvre sociale. La tétanie entretenue autour de l’usage de la force est redoublée par la difficulté à en énoncer le sens. Néanmoins, l’abandonner définitivement à l’État revient à s’ôter le droit au conflit. Et contrairement à ce qui est prétendu, cet abandon dessine moins un art de vivre ensemble qu’une commune résignation.

Ouvrir un front et ressusciter le politique
C’est pourtant la « violence » qui crève l’écran en même temps que la zad à l’automne 2012. Les médias, friands comme à leur habitude de clichés spectaculaires, ont alors largement propagé la figure du jeune cagoulé, maculé de boue, vilipendant la presse bourgeoise derrière sa barricade de fortune et caillassant les forces de l’ordre venues raser les cabanes. Mais là où une telle image a souvent comme principal effet d’isoler une lutte dans sa gangue radicale, l’inflexibilité de la pratique, son intransigeance, sa ferveur intraitable ont cette fois-ci au contraire marqué les esprits et emporté les sympathies. Le solide ancrage du mouvement depuis des années dans le paysage politique, et la détermination commune de tous à résister qui a transcendé la diversité des pratiques, ne sont évidemment pas pour rien dans ce retournement de l’infamie contre les dépositaires de la violence légitime. Une figure d’espoir est née, démontrant en actes qu’on peut encore accrocher le réel et obliger le gouvernement français et ses gardes mobiles à battre en retraite. Ce caractère un brin bagarreur n’était certes pas une évidence à priori pour tous les opposants à l’aéroport ou au TAV, mais à mesure que les projets d’infrastructures sont devenus de plus en plus tangibles, la « violence » s’est lovée dans la conflictualité de ces mouvements qui n’ont plus pu faire l’impasse sur l’usage des pierres, des tracteurs-barricades et des bouteilles incendiaires. Les chicanes et longrines(4) qui peuplent les fossés des routes de Notre-Dame témoignent bien d’un refus de toute pacification ou d’une fin des hostilités, puisqu’au point où en est rendu le combat, cela reviendrait à une reddition. Plus remarquable encore, c’est que loin de s’excuser de cette radicalité, ces mouvements ont réappris a en être fiers, à s’enorgueillir de ne pas baisser la tête, à tenir des positions et des pratiques qui ne semblaient plus admissibles dans une lutte populaire. Elle a donné lieu à la constitution d’imaginaires hétéroclites empruntant tout autant à Astérix et son village imprenable, qu’aux actions coup-de-poing de l’autonomie italienne des années 1960 à 1980.
Les conflits du No TAV et de la zad s’intègrent également dans l’histoire immédiate des quinze dernières années, qui ont vu surgir des retours spectaculaires de la conflictualité, souvent médiatiquement réduits à l’étiquette « black bloc », au sein des mouvements sociaux mais aussi antimondialistes et indignés. En Italie, on se souvient de leur irruption dans les manifestations anti-G8 à Gênes au début de l’été 2001. L’assassinat de Carlo Giuliani par un carabinier au cours de l’émeute, les centaines de manifestants blessés dans la rue ou lors des descentes de police les nuits suivantes dans les locaux militants, furent autant de blessures qui ont traumatisé durablement les activistes de la péninsule. À la répression policière avait succédé une vague de condamnations quasi unanimes de la part de tous les organisateurs de l’événement vis-à-vis des émeutiers, accusés au mieux d’être des irresponsables, au pire d’être manipulés par la police. Un drame politique se superposant à un drame humain, la perspective de discuter à nouveau de possibilités révolutionnaires se voyait du même coup renvoyée à d’autres lendemains. Ce sont les Valsusains qui, dix ans plus tard, à l’occasion des manifestations de l’été 2011 à la Maddalena, viennent rouvrir ce possible en affirmant « nous sommes tous des black bloc ». Certaines manifestations No TAV sont ouvertes par la mère de Carlo, Heidi Giuliani, qui s’est liée d’amitié avec la vallée. Le 15 octobre de la même année, à Rome, conséquence peut-être de la propédeutique No TAV de l’été, un rassemblement des Indignés se transforme en long affrontement avec les carabiniers. Au milieu des agences bancaires détruites et des projectiles qui volent en tous sens, un bus de police est en flamme ; sur la tôle de sa carrosserie, un slogan : « Carlo Vive. »
Si la zad et le No TAV ont contribué à rouvrir la possibilité d’un affrontement, il n’en demeure pas moins que le terme « violence » charrie malgré tout des ambiguïtés qui incitent à toujours s’y rapporter avec circonspection. Il énonce le jugement de l’État, depuis lequel il est bien délicat de se définir, que l’on parle de « réappropriation de la violence » ou de « non-violence ». Selon qu’on en limite la portée aux impacts physiques ou qu’on l’étende aux effets psychiques, qu’on entre dans la délicate – et souvent fallacieuse – question de déterminer qui se défend et qui attaque ou qu’on essaie de tracer une délimitation de ce qui est légitime en fonction de critères stratégiques, éthiques ou politiques, la définition en sera fluctuante, et finalement peu propice à construire une pensée de l’affrontement. Ce qui importe est moins le positionnement vis-à-vis de la violence (qu’on la revendique ou la rejette), que la détermination à ne pas se laisser arracher la possibilité d’être radicalement en désaccord avec les décisions de l’autorité. Si les mots pour parler du conflit sans en faire une malédiction à conjurer n’ont pas encore éclos dans nos bouches, ces deux luttes ont activement contribué à en énoncer quelques syllabes.

Des conditions pour qu’un front perdure : asymétrie et équilibre
Ouvrir un front et le tenir, c’est aussi s’exposer à recevoir des coups. L’État n’accepte évidemment pas passivement qu’on remette en cause le périmètre de son pré carré. S’il tente régulièrement de rétablir une situation pacifiée en tendant la main aux opposants les moins virulents, la persistance et la radicalité des luttes à Notre-Dame ou en Val Susa l’obligent dans le même temps à durcir et à militariser un peu plus sa présence pour garder plusieurs longueurs d’avance en matière de force de frappe. Ce faisant, il reconnaît et avalise lui aussi l’existence de ce « front intérieur ». Le déploiement de l’armée italienne tout juste revenue d’Afghanistan, la mise en place de tribunaux d’exception ou la construction à la Maddalena de murs dignes des frontières les plus imperméables ne laissent plus de doute sur l’existence d’un conflit physique au sein même de la nation. Ce conflit, la police seule ne suffit pas à l’endiguer et sa persistance constitue un accroc dans l’image d’une société prétendument pacifiée. Les oripeaux de la guerre s’érigent donc dans la vallée, une guerre avec l’État, mais qui n’est pas une guerre civile, puisqu’aucune frange de la population ne s’oppose ouvertement aux No TAV. Les forces de l’ordre défendent seulement l’autorité de l’État, sa capacité à faire respecter ses prérogatives sur ses administrés. Cette militarisation intérieure ne doit pas masquer que si guerre il y a, les belligérants n’y sont absolument pas engagés de la même façon.
Ce n’est qu’en envisageant l’asymétrie fondamentale de ce conflit que l’on peut comprendre le fait que les mutins tiennent bon et ne soient pas écrasés militairement, malgré l’énorme disproportion de moyens. Cette asymétrie ne tient pas à la simple différence de force entre les adversaires qui, tels David et Goliath, se battraient en duel. Elle tient à leur nature même : une part du corps social affronte l’institution qui prétend le représenter dans son entier. Une faille s’opère donc au sein de l’abstraction qui légitime l’État, par où s’échappe et se construit une forme de sécession. En même temps que cette part rebelle de la population se distingue, en même temps qu’elle se soustrait, son aire d’influence et ses frontières ne cessent d’évoluer. Le front bien identifiable, celui qui se dessine sur les lieux mêmes de la construction de la ligne à grande vitesse ou de l’aéroport, se redouble d’un second qui est quant à lui tout autre chose qu’une ligne droite autour de laquelle des armées se toiseraient. Il est flou, mouvant, difficile à cerner, et cette guerre-là n’a donc aucune commune mesure avec celle que se livrent deux États ou deux forces similaires dont les positions pourraient être clairement distinguées. Il s’agit davantage d’un « kyste » qui se développe et se métastase, comme l’a si bien exprimé le Premier ministre français. Cette intériorité du conflit rend la tâche bien difficile à l’appareil répressif qui ne peut se permettre d’envisager un anéantissement pur et simple. Car à souligner l’existence de ce front, il risque d’admettre que c’est l’unicité qui le fonde qui est remise en cause. Pour assumer le conflit, il n’a donc pas d’autre choix que de tenter de circonscrire les limites de l’adversaire, de le figer en un sujet qu’il pourra éjecter pour mieux le combattre et le vaincre.
Pour cela il dispose d’une méthode d’autant plus fiable qu’elle cache son jeu. La répression, en venant rendre chaque geste de résistance plus pesant et en faisant naître des envies de vengeance, ne se contente pas de dissuader, elle attire aussi sa cible sur son terrain. En frappant, l’État pousse la partie opposée vers une certaine paranoïa, voire, selon le degré de bravoure ou d’orgueil, vers une contre-attaque. Ainsi espère-t-il la délimiter à sa part capable de réagir et créer ce face-à-face où elle n’a aucune chance. Produire l’ennemi afin d’ensuite le détruire est une vérité de la répression qui s’énonce dans les traités contre-insurrectionnels inspirés des guerres de décolonisation. Cependant la méthode n’opère pas toujours, notamment quand, comme dans les cas du mouvement No TAV et de la zad, la confrontation avec le pouvoir part d’un point extrêmement précis, situé, et qu’elle est profondément enchevêtrée dans la population. Même si leur autorité est fondamentalement remise en cause, les États français et italien peuvent difficilement accuser les mouvements dans leur ensemble d’attenter à leur sécurité quand il ne s’agit que de l’opposition à un projet d’infrastructure. Et leurs tentatives d’isoler une frange radicale et offensive se heurtent inlassablement à la réalité des liens qui unissent de proche en proche tous les opposants et à celle de la répartition de la colère et de la détermination qui est loin de suivre les frontières des tendances politiques.
À chaque fois qu’une des parties tente d’enfreindre cette asymétrie du conflit, elle risque de tomber à côté du champ de bataille. Comme quand un ancien président PS de la région Pays-de-la-Loire suggère d’éliminer les zadistes avec les méthodes appliquées contre les jihadistes au Mali(5). Ou quand un mystérieux communiqué enjoint les No TAV à prendre les armes et à entrer en lutte ouverte contre l’État. Le mouvement prête attention quant à lui à ne pas franchir certaines limites. Il y avait sans doute dans les bois de la Maddalena le 3 juillet 2011 quelques No TAV qui auraient été tentés par l’opportunité rare de se venger radicalement des carabiniers. Pourtant quand le brigadier Di Matteo tombe entre les mains des manifestants, abandonné par ses collègues après une charge, le lynchage tourne court. Dans le sous-bois où se discute son sort, les arguments qui sauveront sa peau de flic sont autant éthiques que stratégiques. Les conséquences qu’entraînerait pour la lutte une telle gradation dans la conflictualité ont été immédiatement perçues. On peut aussi ajouter une considération plus politique, qui révèle bien l’enjeu du conflit : il ne s’agit pas d’anéantir physiquement l’ennemi, quand bien même ce serait possible, mais de se défaire de son emprise.

La stratégie de l’aïkido politique et ses limites
Cette soustraction aux opérations de l’adversaire n’est pas toujours le résultat d’un calcul conscient et savamment orchestré par les opposants. Même si ce genre de pari politique anime constamment certaines franges des deux mouvements et a été déterminant à bien des moments, les options stratégiques émergent souvent d’un maelström bouillonnant d’intuitions et d’élans qui peuvent être contradictoires. Difficile alors de saisir toutes les opportunités, et certains No TAV regrettent par exemple de ne pas avoir profité de l’élan victorieux de Venaus et des Jeux Olympiques qui se préparaient en 2006 dans la vallée, bref d’une position de fébrilité de l’État italien, pour lui arracher un arrêt définitif du TAV. Car quand quatre ans plus tard il est revenu, c’est en imposant son rythme, son intensité, et ses champs de bataille.
Leur position d’agressés répondant à leur agresseur n’est pas sans effet sur les possibilités tactiques de ces mouvements. Il leur est de ce fait plus naturel et facile de réagir, ou d’anticiper un geste prévisible de l’adversaire, que de tracer leur propre ligne d’action comme le ferait un groupe politique avec son organisation, son programme et ses congrès. Ils se retrouvent donc fréquemment à subir la situation. Mais alors qu’on pourrait y voir un désavantage certain, la pratique d’une forme d’aïkido politique renversant les attaques de l’adversaire contre lui-même tire au contraire avantage de cette position. Et parvient ainsi à arracher quelques-unes de leurs plus belles victoires.
Les stratèges militaires le savent bien : plus que tout autre, l’assiégeant court le risque d’être assiégé à son tour, surtout quand il opère au cœur d’un territoire hostile. Quand les forces de l’ordre viennent expulser le presidio de Venaus ou les cabanes de la Châtaigne pour ôter au mouvement ses lieux d’organisation, c’est elles qui se retrouvent finalement contraintes d’évacuer, submergées par la pression populaire qui les entoure. Et quand la présence policière parvient tant bien que mal à s’installer plus durablement au carrefour de la Saulce ou à la Maddalena, les opposants tirent encore une fois avantage de la situation en dénonçant cette force d’occupation illégitime. La défaite militaire devient une prise politique, une situation stimulante pour l’inventivité de la lutte, car se cristallisent alors une cible claire, un lieu de harcèlement de l’ennemi et de croissance du mouvement. Les secteurs des checkpoints policiers dans le bocage et la vallée font aujourd’hui partie du patrimoine de la lutte, contribuant à former toute une génération politique aux escarmouches et autres sabotages. Une réinvention de la guérilla sans fusils ni clandestinité, ajustée en cela à la situation de la lutte, et qui lui ouvre de nouveaux horizons. Les pratiques s’inscrivent alors dans des expériences très concrètes où leurs rythmes, leurs sens et leurs conséquences doivent être analysés et réfléchis.
L’humour est également mobilisé pour retourner les opérations ennemies contre elles-mêmes, semant une dérision dont ne seront jamais capables les tristes sires qui en font les frais. Quand la préfecture de Loire-Atlantique fantasme une reprise des travaux en lançant un appel d’offres aux entreprises de BTP, les occupants répondent par leur propre « appel d’offres » à venir contribuer à construire la zad, qui, lui, sera suivi d’effet avec près d’un millier de personnes venues seules ou en collectif participer sur place à une trentaine de chantiers. Quand les promoteurs du TAV proposent de retirer leurs plaintes et de lourdes amendes en échange de garanties de pacifisme de la part des No TAV, ceux-ci leur proposent en retour d’évacuer immédiatement leur chantier faute de quoi ils ne pourraient garantir l’absence de nouveaux dégâts sur les machines.
Enfin, plus décisif encore : jamais sans doute le mouvement anti-aéroport n’aurait imaginé revendiquer une indépendance territoriale des 1650 ha de la zad. Ce sont sur de tels objectifs que les mouvements autonomistes régionaux se sont tant de fois cassé les dents, peut-être justement parce que leur but affiché était cette indépendance, ce qui n’est pas le cas à Notre-Dame-des-Landes. C’est incidemment, dans la déroute de l’opération César, dans la reconnaissance d’une impossibilité à maintenir l’ordre sur ce territoire, que cette autonomie est devenue, de fait, et dans une relative douceur, une perspective durable pour la lutte. Et ce jusqu’à obtenir la reconnaissance implicite des dirigeants eux-mêmes, qui se lamentent périodiquement de l’existence de cette zone de non-droit-où-la-police-ne-rentre-plus. De la même manière, c’est face aux risques de travaux imminents que les Libres Républiques sont apparues, mais jamais ces Communes n’ont été préméditées et formellement préparées. Elles ont été libérées, elles aussi, après un revers infligé aux forces de l’ordre mises à l’arrêt à la Maddalena devant une barricade, et acculées par un siège inattendu à Venaus. Mais ce ne sont pas là des victoires dues à une supériorité de la force physique des opposants. Si l’État n’a pas contre-attaqué immédiatement, ce n’est pas en raison d’une possible défaite militaire, mais d’une impossibilité politique à user du degré de force nécessaire à la reprise des lieux. Cette mise en échec a laissé éclore sur ses talons les germes de Communes libres.
Néanmoins, la stratégie du retournement trouve aussi ses limites, notamment dans les salles sombres des tribunaux. Les offensives se durcissent, les stratégies judiciaires changent. Avec le maxi-procès, les No TAV ont eu un aperçu des conséquences d’une répression massive touchant un mouvement populaire dans son entier. L’intégration des logiques de l’état d’urgence dans la Constitution française augure elle aussi de belles entorses aux prétentions démocratiques et un accroissement des moyens pour mater les récalcitrants. Il n’y a pas de réponse évidente à l’ascension mécanique de cette attrition, de cette friction. Le chantier de la Maddalena est chaque jour la démonstration qu’il est possible au TAV, malgré une opposition farouche, de continuer à avancer.
L’hypothèse de certaines théories révolutionnaires selon laquelle l’augmentation de la répression, déchirant le voile tendu sur les rouages secrets de l’État, révélerait au peuple le caractère intrinsèquement violent de la société et entraînerait celui-ci vers une insurrection généralisée, semble ne plus être au goût du jour. Le durcissement de la répression est plutôt perçu avec inquiétude dans la vallée et le bocage. D’autant que l’exemplarité de ces deux luttes décuple en retour la portée des coups de l’adversaire. Mais si cette situation particulière « [leur] coûte quelques complications », selon les mots d’un paysan de la zad, elles ne se dérobent pas pour autant à leurs responsabilités historiques. Elles ont suivi le fil des lignes de conflit qui ont émergé autour de l’aéroport et du TGV jusqu’à dérouler toute la pelote. Cette propension à généraliser la bataille, que ce soit en nouant des liens avec des luttes sœurs ou en démultipliant les fronts, démontre qu’à la zad comme dans la vallée, on assume les dimensions pratiques, physiques, mais également politiques du conflit. La dernière s’est faite le héraut des oppositions à des projets d’aménagement dans toute l’Italie, et ce qui fermente de la commune à Notre-Dame-des-Landes ne peut se concevoir sans trouver à se relier avec les dizaines d’autres foyers qui se sont reconnus dans le slogan « zad partout ». Des deux côtés des Alpes, se pose désormais la question des formes que pourrait prendre un mouvement des mouvements.
La version "Lyber" de CONTRÉES est disponible ici.






