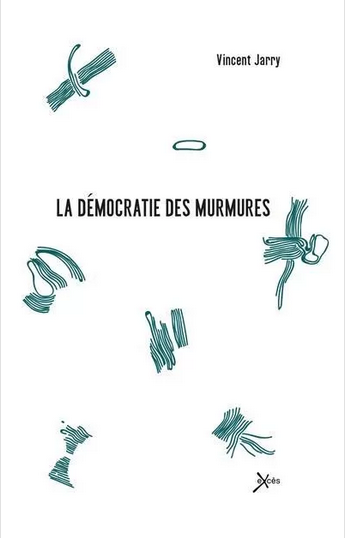Je suis souvent instruit par tes articles dans Le Monde Diplomatique, souvent ravi par La Pompe à phynance mais cette fois plein de choses ne vont pas. J’ai été beaucoup en colère en lisant Vivre Sans ?, et je me demande si la fougue de pamphlétaire et l’amour de la polémique n’ont pas été dommageables à la qualité de l’analyse.
Le problème auquel tu t’attaques est essentiel. On est en plein dedans depuis longtemps, plus encore avec tous les mouvements qui s’enchaînent depuis 2016, les ZAD, les Gilets Jaunes et la brutalité par laquelle les gouvernements y répondent.
Je le reformule rapidement comme ça :
— Quelle forme d’organisation politique peut être efficace contre ceux qui nous font la guerre et détruisent nos vies ? Les forces d’en face sont puissantes et très organisées, ne rendront pas les clés de gaîté de cœur ; les questions de la violence et de l’affrontement ne peuvent être éludées. La désertion ne peut sans doute pas suffire.
— Pour être efficaces dans la lutte, il faut sans doute d’abord que nos formes d’organisation soient attirantes pour un grand nombre de personnes, parce que le renversement de l’ordre existant ne peut pas se faire simplement avec quelques esthètes, virtuoses, super-militants, avant-garde ou je ne sais quoi du même type. Or les formes traditionnelles de l’action politique sont détestées. Mais la spontanéité peut-elle plus ou mieux que les bonnes vieilles organisations dont plus personne ne veut ? etc, etc.
Notre bourbier habituel en somme.

Malentendus ou sourde oreille ?
Ce qui m’a mis en colère, c’est que ce livre qui pose ces bonnes questions rajoute souvent de la confusion au problème qu’il se proposait d’éclaircir. Une raison principale donne lieu à des confusions en cascade : la lecture souvent caricaturale ou maladroite des philosophes auxquels tu t’attaques (Deleuze, Rancière, Badiou, Agamben), qui te mène à une sous-estimation de leurs hypothèses et donc à construire des fausses oppositions qui sont au mieux superflues, au pire nuisibles. Le livre donne l’impression que tu ne les prends pas au sérieux, en réduisant leurs positions à des énoncés impuissants ou absurdes.
Je m’arrêterai principalement sur la sous-estimation de l’importance des rapports entre esthétique et politique. Principalement contre Rancière et Deleuze, tu réduis leurs considérations esthético-politiques à des fuites désespérées, échecs qui ne s’avoueraient pas être tels, se payant de mots en affirmant être « la continuation de la politique par d’autres moyens ». C’est pour moi la grande erreur de fond de ton livre.
Je ne reviens pas longuement sur les constats du premier chapitre, justement intitulé « L’Enfer des institutions », que je partage dans l’ensemble. Quelques rappels seulement pour éclairer la lecture de la suite : tu affirmes le « devenir-infernal » de ce que nous entendons habituellement sous le terme « institutions » (État, police, université,…). Ces structures connaissent une « dégénérescence autocentrée », ne vivent plus que « d’après des finalités internes », dans « l’oubli grandissant des finalités externes » [1]. Ce constat, qui était déjà celui de Simone Weil dans sa Note sur la suppression générale des partis politiques [2], t’amène à ton propos : ces institutions sont pourries, mais des institutions il y en aura toujours, on ne peut pas « vivre sans ».
Voilà le constat permettant la grande caricature qui court jusqu’à la fin du livre, même quand il est question d’analyser des expériences concrètes [3]. La grande ambiguïté portée par le terme d’institution te permet ces caricatures, du fait de la définition très large que tu finis par en donner : « J’appelle institution tout effet, toute manifestation de la puissance de la multitude [4] ». Ce qui est curieux, c’est que tu anticipes toi-même la critique qu’on te fera, parce qu’on te l’a déjà faite à plusieurs reprises : « ah d’accord, c’est ça pour toi les institutions, mais alors c’est tout et n’importe quoi ». Seulement cette définition vient plus de cent pages après le début du texte, montrant enfin que ta critique de Deleuze, Rancière, Agamben et ceux qui s’en réclament tient surtout au fait que vous ne parlez pas de la même chose.
Cette définition est pourtant le soutien principal de l’argument du livre : des institutions, il y en aura toujours, reste à savoir lesquelles on veut. Tout cela est très bien, mais une fois qu’on a dit ça, on se demande qui sont les adversaires à qui tu t’en prends, parce que personne à ma connaissance n’a déclaré que la bonne politique devrait consister à arrêter de se serrer la main ou d’utiliser le langage pour être enfin libres et égaux. Personne, en d’autres termes, ne prétend vivre sans « institutions », au sens où tu entends le terme.
C’est le problème logique de toute l’argumentation : à chaque fois, tu prends une définition très large d’un terme pour réduire à l’absurde un concept qui avait du même terme une acception plus spécifique :
On ne va pas vivre sans institutions, puisque même le langage est une institution ; on ne va pas vivre sans police, puisque « police » signifie « tout dispositif institutionnel d’accommodation des différends internes à un collectif [5] », on ne va pas vivre sans État si l’État est « un certain ensemble humain (à échelle macroscopique) appareillé dans une certaine configuration institutionnelle [6] », etc. Mais à un tel niveau de lâcheté de la définition, l’argument apparaît bien souvent comme une enfilade d’évidences, alors même que tu te dis soucieux d’éviter les malentendus nominaux. Mais laissons la logique générale pour le vif du sujet.
Éthique, esthétique : des coquetteries radicales
Il me semble que le problème principal du livre tient à ce que tu ne prends pas au sérieux les considérations esthétiques ou éthiques de ceux à qui tu t’attaques. Le fait que Deleuze et Rancière parlent de politique de l’esthétique t’apparaît comme l’aveu d’impuissance de leurs conceptions politiques. Cette critique leur a été faite de nombreuses fois. Cela ne t’empêche pas d’en remettre une couche : « Ici en général, les deleuziens se récrient : l’esthétique n’est en aucun cas une solution de désertion ou de retraite. Tout au contraire : une manière de relancer la politique sur un autre terrain, le terrain de la création ».
Cela ne te convient pas, parce que tu réduis cela au discours effectivement très agaçant et souvent sans aucun effet subversif de ceux qui disent que « créer c’est résister, résister c’est créer [7] ».
Seulement, le lien entre esthétique et politique ne se réduit pas, loin s’en faut et heureusement, à la question de « l’art engagé », souvent bonne conscience morale à peu de frais, parfois même position juteuse sur le marché de l’art. Au cours de quelques dizaines d’années de travail, Jacques Rancière nous a pourtant mis la puce à l’oreille sur ce sujet, montrant que le passage à des analyses sur l’esthétique est tout sauf une fuite impuissante. Travailler le rapport esthétique/ politique, c’est interroger les manières de régir le sensible et le monde commun que portent avec elles les formes de ce que nous entendons par « politique » : « Aujourd’hui encore, il importe de pouvoir juger si ce que nos institutions, nos images et nos discours imitent est l’espérance démocratique ou son deuil.
Réflexions où la philosophie peut se trouver impliquée, sans prétendre y donner les leçons [8] ». Analyser nos institutions, images ou discours en termes esthétiques veut aussi dire les regarder en termes de cohérence interne, voir s’ils sont susceptibles d’être enthousiasmants, crédibles, ou si au contraire la différence entre les fins proclamées et les moyens mis en œuvre est trop béante pour attirer qui que ce soit. Ne reste alors que le deuil.
Le contexte d’écriture de Deleuze et Rancière est aussi celui là, l’analyse de nos échecs, de nos maladresses, de toutes les fois où nous avons nous-mêmes mis le ver dans le fruit. Loin d’être une pensée détachée des questions de l’efficacité, la politique de l’esthétique est une radicalisation de la recherche : elle est radicale parce qu’elle pose la question du premier lien entre les militants et les gens auxquels ils s’adressent. Ce premier lien sera-t-il seulement possible ?
La réflexion sur ces formes est une radicalisation de l’analyse. Pour toi, c’est l’inverse : « dire qu’une pensée de l’esthétique est une pensée de la politique poursuivie par d’autres moyens me semble par conséquent un argument assez spécieux [9] ». Sans appel, tu réduis cette pensée à « la poésie militante incapable de mobiliser les ouvriers ». Très franchement, pour quelqu’un qui prétend être à « contre-sens de son époque [10] » c’est réussi, ça ressemble à une caricature d’arrière-garde…
Car si une pensée de la politique est, pour ce qui nous intéresse, une réflexion sur les possibilités d’une action commune efficace en vue de la transformation du monde (définition sur laquelle on imagine que tu seras d’accord), l’esthétique est autre chose qu’un collier de fleurs. Avec la poésie, tu balaies d’un revers de main rigolard la recherche de « nouvelles modalités d’énonciation ». Pourtant, d’un point de vue logique autant que chronologique il est essentiel de se demander comment on rentre en relation avec ceux qu’on veut toucher ou convaincre, tu en conviendras. Or les modalités traditionnelles d’appel au peuple ou à la résistance, au « Grand soir » auquel tu reviens à la fin du livre d’ailleurs, battent quand même un peu de l’aile, et depuis un moment… Pour quelqu’un qui affirme la nécessité d’une politique du nombre, la question de la possibilité du premier lien aux autres devrait compter.
C’est à ce battement d’aile que se sont frottés les Rancière et Deleuze que tu remises bien vite, notamment au motif que leur politique refuse la notion de « projet », qu’elle serait « sans trop d’égards pour l’idée de destination [11] ». La politique rancérienne se résumerait à défaire l’ordre policier, et donc à bifurquer : « Bifurquer pour où, bifurquer pour quoi, peu importe à la limite : bifurquer [12] ». Le refus du « projet » se transforme pour toi en une sorte de relativisme étonnant, comme si le changement était la seule valeur. Ce n’est évidemment pas la position de Rancière, dont tout le travail est tendu par le principe d’égalité. C’est ce principe qui nourrit le refus du projet, le refus du déploiement de l’action sur un mode stratégique, ces notions ayant été dans l’histoire politique récente, pour le dire vite, la justification d’un certain nombre de sacrifices de l’égalité ici et maintenant au nom d’un avenir incertain. Et comme l’affirmation seule n’a pas empêché que des révolutions soient trahies dans le sang et la boue, il s’agit que toute notre organisation politique soit cohérente avec le principe. Qu’elle soit comme la métonymie du monde que nous voulons.
L’exigence égalitaire ne signifie pas que la politique n’existerait qu’en de rares moments et que le reste du temps serait consacré à la morosité en attendant le prochain miracle. « Entre deux moments de grâce », comme tu dis, et bien on se prépare, on essaie de se rendre un peu plus cohérents avec ce qu’on veut. Ça a le mérite d’être immédiatement en notre pouvoir. On essaie, pour baragouiner le Spinoza, de composer notre rapport d’une manière plus adéquate avec nos principes. « Sera dit bon (ou libre, ou raisonnable, ou fort) celui qui s’efforce, autant qu’il est en lui, d’organiser les rencontres, de s’unir avec ce qui convient à sa nature, de composer son rapport avec ce qui est combinable à lui et par là d’augmenter sa puissance [13] ». Peut-être que la lutte sera alors plus attirante pour des gens qui jusqu’ici n’ont pas milité, qui n’ont souvent eu sous les yeux que les passions tristes de l’héroïsme sacrificiel et de l’appel à rejoindre les derniers résistants dans la citadelle assiégée. Comme ces gens ont peut-être déjà un papa, un patron, un mari ou des bureaucrates dont les commandements les agacent, l’enthousiasme n’est sans doute pas à chercher du côté des mots d’ordre de stratège ou de militant maître d’école.
Institutions désirables et virtuosité démocratique
Cette vertu de la cohérence est donc loin de l’histoire du colibri de Rabhi qui fait sa petite affaire, ayant au moins la conscience tranquille. C’est une réflexion sur la possibilité du nombre qui ne se contente pas d’en appeler au nombre. Elle commence par le « travail sur soi fondamental dans toute démarche d’égalité [14] », se demandant entre autres pourquoi les rencontres précédentes ont échoué. C’est peut-être notre meilleure chance.
Ces hypothèses semblent d’ailleurs moins éloignées des tiennes que ce que tu dis. L’éthique et l’esthétique au prisme des conditions de cohérence qui favorisent un certain enthousiasme sont assez proches de ce que tu développes sur l’intérêt dans le chapitre sur Badiou. Tu soupçonnes chez lui une politique de virtuose au sens de « héros désintéressé » [15]. Je ne sais pas pour Badiou, mais comment ne pas être d’accord avec toi sur le fait que le désir, l’intérêt, comptent ? N’est-ce pas justement un des avantages des expériences comme la ZAD : objets de désir immédiatement perceptibles, intéressants ici et maintenant sans être suspendus à une promesse lointaine aux conditions douloureuses et incertaines ? ; souci d’espaces « safe » où se travaille la qualité du lien entre les individus autant que l’offensive, bien mieux que dans des groupements qui sont de simples agrégats en vue de l’accroissement de la puissance, fonctionnant en conséquence par caporalisation : les partis désertés n’ont que ce qu’ils méritent.
J’en comprends d’autant moins que tu refuses le dialogue au travail de Rancière sur le plan pragmatique : « Ici bien-sûr, il ne s’agit pas de poser la question de l’utilité », dis-tu. Pourquoi ne pas la poser ? L’intérêt pratique de son travail réside à mon avis précisément dans ce que tu dénigres, dans cet approfondissement esthético-politique qui permet de mieux cerner des points aveugles de nos manières de militer (d’agir, de nous organiser, de parler aussi). C’est une des choses qu’on peut en faire, il y en a sans doute plein d’autres. Ça me semble en tout cas plus intéressant que de simplement « se faire Rancière » en lui ressortant les vieux arguments sur la politique exceptionnelle et rare, « voilà, y’en a combien des prolétaires qui lisent la nuit ? », arguments auxquels il a d’ailleurs souvent répondu de manière assez claire pour dissiper la galéjade [16].
Au lieu d’en faire l’affaire de « quelques virtuoses », on peut tirer sa politique du côté d’une virtuosité au sens machiavélien du terme, de cette virtù [17] consistant à adopter les manières qu’il faut au moment où il le faut. Pour ce qui nous concerne, en cherchant à réunir les conditions d’un mouvement de masse dans des conditions démocratiquement désirables. La virtuosité en ce sens ne s’oppose nullement au nombre. C’est un souci de cohérence interne, peut-être le plus essentiel pour favoriser le lien avec des milliers d’individus qui ne s’en laissent plus conter et ne croient que ce qu’ils voient. J’ai développé cette hypothèse dans La Démocratie des murmures [18].
De même, ce que tu vois comme l’obsession de l’inséparation chez Agamben m’apparaît plutôt comme un pari (tu dirais stratégique) sur le primat de la perception. L’éthicisation de la politique, comme son tournant esthétique, n’est nullement une manière de botter en touche. Elle touche le cœur du problème et une partie de la solution : si la notion de « projet » est refusée par Deleuze, Rancière et Agamben, c’est parce qu’avec elle la fin justifie éventuellement des moyens impropres, et donc rebutants. Ta critique apparaît alors comme celle d’une sorte de Péguy raillant Kant : « le kantisme a les mains pures mais il n’a pas de mains ». Il me semble que dans notre contexte la chose se retourne : pour avoir des mains il faut qu’elles soient propres.
Sans cela pas grand monde pour venir les saisir, à part ceux qui sont déjà nos camarades, et parfois avec un juste dégoût. Avec cette interprétation, l’opposition « par le nombre ou par l’éthique ? [19] » me semble tomber d’elle-même. De même, la recherche de « l’indistinction entre ce que l’on est et ce que l’on fait [20] » peut partir d’un souci radicalement démocratique.
La « suspension de la puissance » que tu critiques chez Agamben me semble aussi pouvoir être lue de cette manière. Là je marche un peu plus sur des œufs, parce que je ne le connais pas autant que Rancière, mais allons-y. La puissance doit « se suspendre, se retourner sur elle-même, pour, dans ce retournement, entrer dans un régime d’effectuation qui s’est soustrait à la conduite des dispositifs [21] ». De cela tu tires la conclusion que la puissance chez Agamben ne se soucie pas de ses conséquences, ce qui me semble d’une mauvaise foi incroyable. S’il s’agit de se défaire de la « structure télique » de l’action, c’est à dire de la visée de quelque chose qui n’est pas soi, il s’agit bien d’un régime d’effectuation. D’une visée donc, mais du prolongement idoine de ce qui est déjà là plutôt que d’un but lointain. Souci éthique de cohérence, toujours.
De même, la « puissance de ne pas » à laquelle Agamben se réfère te semble absurde.
L’argumentation sur le réel semble alors tributaire d’une sorte de partie de Jacques-a-dit dont le Jacques s’appelle Spinoza : Spinoza a dit « toute puissance s’effectue, donc l’idée de puissance retenue est absurde ». L’opposition classique entre l’acte et la puissance devra sans doute être gommée des programmes scolaires de philosophie aussi, comme un reste suranné de la période pré Jacques-a-dit ?
Ton argumentation spinozienne, sur ce point précis, me semble assez bancale : « toute puissance va toujours au bout de ce qu’elle peut [22] », cites-tu. Même si cela est vrai en un certain sens, c’est oublier qu’il y a des contradictions et qu’une puissance ne peut pas actualiser une chose et son contraire en même temps et sous le même rapport [23], même si elle peut, (en puissance) l’une et l’autre. Il y a parfois alternative, variété même. N’est-ce pas précisément là dedans que réside la liberté ? Dans le fait de se glisser autant que faire se peut dans les déterminations qui nous plaisent ? Un peu comme ce que dit Colette sur la quiétude, « le bien de ceux qui ont à jamais choisi une part de leur destin, et rejeté l’autre [24] ». On peut imaginer que dans ce genre de sentiments vienne se loger une détermination vigoureuse face à ceux qui voudraient nous en faire dévier. Seulement, une telle détermination se déploie mieux de proche en proche qu’au son du clairon.
Restons un instant avec la paix chez les bêtes :
Qu’un Lion d’un Rat eût affaire ?
Cependant il advint qu’au sortir des forêts
Ce Lion fut pris dans des rets
Dont ses rugissements ne le purent défaire.
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents
Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage.
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage ».
La Fontaine, Le Lion et le Rat.
Si comme tu le dis avec Spinoza « rien n’existe sans que de sa nature s’ensuive quelque effet », rien n’implique qu’il s’agisse d’un unique effet nécessaire, il peut y avoir des effets contraires. Tu l’admets d’ailleurs quelques pages plus tard : « Se retenir, c’est mobiliser une part de sa puissance contre une autre part, bref c’est ne pas cesser d’être dans le registre des effectuations de puissance »… pour faire machine-arrière : « une puissance se suspendant est une contradiction dans les termes [25] ». Ça pourrait continuer un moment, sauf à admettre simplement que les termes « puissance », « suspendre » et « retenue » ne sont pas entendus de la même manière par Agamben, Spinoza et toi. « Depuis un point de vue spinoziste, on voit donc Agamben poser un problème qui n’existe pas pour lui apporter une solution qui n’a pas plus de sens [26] ». Exact. De même, en français le mot « dog » ne veut rien dire, alors qu’en anglais il signifie « chien ».
Avec le parti de prendre au sérieux Agamben, Rancière et Deleuze, les choses changent. La suspension de la puissance, ou le refus du projet, ou la vigilance face aux microfascismes sont des voies en apparence moins directes que l’appel au Grand soir. « Voies courbes mais irréversibles de la réappropriation de soi », dit Rancière [27], sans doute à même d’être plus sûres que les vieilles marmites de la pensée stratégique, viriliste et autoritaire. Je suppose que ces soucis sont aussi les tiens, comme en atteste à la fin du livre la judicieuse image des « cristaux liquides » pour éviter la formation de bureaucraties et penser nos institutions. La question qui demeure alors est la suivante : pourquoi avoir cassé tant de sucre ?
Le refus du projet comme la suspension de la puissance signifient qu’on va faire quelque chose d’autre, changer de manière de faire. Pas qu’on ne se soucie pas des conséquences, sauf à faire de Rancière, d’Agamben, des gens qui pensent et agissent avec eux de purs esthètes cyniques, ce qu’on peut supposer qu’ils ne sont pas. Or, d’Agamben, tu affirmes qu’il ne lui reste que le style, « seule chose à cultiver quand on a abandonné toute visée [28] ». Énorme.
Mais arrêtons-nous là sur cette partie en insistant encore sur deux choses.
Premièrement, il y des terrains qui sont ceux de l’ennemi. Il y est souvent plus fort que nous. Cela ne veut pas dire qu’on fuit dans l’esthétique ou l’attente du miracle, mais simplement qu’on s’organise autrement qu’avec ses manières et son calendrier : « encore une fois, de l’organisation il y en a toujours et partout. Pas besoin de se fatiguer à le claironner. La seule question c’est : qu’est-ce qu’on organise ? Pourquoi ? Et donc, comment ? ». Le souci d’institutions communes et durables entre les démocrates est bien présent chez Rancière : « on peut dire qu’il faut que la politique se donne des institutions : des partis, des écoles, des journaux, des universités, des coopératives, en sachant aussi que pour que ça ait un sens, il faut que ce soit des institutions de la politique », c’est-à-dire des institutions qui « [aient] pour but l’accroissement du pouvoir de n’importe qui [29] ». On est donc loin de la politique de quelques esthètes-virtuoses-stylistes. En fait, c’est même exactement l’inverse.
Deuxièmement, en politique « la puissance de ne pas » ou inaction active par excellence, c’est la grève. Il arrive que ça fasse des étincelles.
Et surtout la santé
Il ne s’agit pas de dire que ces choses suffiront à renverser le capitalisme. Bien malin qui en a la solution clé en main. Toutefois, les questions du désir et de l’intérêt, et le débat qui s’ouvre entre Félix Boggio Ewanjé-Epée et toi à partir de la page 246 est assez passionnant et me semble mettre le doigt où il faut. D’un côté, ton exposition de la solution de Bernard Friot a des aspects convaincants [30] mais contourne le problème, puisque les conditions de sa mise en œuvre sont très loin d’être réunies, gouvernement de gauche au pouvoir ou pas. De l’autre, on peut convenir assez facilement que le renversement du régime ne peut s’opérer par une masse de gens, et donc s’opérer tout court, si ces gens n’y trouvent pas avantage à un terme assez court : je ne crois pas plus que toi à l’héroïsme passionnel de masse. Ainsi, une partie de ce que tu dis sur l’éthique, en tant qu’elle impliquerait un certain nombre de privations, me semble assez juste. Difficile de faire l’économie du calcul coût/ intérêt, d’autant plus quand le renversement implique d’éventuels coûts physiques, vu l’ampleur de la répression. Cela même si il y a des révoltes qui ont pour catalyseur la dignité bafouée : l’arrogance de Macron n’est pas pour rien dans le soulèvement des Gilets Jaunes.
Mais restons-en à cette question du calcul coût/intérêt, ou de « balance affective [31] » si tu veux, dans les expériences de « vivre-sans » les institutions salariale et étatique. Je trace ça un peu grossièrement : beaucoup y gagnent en liberté et joie de vivre ce qu’ils perdent en pouvoir de consommation. On peut imaginer y gagner en santé aussi à moyen terme si ces expériences signifient aussi une alimentation plus saine : on a le temps de cultiver, on mange mieux, on est moins stressé si on évite les burn-out du militantisme et quand la pression policière n’est pas trop forte, etc. Sans parler de tous les gains affectifs et existentiels dans la rencontre avec d’autres vivants.
Il peut y avoir une perte de niveau de vie matériel, encore que cela se discute, notamment pour ceux qui tirent la langue au smic ou moins pour payer leur loyer dans les métropoles. Après il y a les coûts symboliques. Renoncer à un statut, donner du souci à sa famille éventuellement, être taxé de marginalisme. A mon avis ces choses là sont supportables et se guérissent à la chaleur humaine.
L’obstacle substantiel pour faire pencher la balance pour beaucoup de gens du côté de la désobéissance civile et de ses vies « sans », c’est la vieillesse et la santé. La peur. Comment la solidarité peut-elle s’organiser assez pour enlever cette peur du lendemain dans le cas où l’on ne peut pas ou plus subvenir à ses besoins ? Comment chasser la peur de mourir misérable et malade ou de voir les gens qu’on aime dans ces situations ? Alors on peut penser à la chaleur humaine encore, à la gratuité, aux caisses de secours mutuel d’avant l’étatisation de la sécurité sociale, au détournement de l’impôt… et pas seulement aux médecins cubains, c’est sûr. En tout cas c’est un des nerfs de la guerre, puisque évidemment la servitude n’est pas toujours volontaire.
Alors il s’agirait à la fois de saper la légitimité de l’État capitaliste et de faire la preuve qu’on peut soigner aussi, soigner mieux. Ici la gestion du Covid dans les Ephad a peut-être ouvert une brèche, relativisé dans beaucoup d’esprits la sécurité pour les vieux jours qu’apporte une vie salariée dévouée. Reste à mettre en face quelque chose de solide. Là dessus le Chiapas est très inspirant, comme tout ce qui montre que l’État n’est pas le garant du bien commun. Il nous faut donc du courage, de la lucidité, mais aussi rebâtir des assurances contre la précarité de l’existence.
Sur ce point ton opposition nombre/ éthique est effectivement importante. C’est à conjurer ça qu’il faut travailler.
La Destitution n’est pas le Déluge
Malheureusement tu ne construis pas cette opposition uniquement sur ces bases matérielles. Avoir rangé l’éthique et l’esthétique au rang des coquetteries superflues te conduit à opposer « politique du nombre » et politique des virtuoses d’une manière dont Félix Boggio Ewanjé-Epée s’étonne à juste titre : ce que tu qualifies de politique « des virtuoses », cela attire beaucoup de monde. Et là ta réponse est franchement déroutante : si ça leur plaît, « c’est typiquement de l’ordre du malentendu [32] », malentendu que tu t’empresses de nous expliquer. Qui joue au virtuose d’exception dans cette histoire ?
Plus bas c’est l’idée de destitution qui en prend pour son grade, avec l’argument suivant : partout où il y a multitude ou collectif, il y a toujours des institutions. Mais si c’est là la grande affaire, il se pourrait bien qu’il y ait consensus… Même chez Agamben, la destitution ne signifie pas qu’après ça il n’y a « rien ». Comme cela a très bien été rappelé ici, « la destitution est définie par Agamben comme le fait « de désactiver et de rendre inopérant quelque chose — un pouvoir, une fonction, une opération humaine — sans simplement le détruire, mais en libérant les potentialités qui étaient restées en lui inactivées pour en permettre un usage différent » ». Il ne s’agit donc pas d’un déni d’institution ou de verticalité comme tu l’affirmes à propos d’Agamben et des ZAD [33]. Des valeurs, des principes, il y en aura toujours et c’est heureux. Je ne crois pas que quiconque affirme le contraire, fût-ce celles qui se disent « ingouvernables » ou « sans-nom » (oui, « les sans-nom c’est encore un nom », et alors ?). Comme tu le dis, « il n’y a pas de vie collective qui ne se construise de quelque manière dans l’élément institutionnel ». « Ce sont de tout autres questions qui devraient nous occuper : des normes -puisque nécessairement il y en aura- mais lesquelles ? Conçues dans quel degré d’autonomie ou de distance de nous ? Avec quelles possibilités de révision ? Inscrites dans quelle sorte d’agencement institutionnel ? Pour quels effets sur nos puissances [34] ». Cela est bien dit, et on en convient depuis fort longtemps : personne ne se propose de supprimer toutes les médiations, d’être « un fou de guerre ou un pion isolé au jeu de tric-trac [35] », ni d’aller tout seul dans son coin manger des cailloux.
J’espère que tu me pardonneras le ton, mais à force de te voir jouer sur la polysémie des termes pour faire argument on s’agace. Affirmer vouloir vivre « hors des normes » ne signifie pas « hors de toute norme », vivre sans parti politique ne signifie pas qu’on ne prend pas parti, et, plus agaçant encore, le « chez nous [36] » de la ZAD n’a évidemment pas grand-chose à voir avec le « on est chez nous » de l’extrême droite. Il y a un chez nous identitaire et un qui fait du commun avec autre chose que de l’identitaire. Faire communauté à partir du principe égalitaire mis en acte plutôt qu’à partir d’identités assignées fait tout de même une sacrée différence. En disant que « ça peut devenir une identité de se reconnaître dans la désidentification [37] », tu fais comme si tout sentiment d’appartenance était identitaire, ce qui au minimum se discute. Tu railles ceux qui font commun à partir de ces désidentifications au motif qu’ils se priveraient au final des catégories et du langage, mais en l’occurrence c’est toi qui te prives d’une distinction précieuse entre communautaire et identitaire.
Avant de finir, je rappelle la juste référence que tu fais à Bourdieu, peut-être pour me justifier à mon tour : « tous les univers sociaux ont à se réfléchir, et aussi à être réfléchis - du dehors. Du dehors, parce que les forces de la complaisance sont de redoutables ennemies de celles de la lucidité, et que la réflexivité s’exerce toujours au risque du déplaisir de ne pas se voir exactement conforme à l’idée qu’on se fait de soi-même [38] ». Vertu de la critique. « L’objectivateur n’est donc exonéré de rien et, s’il est bourdieusien, il sait qu’il est exposé à tout moment à ce qu’on lui retourne ses propres procédés, ceci d’ailleurs le plus légitimement du monde [39] ».
J’ajouterai pour compléter ces phrases de Rancière qui illustrent bien ma perplexité devant ton livre : « est-ce qu’on est intelligent parce que les autres sont bêtes, ou est-ce qu’on est intelligent parce qu’ils sont intelligents ? C’est une maxime de type kantien : est-ce que je parie que la capacité de pensée que je m’accorde est la capacité de pensée de tous, ou est-ce que ma pensée doit se distinguer du fait que tous les autres sont crétins ? [40] ».
Je précise encore que ton livre a eu le mérite de bien me mettre au travail, qu’il m’a appris des choses à de nombreux moments, notamment les développements sur le fascisme, l’expérience de pensée sur la gauche au pouvoir [41] et le bourrage de crâne que subissent aussi les policiers. De même, la question des échelles est évidemment cruciale. Comme tu le dis très bien les solutions locales ne peuvent pas triompher du désordre global sans se fédérer sérieusement, et les îlots d’autre monde risquent toujours de se faire écraser par un pouvoir capitaliste-étatique qui les tolère de moins en moins, et qui « a conquis les moyens structurels de ne plus transiger [42] ». Du conflit il y en a, et il y en aura. Il y a pour autant des points esthétiques et éthiques qu’il s’agit de ne pas lâcher. A la fois pour ne pas risquer de devenir des monstres, mais aussi d’un point de vue tout à fait pragmatique, pour éviter d’être des maladroits. En d’autres termes, si tant est que l’expression soit encore récupérable, un Grand Soir ne se prépare pas avec de gros sabots.
Anosamicalement,
Vincent Jarry