In memoriam Florian
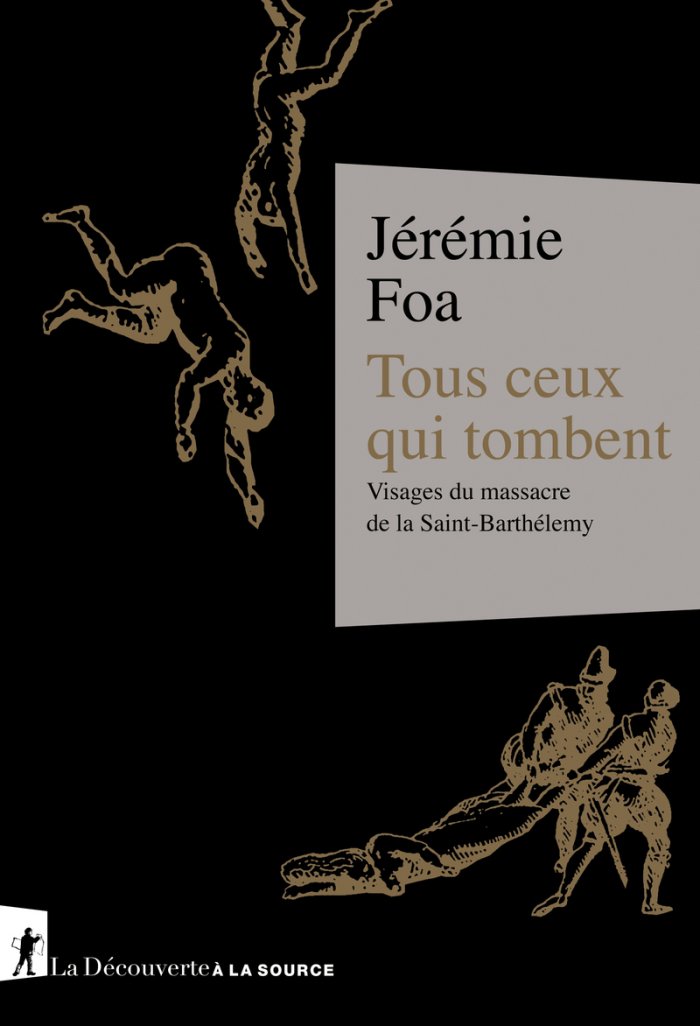
L’une des caractéristiques de cette tuerie (on ne sait toujours pas précisément combien de personnes ont été assassinées cette nuit-là, et durant les semaines précédentes et suivantes, par la police française) est que les tueurs se débarrassèrent le plus souvent de leurs victimes en les jetant dans la Seine [2]. Qu’est-ce qui ressemble plus à un corps (souvent déjà mort, ou grièvement blessé) précipité dans l’eau du haut d’un pont qu’un autre corps précipité, du haut d’un autre pont, dans le même fleuve ? Le bruit du plongeon et l’effroi qu’il suscite sont probablement les mêmes, que le crime ait lieu au XXe ou au XVIe siècle.
Autre similitude tout aussi macabre : on ne saura probablement jamais précisément combien de victimes furent ainsi immolées, et bien sûr on ne connaîtra jamais leurs noms – « on », je veux dire nous autres d’aujourd’hui et de demain, qui n’avons pas participé à ces horreurs, pas plus que nous ne participons, directement du moins, aux horreurs contemporaines que sont les noyades en Méditerranée [3]. « Directement, du moins » : ce que je veux dire par là, c’est qu’il est des façons de contribuer indirectement à ces crimes, et c’est de taire ceux d’aujourd’hui, qui se produisent sous nos yeux (médias obligent) mais loin de nos regards et de nos cœurs (qui ne peuvent pas, bien sûr, « accueillir toute la misère du monde », comme disait l’autre), et c’est aussi d’oublier « tous ceux qui tombent », qu’ils soient huguenots à la Saint-Barthélémy, communards pendant et après la « semaine sanglante [4] », Algériens le 17 octobre 1961.
« Historien, il faut avoir cette “sombre fidélité pour les choses tombées” », dit Jérémie Foa [5] (p. 81), citant le Victor Hugo des Châtiments [6]. J’ajouterai cette citation de Walter Benjamin, qui ne m’a jamais parue aussi juste que ces derniers jours, alors que je lisais Tous ceux qui tombent : « Seul un historien, pénétré qu’un ennemi victorieux ne va même pas s’arrêter devant les morts – seul cet historien-là saura attirer au cœur même des événements révolus l’étincelle d’un espoir. En attendant, et à l’heure qu’il est, l’ennemi n’a pas encore fini de triompher [7]. »
Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler en deux mots ce que c’est que la Saint-Barthélémy. Arlette Jouanna, historienne spécialiste des guerres de religion et qui a donné un essai [8] sur l’événement à la prestigieuse collection « Les Journées qui ont fait la France », l’a sous-titré : Les mystères d’un crime d’État. Le 24 août 1572, plusieurs milliers de protestants (les fameux « huguenots », ou tenants de la « nouvelle opinion », comme les appelaient les catholiques romains, ou adeptes de « la religion » ou de la « vraie religion », comme ils se nommaient eux-mêmes) furent massacrés à Paris par « des bandes catholiques » (dixit Arlette Jouanna). À cela il faut ajouter que non contents d’assassiner les « réformés », leurs bourreaux déchaînèrent contre eux des violences inimaginables – corps mutilés, décapités, démembrés, éviscérés, brûlés, pendus par les pieds et/ou jetés au fleuve, faces martelées au point d’être rendues méconnaissables, sans parler de l’acharnement sur les femmes, y compris les femmes enceintes, et les enfants jusqu’aux bébés dans leurs berceaux. Les historiens ont longuement discuté (et discuteront encore, parions-le) à propos des responsables de ce massacre et de ses causes – ce que traduit le sous-titre de Jouanna. Telle n’est pas l’approche de Jérémie Foa : « Plutôt qu’une autre histoire de la Saint-Barthélémy, écrit-il, j’ai voulu faire une histoire des autres dans la Saint-Barthélémy. Une histoire du petit, du commun, du banal dans un événement qui assurément ne l’est guère. J’ai choisi de l’observer par le bas, au ras du sang, à travers ses protagonistes anonymes, victimes ou tueurs, simples passants et ardents massacreurs, dans leur humaine trivialité. À la rencontre des vies minuscules, des épingliers, des menuisiers, des brodeurs, des tanneurs d’Aubusson, des rôtisseurs de la Vallée de Misère, des poissonniers normands, des orfèvres de Lyon et des taverniers de la place Maubert. » (p. 7) Ces vies minuscules soulignées dans le texte font évidemment allusion à celles de Pierre Michon [9], ce qui n’est pas pour me déplaire. Une histoire par le bas, donc, qui « entend repeupler le massacre » (p. 9), envers et contre « l’ennemi victorieux » de Benjamin. L’enquête voudrait, poursuit Foa, « citer les dix mille, nommer les anonymes, les vies perdues, les obscurs jetés au fleuve ou mêlés à la fosse, à jamais engloutis » (p. 9). Mais comment faire ? Les massacreurs n’ont certes pas tenu de registres de leurs exactions… quoique. S’il n’existe pas de liste des victimes, sauf celles, bien incomplètes, qu’ont tenté d’établir les martyrologes protestants, d’autres sources se sont révélées fécondes : ainsi par exemple les registres d’écrou de la Conciergerie, principale prison parisienne, conservés depuis l’année 1564. En effet, le cycle de ce que l’on a appelé « guerres de religion » avait commencé dix ans avant la Saint-Barthélémy, laquelle marqua le déclenchement de la quatrième. La précédente s’était terminée par l’édit de Saint-Germain signé le 8 août 1570 qui « accordait aux protestants une liberté limitée de pratiquer leur culte » (Arlette Jouanna). La situation n’en était pas moins restée tendue. Au moindre prétexte, les adeptes de la « nouvelle opinion » étaient harcelés par leurs voisins et/ou rivaux, concurrents catholiques et très souvent ces litiges ou même de simple dénonciations (avoir mangé des œufs, voire de la viande, pendant le carême) aboutissaient à leur incarcération, parfois seulement quelques jours, mais souvent aussi des semaines voire des mois. Ainsi, par recoupements, entre autres, avec les archives notariales (en particulier les inventaires après décès) Jérémie Foa a-t-il pu reconstituer des bouts de biographies (ou plutôt de nécrologies), des esquisses de portraits ou de « visages » comme l’annonce son sous-titre. Il explique aussi par les tracas judiciaires et les arrestations récurrentes durant les mois et les années précédant le massacre le fait, qui a souvent surpris les historiens, que les huguenots ne se soient pas plus défendus contre leurs bourreaux : ils ont souvent cru en effet à une convocation, à une arrestation de plus – ce qui leur était pénible, certes, mais à quoi ils s’étaient résignés à force de le subir. C’est pourquoi l’on trouve la plupart du temps des récits de victimes ouvrant sans difficulté leur porte aux assassins, qu’ils connaissaient bien, non seulement parce qu’ils avaient déjà eu affaire à eux par un passé récent, mais aussi parce qu’ils étaient voisins, tout simplement : « La Saint-Barthélémy, écrit Foa, est un massacre de proximité, perpétré en métriques pédestres par des voisins sur leurs voisins. » (p. 8) Autre conséquence des faits de harcèlement, voire de persécutions infligées des années durant aux « hérétiques » : les tueurs s’étaient « entraînés », en quelque sorte, ils savaient pertinemment qui était qui et qui croyait quoi et à quelles adresses on les trouvait. Voilà qui m’a ôté d’une erreur apprise à l’école, primaire je crois bien : les catholiques avaient marqué, nous enseignait-on alors, les portes des réformés de croix afin de désigner les habitants à abattre. Ce qui rejoignait la représentation largement répandue d’un massacre perpétré avant tout dans les grandes villes parce qu’en milieu urbain règne un certain anonymat qui seul rendrait possible l’absence totale d’empathie, autorisant les citadins à se livrer aux pires agressions contre leurs concitoyens. Or il semble bien que cette histoire de marquage préalable ait été une légende urbaine – destinée à maquiller la réalité ? c’est ce que nous ignorons – car des gens qui opéraient dans leur propre quartier contre des voisins disposaient déjà de toutes les informations nécessaires. Point besoin de croix pour désigner leurs proies. (Point besoin de croix, ni de signe particulier telle l’étoile jaune stigmatisant les juifs sous Vichy. Par contre, le rapprochement que je me permettrai avec la persécution des juifs en France dans les années 1940, c’est que cette dernière ne tomba pas non plus du ciel en même temps que l’occupation allemande. Au temps de son naufrage, mettons après le Front populaire – dont on sait de reste que la droite du temps lui préférait Hitler –, la IIIe République avait déjà multiplié les lois et règlements xénophobes et antisémites. Le ventre était déjà fécond, d’où allait surgir la bête immonde. Et sans vouloir en rajouter plus qu’il ne serait raisonnable, on peut tout de même s’inquiéter lorsque l’on entend aujourd’hui les féaux du « grand remplacement » s’épancher complaisamment sur les plateaux de télévision en même temps que la police continue à harceler, certains disent même à tuer, de préférence des jeunes et de préférence pas blancs, dans notre « douce France » [10]. Je ne dis pas que cela nous prépare une nouvelle Saint-Barthélémy qui viserait les Arabes et/ou les musulmans, hein [11]. Mais pour le moins, ça n’augure rien de bon.)
Bref, je m’égare. Revenons à Jérémie Foa. Il a donc choisi d’organiser son essai en vingt-cinq récits, vingt-cinq « visages du massacre », autant d’histoires de vies et surtout de morts violentes qui ont nécessité autant de longues et minutieuses enquêtes menées tout à la fois à travers les documents imprimés de l’époque, les archives (notariales, judiciaires, carcérales…) quand elles existent encore (en pétard contre un ordre inégalitaire perpétué depuis des siècles par les logiques patriarcales et capitalistes de transmission du patrimoine, les communards brûlèrent les archives de l’état-civil de Paris), l’historiographie existante, aussi. Il en résulte un livre d’histoire(s) fascinant par son souci des détails qui n’en sont pas, tout simplement parce qu’ils sont ce qui trame la vie quotidienne et, hélas, la mise à mort ignominieuse des huguenots. Les interprétations plus générales viennent à la fin du livre, appuyées sur toutes les observations glanées en route, elles-mêmes confortées par des coups de sonde, si l’on peut dire, en divers lieux – car le massacre déclenché à Paris lors de la Saint-Barthélémy se prolongea en plusieurs villes du royaume, d’où Jérémie Foa a aussi ramené des histoires – Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen…
Je retiens deux de ces interprétations. Tout d’abord, et ce n’est pas forcément la plus importante, celle de la responsabilité, ou non, du « pouvoir » dans les massacres. À l’évidence, il y en a une, mais probablement pas « directe », au sens où des consignes auraient été données par le roi Louis IX et la reine-mère, Catherine de Médicis, de massacrer les huguenots. On sait à peu près sûrement aujourd’hui qu’ils donnèrent effectivement l’ordre d’éliminer un certain nombre de chefs protestants. Par contre, il semble qu’ils aient plutôt tenté de protéger la masse des réformés (si tant est qu’il s’agisse d’une masse, ils étaient tout de même assez minoritaires, et spécialement à Paris, ville « ligueuse » ultracatholique). Cependant, Foa observe à la fin de son livre que jamais, au cours des années qui suivirent, un chef catholique ne fut incriminé pour sa participation aux exactions, et que, bien au contraire, la plupart d’entre eux bénéficièrent de promotions et d’avantages divers et variés de la part de la Couronne.
Pas de planification centrale du massacre de masse, donc. Par contre, Jérémie Foa s’élève contre l’image d’une populace hurlante, sauvage, barbare, participant en masse à la curée. Loin de là, il peut même intituler l’un de ses chapitres : « Saint-Barthélémy, connais pas ». Entendons-nous, il y parle bien des contemporains du massacre, habitant les mêmes villes, à commencer par Paris, que celles où il fut perpétré. Par déformation professionnelle, si je puis dire, les historiens ont pour habitude de chercher dans les archives les traces de l’événement, et ont tendance à ignorer l’énorme silence de la grande majorité des actes « ordinaires ». Jérémie Foa cite quelques extraits de documents datés de ce 24 août 1572, testaments, pactes de mariage, contrat de location… « Que faire de ces archives sans sang ? demande-t-il. Que faire de ce dont on ne parle pas d’habitude ? Car, bien sûr, si l’on parcourt haletant des milliers de pages de paléographie, c’est pour trouver du spectaculaire. Las. On trouve en masse des documents qui parlent de tout sauf des violences et qui composent pourtant le bruit de fond du massacre. » (p. 124) Mais alors, devrait-on parler d’une sorte de « séparation » entre l’événement – le massacre – et la vie « ordinaire » ? « Cette imperméabilité des temps et des espaces, poursuit Foa, fut-elle sincère ou artificielle ? Si certains n’ont vraiment rien vu, d’autres ont détourné les yeux et fait semblant de ne rien voir. L’important est de percevoir la persévérance d’un rythme ordinaire à travers les nombreux actes administratifs sur lesquels la curiosité savante est souvent passée bien vite. Combien d’historiens les ont laissés de côté et, c’est compréhensible, ignorés précisément parce qu’ils ne relevaient pas du “contexte” ? Pourtant, ces documents qui ne parlent pas du massacre en parlent malgré eux : ils témoignent de l’épaisseur d’un monde capable de ne pas s’émouvoir, avançant imperturbable. Ce stoïcisme du social est aussi un moyen de survivre. Fermer les yeux, regarder ailleurs. » (p. 126, soulignement de l’auteur.) On pourrait désespérer du genre humain qui « laisse faire », voire est complice par défaut des pires horreurs. Mais on peut aussi suivre Jérémie Foa dans la conclusion de ce chapitre : « […] braquer le projecteur sur la vie quotidienne pendant le massacre, c’est pointer du doigt les vrais responsables : dire que de très nombreux Parisiens ont, les jours d’hécatombe, fait tout autre chose que la chasse aux huguenots, ce n’est pas nier les tueries. Il est toujours délicat d’interpréter le sens et les conséquences de cette passivité ordinaire : détourner les yeux, est-ce approuver, consentir, participer du bout des lèvres ? Les archives des notaires ne permettent pas de répondre à ces questions. Mais elles invitent à recentrer le regard vers la poignée de miliciens […], le groupe d’hommes motivés et organisés, qui ont mis en œuvre les massacres, tandis que la majorité de leurs voisins catholiques faisaient autre chose, vaquaient à leurs occupations, vivaient leur vie. S’intéresser aux sources de l’ordinaire, c’est refuser de pointer en bloc les Parisiens, pire, le « peuple », trop souvent accusé des pires tueries, pour mieux s’arrêter sur ceux, bons bourgeois, capables, en temps voulu, d’organiser un impitoyable massacre de civils. » (p. 128)
Pour terminer cette note de lecture, et sans qu’il soit besoin, je suppose, de dire combien ce livre m’a impressionné et ému, je vais citer un bref chapitre (« Le petit enfant au maillot », p. 213) qui donne une bonne idée, me semble-t-il, de l’« engagement », au bon sens du terme, de Jérémie Foa envers son objet. Auparavant, je veux signaler une autre parution du même auteur, en collaboration avec le dessinateur Pochep : Sacrées guerres. De Catherine de Médicis à Henri IV, et qui est la dixième livraison de la série « Histoire dessinée de la France [12] ».

Cette bande dessinée didactique, complétée par un dossier de textes sur les différents thèmes et personnages abordés en dessins, pourra fournir des éléments de contexte utiles à qui voudra resituer la Saint-Barthélémy au sein de ces « sacrées guerres ».
franz himmelbauer depuis antiopées
Le petit enfant au maillot
Citer les noms.
De ces morts lancés dans la Seine, perdus dans le Rhône. De ces Troyens disparus un petit matin de septembre 1572, jetés pêle-mêle derrière la chapelle « dans une grande fosse [13] ». Mais comment agripper celles et ceux dont personne n’a parlé, dont nul n’a, plume à la main, regretté ni même remarqué l’absence ? Ils sont la masse, l’imprononçable nombre du massacre. Ils hantent ce livre. « Ce ne sont pas les personnages nommables qui font les meilleurs fantômes [14]. »
D’eux ne reste qu’une inconsolable dictée à trous :
Le « nommé Kenny [15] », aux Trois rois, rue de la Calendre.
Le « petit enfant au maillot », traîné par le cou avec une ceinture sur les pavés de Paris.
La « femme enceinte » de la rue Saint-Martin qui se sauve par les tuiles de sa maison.
La veuve « nommée Marquette », chaperonnière de la rue Saint-Martin.
Le « barbier » de la porte Saint-Honoré.
Le « tireur d’or, surnommé le Petit Jacques [16] ».
Ils sont les noms de l’impuissance, la limite d’une discipline, ces visages que nous n’avons pas reconnus [17].






