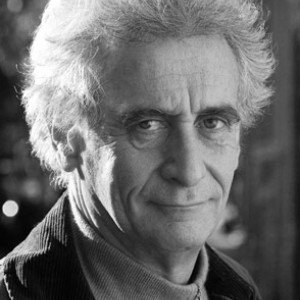L’Empire, les Grands Projets et la guerre
Aussi déterritorialisées qu’elles soient, toutes les puissances impériales obéissent à une logique capitaliste, elles visent donc nécessairement un développement élargi de leur capital, qu’il soit financier, symbolique ou – la plupart du temps – les deux, ce qui nécessite une exploitation accrue des humains, de la nature et de la nature humaine. Il leur faut donc régulièrement quitter le ciel numérisé des transactions financières pour remodeler la terre à leur image. Cette descente sur terre peut prendre de multiples visages, dont deux tout particulièrement assument une importance symbolique aussi décisive que leur dimension financière : les Grands Projets et la guerre.
Nulle part ailleurs que dans les guerres du xxie siècle, les contradictions de l’Empire n’apparaissent avec tant d’atroce virulence. Nulle part ailleurs que dans les Grands Projets, l’unité de l’Empire ne se présente avec tant d’éclat. Commençons par ces derniers.
Quand une puissance impériale de moyenne importance comme Vinci, deuxième entrepreneur mondial du BTP, fond sur une zone humide du bocage nantais, l’opération de réunification des fragments dispersés passe par un Partenariat public-privé que résume bien la figure d’un préfet fidèle soutien du projet, qui va bientôt se faire embaucher dans l’entreprise. Cette dernière rassemble autour d’elle d’autres puissances de moindre importance, politiciens locaux de droite et de gauche en mal d’affirmation égotique, politiciens nationaux soucieux de montrer qu’ils commandent, appareils sécuritaires avec leurs journalistes embarqués et lobbies divers… Dans la vallée de Suse, pour réaliser la partie italienne du Lyon-Turin, on a vu s’allier la Commission européenne, deux coopératives italiennes, structures typiques de la lottizzazione, l’une de droite, l’autre de post-gauche, des groupes mafieux, notamment calabrais, des politiciens turinois et des magistrats qui s’étaient distingués successivement dans l’écrasement de la lutte armée puis dans l’opération Mani Pulite. Aéroport ou ligne ferroviaire, le Grand Projet réunit des puissances autonomes qui peuvent ailleurs s’opposer. Cette opposition peut aller jusqu’à la guerre.
Ce qui se présente comme un plan pour l’humanité entière, son homogénéisation à la double enseigne de l’increvable Progrès et de l’éternel Développement, entraîne l’exacerbation d’anciennes différences et la création de nouvelles qui, toutes, entrent en concurrence. À l’heure où s’écrivent ces lignes, dans le canton syrien d’Afrin, les YPG kurdes et leurs combattants internationaux libertaires cherchent le soutien d’Assad pour résister à l’offensive de la tyrannie turque appuyée par d’ex-combattants de la liberté syriens devenus islamistes, tandis que les États-Unis, qui avaient soutenu les Kurdes, regardent ailleurs. Cette situation illustre l’affreuse intrication d’intérêts que sont devenus les guerres d’un monde où le rôle d’ennemi principal du genre humain (un temps brillamment assumé par Daesh, après Saddam Hussein et Al Qaïda) valant tôt ou tard anéantissement, il ne reste plus sur les ruines que des fragments de l’alliance universelle du Bien. Et ces fragments, comme l’illustre l’exemple syrien, se jettent aussitôt les uns contre les autres, se manipulent et tuent à l’envi. Penser cela comme une guerre civile interne à l’Empire rend plus compréhensibles les retournements d’alliance, les abandons sans scrupule des alliés d’hier et l’intrication d’intérêts qui n’ont absolument rien à voir avec l’affrontement de deux camps définis. Ainsi évite-t-on d’avoir à choisir entre les errements de l’archéo-anti-impérialisme « campiste » et la croisade du Bien incarnée par les puissances occidentales si largement responsables de l’existence des monstres qu’elle ont fini par combattre.
À cette guerre des fragments qui est comme le retour du refoulé de l’Empire, s’oppose ce qui se présente comme son côté éminemment positif, les réalisations de son appareil productif en général et de la technoscience en particulier, dont les Grands Projets sont des exemples parmi les plus spectaculaires. Plus que toute autre prouesse technique – hauteur des gratte-ciel de Dubaï, vitesse de diffusion des OGM ou des logiciels –, le bouleversement d’un lieu qu’est toujours un Grand Projet se présente chaque fois comme une Bonne Nouvelle, un nouveau verset de l’Évangile de l’Empire. L’annonce toujours renouvelée d’une exploitation durable de la planète, d’une occupation harmonieuse et pacifique de son sol est la Promesse dont les guerres sont en permanence le démenti sanglant. Les Grands Projets sont les portes d’un Paradis qui débouche dans l’enfer des guerres d’extermination en cours en Syrie.
C’est par le miracle de leur Promesse que les Grands Projets emportent toujours une adhésion qui va très au-delà des cercles directement intéressés par leur réalisation. On aurait tort de mésestimer la profondeur des affects qu’ils mobilisent. Aux yeux de beaucoup, si certains de leurs aspects peuvent être révisés, si certains projets particuliers peuvent même être abandonnés, les Grands Projets, dans leur principe, représentent une nécessité : dans le monde tel qu’il est, il faut bien développer le réseau des transports, des communications, de l’énergie, il faut bien extraire du minerai, il faut bien stocker les déchets nucléaires, il faut bien créer des emplois… Tout cela n’est-il pas du simple bon sens ? La prétention du monde des Grands Projets à être le seul possible tient à sa capacité à se présenter comme reposant sur la raison, sur de multiples incarnations de la raison censées recouvrir tout le réel : la raison du financier, de l’économiste, de l’ingénieur, de l’aménageur, du manager. La critique de ces raisons sera au cœur des luttes du siècle qui vient.

- Véhicules de l’ONU ayant servis en Afghanistan avant d’être utilisés ensuite dans la Vallée de Suse.
Les raisons des Grands Projets
Sur les raisons financières au fondement des Grands Projets, la Charte de Tunis adoptée lors du Forum Social Mondial le 29 mars 2013 est assez claire : « Le système économique libéral qui domine le monde est en crise profonde, les Grands Projets Inutiles Imposés sont un des instruments qui garantissent des profits exorbitants aux grands groupes industriels et financiers, civils et militaires, désormais incapables d’obtenir des taux de profits élevés sur des marchés globaux saturés.
La réalisation de ces projets inutiles, toujours à charge des budgets publics, produit une énorme dette, ne génère aucune reprise économique, concentre la richesse et appauvrit les sociétés.
Ces grands projets permettent au capital prédateur d’augmenter sa domination sur la planète, portant ainsi des atteintes irréversibles à l’environnement et au bien-être des peuples.
Les mêmes mécanismes qui endettent les pays les plus pauvres depuis la fin de la colonisation directe sont maintenant utilisés aussi dans les pays occidentaux. »
Ainsi, ce qui apparaît critiquable aux yeux des rédacteurs de la charte, ce n’est pas que de grands groupes tirent profit de l’exploitation des humains et de la nature, mais que les profits soient « exorbitants », et que les Grands Projets « ne génèr[ent] aucune reprise économique ». Livré à ses seules forces, le citoyen ne peut accéder qu’à une conscience économiste.
De Giorgio Agamben à Pierre Musso, d’excellents auteurs viennent pourtant confirmer une intuition à la portée de n’importe quel citoyen qui, délaissant un moment les catégories économiques de son credo, observera d’un œil critique les écrans qui modélisent les catégories du sens commun : l’Économie est la théologie de notre temps. Elle entretient avec le réel le même rapport que les épîtres pauliennes ou la Cité de Dieu : elle prétend dire une réalité produite par les hommes mais perçue par eux comme une toute-puissance qui leur est extérieure. De cette réalité, les théologiens de notre temps discutent à l’infini les « tables de la loi » – comme les appelaient Jacques Attali –, et ce faisant s’emploient à la créer. Mais les capacités performatives de la « science économique » ayant d’irrémédiables limites, comme le montrent ces crises, telle celle de 2008, qui les prennent régulièrement par surprise, les économistes assument principalement dans le monde tel qu’il va le rôle de gestionnaires de l’angoisse qu’il produit. Dans une société qui fait du travail humain sa valeur centrale et qui n’a de cesse de diminuer la valeur du travail des humains, les économistes sont là pour inviter le vulgum pecus (c’est-à-dire ni les économistes ni ceux qui les emploient) à travailler plus pour gagner moins. Comme les « spécialistes » de l’antiterrorisme soignent et entretiennent à longueur d’émission la peur du terrorisme, les économistes sont là pour soigner les plaies sociales en les frottant du sel de leurs infinis commentaires et du piment de leurs micro-divergences. Tout quidam habité par la peur de perdre son travail ou de ne pas en trouver devrait écouter religieusement leurs prêches autour de la nécessité de « combattre le chômage » et de « relancer la croissance », soit deux manières de ne jamais aborder les questions que tout un chacun risque de se poser, pour peu qu’il s’écarte de la chorale bruyante des spécialistes télévisuels : quelle est cette essence divine qui légitimerait les revenus des plus riches ? Les labeurs répétitifs et fastidieux du bas de l’échelle ne mériteraient-ils pas d’être bien mieux payés que ceux des hautes sphères, lesquels devraient trouver en eux-mêmes, dans les délices de la conception et du commandement, leur propre récompense ? Pourquoi appauvrir et précariser toujours davantage le plus grand nombre devrait-il à la fin des fins faire son bonheur ? Si l’on a besoin de moins en moins de travail pour produire de plus en plus d’objets, pourquoi faut-il que les uns souffrent de trop de travail et les autres de son absence, et pourquoi produire tant d’objets ? Quelles richesses produire et comment se les répartir ? L’activité humaine a-t-elle toujours été enfermée dans une forme mesurable et exploitable par un capital ? Le travail est-il désormais l’horizon indépassable de l’activité humaine ? On n’en finirait pas de lister les questions que les économistes s’emploient à empêcher de poser un peu sérieusement, c’est-à-dire en leur donnant ne fût-ce qu’un début de portée pratique (ce qui se fait quand même un peu sans eux, sur les ZAD et dans d’autres expériences collectives). Les économistes sont les gardiens du « cercle de la raison » d’un monde qu’emporte la folie de l’accumulation capitaliste. Leur tâche est de nous y garder enfermés.
On peut certes critiquer les Grands Projets depuis l’intérieur de ce cercle. Comme on le verra, en dépit de la longue cécité volontaire des pouvoirs publics, les luttes des territoires agressés ont développé de longue date un contre-savoir bien plus pertinent que le savoir officiel, y compris dans les termes de ce dernier. Les arguments des opposants raisonnables (au sens de la raison économique) à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou à la ligne Lyon-Turin ont bien dû avoir à la fin quelque écho. C’est en tout cas ce dont témoigne le fait que le gouvernement français se décide à remarquer que le projet d’aéroport ne correspondait plus depuis longtemps à l’organisation internationale des transports aériens, ou le fait que la présidence du conseil des ministres italiens, dans un document officiel, reconnaisse une réalité démontrée depuis des années : fondée sur des estimations et des prévisions erronées, la ligne à grande vitesse est apparue complètement inutile. Mais si les opposants à l’un ou l’autre projet se contentaient de la reconnaissance officielle de son inutilité, le danger serait une forme de NIMBY (Not in my backyard, « pas dans mon arrière-cour ») : se contenter de l’abandon d’un Grand Projet en acceptant implicitement tous les autres. La mise en réseau des luttes de territoires et l’adjonction fréquente du slogan « ni ici ni ailleurs » dans leur argumentaire montrent que leurs militants sont sur une trajectoire les poussant peu à peu, si ce n’est déjà fait, hors de la raison économique. Refuser les Grands Projets dans leur principe même, c’est, comme le dit un autre slogan, refuser leur monde. Et qu’est-il d’autre, ce monde, sinon celui de l’Économie, « réalité » perçue comme une essence extérieure aux humains, alors qu’elle est produite par eux ?
À l’instar de l’Économie, un autre monstre ayant échappé à ses créateurs, la technoscience, est en corrélation permanente avec elle. C’est ce dont témoigne cette discussion que m’a rapportée un activiste No-Tav d’une vingtaine d’années. Dans son école d’ingénieur, un de ses professeurs s’est avoué plutôt favorable à la nouvelle ligne Lyon-Turin. Comme il s’enquerrait de ses raisons, il s’est attiré cette réponse qui a au moins le mérite de la sincérité : « Parce que techniquement, c’est un défi, mais on peut le faire. » Le rôle des ingénieurs et de leur passion du faire dans l’édification du capitalisme est un sujet passionnant et les études sur le saint-simonisme insistent souvent sur la transmission de la raison de l’ingénieur depuis cette branche du premier socialisme jusqu’au PS. Quiconque a la chance de circuler sur un de ces trajets ferroviaires que la rationalité économique menace sans cesse de supprimer, comme Corte-Ajaccio ou Limoges-Ussel, ne peut qu’admirer ce qu’on appelle si justement les « ouvrages d’art », par lesquels la raison de l’ingénieur impose ses droites et ses courbes mathématiques dans le chaos des montagnes et des forêts. Pourquoi le nier ? Le pont de Millau ou un avion qui s’envole, c’est beau. La technique a une beauté qui peut être exaltante mais ce n’est pas un hasard si la célébration extrême de cette beauté a été, futurisme aidant, l’un des traits du fascisme historique Il y a au moins un élément en commun entre un régime où, selon ses nostalgiques, « les trains arrivaient à l’heure », et le système technicien, tel qu’un Jacques Ellul l’a analysé : en dernier ressort, il ne tire sa légitimité que de sa force.
Ou, pour utiliser un maître-mot de la révolution managériale, de sa capacité à être efficace. L’ubris technicienne a été fort bien exprimée, sans intention critique, par le chantre de la réaction dépressive contemporaine, le romancier Houellebecq : « Tout ce que la science peut permettre sera réalisé, même si cela modifie profondément ce que nous considérons aujourd’hui comme humain, ou comme souhaitable. » Et d’ajouter : « J’ai mis longtemps à l’admettre, mais la philosophie relève de la littérature, et ce n’est pas la littérature qui dit la vérité. Seule la science dit la vérité. Et sa vérité s’impose. » Parce qu’elles intègrent la dimension de l’éthique et celle des passions dans leur appréhension du monde, parce qu’elles traitent des « significations imaginaires sociales », comme dirait Castoriadis, la philosophie et la littérature seront toujours plus aptes à dire la vérité des humains et de leur rapport au monde qu’une « science » qui « permet » le nucléaire et les nanotechnologies. La création artistique et littéraire, avec la théorie critique, sont seules à même de préparer le surgissement de l’événement politique que la science sera toujours incapable de prévoir.

Tous les combats dont parle le présent livre s’inscrivent en faux contre l’idolâtrie de la technique (rebaptisée « science » par Houellebecq). « Avec la techno-science, l’homme moderne croit s’être donné la maîtrise. En réalité, s’il exerce un nombre grandissant de “maîtrises” ponctuelles, il est moins puissant que jamais devant la totalité des effets de ses actions, précisément parce que celles-ci se sont tellement multipliées, et parce qu’elles atteignent des strates de l’étant physique et biologique sur lesquelles il ne sait rien. » Il faut cependant reconnaître au romancier français le mérite de pointer une réalité : l’autonomisation de la technoscience. Ce complexe qui fusionne le développement de la science et de la technique trouve largement en lui-même la dynamique de son développement et, désormais, n’influence pas seulement la sphère de la production ; c’est l’ensemble de la vie sociale qui est conditionné par des techniques d’organisation, notamment de l’attention. En dépit de tous les discours sur le « développement durable », de toutes les COP21 et autres « sommets », les dernières décennies ont vu un essor sans précédent du système technicien. Celui-ci considère la nature, l’humain et la nature humaine comme une quantité de ressources à s’approprier et à exploiter. Avec le transhumanisme, il ne prétend à rien de moins qu’à abolir la frontière entre l’humain et la machine, pour transformer bientôt toute la planète en machine, avant de s’attaquer à l’univers. Que ce projet délirant soit porté par quelques-uns des patrons des GAFAM montre à la fois la puissance de la technoscience et les limites de son autonomie – n’en déplaise à l’âme éternelle d’Ellul. Quel que soit le degré d’autonomie de son développement, et il est grand, puisqu’elle est désormais capable d’inventer d’abord des objets avant d’en créer le besoin, l’« hypermégamachine », comme l’appelle Castoriadis, est in fine orientée par les nécessités du profit capitaliste. Elle peut tomber en panne aussi bien en cas de troubles des flux de la finance (explosions de bulles) que de résistance des exploités (explosions de rage). Les 17 000 employés de Facebook, les 72 000 de Google, les 541 900 d’Amazon, ou encore les centaines de milliers de travailleurs surexploités dans les mines et les usines-dortoirs de sous-traitants peuvent un jour déranger les desseins démiurgiques des héros de la Silicon Valley avec de vulgaires exigences d’augmentation de salaire ou d’amélioration des conditions de travail. De même, les infrastructures indispensables à la dématérialisation et à la délocalisation peuvent se heurter à la résistance d’êtres concrets. Leur emprise croissante sur le monde peut être ralentie en des lieux singuliers, par la singularité même, naturelle et humaine, des lieux. Cette expansion peut être arrêtée quand elle bute sur des communautés matérielles, qui sont aussi bien faites de rêves et d’histoires que de l’Histoire.
Ce ne sont donc pas seulement les effets inattendus de son action sur les strates profondes de l’« étant physique et biologique » qui menacent le système technicien, c’est aussi le facteur humain. Peut-être faudrait-il plutôt considérer que le facteur humain fait partie de ces strates profondes, en ce qu’il y aura toujours, dans l’humain comme dans la nature, une part que la science n’arrivera jamais tout à fait à recouvrir. En tout cas, il n’est pas étonnant que l’ingénierie sociale occupe désormais une place centrale dans le système technicien. Pas étonnant non plus que l’« acceptabilité » y soit une discipline en plein essor. Les procédures que des sociologues sont chargés de mettre au point pour obtenir l’acceptation des nouvelles technologies ne sont qu’un raffinement de ces « enquêtes publiques » et autres « assemblées citoyennes » qui entourent les Grands Projets et qui n’ont d’autre objet que l’intégration par les citoyens de la nécessité de travaux décidés sans lui. La « démocratie participative » est l’application à l’aménagement du territoire de la révolution managériale telle que définie à l’aube du xxe siècle par Robert Taylor. « Il faut », explique Pierre Musso en citant Taylor, « une “coopération étroite, intime, personnelle entre la direction et les ouvriers”, ce qui est l’essence du système de la direction dite “scientifique”. Il doit même exister un “sentiment de fraternité” […] Conclusion de Taylor : “Il est certain que ces principes seront appliqués d’une façon générale dans le monde civilisé, tôt ou tard” ». La direction scientifique du travail sera désormais la clé universelle pour gouverner aussi bien l’entreprise, la politique que la « civilisation ». Avec ses discours sur la « start-up nation » qui ramènent toute la vie sociale au modèle de l’entreprise, son « management par projet » qui voudrait faire de chaque groupe et de chaque individu une entreprise, son mantra de l’efficacité comme seul critère et sa prétention à incarner la raison dans le corps jupitérien constamment mis en scène du président, le macronisme n’est pas seulement l’application enfin complète, trente ou quarante après, des recettes thatchériennes et reaganiennes, promise aux mêmes effets d’exacerbation capitaliste, c’est aussi le stade ultime de la révolution managériale.