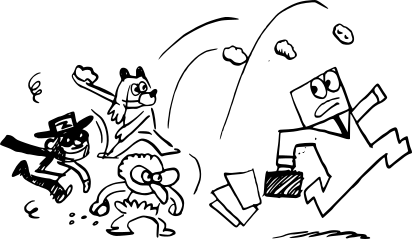On est alors au plus loin d’une sociologie critique qui chercherait à confirmer ce qu’elle pense déjà savoir. Car c’est dans leur générativité que les assemblages par lesquels s’instaurent des lieux trouvent les ressources pour résister à la gouvernementalité. Et les manières de nous étonner.
Alors, la question qui se pose aux chercheurs est plutôt : comment se saisir des vies qui ne sont pas les nôtres, comment approcher ce qui fait lieu, comment éveiller des perceptions irrégulières portant sur les embrouillaminis de modes d’existence dans lesquels se trament les situations auxquelles, soudainement, on appartient ?
Et comment se faire accueillir face à la réticence de ceux qui ne nous ont rien demandé, et puis parce que l’on veut transmettre quelque chose qui tient à l’esprit d’un quartier, que l’on voudrait le faire partager, et que cela devient urgent ? Les auteurs revendiquent une approche vitaliste et spirituelle. Il ne faut pas avoir peur des mots. Vitalisme car c’est la vie même qui est en jeu dans leur recherche, l’enchevêtrement de manières d’exister, y compris celles des chercheurs. Spiritualité car il s’agit de percevoir quelque chose de l’ordre des formes et des forces qui animent des lieux. Percevoir une réalité vivante, c’est déjà participer au réel observé. Ou contribuer à ses manières d’exister, à ce qui anime ces êtres et s’anime entre eux et les choses. Et s’attarder sur d’anciennes histoires qui insistent à vouloir affleurer à nouveau.
L’enquêteur devient alors une sorte d’itinérant en quête de… Mais de quoi au juste ? Ici, de ce qui résiste, des opacités à l’intelligibilité de l’entreprise aménageuse dans le monde enchanté de la métropole. Après tout, « ni les quartiers, ni les esprits n’aiment les enquêtes ». Ce sont là les derniers mots de l’introduction à Quartiers vivants, un livre… d’enquête qui au travers des Murs à Pêches de Montreuil, et du quartier Saint Léonard à Liège, agit comme une déambulation entre des vies disparates dont les amalgames rendent des territoires récalcitrants, aussi bien aux aménageurs qu’aux sociologues critiques.
Si les auteurs récusent la notion de gentrification, trop catégorielle, trop identitaire, pour lui préférer celle de métropolisation, c’est qu’elle dit mieux les nouvelles formes de gouvernementalité qui combinent l’impitoyable mise en valeur du territoire, avec la brutalité de leurs Plans prospectifs, et l’action douce, par « le bas », de l’enrôlement d’entrepreneurs high-tech écolos, d’acteurs de l’économie sociale et solidaire dont l’action participe imperceptiblement à la colonisation de lieux rétifs à l’administration de la valeur.
« De pays en pays, de cité en cité, de quartier en quartier, il y a un cycle de la normalisation. Tout commence par un « quartier populaire ». Un « quartier populaire » n’est pas un quartier pauvre, du moins pas nécessairement. Un « quartier populaire » est avant tout un quartier habité, c’est-à-dire ingouvernable. Ce qui le rend ingouvernable, ce sont les liens qui s’y maintiennent. Liens de la parole et de la parenté. Liens du souvenir et de l’inimitié. Habitudes, usages, solidarités. Tous ces liens établissent entre les humains, entre les humains et les choses, entre les lieux, des circulations anarchiques sur quoi la marchandise et ses promoteurs n’ont pas directement prise. L’intensité de ces liens est ce qui les rend moins exposés et plus impassibles aux rapports marchands. Dans l’histoire du capitalisme, cela a toujours été le rôle de l’État que de briser ces liens, de leur ôter leur base matérielle afin de disposer les êtres au travail, à la consommation et au désenchantement ».
En reprenant ainsi dans leur conclusion les mots du texte d’intervention politique La fête est finie, à propos de l’opération Lille 2004, les auteurs inscrivent leurs enquêtes dans un travail généalogique de l’entreprise de capture et de destruction métropolitaine.
On savait les opérations de distribution opérées par les anciennes formes de gouvernement (de places, d’identités, de classes...), nous voilà dorénavant dans un nouvel âge : celui de l’intégration totalisante dans des parcours balisés de la Smart City, avec ses algorithmes, des positions dans le réseaux, ses nouvelles formes d’identification. La métropolisation, aujourd’hui, réunit dans un même plan les distributions sociales, ses rebuts et l’intégration de tout être et de toute chose dans ses flux optimisés. Le tout indissociable d’une action de pacification.
Mais ce serait sans compter avec un reste, notre inadaptation, ce qui se recompose à chaque fois dans des amalgames improbables, qui fait resurgir des histoires aberrantes, toujours souterraines, propres à l’esprit d’un quartier... Jusqu’à quand ?
Les chercheurs ne sont alors rien d’autre que des itinérants entre des formes de vie. Mais il arrive qu’ils soient possédés par la passion du récit. Et cela aussi, il faut pouvoir le raconter, afin de faire surgir de nouvelles formes de partage. Par des déplacements, pouvoir dire ce qui se passe ailleurs. L’enquête est alors au fond la quête… d’un étonnement.
Le livre dont il est question reste fidèle à une expérience. L’expérience d’être animés par la vie des lieux que l’on appelle des quartiers, d’être happés dans leurs fragments et traversés par leurs connexions partielles à d’autres fragments. Il s’agit d’incarner des cartographies dont les contours restent fuyants. Les auteurs de Quartiers Vivants refusent le docte rôle des interprètes. Aussi, ne prétendent-ils pas à plus que de participer du réel dont ceux-ci sont les lieux. Nous le faire partager. Et c’est beaucoup.
En voici l’introduction.
Josep Rafanell i Orra
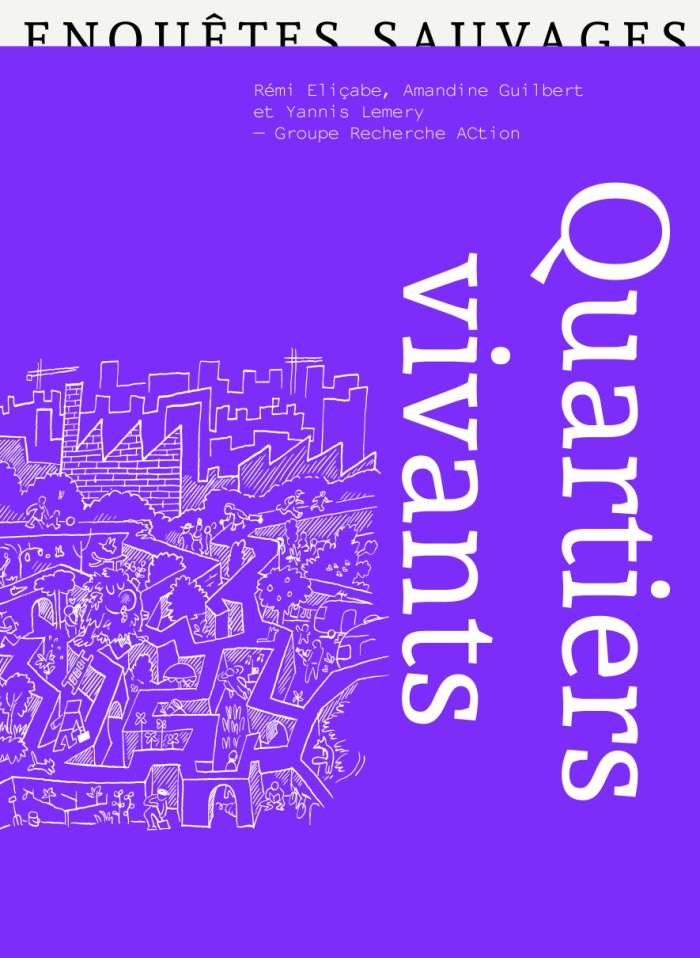
Préambule
Ce livre parle de deux quartiers de grandes villes européennes, les Murs à Pêches à Montreuil et le quartier Saint-Léonard à Liège. Mais, à travers eux, il parle de ces quartiers innombrables qui, par leur simple existence, mettent à mal les processus de valorisation métropolitains et ouvrent à d’autres possibilités de vivre dans ces grandes villes. Car si la métropole est une certaine manière, politiquement organisée, de faire l’expérience des réalités urbaines, elle est aussi un mode d’imposition de tout un ordre du monde qui cherche à juguler ou capturer ce qui lui échappe. Ces possibilités marginales, diffuses, insistantes, peuvent prendre l’aspect incandescent d’une insurrection urbaine, d’un carnaval, emprunter les voies labyrinthiques d’espaces post-industriels re-bricolés ou les modalités ordinaires d’une vie de quartier qui persiste, à contre-temps des grands processus de valorisation économique. C’est notamment à la description de ces autres urbanités que notre collectif d’enquête [1] s’est attaché depuis plus de dix ans, en explorant les devenirs de la ville depuis ce qui ne cadre pas avec la métropole.
Nos recherches urbaines ne s’inscrivent pas à proprement parler dans une critique de la métropole, elles proposent plutôt une exploration de ses bordures, de ses lacunes et de ses limites : un fond de vallée squatté et rendu aux usages communs dans la périphérie de Barcelone (Can masdeu), d’improbables collectifs artistiques disputant au design le patrimoine industriel et prolétaire de Saint-Étienne (Avatarium), les faunes de « nuisibles » humains et non humains qui hantent la ville 2.0 au cœur de la presqu’île de Lyon... Dans nos enquêtes, nous avons croisé beaucoup de quartiers en lutte : à Pointe-Saint-Charles à Montréal, contre la construction d’un casino et pour la réappropriation d’une immense friche industrielle, aux Minimes à Toulouse contre la résidentialisation du quartier et pour l’occupation d’une caserne laissée à l’abandon (Les pavillons sauvages), dans les Hauts-de-Montreuil, contre la densification et la bétonisation et pour le maintien des terrains vagues. Les quartiers que nous présentons dans ce livre diffèrent de ces derniers en ce qu’ils ne sont pas directement en lutte, ils ne sont pas non plus emblématiques ou particulièrement représentatifs de ce qu’on peut entendre par quartier. Mais précisément, un quartier qui persiste en tant que quartier et que l’on définit comme tel constitue d’abord une singularité territoriale, et il ne peut jouer le rôle que d’une déclinaison de cette puissance irréductible. Ce sont des quartiers vivants, des entités animées. L’esprit des lieux n’est pas l’apanage de quelques bosquets sacrés ou de montagnes lointaines, il y a bien des esprits qui peuplent les villes, et tout artificieux qu’ils soient, ces esprits disputent aux intelligences artificielles de la smart city le terrain de l’enchantement.

Le choix des quartiers de Saint-Léonard et des Murs à Pêches s’est avéré complètement arbitraire et complètement nécessaire : des amis vivaient dans le coin, on avait enquêté à leurs abords mais sans pouvoir tout à fait pénétrer leurs mystères, la métropolisation battait son plein à leurs entours sans parvenir à absorber leurs réalités récalcitrantes. La méthode peut paraître partiale voire carrément injustifiée, mais elle est conforme à nos yeux à ce que nous nommons l’enquête politique [2] : s’attacher à ce qui déborde et résiste aux grandes machines de gouvernement, parcourir des géographies divergentes, et voir ce que l’on a appris au passage. Elle s’inscrit également tout à fait dans la collection que ce livre initie aux éditions D’une Certaine Gaieté : c’est bien une enquête sauvage, initiée par des nécessités vitales, orientée par l’antipathie et la sympathie et conduite de proche en proche, au gré de nos rencontres. Nous espérons que ce livre, du fait même des singularités radicales dont il rend compte, résonne intimement chez ceux et celles qui nous lisent et par là, parvienne à dire quelque chose de plus grand que lui.
La métropole à grands traits
Nous faisons toutes et tous, avant définition, l’expérience de la métropole. Georg Simmel, pour caractériser la modernité au tournant du XXe siècle, définissait l’expérience de la grande ville par une incessante amplification des stimulations nerveuses, liée à un environnement converti en espace de calcul, par la diffusion et l’intégration des horloges et autres chronomètres, caisses enregistreuses et pointeuses en tout genre. Notre expérience contemporaine est toujours marquée par cette double spécification de l’espace urbain, tout à la fois sensible et économique, elle l’est aussi par un phénomène d’accélération multiforme et généralisée (pour la mobilité, la communication, les rythmes de travail comme de loisir). Si l’on perçoit la continuité – une certaine manière d’être sollicités, happés, accélérés, valorisés et mis à contribution pour produire de l’excitation, de la valorisation – le changement de degré, à force, vaut pour changement de nature. Le passage de la grande ville capitaliste à la métropole néolibérale s’est fait sans à-coup, avec cette impitoyable fluidité qui caractérise le processus d’économisation du monde dans lequel nous sommes désormais embarqués de force.
« La métropolisation se base notamment sur la valorisation des singularités territoriales (patrimoine, paysages environnants, spécialisations économiques). Aujourd’hui toutes les villes, par-delà leur dimension physique et démographique, sont des métropoles au sens où elles doivent être gérées et valorisées. Une des caractéristiques de la métropolisation semble être l’apparition d’un mode de gouvernance entrepreneuriale reposant sur des grands projets destinés à valoriser la ville, à la rendre attractive, dans le cadre d’une mise en concurrence nationale et internationale. Le développement des villes est coordonné à la nécessité d’attirer des capitaux, des forces vives et des touristes. La ville devient marque et marchandise afin d’assurer son rayonnement. Dans le prolongement de cette régionalisation, la métropolisation doit être comprise simultanément comme une réalité géographique et économique : il s’agit d’une étape dans le mode de production de valeur par le capitalisme. » [3]
Entre les années 1970 et la première décennie des années 2000, en France et en Belgique, les métropoles se sont ainsi affirmées comme de « nouvelles » réalités géographiques, économiques, mais aussi, dans le cas de la France, politiques, au sens administratif du terme. En 2010 et 2014, deux réformes territoriales créent parallèlement le statut de métropole [4] et les méga-régions. Cette mutation entérine le processus libéral autoritaire en cours depuis les années 1970 visant à faire des grandes villes les lieux de l’accumulation capitaliste et des centres de gouvernance efficace. À l’échelle internationale, certains pôles urbains pèsent désormais plus que les États dans l’économie globalisée. Le moindre projet immobilier d’une arrière-cour de Montreuil ou de Saint-Étienne Métropole, en tout cas quand il vise à « designer la ville de demain », cherche désormais à faire signe vers cette réalité scintillante qui trouve son épicentre à Sidney, Tokyo ou Singapour. C’est donc à toutes les échelles que la métropole prétend faire monde, et ce alors même que les terriens font l’expérience d’une catastrophe planétaire sans précédent. La fonction métropolitaine des villes consiste à réencastrer le capitalisme dans les territoires afin de le « réarmer » face aux désordres climatiques, politiques et sociaux en cours et à venir. Puisque tout horizon historique semble s’écrouler, la performance des métropoles se jugera à l’aune de leurs capacités de résilience, et non plus seulement selon l’axe du développement et du progrès. Comme il n’y a plus grand monde pour croire aux vertus civilisatrices du capitalisme, les métropoles, parées des vertus de la durabilité et de la résilience, sont là pour garantir la pérennité du capitalisme et susciter l’adhésion.
L’origine de la métropolisation, une martingale d’ingénieur
On peut faire remonter les prémisses de la conception métropolitaine française et belge aux débuts des années 1970 et à l’avènement d’un nouvel agencement entre le marché et l’État, une nouvelle manière de concevoir l’action de l’État, orientée par l’optimisation économique des infrastructures. En France et en Belgique, cette pensée de l’optimisation des infrastructures publiques a été impulsée par les ingénieurs des mines et des ponts et chaussées et appliquée d’abord à l’industrialisation du parc nucléaire civil. La planification ne répondant pas adéquatement aux problèmes techniques liés à la construction des infrastructures nucléaires, ou à l’acheminement et la tarification de l’électricité, il fallait un modèle d’action plus souple, plus fin et adaptable, nécessitant une pensée économique d’un genre nouveau. Inspirés par le succès de la pensée cybernétique, les ingénieurs des mines veulent eux aussi unifier les domaines de l’automatique, des mathématiques, de l’économie et du gouvernement des hommes. Il s’agit pour eux d’optimiser toute la chaîne de production, depuis le fonctionnement des grandes institutions jusqu’aux ramifications les plus ténues des réseaux de communication. Dès lors, l’optimum (soit l’état le plus favorable, le meilleur possible d’une chose en fonction de conditions données) deviendra l’un des axiomes centraux dans la production des nouvelles infrastructures et plus largement des politiques publiques menées dans l’Hexagone.
L’application de l’optimum au gouvernement des villes intervient assez naturellement : quoi de plus difficilement contrôlable qu’une ville qui se développe rapidement ? Quoi de plus enchevêtré que les réseaux urbains ? Aux caractéristiques propres à la ville s’ajoute le contexte mondial des années 1970 : les chocs pétroliers successifs et la désindustrialisation poussent les autorités à réorienter les conditions de production de valeurs en milieu urbain. Tout ce qui était jusque-là considéré comme improductif dans la ville se voit soumis à une logique de marché, mais redéfinie et régulée par l’État : la voirie, l’habitat, les équipements collectifs sociaux et culturels, les réseaux énergétiques… deviennent tous des fonctions à valoriser. Cette logique de marché agit selon un principe qui veut que la production de valeurs n’émane plus simplement des unités de production (les usines), mais de la circulation des humains et des marchandises, c’est-à-dire des infrastructures qui permettent aux premiers de vivre (et donc de produire) et aux secondes d’être acheminées avec fiabilité, efficacité et en maîtrisant les coûts. Les infrastructures urbaines deviennent des instruments de premier plan pour assurer ce changement de paradigme tout à la fois économique et gouvernemental (l’usine s’étend à la ville tout entière / vivre en ville c’est, d’une manière ou d’une autre, être productif).
La dynamique de métropolisation telle qu’on la connaît aujourd’hui s’est considérablement accélérée depuis le début des années 1980. Sous l’impulsion d’une première diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et par la mise en œuvre de nouvelles modalités de gouvernance des projets urbains (axés sur une sémantique de gestion des risques et des incertitudes et une logique de pilotage et d’adaptation), les grandes métropoles européennes ont progressivement accru leur influence à l’échelle des territoires régionaux.
City branding
Depuis les années 2000, nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Le processus entamé dans les années 1970 aboutit à un phénomène assez nouveau : les villes sont devenues des entités économiques en tant que telles. Non seulement il existe une valorisation économique des services et fonctions urbaines réputées improductives, mais la ville même devient une marchandise en concurrence avec les autres villes sur le marché global de l’attractivité urbaine. Nous assistons de ce point de vue à une curieuse reconfiguration de tous les centres-villes et plus largement des agglomérations autour de « pôles d’attractivité » alignant les différentes fonctions urbaines historiques pour les placer sur un même plan d’équivalence, une même économie de la qualité urbaine : les musées, les universités, les hôtels, les parcs urbains, les quartiers anciens, les immeubles d’habitation, les commerces, les sièges sociaux des entreprises mais aussi les rues, les places, les réseaux de transport, doivent pouvoir être valorisés économiquement afin de permettre la requalification d’une ville moyenne (dans tous les sens du terme) en métropole d’envergure internationale. Évidemment, cette grande course à l’échalote ne manque pas d’accroître les disparités territoriales : plus certaines portions de l’urbain gagnent en puissance, plus d’autres se trouvent reléguées et délaissées. À côté des grandes métropoles régionales, les villes moyennes qui ne parviennent pas à passer le cap de compétitivité ne peuvent qu’être ravalées au rang d’urbanités médiocres. On comprend aisément de ce fait que leurs habitants, frappés du même genre d’indignité, soient les moteurs de la révolte actuelle des gilets jaunes et que bloquer les flux métropolitains leur procure une certaine allégresse.
Ce nouveau « stade » de la métropole se caractérise par la prépondérance des stratégies de communication (ou de « marketing urbain »), au premier rang desquelles figure le city branding. Le branding est une sorte de campagne publicitaire ininterrompue vantant les mérites de telle ou telle qualité urbaine, sur une scène qui se veut internationale. Cette manière de transformer la ville en marque remonte sans doute au célèbre I love NY (campagne initiée en 1977), mais c’est vraiment à partir du début des années 2000 que le phénomène se généralise à l’ensemble des grandes métropoles mondiales. I amsterdam, ONLYLYON, I love BCN, Be Berlin... Pour accroître la valeur de la ville, la marque doit être en mesure d’incarner l’identité urbaine, faire sentir la puissance de telle ou telle grande métropole et son positionnement sur le marché global. Elle s’appuie aussi bien sur le patrimoine que sur les personnalités locales, les grandes enseignes, les restaurants, les équipements culturels, la gastronomie même… Tout lieu, bien (matériel et immatériel) ou personne à forte valeur ajoutée est susceptible d’augmenter, en vertu des incantations marketing, la performance de la métropole.
Parmi les stratégies de communication et de branding métropolitaines, l’organisation de grands événements internationaux est un élément central. Jeux Olympiques, Coupes du monde de football, Expositions universelles, festivals de musique : ces événements, parce qu’ils ont la capacité de faire parler de la ville au-delà des frontières du pays, d’attirer des investisseurs et des foules de consommateurs, ont une fonction essentielle dans l’avènement des métropoles. Et au-delà de leurs seules capacités d’attraction et de fascination, ce sont pour les autorités de formidables occasions pour remodeler des pans entiers de la ville. Les pouvoirs publics espèrent profiter en effet de l’aura générée pour désactiver par avance toute opposition aux transformations urbaines « nécessaires ». Les grands événements métropolitains permettent d’accélérer considérablement le rythme de transformations qui, sans eux et du fait du caractère intrinsèquement morcelé et fragmenté de l’espace urbain, prendraient des dizaines d’années.
Les stratégies de communication métropolitaines ont aussi la spécificité de s’incruster à même le bâti. L’architecture monumentale d’une gare, la hauteur des tours qui ornent un centre-ville ou l’éminence de tel musée affirment et magnifient la splendeur métropolitaine. De manière moins tape-à-l’œil, la communication métropolitaine s’incarne dans une foule de petits équipements urbains ou d’aménagements de l’espace, des devantures de magasins au design du tramway en passant par les flottes de vélos en libre-service, l’ensemble fabriquant une atmosphère, une ambiance ou une qualité urbaine policée et (si les designers et les communicants ont réussi leur coup) bien identifiable.

Gouvernance et enchantements métropolitains
Au-delà des fins économiques, ou à travers elles, s’affirme une volonté de gouverner tout aussi fondamentale. L’aménagement urbain, en même temps qu’il véhicule la « marque urbaine », embarque une machinerie complexe d’incitations comportementales, de calibrages des subjectivités, de manières de piloter à distance et de « conduire les conduites » des citadins. Plusieurs registres ou familles de dispositifs sont mobilisés.
Il y a bien sûr le registre sécuritaire : les portiques de sécurité, les patrouilles de militaires en armes dans les gares, les équipages de BAC qui sillonnent la ville, l’omniprésence des contrôleurs dans les transports en commun, ou celle des caméras de vidéosurveillance. Dans la même veine, les métropoles constituent un espace de déploiement privilégié pour ce que les urbanistes nomment la prévention situationnelle : en supprimant les passages couverts et les angles morts dans l’espace public, en éliminant les points de stagnation (comme les bancs) et en installant des miroirs dans les couloirs du métro, l’urbanisme préventif instaure un espace public « transparent » dédié exclusivement à la circulation et à la gestion des flux.
Un second registre concerne le tri des populations : péages urbains, mobilier anti-SDF, coût excessif des petits supermarchés, des restaurants, des parkings, des navettes d’aéroports... Un ensemble de dispositions sont prises pour réserver l’espace métropolitain aux populations qui ont les moyens de le fréquenter, et plus encore, de l’habiter.
On retrouve pour finir un registre plus « doux » que l’on peut regrouper sous le motif de l’incitation comportementale, du nudge, comme disent les experts en économie cognitive. Le nudge (que l’on pourrait traduire en français par « petit appel du pied ») est un « signal faible » permettant d’orienter une conduite dans le sens désiré. Massivement utilisés en France dans le domaine de la sécurité routière (les personnages qui boudent lorsque nous roulons au dessus des limites de vitesse), les nudges se développent désormais dans toutes sortes de domaines. Que l’on songe au nouveau compteur Linky, censé influencer notre consommation électrique en nous indiquant en temps réel nos consommations, ou aux dents peintes sur les portes de cette rame du RER E à Paris, qui doivent inciter les usagers à ne pas « forcer le passage » au dernier moment.
L’ensemble de ces incitations comportementales participe au profilage de subjectivités qui ne doivent pas faire déraper le programme métropolitain. Mais au-delà de ce volet prescriptif, la métropole insiste comme résonance intime, comme émotion ou comme ambiance. Des portiques et des nudges ne suffisent pas à peupler les nouvelles urbanités : la métropole ne peut se résumer à une conjuration de l’imprévu ou de toute vitalité trop remuante, elle secrète aussi ses désirs, ses positivités. Parfois ces affects traversants s’incarnent en figures aimables, susceptibles d’incarner l’habitant exemplaire : les êtres branchés et connectés (smart people, hipster, classe créative) ou l’écocitoyen responsable dans la ville durable... Sans doute les formes contemporaines de gouvernementalité accomplissent pleinement leur objet quand elles parviennent à configurer ces intimités stabilisées (et qui deviennent elles-mêmes les agents d’un certain ordonnancement du monde, en bons relais métropolitains). La métropolisation est aussi le nom d’un nouveau processus de mobilisation des corps, des énergies et des âmes.
Smart cities
En parfaite continuité avec la métropolisation, un nouveau syntagme désigne depuis quelques années la ville en train d’advenir, celui de smart city. Il n’est pas évident de comprendre en quoi cela consiste précisément, mais si l’on regarde ce qu’en disent ses promoteurs, on comprend que le smart est une augmentation des fonctionnalités urbaines par ajout d’une couche informationnelle à la configuration matérielle de la ville. Plus exactement, elle est conçue comme une hybridation entre réseau informationnel et réseau technique, grâce à l’ajout massif de capteurs de tous ordres couplés à des systèmes de visualisation et d’organisation de données. La ville, en tant que telle, ne devient pas vraiment plus intelligente, des dispositifs d’intelligence artificielle ne sont pas non plus spécialement diffusés partout dans l’espace urbain ; simplement, des objets auparavant « muets » se mettent à parler, ce qui permet dans un second temps d’utiliser ces données à des fins de gestion.
On peut repérer trois grands usages du terme intelligence mis en avant par les promoteurs des smart cities :
1. L’intelligence est invoquée sous le motif de l’optimisation des flux de données et des circulations de biens et de personnes, et comme un mode d’utilisation raisonné des ressources. Elle constitue alors l’un des piliers du caractère indissociablement durable et rentable des villes de demain.
2. L’intelligence serait liée à la capacité des smart cities à accroître la transparence des politiques urbaines et à faciliter les interactions entre les citoyens-usagers et les autorités métropolitaines. L’exemple souvent cité à cet égard est celui de l’application SeeClickFix, mise en place à Chicago et Washington et qui permet d’envoyer des requêtes directement aux pouvoirs publics en cas de dysfonctionnement des dispositifs urbains.
3. Enfin, la smart city serait une façon de concevoir à nouveau le système de fonctionnement urbain comme une totalité intégrée. Le smart ne constitue pas une nouveauté radicale dans la conception des villes mais plutôt une intensification de leur métropolisation, axée sur la double logique d’optimisation des flux et de gouvernement des conduites comme des circulations.
Pour l’instant, la smart city est avant tout un signifiant flou distribué dans un assemblage d’images, de textes, de schémas, c’est une nouvelle manière de raconter l’urbain encore très largement fictionnelle. Sa réalité se limite à quelques portions de villes et à des artefacts dont la portée est logiquement exagérée par la publicité qui en est faite. Cela étant, elle se traduit par l’installation de dispositifs bien opératoires, des plus terrifiants, comme les programmes de reconnaissance faciale et les virtual fences (clôtures virtuelles)à ceux qui désormais tissent notre quotidien : les puces RFID (comme pour le pass Navigo), la géolocalisation des GPS, les smartphones, les tablettes numériques, les programmes de « réalité augmentée », les SCADA (terminaux distants qui permettent de gérer un environnement technique), les compteurs Linky... On retrouve une myriade d’objets connectés, mais ils ne forment pas (encore) une totalité unifiée. La smart city ressemble toujours, à l’heure actuelle, à une déclinaison de la ville utopique du XIXe siècle, avec cette idée qu’il serait possible de saisir les principales caractéristiques d’un environnement urbain au premier coup d’œil, de faire se rejoindre la carte et le territoire, la vie et la police. Depuis un tableau de bord centralisé, les gouvernants pourraient alors gérer l’ensemble des fonctions urbaines pour rendre (enfin) la ville intégralement gouvernable.
Perspectives critiques et terrains de lutte
La métropolisation est d’abord un phénomène sensible. Par conséquent, c’est sur ce même plan du sensible qu’elle suscite une défiance immédiate, à partir de laquelle trouve à s’articuler une critique, que l’on pourrait qualifier d’esthétique (au sens où elle s’attaque aux formes et aux matières qui font la métropole). En se baladant dans les grands centres métropolitains, beaucoup d’entre nous ont pu éprouver la sensation de se trouver dans un environnement hors-sol tenant plus de la maquette d’architecte que d’un lieu de vie. Sensation prégnante de déjà-vu, de déambuler inlassablement dans la même ville du fait de la standardisation et de l’uniformisation des aménagements et mobiliers urbains ; sidération ou sentiment d’écrasement ressenti face à ces réalisations architecturales titanesques...
Au-delà de ce registre esthétique, la métropolisation constitue aussi un objet de critique politique et sociale. La métropole est décriée pour la muséification ou la touristification dont elle est vectrice, pour l’éviction des pauvres des centres-ville et la transformation des quartiers qu’elle entraîne. Elle est critiquée aussi sur son volet juridique, pour la concentration des pouvoirs et le millefeuille institutionnel sur lequel elle repose. Est dénoncée encore l’influence néfaste qu’elle exerce sur l’ensemble du territoire : extension du marketing territorial aux zones rurales, abandon des petites lignes de train au profit des lignes TGV, délaissement des bourgs et des zones faiblement valorisables, accroissement de la réglementation des espaces naturels, etc.
Ces critiques ont notamment surgi dans l’espace public à l’occasion d’événements d’ampleur internationale. Portées par des mouvements d’opposition, elles étaient centrées sur la résistance à l’éviction des populations les plus pauvres des centres-villes et accompagnées de toute une panoplie de gestes politiques, manifestations, occupations d’immeubles, productions de textes et d’affiches. Elles ont depuis fait le tour du monde. De Séoul à Atlanta en passant par Athènes et Rio, les Jeux Olympiques ont suscité d’importants mouvements de protestation à l’endroit des opérations accélérées de métropolisation qui parviennent, en quelques années à peine, à reconfigurer complètement le tissu urbain des villes hôtes.
De manière plus diffuse, les mouvements d’opposition à la métropolisation ont également pris corps dans la résistance à des opérations d’urbanisme moins « événementielles », comme le réaménagement de quartiers ou de parcs. Parmi les exemples à la fois les plus récents et les plus emblématiques, on peut citer l’occupation du parc Gezi et de la place Taksim, à Istanbul, en 2013, ou la révolte du quartier de Sants à Barcelone qui a fait suite à l’expulsion du Centre Social Autogéré Can Vies en mai 2014. En France, le cas le plus actuel et le plus retentissant concerne une lutte engagée en ce moment même à Marseille contre le réaménagement de la place Jean Jaurès, dans le quartier de la Plaine. Ce qui nous intéresse particulièrement dans ces luttes de quartier, c’est que leur moteur est tout autant la résistance à la métropolisation (à l’inscription spatiale du capitalisme ou à l’autoritarisme des pouvoirs publics), que la défense des usages et des manières de vivre qui précèdent l’opération d’urbanisme dénoncée. Elles ont cette qualité de ne pas se satisfaire d’une pure dénonciation, elles allient en conséquence une dimension affirmative et positive à la critique de la métropole.
Les théories critiques dominantes dans les courants anti-métropolitains gravitent pour l’essentiel autour de la notion de « gentrification ». D’origine académique et héritière d’une tradition intellectuelle allant de Georg Simmel et Siegfried Kracauer à Henri Lefebvre ou, plus récemment, David Harvey, cette dernière éclaire le caractère spatialisé de la domination urbaine par des enquêtes empiriques attestant le remplacement des classes populaires des centres-ville par des populations de classes plus aisées. S’il n’y a pas lieu de nier la réalité du phénomène décrit par les théoriciens de la gentrification dans de nombreux quartiers de villes du monde entier, ce type d’analyse présente trois inconvénients majeurs.
Le premier a trait à l’effet totalisant de l’interprétation qu’il propose, ce qui explique en partie son omniprésence dans les débats sur la ville. La gentrification condense l’ensemble des critiques formulées à l’encontre de l’économisation et du gouvernement des villes sur l’argument du remplacement de population. L’argument tient lieu tout à la fois de clé interprétative (il s’appliquerait partout sans transformation majeure) et de bannière (il donnerait sens aux luttes ou en élargirait nécessairement les enjeux). S’il est vrai que le concept fédère et donne une image nette d’un aspect du problème, il occulte en même temps d’autres modes de description et de problématisation. Plus ennuyeux, il recouvre bien souvent à l’avance les pensées critiques qui se construisent là où les problèmes se posent, celles qui tiennent compte des êtres et des positions en présence, des parcours de vie et des possibilités d’action.
Le second inconvénient découle du premier. En unifiant et généralisant le phénomène, et contrairement à ce que l’on pourrait penser, la gentrification participe moins à le défaire qu’à le renforcer. La gentrification agit comme unique ressort de son propre développement, lequel semble régi par des lois inflexibles (et ce, que son moteur soit l’offre ou la demande, qu’il soit socioculturel ou économique). La gentrification semble s’imposer partout avec la même implacable efficacité [5]. Comment résister à un phénomène aussi massif, aussi omniprésent ? Quelles autres prises que la dénonciation nous laisse-t-il ?
L’embarras vient enfin de la personnification de la domination induite par cette tournure, du climat de suspicion qu’elle génère et, in fine, de l’impossibilité d’investir politiquement l’une ou l’autre des positions sociales qu’elle décrit : qui se vit comme gentrifié ou gentrificateur ? On ne voit pas bien comment nouer depuis cette alternative des alliances capables de déjouer la méfiance et l’inattention polie que la métropole dresse entre les formes d’existences qui la peuplent ordinairement.
À de nombreux égards, on peut lire le présent ouvrage comme une tentative de proposer une autre manière de percevoir et de concevoir les rapports de pouvoir associés à la transformation actuelle des villes. Il s’agit bien de rendre compte de ces rapports de pouvoir (et là où il y a pouvoir il y a résistance), de décrire les grandes opérations de gouvernance métropolitaine, mais tout en potentialisant ce qui d’ores et déjà les mine, les déborde et les configure autrement.
La métropolisation, phénomène diffus et lacunaire
Les métropoles contemporaines se développent de manière très inégale, et ce à l’échelle des agglomérations comme à celle, plus réduite, des quartiers, des différentes zones urbaines et périurbaines qui composent les territoires. Une même aire métropolitaine peut en ce sens regrouper des zones très diversement « développées », et l’on peut trouver au sein même de ces zones, à l’échelle d’un îlot ou d’une rue, des fractions de l’urbain elles encore disparates. Cette hétérogénéité est accentuée par le mode de diffusion du phénomène métropolitain : à côté des grands projets prestigieux, la conversion des réalités urbaines prend autant par des projets d’ampleur beaucoup plus réduite, des petits aménagements d’espace public disséminés un peu partout dans la ville. Elle est accentuée encore par sa diffusion sensible et l’adhésion subjective qu’elle requiert. Il ne suffit pas de quelques réalisations architecturales et d’une bonne campagne de marketing pour convertir l’entièreté d’une population urbaine à l’ethos métropolitain. Ce caractère diffus, éclaté, rend le processus d’ensemble difficile à appréhender, cela fait sa force mais cela fait aussi de lui un phénomène éminemment paradoxal.
Attachons-nous un temps au centre-ville de Barcelone et à son processus chaotique et pourtant exemplaire de métropolisation. Vue d’en haut, la métropolisation à la catalane peut être considérée comme exemplaire, étant donnés les flux internationaux qu’elle attire, l’attraction qu’elle génère. Pourtant, elle est en même temps très controversée du côté des habitants : Barcelone est sans doute la ville européenne où la vie de quartier y est la plus animée, celle qui a connu le plus de luttes contre des réaménagements urbains ou des promotions privées ces quinze dernières années. C’est aussi la première métropole à avoir élu pour maire une personnalité directement issue d’un mouvement social lié précisément à la question du logement [6]. Ainsi, des quartiers de l’hypercentre comme celui du Raval peuvent mélanger grands hôtels et commerces touristiques, grands aménagements métropolitains (comme le MACBA, Musée d’art contemporain de Barcelone) et un fort tissu associatif de quartier, des communautés de primo-arrivants encore importantes, des commerces interlopes, mais encore des mobilisations d’ampleur engagées contre la métropolisation du quartier [7]. Le paradoxe de la métropole barcelonaise est celui d’un processus métropolitain qui, s’il rencontre des succès certains sur le plan du marketing urbain, comme sur celui de sa politique de grands travaux de réaménagement (entamée à la suite des Jeux Olympiques de 1992), échoue dans la conversion sensible de la ville et ne parvient pas à recouvrir l’extrême diversité des formes de vie urbaines.
Au fond, et mis à part les capitales et les grandes villes qui étaient déjà « gagnantes » avant de devenir des métropoles, la plupart des autres villes ne sont pas parvenues jusqu’à présent à le devenir à leur tour. Toutes font du marketing urbain, toutes communiquent sur leur conversion et tentent de produire les subjectivités requises à leur développement, mais, pour la grande majorité d’entre elles, la réalité économique ne suit pas.
Enquêter aux bords de la métropole
Enquêter sur la métropole, pour nous, signifie enquêter sur ses bords. Bords spatiaux bien sûr mais aussi bordures économiques, sensibles et politiques. Enquêter sur les bords de la métropole, c’est prêter attention au phénomène en train d’advenir, c’est aller regarder précisément là où il réussit ou là où il échoue, là où ses prises sur le réel se renforcent, et là où elles se dissolvent, se désagrègent. La métropolisation n’est pas un phénomène stabilisé. Aussi, on ne sait jamais avec certitude là où elle commence et là où elle prend fin. Elle est plutôt affaire d’emprise, elle agit comme une modalité particulièrement effective – quoiqu’instable et diffuse – de prise de contrôle sur l’expérience urbaine. Enquêter sur ses marges éclaire donc ses modalités spécifiques de déploiement, sa diffusion labile et discontinue.
L’autre raison pour laquelle nous enquêtons sur les bords du phénomène métropolitain est politique. Affirmer que la métropole est une totalité partielle, qu’elle n’agrippe jamais complètement le réel, qu’elle est, jusqu’en son centre, trouée de toute part, a des conséquences politiques cruciales. D’abord, ce parti pris méthodologique contrecarre l’effet de sidération qu’elle véhicule, et qui reste sans nul doute l’une de ses armes les plus puissantes. On ne peut rien gagner face à un ennemi que l’on a préalablement constitué comme trop grand pour soi. Ensuite, concevoir la métropole comme une totalité partielle invite à prêter attention à toute l’activité de basse intensité qui lui est fondamentalement rétive, à toutes les récalcitrances que les processus de métropolisation génèrent. Une lutte urbaine conséquente ne surgit pas de nulle part. Aucune n’a été construite de toutes pièces, par la seule volonté d’une poignée de militants conscients et lucides. Toutes naissent d’un substrat qui leur préexiste, d’une trame de liens, de gestes, d’histoires et d’habitudes grâce auxquels la lutte acquiert sa force propre, et par lesquels elle est en mesure de s’inscrire dans la durée. Porter un tel regard sur les villes en cours de métropolisation autorise enfin à considérer toutes les portions de l’urbain qui n’ont pas encore été submergées, non plus (seulement) comme les prochaines cibles mais comme de potentiels foyers de résistance, à l’état plus ou moins latent. En somme, l’essentiel de ce qui résiste à la métropolisation est déjà là. Le travail politique de ceux et celles qui s’opposent à la métropolisation des vies urbaines nécessite avant toute chose une conversion dans la perception du phénomène, afin de reprendre prise dans la ville et goût à la vie urbaine.
Esprit des lieux et vie de quartier
Avant d’être complètement réécrit, ce livre a été un rapport de recherche, rédigé dans le cadre du programme « Ordinaire et métropolisation » du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA). Destiné, comme tous les écrits de ce genre, à grossir la taille d’une pile sur une étagère, c’est à Greg Pascon et Marc Monaco que nous devons de lui avoir donné une fin moins piteuse, nous les en remercions chaleureusement. Malgré tous nos efforts, la tonalité sociologique n’a pas complètement disparu. Cela s’explique par la difficulté à orienter un texte dans une direction différente de celle dans laquelle il a été initialement rédigé, mais cela se comprend aussi par le type de sociologie dont nous avons usé et dont nous voulions conserver certaines qualités. On peut résumer ces acquis à deux partis pris essentiels (pourtant réputés parfaitement anti-sociologiques si l’on se réfère à la conception durkheimienne dominante) : celui du vitalisme et celui du spiritualisme. Ou, pour le dire autrement, au titre de politique de l’enquête, ne rien piétiner de ce qui fait la vitalité d’une situation, et apprendre à reconnaître, discerner, respecter, honorer les esprits des lieux.
S’agissant du premier, et dans la lignée de la sociologie générale de Gabriel Tarde [8] et de la sociologie urbaine de l’école de Chicago [9], nous considérons la ville comme un milieu de vie, dont les modalités d’existence ne peuvent être réduites à des logiques mécanistes ou de planification. « La ville est quelque chose de plus qu’une agglomération d’individus et d’équipements collectifs. La ville est plutôt un état d’esprit, un ensemble de coutumes et de traditions, d’attitudes et de sentiments organisés, inhérents à ces coutumes et transmis avec ces traditions. […] Autrement dit, la ville n’est pas simplement un mécanisme matériel et une construction artificielle. Elle est impliquée dans les processus vitaux des gens qui la composent : c’est un produit de la nature et, particulièrement, de la nature humaine. [10] » Pour Robert Park, la ville est le produit de l’histoire naturelle des sociétés, elle est mue par des désirs, des forces et des croyances, c’est une ville dont la dynamique est rythmique et ondulatoire, et dont la teneur est essentiellement sensible. L’analyse d’une telle réalité est moins orientée par la recherche de fonctions, de projets, de constructions institutionnelles ou d’agglomérats privés, que par les interactions qu’entretiennent différents milieux de vie et communautés, par les conflits et les frottements que ces interactions produisent. Rapportée au phénomène métropolitain, cette perspective vitaliste a l’avantage de fournir des instruments permettant de décrire aussi bien le phénomène métropolitain lui-même, les forces qui la travaillent et les désirs qu’il mobilise, que tout ce qui dans la ville, lui reste hétérogène. Il n’y a pas d’un côté la métropole, ses flux de valorisation économique et ses grands projets d’aménagement et, de l’autre, une ville vivante et ordinaire ; il y a des vivants et des milieux de vie en concurrence sur le terrain troublé du sensible, en lutte pour imposer leurs vues.
Il s’agit toujours, pour les grandes politiques urbaines, d’aligner la vitalité de la ville sur un ordre de circulation, un ordre de police dont l’effectivité n’est jamais complète et entière. La fabrique de la ville trouve son dynamisme dans cet écart, dans cette béance toujours maintenue entre ce qui survient et la possibilité de l’ordonner. La vitalité d’une ville tient à sa capacité à déborder l’ordre public. L’ordre public se maintient, au mieux, lorsqu’il parvient à anticiper et piloter les débordements possibles, le plus souvent, il ne procède que de recadrages a posteriori. La vie de quartier est par excellence ce qui échappe à son ordonnancement, elle est ce plan de déploiement des vies locales qui interagissent un cran en dessous du public, elle est l’émanation directe de la densité ou de la ténuité du réseau qui relie ces vies entre elles. Elle est leur mémoire, leur esprit.
C’est pourquoi notre second parti pris, au titre de politique de l’enquête, est celui du spiritualisme. Dans le compte-rendu d’enquête que nous présentons ici, l’idée de vie de quartier doit être comprise comme une véritable catégorie d’analyse, désignant ces phénomènes qui relèvent de l’évidence pour qui habite un quartier, mais qui semblent recouverts d’un épais mystère pour l’observateur non averti. Le parti pris spiritualiste que nous défendons est intimement lié au premier : il ne peut y avoir un « esprit » de quartier que dans la mesure où des formes de vie spécifiques s’en dégagent. Pour cela, les quartiers choisis pour l’enquête l’ont été autant du fait de leur capacité à ne pas se laisser aisément réduire, pour leur vitalité débordante pourrait-on dire, que pour leur capacité à s’imposer d’eux-mêmes, à projeter sur le mode de l’évidence le halo d’un esprit singulier. Plutôt que d’avoir été choisis comme de bons terrains d’enquêtes, les quartiers des Murs à Pêches et de Saint-Léonard nous ont en quelque sorte obligés. Le premier, nous l’avions rencontré au cours d’une précédente enquête concernant les luttes urbaines à Montreuil. Sa fragmentation spatiale et son peuplement anarchique nous avaient séduits quoique, de ce fait même, nous ayons eu alors beaucoup de mal à l’intégrer au périmètre de l’enquête. Or, c’est justement cette rétivité à se laisser sociologiser qui, quelques années plus tard, en a fait un site parfait pour explorer ce qu’il y a de vivant et d’animé (au sens de « doté d’une âme ») dans des quartiers résistant à leur métropolisation. Pour le second, l’évidence a surgi de récits croisés de Liégeois. Dès que nous évoquions notre intérêt pour ce type de quartier, c’est invariablement le nom de Saint-Léonard qui se trouvait mentionné. Il se passait là-bas quelque chose qui n’avait pas lieu ailleurs dans la ville. Le génie du lieu commandait qu’on le prenne, respectueusement, en considération.
Voilà donc ce que nous proposons pour la suite : deux incursions au cœur de réalités foncièrement rétives aux processus de métropolisation qui les environnent et les traversent. En termes de méthode nous ne nous étendrons pas trop (fidèles à notre tentative de désociologisation de nos travaux). La seule indication importante à garder à l’esprit est que nous avons dû procéder par approximation. La vie de quartier, sans conteste, est ce qui fait des trous dans les totalités unifiées de la trame urbaine, ce qui fait dévier les fonctions, mine les structures établies, fait du bruit dans le transfert d’informations et produit une opacité à même de troubler les perspectives impérieuses des espaces publics. Et les valeurs, les accents, les éthiques locales, les tournures d’esprit percent aussi sûrement leur unification hâtive qu’ils fuient leur relevé empirique. La vie de quartier tient sa réalité de son intangibilité et tire sa force de sa présence spectrale. Le quartier résiste et existe sur ce mode d’une hantise intime. Faute de pouvoir saisir ou « attraper » ces urbanités fuyantes, nous n’avons d’autre solution que de nous en approcher pas à pas, prudemment. Ni les quartiers, ni les esprits n’aiment les enquêtes.