Comme n’importe quel pitch, cette phrase dit tout du livre et en même temps rien. Ce bref résumé révèle pourtant l’unique source possible de suspense : Ils vont mettre le feu à Eurodisney. Non sans humour, c’est toute la psychose du « spoil » qui est désarmée. Preuve qu’au final, une bonne fiction ne craint pas le « divulgâchage » qui, avant d’être une psychose de masse est une angoisse de commerçant : qu’on ne « gâche » pas l’élément d’intrigue moisi sur lequel tient parfois l’économie d’un mauvais produit culturel. C’est pourquoi ce livre, ne reposant pas sur un ou quelques ressorts narratifs mécaniques mais sur une intensité qualitative, ne craint pas que soit divulguer certains éléments de son histoire ni sur son marque page, ni, je l’espère, dans un article de critique. Tout en faisant office de présentation du livre, nous entendons bien entrer dans le cœur du récit, que les consommateurs à suspens s’en détournent ou se ravisent – je vous promet que la richesse imaginative de l’autrice est telle qu’aucun texte critique ne parviendra à l’étouffer – gare au spoiler !
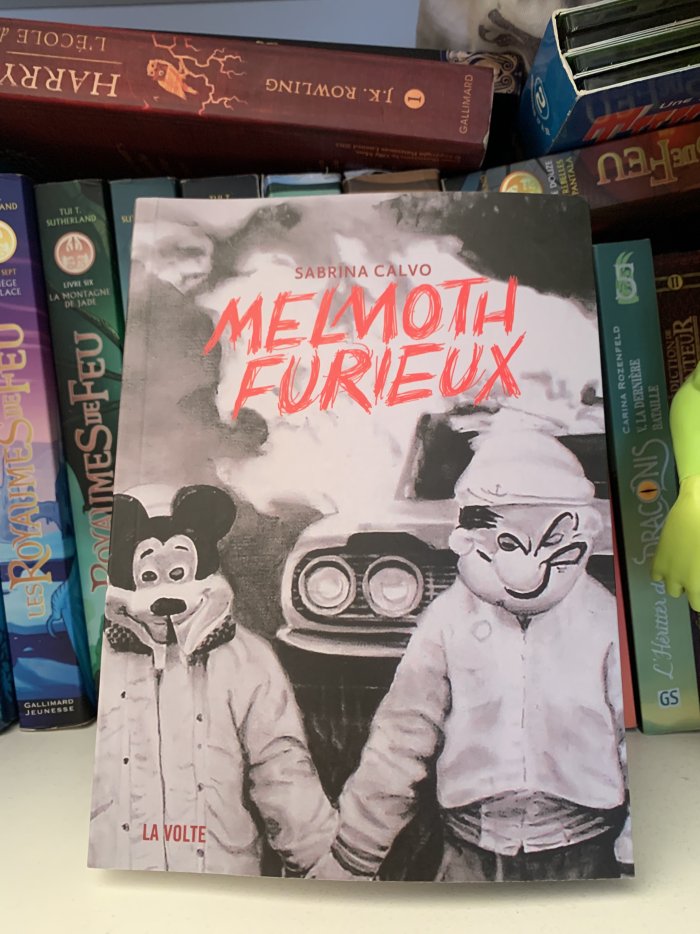
La commune comme territoire psychogéographique
Melmoth furieux se passe dans les rues d’un territoire réel, le quartier de Belleville, entre la Place des Fêtes et Ménilmontant sur une surface qui pourrait correspondre à l’ancienne commune d’avant l’annexion de 1860. Ce quartier choisi comme cadre narratif est une réalité sociale (lieu de mixité forte), géographique (puisqu’elle est une colline) autant qu’historique (dernières défenses de la commune de Paris en 1871). C’est une réalité multispécifique, un tissu social, associatif, politique, un écosystème de rapports non-marchands que l’on peut appeler « commune », en faisant référence autant à la commune historique révolutionnaire (représentante d’une alternative politique radicale) qu’au territoire de résistance réellement existant et contemporain : « la commune n’est pas qu’une idée, ou même une démarche politique, c’est une vie. » (p.145)
Plus qu’un décor, cet environnement comprenant à la fois des lieux et des liens, est le terrain quasi- anthropologique d’où s’invente l’histoire. L’autrice part de ce réel spécifique – l’existence de liens politiques intenses – pour le transcender, en faire sortir ce qu’il comporte de plus puissant.
La narration est dévoilée à travers les déplacements de Fi, le personnage principal, selon un cadastre imaginaire qui se superpose au cadastre réel du quartier. Le livre à donc bien quelque chose à voir, dans son processus de création, avec la « dérive psychogéographique » au sens situationniste – à la fois mode de déplacement typiquement urbain et recherche de sens nouveau, déplacement non-utilitaire, attention aux lieux et aux signes – et avec la maraude – selon le terme employé pour parler de certaines activités militantes à Belleville, comme la distribution de repas solidaires ou la surveillance des keufs.
A l’origine du livre il y a donc des errances – celle de Fi diégétiquement et celle de l’autrice dans son travail poïétique – qui permettent d’écrire un nouvel imaginaire communard. La fiction s’ancre dans une réalité politique (elle-même rattaché à un territoire particulier) qu’elle « dégénère » pour construire une réalité futur : « la commune libre de Belleville ».
L’autrice invente le futur à partir du présent et de l’ici, si elle cherche à décrire un futur désirable, « libre », un « possible-impossible » au sens de Henri Lefebvre son geste est l’inverse du geste utopique : la situation politique futur imaginée n’est pas sans lieu, elle est au contraire installée dans un territoire réel, vécu comme tel, et en perpétuelle évolution : Belleville.
La commune comme refuge
Le monde « futur » décrit dans Melmoth furieux est lié au monde du présent, simplement séparé de lui par l’anticipation des devenirs. S’il y est question d’un endroit résistant, organisé, protégé par des barricades, le livre décrit également son envers : la dystopie marchande. Dans l’univers du livre, le règne de l’économie existe au delà des limites de « la commune libre », l’entoure même ; des troupes stationnent au bas des barricades et enferment leurs proies dans des cages. Le monde détestable du pouvoir continue et menace même Belleville de sa supériorité.
Là aussi, le travail de fiction consiste à imaginer les formes que prennent la domination mais contrairement à d’autres œuvres de science-fiction, la description du pouvoir ne prend que peu de place dans l’ensemble de l’ouvrage et n’existe que pour faire perdurer une menace fasciste dans un monde futur, on n’y trouve aucunes traces de fascination pour elle.
Le livre parle d’un Paris dystopique abandonné à la gouvernementalité néo-libérale autoritaire dont les barricades de Belleville protège fébrilement. Ce que Melmoth furieux ne raconte pas c’est l’histoire immédiate du quartier : sous la menace d’une métropolisation des existences, de nombreux habitant.e.s viennent chercher secours à Belleville, qui par ces liens et sa mixité sociale apparaît comme un refuge au contrôle et à la valorisation capitaliste. Ainsi, se construit un mouvement de gentrification du quartier mettant en péril ce que les fuyards étaient venus y chercher.
Par contre dans le livre, « la commune » joue un rôle transcendantale qui ouvre une autre voie dans ce fatalisme : attirant les populations en exode, la commune (comme force collective), les transforme. Les nouveaux venus se mêlent aux habitants (comme Fi), par une attention et une présence au territoire et participent à la construction d’une « commune libre », tiennent des barricades, réinventent la vie.
La genèse du livre se nourrit de toutes ces errances : le mouvement d’exode des déserteurs de la métropole fait écho à l’errance du personnage principal – qui va de « l’orée du bois » (son quartier d’origine) vers Belleville puis des marges de cette commune vers son cœur – qui elle-même se superpose au parcours de l’autrice qui, voyageant de villes en villes, écrivant de Montréal à Zanzibar, vient habiter à Belleville. « C’est comme m’enraciner, d’un coup. Là. Besoin de stabilité. » (p.187) La question de l’ancrage – connaître le territoire, l’arpenter, s’y cacher, y vivre, y tisser des liens – est un élément central du livre, en plus de la volonté de mettre en commun sa révolte elle est la quête ultime du personnage principal : « J’ai la sensation de trouver une place dans cette vie quotidienne, récurrence que je n’avais pas pu saisir avant » (p.133)
La subjectivité contemporaine se caractérise par l’angoisse d’être sans-lieu, hors-sol. Dans la phase de domination réelle du capitalisme, au sens de Cesarano, chacun.e est sans liens, sans attaches, sans lieux et sans communautés dans la société atomisée.
Le personnage, comme l’autrice quelque part, fait partie de cette population qui arrive à Belleville à la recherche d’un refuge, d’un lieu où vivre, d’une zone à défendre. Tout au long du livre Fi cherche un lieu et l’autrice, au long de son œuvre, cherche une commune. Fi, lourdé par sa meuf dans les premières pages, cherche un lieu où vivre, où partager sa colère, sa révolte, où s’organiser, où construire un avenir. Selon l’évolution de son œuvre, l’autrice cherche une alternative radicale à défendre, s’inspirant des élans libertaires de la commune de Montréal dans Toxoplasma et de Belleville dans Melmoth furieux.
La commune, matrice imaginaire
Fi commence timidement à s’installer dans le quartier et son parcours, qui est encore dérive, la mène au centre de la commune, jusqu’aux souterrains de la Place des Fêtes, dans les dessous de la conspiration. Dans Toxoplasma Sabrina Calvo construit un récit en marge de la commune, en suivant Nikki qui vit en périphérie des événements politiques tandis que Fi se tient au cœur du mouvement communal. Fi (et si on extrapole, l’autrice) suivent un chemin de politisation, de radicalisation qui va des marges vers le cœur de la révolte. Et cette trajectoire passe par la création de liens, par la connaissance du milieu, par l’attachement. Dans Melmoth furieux, là où Nikki restait méfiante, Fi se lie de plus en plus avec d’autres défenseurs et défenseuses et parallèlement s’enfonce de plus en plus dans le territoire, cela correspond surement au fait que le travail de l’autrice s’est amplifié par une connaissance du territoire et des habitant.e.s.
La commune dans le livre, dans l’oeuvre, et dans le réel est un événement qui fonde l’imaginaire, qui ouvre les possibles et permet l’écriture d’un tel livre. La commune, comme expérience historique ou comme expérience contemporaine permet de donner un lieu à l’imagination de nos futurs désirables. Le livre s’inscrit dans ce que Henri Lefebvre appelle un « romantisme révolutionnaire » ou autrement dit une « investigation des possibles », quelque chose qui manque cruellement dans la production artistique contemporaine.
Libérée de son carcan stalinien, l’imaginaire de la commune redevient une force subversive, une matrice depuis laquelle inventer un monde nouveau – à la fois dans le réel et le travail politique où l’on part de ce qui existe pour inventer un autre monde réalisable : comment faire une commune libre à Belleville ? – ou dans l’imaginaire et le travail poïétique qui consiste à inventer une autre réalité : comment décrire cette commune libre ? On en revient à Rancière qui a bien montré que toute révolution sociale est une révolution esthétique, ce que fait un art « politique » ce n’est pas seulement qu’il « dénonce » mais plutôt qu’il ouvre du dissensus dans le régime de réalité dominant, contre l’ordre policier du sensible (où chaque chose est bien à sa place). C’est ce que fait ce livre, il déchire les perceptions policière du réel, il les transforme.
La situation dégénérée : l’Empire
La dystopie futur – déjà là – s’appelle « la Métrique » dans le livre et peut être comprise comme une métaphore du capitalisme néo-libérale « autoritaire » que nous connaissons bien. En effet, on trouve ce pouvoir caractérisé par une ultime alliance entre les grandes entreprises privées et l’Etat, lié par un culte voué au chiffre, à la mesure, à des systèmes d’informations cybernétiques. La métrique représente le monde de l’économie et sa production perpétuelle de valeur quantitative à laquelle s’oppose « la commune libre », créatrice de sens nouveau et de valeur qualitative. Sans entrer dans les détails de l’exploitation économique, ce qui peut être dommageable, la Métrique apparait dans le livre surtout par ses dispositifs de contrôle et d’enfermement, par ses forces paramilitaires répressives qui assiègent la commune.
Ce système politique est ce qu’on peut appeler « l’Empire », le « retroussement de l’Etat libérale », ultime possibilité de ce système acculé qui n’existe que dans la crise permanente, qui appuie son pouvoir sur des dispositifs (les cages) dans une paix armée où les forces de l’ordre n’existent que pour conjurer l’événement, pour étouffer toute situation. L’Empire, malgré sa grande cruauté, se présente comme le dernier rempart contre le chaos et la barbarie. Au-delà des barricades du nord-est parisien, la barbarie ; de l’autre côté, la Métrique qui représente la civilisation en bout de course.
Ce système économico-politique s’allie avec une force métaphorique, venant de l’impérialisme américain, Disneyland. La Métrique est allié à Melmoth, directeur du centre Eurodisney de Marne-la-vallée et agent au service d’un nouveau type de pouvoir horizontal, impersonnel, qui fonctionne mieux que les anciennes sociétés libérales et disciplinaires : l’Empire encore. Depuis le parc, Melmoth organise avec la complicité de la Métrique, l’exploitation d’enfants dans des sous-sols et leur aliénation par la capture de leurs amis imaginaires. Par ce biais, le livre décrit assez simplement deux concepts fondamentaux de la critique de l’économie de Marx.
Surtout, par l’intermédiaire de cette répugnante alliance, le livre décrit un aspect moins connu de la domination capitaliste : le spectacle, au sens de Guy Debord, c’est-à-dire la perspective d’une aliénation qui s’étend à l’ensemble de la vie quotidienne, aliénation totale des rêves et des passions ; conquête de l’intime et de l’imagination par la société marchande.
Le spectacle est « ce qui échappe à l’activité des [humains], à la reconsidération et à la correction de leur œuvre. » Ce qui échappe aux humains dans le livre, c’est d’abord leur imagination : sont concernés d’abord celles et ceux dont l’ami imaginaire est capturé – c’est le cas pour Mehdi, le frère de Fi – mais avec elles et eux, c’est l’imagination de tous et toutes qui est menacé par l’exploitation de l’imaginaire en tant que telle puisque par la suite l’imaginaire ainsi aliéné sert à la création de produits culturels qui sont aussi des armes. L’inquiétude vient de la « classe créative » dont le travail, aliéné par le capitalisme de l’intime, sert à alimenter l’aliénation de tous et toutes.
Cette alliance entre la Métrique et le Melmoth fonde un nouveau type de pouvoir spectaculaire que l’on pourrait appeler l’Empire, qui apparaît moins comme un ennemi qui se dresse en face de la commune libre que comme un milieu dans lequel chacun est pris en réseau, dans des flux interminables. C’est pourquoi, l’Empire, qu’il soit dans l’imagination ou dans le territoire n’est jamais vraiment limité par les barricades de la commune, le pouvoir ne cesse pas de s’exercer à Belleville, les miliciens passent les frontières et viennent jusque dans le cœur de la résistance s’en prendre à François Villon ; mais surtout, Fi est en permanence assiégée par des angoisses qui sont la marque du pouvoir dans nos vies. L’Empire apparaît comme liquide, partout présent comme contre-révolution préventive à tout ce qui pourrait constituer des trous dans le tissu biopolitique continu. « Je ne sais pas si j’arriverai à sortir. Odeur de fripes et d’ordures, de frites et de polymère. J’envisage d’aller m’affaler et de me remplir de jeux vidéos jusqu’au matin, mais non. Je reste focus sur ce qui m’émeut. » (p.34)
La situation dégénérée : La résistance
Dans ce monde aussi dystopique et d’actualité soit-il, le livre se concentre sur la possibilité de la résistance et sans être un manuel d’action directe, il pose néanmoins les bases d’une possibilité de la résistance en rappelant cette idée salvatrice qu’à chaque transformation du pouvoir s’actualise la possibilité de son dépassement ; et le livre propose ou soutien certaines perspectives stratégiques implicites. « Les armes imaginaires de l’ennemi n’auront plus d’emprise car nous serons devenus nos peaux. » (p.284)
Le champ de bataille étant sur le plan de l’intime, la résistance part de l’individu, de sa vérité profonde, du néant inaliénable au fond de l’être. C’est dans les troubles existentielles de Fi que va se nouer la révolution, depuis sa révolte profonde après la mort de son frère, immolé pour dénoncer en vain les activités de Melmoth. L’histoire débute quand Fi s’attache à ce qu’elle éprouve comme vrai : vivre à Belleville. Qu’elle part de là : « une rencontre, une découverte [un] événement [qui] produit de la vérité en altérant [son] rapport au monde » : l’obsession de vouloir brûler Eurodisney. La commune apparaît alors comme le moyen matériel d’assembler et d’organiser sa révolte solitaire, de trouver des camarades et des armes pour faire aboutir son projet, de trouver un communauté de lutte avec qui partager sa vie.
Fi s’inscrit dans son environnement, prend des repères dans les différents collectifs, développe des formes-de-vies, ouvre un squat (dés la page 66), rassemble des gens autour d’elle, prend parti en formant une communauté puis en rejoignant un groupe, PdF. Cette prise de parti est un moment de vérité et une définition de l’être ensemble qui constitue la politique. Ce moment de prise de parti peut être difficile car il engage et est un moment de frottement entre les mondes : lorsque Fi va pour rencontrer PdF, elle se heurte à du mépris de la part de ces ami.e.s, de certains militant.e.s. Lorsqu’elle vient voir Gaston pour la première fois, elle est inquiète de ce qu’ils vont penser d’elle : « Un grungeux devant me checke des pieds à la tête. Oui j’ai l’air d’une fashionista à fond de Margiela et je t’emmerde » (p.119). Et le livre raconte cette rencontre tumultueuse entre Fi et un groupe politique.
La résistance ce caractérise donc par l’implication dans une vie quotidienne, locale, vécue dans une attention aux situations et aux autres et par la constitution de mondes qui sont comme des trous dans le tissu social marchand. Puis, par l’agencement et le travail de liaison entre ces groupes. Une montée insurrectionnelle n’est peut-être rien d’autre qu’une multiplication de communes, leurs liaisons et leur articulation : et c’est exactement à ce travail auquel participe Fi en s’installant dans Belleville ; trouver un chemin pour sa révolte, qui soit en même temps un moyen de vivre en commun ici et maintenant tout en luttant contre la Métrique et Melmoth, en ayant comme objectif la destruction d’Eurodisney.
Ce travail individuel de liaison des luttes n’est rendu possible que par ce que l’autrice appelle un « soin radicale », un communisme de l’attention qui tout en construisant un autre monde, invente d’autres rapports aux autres et des possibilités de transformation de soi et des autres dans la tradition politique du féminisme où tout du privé est politique.
Enfin, le travail de tissage politique du personnage ne se distingue pas, et même se confond, avec sa pratique artistique et/ou artisanale de la couture : « J’y glisse parfois des tissages composites – j’aime la juxtaposition des matières […] nous sommes nos propres drapeaux. » (p.144) Quand Fi rejoint PdF, elle s’insère dans la fillasse, une coopérative de couture. La couture, comme l’agencement des luttes, est un travail de tissage et de liaison, de fil et de liens. C’est qu’un aspect important du livre consiste à entremêler l’art et la politique, à démontrer avec Marx que c’est la praxis, « l’ensemble des pratiques par lesquels [l’humain] se transforme lui-même et transforme la nature » qui font aboutir le mouvement révolutionnaire. « Des forteresses à faire tomber. Un nouvel horizon. […] Est ce que c’est si différent de ma couture ? […] Au fond la seule issue, c’est le corps – traces composites reliées d’étincelles […] Nos gestes ont pris la place de nos claviers. Nous sommes nos propres matrices ». (p.196)
L’enfance, un champ de bataille
Ici aussi l’origine de la dialectique entre capture et résistance se trouve dans les inquiétudes de la classe créative. Contrairement à la couturière libérée et militante de la commune, les artistes dans le monde de la Métrique sont pris dans une continuelle exploitation de leur vie par le capitalisme de l’intime. Pour survivre, ils doivent en permanence faire fructifier leur capital culturel et relationnel au centre des métropoles intelligentes, ils vivent une expérience intime de l’aliénation où il faut se vendre soi-même et être toujours en concurrence dans la sélection. « Ici les sourires sont une monnaie d’échange, un moyen de survie. » (p.212) Cette discipline de la résilience consiste entre autre à renoncer à l’enfance, aux rêves, au jeu, à la camaraderie, à ce qui pourtant fonde l’authenticité de la création artistique.
C’est en partie pour cette raison, que Melmoth exploite les amis imaginaires qui viennent de l’enfance, à travers eux c’est la créativité et la spontanéité que Melmoth recherche pour son industrie du rêve ; c’est ce qui est arrivé à François Villon dans les geôles du parc. En miroir, c’est grâce à Villon, c’est-à-dire grâce à un être composé d’imaginaire pur, et à sa matière même – ce sont des fils que Fi tire de lui – que la personnage principale va produire le tissu nécessaire à la construction d’armures et de vêtements pour les défenseurs et défenseuses de la commune. Mais c’est aussi grâce à l’amour que Fi porte au poète que la magie opère. Donc, ce qu’il y a de si précieux dans l’enfance et qu’il faudrait protéger de l’aliénation pour en faire des armes redoutables contre l’Empire, ce sont la créativité et la spontanéité d’une part et de l’autre, l’amour, perçue comme matrice du « soin radicale ».
D’un autre côté, l’enfance est également un état de minorité, de déresponsabilisation qui caractérise la subjectivité métropolitaine et capitaliste. Sous l’Empire, qui s’assure que tout fonctionne, nous sommes en permanence considérés comme des enfants. Sous le contrôle permanent, pris dans des dispositifs ludiques, les consommateurs contemporains restent dans un état de minorité qui justifie la continuité de la gouvernementalité.
C’est pour cela que le livre est peuplé d’enfants, de « pueri » (des êtres puérils ?), d’enfants-monstres qui hantent le centre ville parisien, enfants-rats errants, geeks asociaux, d’adolescentes boudeuses ; quand la copine de Fi la quitte au début du roman, elle lui dit cette phrase terrible : « c’est ça va jouer avec tes copains de maternelle ». Elle laisse entendre que les potes de Fi sont bloqués dans une enfance tardive qu’elle ne prend pas au sérieux : ce sont à la fois des gamins parce qu’ils ne sont pas ouvertement du côté du pouvoir, assis aux postes de responsabilités, et pour cela ne méritent pas le statut d’adulte – d’autant plus qu’ils continuent de rêver – pour les plus téméraires – qu’un autre monde est possible. D’un autre côté ce sont des gamins parce qu’ils son rendus complètement dépendants et tenus dans un état de minorité par un pouvoir que cette situation arrange, pour gouverner, il faut des être gouvernables : que l’on peut appeler des blooms.
Le bloom est cet être qui vie sans forme propre, il porte un désert existentiel et est spectateur de tout y compris de lui-même. Le bloom est déraciné, nulle part chez lui, c’est un être asocial et obsédé par sa survie. La bloomification est le résultat conjoint des effets de la consommation étendu à l’existence entière d’une part et l’inconstance du travail précarisé d’autre part. La bloomification est une expérience de prolétarisation et de marginalité de masse, c’est également la possibilité d’une révolte totale capable de renverser le système marchand : si la ségrégation se transmute en sécession dans une commune fuite vers des périphéries où organiser des communautés autonomes.
Le livre est peuplé de blooms, c’est-à-dire des êtres habités par ce paradoxe de l’enfance, à la fois passionnément soumis par leur état de dépendance au pouvoir et en même temps ingouvernables par leur étrangeté au monde des adultes. Les amis de Fi sont des blooms ouvertement blooms et l’autrice à peut être choisi qu’ils soient des enfants, comme les puéri qui vont en bandes criminelles d’enfants monstrueux, pour pouvoir reconnaitre leur bloomification et partir d’elle. Il y a une ambiguïté dans le fait que certains personnages soient adultes, ou en parti adultes, qui réside peut être simplement dans des niveaux différents et changeant de bloomification.
L’enfance bloomesque est le terrain de l’affrontement entre l’Empire et l’ethos de la commune libre de Belleville ; dans l’enfance en errance réside autant la possibilité de capture par le Melmoth que la possibilité de construire un grouillement de mondes capable de détruire la Métrique.
Transidentité et transhumanité
Malgré la présence menaçante des milices, un autre monde s’esquisse derrières les barricades de la commune libre de Belleville et cet autre monde « ultra-stylé » apparaît comme une explosion de différences, de couleurs, de joie, de nouvelles relations interpersonnelles. « Que l’insurrection c’est aussi style, notre expression jetée à la face du luxe et des imitations, notre besoin de différenciation perpétuel, actualisé dans le taux de rafraîchissement rapide de nos identités. » (p. 201)
Le monde de la commune libre est assurément queer et radical, dans le sens de Marx, c’est-à-dire « qui va à la racine » et « la racine de [l’humain], c’est [l’humain] lui-même. » Les révolutions naissantes à Belleville vont dans milles sens différents, au-delà de la nécessité de se défendre et de vaincre, il n’y a pas une direction unique, les habitant.e.s réinventent l’ensemble de la vie à commencer par la façon de s’habiller, de se déguiser, de se travestir. Les personnages s’affirment dans leurs différences, que ce soit leurs orientations sexuelles ou leurs origines ethniques et de nouvelles relations sont inventées qui transgressent en permanence les délimitations sociales du pouvoir : le frère de Fi n’était pas accepté dans son monde à cause de sa transexualité, Fi entretien des relations sexuelles avec des femmes mais aussi avec un être de tissu ; au 33 on vit ensemble dans une communauté trans-générationnelle, un canard vit parmi elles et eux, des enfants se transforment en rats, puis en caméras, en rats-cyborgs.
Le mouvement Trans est partout transgressif, mais ce mouvement échappe à l’identification et découvre une transhumanité informe et incompréhensible pour le pouvoir, parfois pour le lecteur. L’Empire règne sur la république phénoménale des différences, la différence n’est pas pour lui un problème en soi tant qu’elle se pose sur le plan de l’équivalence générale, qu’elle s’insère dans la valorisation capitaliste, qu’elle comporte cette neutralité éthique compatible avec la gouvernementalité. Dans ce cas, la différence sert même à la gestion impériale des identités. L’Empire se caractérise par la gestion des identités modulables, jetables, transitoires. L’Empire c’est le libre jeu des simulacres.
Dans le livre, plus le pouvoir s’émiette et plus apparaît une trans-humanité qui devient de plus en plus illisible, foule bigarré, guerrière, communautés hybrides, queers, marronnes, pris dans des devenir-trans qui inventent un imaginaire désirable s’opposant politiquement à la gestion étatique des identités : une humanité grouillante, bizarre, transversale, des enfants, des fous qui s’agrègent, font bloc. Vers la fin du roman, il y a de belles descriptions de cette multitude anonyme, informe, qui avec les pueris arrive à la commune de Belleville et qui devient une force révolutionnaire qui fait presque peur tant elle semble ingouvernable, ingérable, impure.
Cette force fait face à l’alliance ultime impériale de Melmoth et de la Métrique, elle est prête à fondre sur le château des contes de fées pour le brûler. Fi est entièrement prise dans ce mouvement, sa révolte est mise en commun grâce à sa dissolution dans le territoire et ne peut plus être limité ni par l’imaginaire rabougris du « réalisme », ni par la menace de l’ennemi, ni par les limites de la commune elle-même.
La croisade métaphysique
La colonne des pueri qui arrive jusqu’à Belleville fait référence à un évènement historique, la « croisade des enfants » qui eu lieu en 1212, une croisade populaire qui fut initiée sans l’appui des puissants et même contre eux. Cette référence à une croisade certes hérétique mais tout de même millénariste a de quoi étonné. Faire référence à la croisade c’est bousculer les références militantes, c’est d’un côté assumer un mysticisme et de l’autre convoquer une révolte populaire et massive dans un champ historique marginalisé par le camp révolutionnaire. Si dans le livre la commune est le lieu et le matérialisme dans lequel s’inscrit la révolte, la croisade des pueri représente sa métaphysique.
La modernité marchande a produit un vide, mais ce vide correspond à l’expérience métaphysique originaire. C’est dans le néant des marchandises accumulées qu’apparait le caractère métaphysique aux yeux de tous. Le nihilisme du pouvoir s’est étendu à la vie quotidienne, dans l’intimité des choses et des êtres. La croisade des enfants errants porteuse d’une métaphysique critique est la rage à un tel degré d’accumulation qu’elle devient regard, le nihilisme vaincu par lui-même.
La métaphysique n’est pas l’envers de la physique mais son dépassement, « le préfixe méta-, qui signifie aussi bien « avec » qu’ « au-delà », la métaphysique désigne donc ce simple fait que le mode de dévoilement et l’objet dévoilé demeurent en un sens originel « la même chose ». Aussi n’est-elle, dans son ensemble, rien d’autre que l’expérience en tant qu’expérience et n’est possible qu’à partir d’une phénoménologie de la vie quotidienne. »
Dans Melmoth furieux, la croisade est l’espoir métaphysique d’un autre monde qui n’existe pas encore et la croyance de sa possibilité même. Une croyance qui permet de passer outre la fin de l’histoire, au-delà du réalisme capitaliste ou socialiste, du post-modernisme. Pour autant, grâce à Luna, une vieille anarchiste du quartier, on reste les pied sur la terre : les spectres n’existent pas, il n’y a pas de Miracle ni de Paradis, la croisade des enfants c’est aussi la croisade « des enfants de dieu », les pauvres mis sur la route de la révolte.
Ce que le livre pique à la croisade, c’est une transcendance, la croisade est une prophétie, la colonne des pueri entre dans la commune assiégée pour lui permettre de se dépasser elle-même. Les deux éléments historiques s’entrechoquent et s’amplifient en se rencontrant. Les myrmidons communaux se battent aux cotés des enfants monstres, les vêtement magiques de la reine mérovingienne, la croyance dans la force des vêtements créer par les couturières de Belleville, ou dans les vêtements spectraux datant de la commune fonde le courage des combattant.e.s, est ce vrai ? magie ou simple croyance ? peut-importe : un autre rapport à la raison que celui de la société marchande nihiliste voit le jour et permet des dépassement en cascade : « comment pouvons nous survivre à l’histoire ? » (p. 256)
Dépassements en cascade
Le mouvement messianique des enfants guerriers qui entrent dans Belleville au moment précis où les barricades allaient tomber, emmène les combattant.e.s de la commune en dehors de leurs murs vers Marne-la-vallée, vers le centre du pouvoir. Dans ce mouvement insurrectionnel, l’imaginaire figé et triste de la défaite est dépassé, dans le livre on se permet de taper sur les flics ; le nihilisme post-moderne de la fin de l’histoire est dépassé, on se permet l’ouverture d’un idéal révolutionnaire, d’un horizon de lutte : aller bruler le centre du pouvoir pour le détruire ; la position défensive, se faire enfermer dans un ghetto comme perspective est dépassé, les combattant.e.s, surprennent le pouvoir en devenant une machine de guerre qui va porter la lutte au-delà d’elle même tout en conservant les moyens de vivre et de lutter dans un même mouvement (on peut juste regretter l’absence de problématique plus techniques quant au travail et à l’autonomie alimentaire…) ; la commune historique elle-même, dont la garde nationale ne va jamais à Versailles et se fait écraser est dépassée, ici pas de semaine sanglante, une marche magnifique sur le centre du pouvoir, un feu de joie, une bataille héroïque.
Dilemme
J’ai fait le choix de ne pas citer les auteurs au fur et à mesure et d’assumer ma digestion subjective des concepts mais j’indique ici les livres de référence qui m’ont permis d’écrire ce texte critique :
Giorgio CESARANO et Gianni COLLU, Apocalypse et Révolution ; Grégoire CHAMAYOU, La société ingouvernable ; Guy DEBORD, La société du Spectacle / Introduction à une critique de la géographie urbaine / aux poubelles de l’histoire ! ; Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI, Mille plateaux ; Mark FICHER, Le réalisme capitaliste ; Henri LEFEBVRE, Vers un romantisme révolutionnaire Karl MARX, Manuscrits de 1844 TIQQUN, Introduction à la guerre civile / Théorie du bloom ; COMITÉ INVISIBLE, L’insurrection qui vient / A nos amis Kristine ROSS, L’imaginaire de la Commune
Signé X






