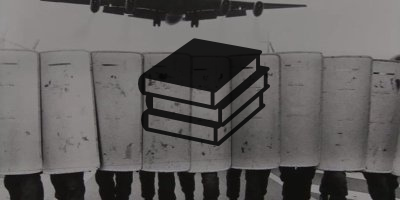On sait que Jupiter Macron, qui prétend réconcilier tout le monde avec tout le monde [1], a récemment reçu en son palais des représentants des « rapatriés », ou « pieds-noirs », soit ces Français d’Algérie dont une très grande partie [2] quittèrent leur pays natal, en panique [3], durant l’année 1962, et furent assez mal accueillis en « métropole » (de leur point de vue en tout cas et de celui de tous les candidats aux élections de la Ve République, qui les flattent régulièrement dans le sens du poil) . Or le discours présidentiel [4], précédé de l’intervention d’une personne qui fut, enfant (elle avait alors cinq ans), l’une des victimes d’un attentat à la bombe commis par le FLN en 1956 [5], après le bla-bla habituel sur « l’amour charnel » des rapatriés pour « cette terre », leur « labeur pour la faire fructifier [6] » puis leur « exode » et leur « exil », poursuit par cet énoncé : « L’histoire des rapatriés est celle de la France. » Quant aux Algériens, on se demande où ils sont passés, ceux-là… D’ailleurs, un peu plus loin, le Président parlera de « l’engrenage mortifère de la guerre civile ». Là, je suis interloqué : « guerre civile » ? – mais entre qui et qui ? Exit donc les Algériens, totalement invisibilisés par ce discours.
Parmi les invités de l’Élysée, ce 26 janvier, figurait Jean-Jacques Jordi, rapatrié lui-même et que La Provence du même jour, en chapô de son interview, présente comme « historien, spécialiste des migrations en Méditerranée [et] incontournable sur la question des pieds-noirs ». Alors il dit quoi, ce monsieur ? Eh bien, que « ce pays [l’Algérie, bien sûr] n’était pas une colonie comme les autres pays africains. Il était considéré comme une prolongation de la France. Les pieds-noirs […] ne doivent pas se considérer comme des colons. Leurs ancêtres ont peuplé ces territoires, mais n’ont rien décidé et il n’y a pas eu de guerre de conquête [7]. » Je ne sais pas ce qui m’a le plus estomaqué à la lecture de ces lignes : l’énormité des mensonges de cet « historien » ou la passivité du journaliste qui n’y réagit pas [8]. Et je ne parle pas des propos du même Tonneau (c’est son nom) sur Macron dont il écrit qu’après avoir suscité contre lui l’hostilité des rapatriés pour avoir déclaré en 2017 que la colonisation était un crime contre l’humanité, il a, depuis, « défriché ce terrain [de la mémoire] où les mines restent entretenues par les gouvernements algériens, bien plus que par le peuple ». Pauvre barrique ! S’il se documentait tant soi peu avant d’écrire un article, en lisant par exemple le livre de Malika Rahal [9], il saurait que parler de mines dans ce contexte, c’est pour le moins une maladresse, sinon une insulte à la mémoire des nombreuses personnes tuées ou estropiées par ces saloperies d’engins posés par l’armée française au long des frontières algéro-marocaines et tunisiennes afin d’empêcher tout soutien de l’extérieur aux combattants du FLN. Voici ce qu’écrit là-dessus l’auteure d’Algérie 1962 :
« Le sol algérien est d’abord empoisonné par la présence de vastes zones minées par les quelque onze à douze millions de mines antipersonnel déposées par l’armée française durant le conflit, principalement – mais pas exclusivement – dans les zones frontalières. […] le sol continue donc à mener une “guerre après la guerre” contre ses habitants et tue aveuglément dès 1962 […]. En avril 2018, le président de l’association algérienne des victimes des mines comptabilisait 7500 victimes de mines datant de la période coloniale depuis 1962. Le 26 décembre 2019 […] Algérie Presse Service (APS) [rapportait] qu’un jeune garçon [avait] encore été tué par une mine datant de la guerre dans la région de Sidi Bel-Abbès. » (p. 259)
Le déminage, dit encore Malika Rahal, avait commencé dès l’indépendance, jusqu’à la proclamation officielle de la fin des opérations en janvier 2017. Or, s’il bénéficia dès 1963 d’un soutien des démineurs soviétiques, il fallut attendre… 2007, soit quarante-cinq ans après les accords d’Evian, avant que le chef d’état-major des forces armées françaises daigne remettre les plans des champs de mines aux Algériens !
Bref, oublions Tonneau, Jordi, Macron et compagnie et retournons en Algérie 1962. J’ai trouvé cet essai vraiment passionnant, d’abord parce qu’il tient la promesse de son sous-titre : Une histoire populaire.
Une histoire : car 1962 est un aboutissement, bien sûr (132 ans de colonisation, sept ans de guerre de libération, pour faire – trop – vite). C’est aussi un début, un commencement, celui d’une nouvelle ère pour les Algérien·ne·s. C’est enfin (surtout ?) une durée en soi, avec ses propres dynamiques, et qui déborde un peu le cadre strict de l’année 1962, puisque l’auteure estime que l’effervescence qui la caractérise commence avec les manifestations de masse de décembre 1960, lesquelles contraignirent De Gaulle à reconnaître la volonté d’indépendance du peuple algérien [10] envers et contre la victoire militaire française sur l’ALN (armée de libération nationale), et court jusque vers mars 1963, « quand la loi sur la nationalité délimite le corps national en fixant les conditions de possession de la nationalité : même si, pour les Français d’Algérie, il reste encore deux années pour se déterminer de façon définitive, l’établissement de la représente une fermeture par rapport à un temps où l’Algérie semblait être le pays de qui voulait s’y reconnaître » (p. 416). Malika Rahal y ajoute la « nationalisation des bien vacants » (laissés derrière eux par les rapatriés), ce qui referme évidemment un certain nombre de possibles (retour d’anciens propriétaires, français ou algériens, mentionne-t-elle, à quoi j’ajouterais la reprise des infrastructures de production et des terres en autogestion, pas forcément facilitée par la propriété étatique).
Une histoire populaire : si vous cherchez à vous renseigner sur l’histoire politique de l’indépendance, au sens des luttes pour le pouvoir entre différentes factions, alors vous n’êtes pas au bon endroit. Ce livre en parle aussi, bien sûr, quand leur évocation est nécessaire afin de mieux comprendre le contexte, mais ce n’est pas, et de loin, son objet central. Son principal centre d’intérêt, ce sont les conditions réelles qu’ont connues les Algérien·ne·s à ce moment-là, comment ielles les ont vécues et ressenties. Naguère, j’avais écrit une note de lecture sur Tous ceux qui tombent, un essai historien sur la Saint-Barthélémy [11]. J’y avais repéré la même sensibilité aux « petites gens » – ou aux gens, tout simplement. Le sous-titre du livre de Foa était d’ailleurs Visages de la Saint-Barthélémy, indiquant son projet de donner des noms et des visages aux victimes du massacre. Ici, nous découvrons aussi beaucoup de visages et de personnalités à travers les nombreux témoignages recueillis directement par l’auteure et ses recherches dans diverses archives, livres et autres périodiques [12].
Elle a donc divisé son livre en quatre parties qui cherchent à répondre aux quatre questions qu’elle (se) pose dans son introduction :
« La première est celle de savoir ce que 1962 fait à la violence. » En effet, avant de marquer la fin de la guerre, on dirait presque que le cessez-le-feu la relance, « avec le déchaînement de celle de l’OAS, ainsi que certaines violences vengeresses de fin de guerre et des violences interalgériennes qui se prolongent » (p . 18). Dans les souvenirs des témoins de l’époque, la période mars (Évian) juillet (indépendance) est souvent nommée « le temps de l’OAS ».
« La deuxième […] est celle de savoir ce que 1962 fait aux corps, corps collectif et corps individuels. » En gros, il s’agit de comprendre et de montrer, au-delà des « récits de déploration » qui insistent sur les déchirements, en quoi « les événements de 1962 sont fondateurs et procèdent d’une dynamique de fusion » – retrouvailles, deuils, auto-organisation obligée afin de parer aux urgences, sans oublier les festivités autour du 5 juillet [13].
« La troisième question est celle de de ce que 1962 fait à l’espace. » (p. 19) Les camps et les prisons s’ouvrent, les réfugiés rentrent, les pieds-noirs s’en vont, le tout dans un espace encore partagé, durant la période transitoire, (de mars à juillet) entre FLN, armée française et OAS ; et dans un espace, particulièrement l’espace rural, ravagé par la guerre (bombardements intensifs, y compris au napalm, champs de mines, destruction de centaines de villages par l’armée française, etc.)
« Enfin, la dernière partie explore ce que 1962 fait au temps. […] L’indépendance réactive la mémoire d’événements anciens, du début de l’occupation française en 1830 aux dépossessions foncières plus récentes. » (p. 21-22) Mais on voit bien qu’elle est aussi porteuse d’immenses espérances et, en cela, tournée vers l’avenir.
« On le comprend, le sujet est immense ; j’assume de ne pas en traiter tous les aspects », peut-on lire (p. 19) dans cette introduction. » Je pourrais en dire autant de cette recension…
Influencé par l’actualité dont j’ai traité au début de cette note, j’ai choisi de m’attarder sur le chapitre 5 : « L’événement : Oran 1962 ». En effet, Macron dans son discours comme Jordi dans son interview parlent de ce massacre du 5 juillet (le jour des festivités de l’indépendance, donc). Le Président évoque « l’engrenage mortifère de la guerre civile [qui] conduisit au drame du 5 juillet à Oran où des centaines d’Européens, essentiellement des Français, furent massacrés […] ». Jordi quant à lui, interrogé par Tonneau sur la fusillade de la rue d’Isly (le 26 mars à Alger), termine ainsi sa réponse, après avoir évoqué les circonstances troubles qui conduisirent les soldats français à tirer sur leurs compatriotes (sur des « Européens », là gît le scandale) : « Certaines choses ne s’expliquent toujours pas. Mais la journée qui compte est le 5 juillet. — Pour quelles raisons ? — Le 26 mars, l’armée française tire [rue d’Isly] sur des Français. Le 5 juillet, alors que l’on fête l’indépendance, un coup de feu à Oran entraîne une “chasse à l’Européen” qui fera 700 morts et disparus. Cette journée fut la plus meurtrière de toute la guerre [14]. »
Malika Rahal a cherché les causes de l’événement. Car de ce point de vue, « un coup de feu » ne nous dit pas grand-chose… Elle montre comment il n’a pas existé isolément, mais a été précédé par « des violences de fin de guerre qui se sont déroulées dans la ville à partir du début 1962 et dont le massacre du 5 juillet n’est que le dénouement » (p. 83). Elle en restitue d’abord le paysage (son « arrière-pays », dit-elle). En 1960, Oran comptait 413 000 habitants, répartis moitié moitié entre « Européens » et « musulmans [15] ». Mais en 1962, la population musulmane a nettement augmenté – du fait probablement de l’ouverture des camps de concentration (dits « de regroupement » par les autorités coloniales) créés pendant la guerre par l’armée française – et qui détenaient, jusqu’aux accords d’Evian au moins 2 350 000 personnes, soit un quart de la population colonisée [16] – peut-être aussi tout simplement parce que les ravages exercés par l’armée française dans les campagnes avaient bouculé leurs habitants vers les villes. D’après un rapport du CICR (Comité international de la Croix-Rouge), venu observer la situation fin mai 1962, « la situation des musulmans d’Oran est actuellement très précaire. Les quartiers qui leur sont réservés et qui contiennent environ 300 000 personnes dont 50 000 enfants sont complètement encerclés par des quartiers européens. Les entrées sont hérissées de barbelés. Nombreux postes de contrôle militaires et FLN à l’entrée, la ville est pratiquement en état de siège. Le téléphone est complètement coupé en ville musulmane et les moyens de communication avec l’extérieur sont très difficiles. » Le même rapport note que « les quartiers musulmans sont soumis à des tirs intermittents de mortier (deux à trois fois par semaine). Le 20 mai par exemple, plusieurs obus sont tombés sur une place publique et ont fait dix-sept morts et soixante-huit blessés. » (p. 86) Le rapport ajoute qu’en plus des mortiers, les « musulmans » sont les cibles de snipers postés dans les quartiers européens et qui « prennent en enfilade » les rues de leurs quartiers. Il y a très peu de médecins, encore moins d’infrastructures médicales en état de fonctionner (coupures d’électicité fréquentes, manque d’approvisonnement en médicaments et en matériel, etc.) La mortalité infantile explose : l’envoyé du CICR note « quatre-vingt décès infantiles [en quatre jours], une menace d’épidémie de méningite cérébro-spinale, des cas de méningite tuberculeuse foudroyante chez des enfants malnutris [17] » (p. 88). Dans ces conditions, les malades et les quelque sept à huit blessés quotidiens par balles ou éclats de mortiers doivent souvent être évacués vers Tlemcen (à 180 kilomètres) pour y être opérés – or ces transports, faute d’ambulances, se font dans des conditions dramatiques, dans de vieilles 403, souvent mitraillées en route par les tueurs de l’OAS (il faut savoir que c’était une des spécialités de ces gens-là que d’aller achever les blessés du camp d’en face dans leur lit d’hôpital et ce non seulement à Oran mais partout en Algérie.
IL existe un autre rapport sur ce qui s’est passé à Oran durant des mois, bien avant le 5 juillet, c’est celui du consul des Etats-Unis William Porter, rédigé un peu plus tard, en 1963. Pendant la période « transitoire » (du 18 mars à l’indépendance), Oran était selon ses termes « a city of terror » : « Nulle part ailleurs, dit-il, l’Organisation armée secrète n’a été aussi puissante, aussi impitoyable et aussi soutenue par la masse de la population qu’à Oran. Les “musulmans” étaient parqués dans ce qu’on a appelé le pire ghetto depuis Varsovie, systématiquement bombardés, privés des produits de base de la vie, et étaient massacrés par des gangs de voyous avec une forme de plaisir lorsqu’ils sortaient de leurs enclaves. » (p. 88) Et Malika Rahal d’ajouter que l’auteur du rapport du CICR, lui aussi, fait la comparaison avec le ghetto de Varsovie, une comparaison que lui ont suggérée les rares médecins tentant d’exercer en secteur musulman.
Elle présente ensuite un schéma des lignes de tir des snipers OAS sur un des quartiers musulmans, montrant qu’ils disposaient de points hauts qui leur permettaient de prendre plusieurs rues en enfilade. « Dans cette période de l’OAS, raconte un témoin cité par Malika Rahal, à cause des snipers, les hommes, notamment les anciens combattants [« musulmans »], ne pouvaient se rendre à la poste Saint-Charles, proche de l’immeuble blanc [où étaient postés des tireurs], pour retirer leurs pensions. Un temps, des femmes y sont allées à leur place, notamment une voisine, Aïcha. Un jour finalement, Aïcha et quatre autres femmes ont été abattues par les snipers à quelques mètres de la poste, depuis le même immeuble blanc, par-dessus les maisons basses. » (p. 91) Ce doit être cela , la « guerre civile » dont parle Macron. Civile ? Coloniale et raciste, oui !
Et ce n’est pas tout. Avant le cessez-le-feu, le 28 février 1962, eut lieu à Oran l’attentat que Paris Presse qualifia de « plus sanglant de la guerre d’Algérie » : deux voitures piégées explosèrent en lisière du quartier musulman de Mdina Jdida et firent des dizaines de morts et encore plus de blessés (le bilan précis est difficile à reconstituer dans la mesure où les « musulmans » ne pouvaient évidemment se rendre dans les hôpitaux des quartiers « européens » où ils auraient été à coup sûr les cibles de l’OAS).
« À la veille de l’indépendance, Oran apparaît donc comme une ville marquée non seulement par les huit années de guerre qui ont affecté tout le pays, mais aussi par un déchaînement spécifique de l’OAS, au point que la panique, la tension et les représentations angoissées de l’avenir transpirent de partout. » (p. 96) Pour couronner le tout, le 25 juin, l’OAS incendie les réservoirs de stockage de carburant du port d’Oran. Le ciel en sera obscurci plusieurs jours, ce qui crée une atmosphère d’apocalypse, rapportent les témoins. Le 5 juillet vers 11h30, alors que commencent les festivités de l’indépendance, on entend des coups de feu. Où et par qui sont-ils tirés, nul ne le sait. Toujours est-il qu’ils provoquent la panique et la rage parmi les « musulmans » – on peut dire à présent : les Algérien·ne·s. C’est la provocation de trop. Contrairement à ce que prétend Jordi dans l’interview citée plus haut, on ne connaît pas le bilan exact du nombre de victimes « européennes »… et Algériennes, car il y en eut aussi ce jour-là, ce qui tendrait à prouver que l’OAS, une fois de plus, était impliquée dans le déclenchement des violences et leur poursuite jusqu’en milieu d’après-midi. Malika Rahal dit que le décompte « officiel » des morts, publié par la presse le 9 juillet, est régulièrement contesté, mais qu’« il demeure le plus solide que nous ayons » : cent un morts, dont soixante-seize Algériens et vingt-cinq « Européens », et cent quarante-cinq blessés (cent cinq Algériens et quarante « Européens ». Il est possible que parmi les Algériens figurent des « harkis », « au sens générique de traîtres ». Quoi qu’il en soit, conclut l’auteure, ce bilan indique un aspect « totalement occulté de l’événement : s’il s’approche de la réalité, il aurait fait plus de victimes “musulmanes” que de victimes “européennes” [18] ». On voit par là que le président de la République française a repris à son compte, dans son discours, une version très éloignée de la réalité du massacre du 5 juillet. Et pour faire bonne mesure, il n’hésite pas à ajouter que « ce massacre, lui aussi, doit être regardé en face et reconnu ». L’ignorance qu’il manifeste ainsi est-elle délibérée ? J’ai tendance à le penser – je pense qu’il raconte ce que veulent entendre les pieds-noirs afin de capter leurs voix. Pour qui voudra ne pas se contenter de ces balivernes, je recommande la lecture de Algérie 1962, en ajoutant que je ne me suis arrêté ici que sur une toute petite partie du livre (un chapitre sur vingt-deux [19]), et qu’il y a vraiment énormément à apprendre dedans – j’espère en avoir donné un aperçu malgré tout.
franz himmelbauer