Au printemps 2020 nous avons été les témoins et les sujets d’une expérimentation sanitaire et gouvernementale inédite : l’assignation à résidence de quatre milliards et demi d’humains. Olivier Cheval propose d’explorer les conditions historiques, sociales, techniques et affectives qui ont rendu possible ce « Grand Séquestre ». Entre philosophie et littérature, ces lettres adressées à des proches sont éblouissantes de sensibilité et de lucidité.
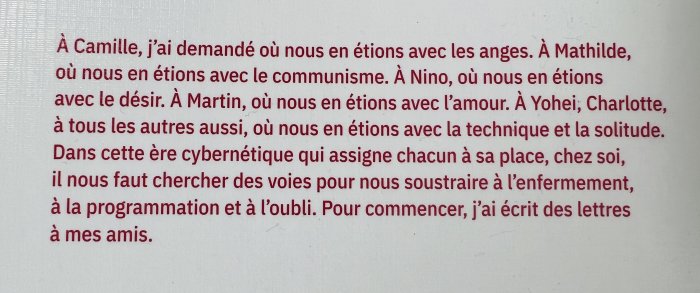
Pour comprendre ce qui nous arrive, Olivier Cheval a commencé par s’appuyer sur quelques jalons solides de la philosophie contemporaine. Mais il fallait être plus vaste pour circonscrire l’évènement dans toute son ampleur, et raconter une nouvelle histoire du monde à partir du règne de la technique. Il fallait être plus intime aussi, et raconter la chair de nos vies à l’heure de la solitude, de l’enfermement et de la séparation. Il fallait abandonner les vieilles distinctions entre philosophie, littérature et sciences humaines, et se mettre à écrire. Écrire depuis le monde qui s’était retiré, depuis nos vies devenues invivables.
Le livre s’ouvre sur un essai court, ciselé et implacable : La Domestication du monde, retraçant la généalogie du règne de la technique et l’emprise de la cybernétique jusque dans chaque recoin de nos vies. Comment le monde est mis en mesure par l’économie, jusque dans ses plis les plus intimes, les plus sensibles. Si le texte est dense, érudit et brillant, il reste fluide, accessible et didactique.
La seconde partie est composée de huit lettres qu’Olivier Cheval a adressées à des amis, à un amant, à un enfant. Dans chacune, il déplie subtilement un des éléments de réflexion condensé dans la partie théorique : l’irréversible, le communisme de pensée, la disparition du paysage, l’inassouvible, l’invivable, l’avenir, l’inoubliable. S’y mêlent la mélancolie et la joie, la mélasse du monde comme il va et la grâce de ce qui persiste. Il y est question de smartphones et d’amour, de voyages et d’existences qui s’évanouissent. Chacune est bouleversante à sa façon et partout le politique et le sensible, la subversion et la littérature s’y indistinguent, comme pour renouer tout ce qui peut encore l’être.
Nos lectrices et lecteurs les plus assidus se souviendront d’Olivier Cheval et de l’excellente série d’articles que nous avions publiée dans les premiers mois du confinement : « L’immunité, l’exception, la mort, penser ce qui nous arrive avec Roberto Esposito, Giorgio Agamben, Michel Foucault et Vilém Flusser ». Ainsi que sa Dernière leçon sur le confinement - Un nouvel art de la partouze et Le Rêve du dernier homme.

Présentations publiques
20 octobre - Paris - Le monte-en-l’air - 19h30
(N’hésitez pas à vous inscrire à l’évènement facebook par ici)
2 novembre - Limoges - Librairie Pages et Plumes - 19h avec Serge Quadruppani
3 novembre - Toulouse - Librairie Terra Nova
17 novembre - Lille - L’anamorphose
18 novembre - Bruxelles - Librairie Météores - avec Gil Bartholeyns
8 décembre - Rennes - Les Ombres Électriques - 19h
9 décembre - Nantes - La dérive
Nous annoncerons très bientôt d’autres dates de rencontres autour du livre, dans des librairies ou des lieux amis.
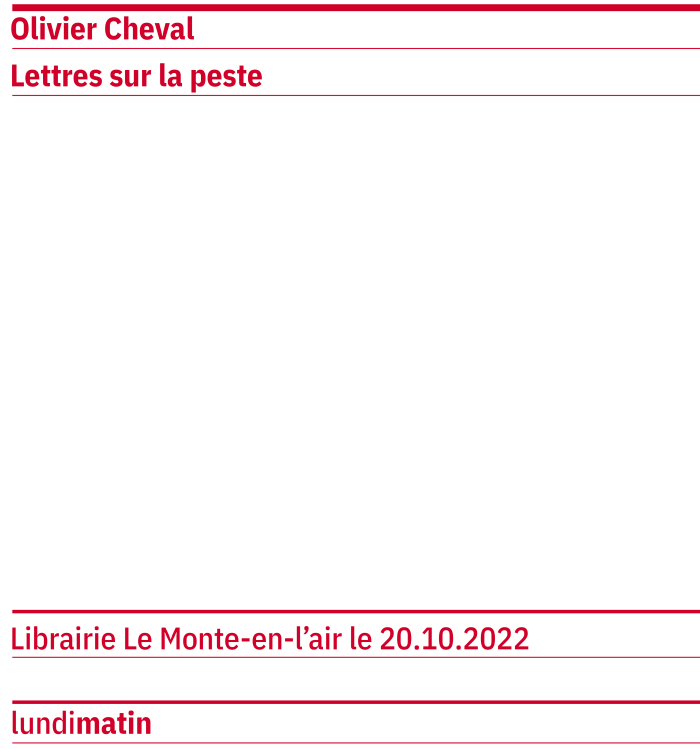
Extraits
« Vivre un tournant époqual, c’est le destin historique qui nous est offert, que nous le voulions ou non. Nous oublions mais, contrairement à ceux qui viendront après nous, nous avons encore la chance de nous souvenir de cet oubli. Témoigner pour ce qui se perd, c’est peut-être là notre tâche. Se souvenir que nous oublions, que nous oublions comment nous passions une journée avant internet, comment nous arpentions la ville avant les smartphones, comment nous nous touchions les uns les autres avant la pandémie, comment nous entrions dans l’espace public avant les masques, les passes et l’aveu collectif, trop longtemps retenu, de la haine mutuelle des uns pour les autres en régime néolibéral. »
Lettre à Camille
sur l’irréversiblePalerme, le 19 septembre 2020
Camille,
Il y a deux endroits qui m’ont toujours immanquablement donné envie de mourir : les cabinets médicaux et les aéroports. Et voilà que le monde, depuis six mois, semble s’être inspiré d’eux pour l’intégralité de l’espace public, où l’on prend ma température, où l’on me scanne, où l’on me marque au sol, où l’on me gère comme élément d’un flux biologique à contenir et aiguiller : ce n’est plus là un monde où je désire vivre.
Je t’écris de l’aéroport de Palerme, d’où je dois m’envoler dans une heure pour Paris. J’ai passé une demi-heure à marcher au pas dans ces files d’attente en zigzag inspirées du parcours que l’on fait suivre aux bêtes dans les abattoirs. À côté de moi, un couple vient de s’embrasser à travers des masques. Le geste n’était reconnaissable qu’au contact des deux tissus ainsi qu’au plissement niais et doucereux des yeux : ici, tout n’est plus que signalétique, même un baiser. Il est huit heures du matin. Je n’ai presque pas dormi de la nuit. Il y a eu, de minuit à six heures, en bas de mon appartement, à l’intersection de la via Goethe et du Tribunale, ce grand mausolée fasciste où l’on se doute bien que jamais justice ne fut rendue, une sorte de course de mobylettes qui jouaient gaiement de leurs moteurs rutilants. Dans la veille altérée de mon insomnie, je pensais : motocyclettes. Je ne sais même pas si ce mot existe. Dans cet appartement, j’ai cru devenir fou.Je ne sais pas ce qui m’a pris de maintenir ces voyages en festivals malgré la situation. Dire que cet après-midi je reprends un train pour Marseille, et que je repars lundi à Lisbonne. C’est que, toujours, on relativise : ces mesures sanitaires, ce n’est pas la fin du monde. Mais si ce n’est pas la fin du monde, c’est justement parce que le monde avait déjà commencé de finir, parce que ces mesures ne font que s’ajouter, comme un glaçage final, aux couches du contrôle, de la surveillance, de l’aiguillage et de la signalétique que nos corps ont depuis trop longtemps intériorisées. Après le 11 septembre 2001, les aéroports ont systématisé l’usage des portiques de détection à champ magnétique pour les humains et les portiques de sécurité à rayons X pour les bagages à main. Il ne fallait pas que l’on puisse de nouveau détourner un avion avec un cutter. Les compagnies ont rapidement blindé la porte des cockpits, verrouillés de l’intérieur par le copilote. On ne pouvait plus détourner un avion avec un cutter. On n’a pas pour autant supprimé les portiques. De la même manière, je ne sais pas si on reprendra un jour l’avion sans masque, même quand le virus aura disparu. C’est la tâche historique de notre génération que de se souvenir de l’apparition de cette dernière couche du contrôle pour en témoigner aux générations qui bientôt déjà la vivront comme naturelle, qui ne la distingueront même plus des autres, toute noyée qu’elle sera dans le dispositif global de la gestion des flux vivants. Je n’ose imaginer le monde dans dix, vingt, trente ans : mais ce qui est sûr, c’est que l’aéroport est le cristal le plus pur où lire l’image de ce qui nous attend, l’avant-garde paranoïaque de ce monde à venir.
À Palerme j’ai découvert au Palazzo Abatellis une grande toile du xve siècle, Le Triomphe de la mort. On n’en connaît pas l’auteur. Elle doit faire sept mètres par six. J’exagère sûrement : quatre mètres par cinq. Je ne sais pas. Elle est immense. On y voit un squelette chevaucher un cheval si maigre que ses côtes ressortent : la mort sur son équipage mort-vivant. Le cheval galope. Dans sa course il surmonte un charnier de notables qui gisent dans leurs habits d’apparat. Tout autour, une foule compacte, où l’on s’apitoie, bien sûr, mais où l’on continue aussi à vivre. Personne ne fuit ni ne s’écarte. Il s’y trouve même un homme pour entonner un petit air de luth. Chez Brueghel, tout en bas à droite de son petit tableau du même titre, à quelques mètres de l’hécatombe, un homme joue de la mandoline, lové dans la longue robe d’une cantatrice trop concentrée sur son livret pour deviner que derrière son épaule, c’est un squelette qui l’accompagne au violon. De cette musique que l’humanité jouait au temps de la peste, je crois que nous ne pouvons plus rien savoir. Elle nous est inaudible jusqu’au principe même qui l’avait vue naître...






