Olivier,
J’ai lu ton livre. Comme d’habitude, en retard : ici, on est ravitaillé par les corbeaux. Par contre, à peine l’avais-je ouvert, j’apprenais que d’autres voulaient le fermer pour toujours – hors de question d’y voir autre chose que des jérémiades. Je voulais te dire que pour moi, il est de ceux qui doivent exister. Car il tente de réanimer une chose en voie de disparition dans nos vies. J’espère donc entrer en résonance avec elle, et toi – désaccords compris.
Manifestement, nous n’avons pas la même vie. Nous ne fréquentons pas les mêmes lieux, nous n’apprécions pas les mêmes trajets, nous ne vivons pas les mêmes amours. Peut-être se croisent-ils parfois. En tout cas nous n’avons pas vécu le même confinement. A part la peur et une pensée pour les gens piégés, à part la conscience de l’aubaine que l’événement constituerait pour la cybernétique, il a été pour moi une libération.
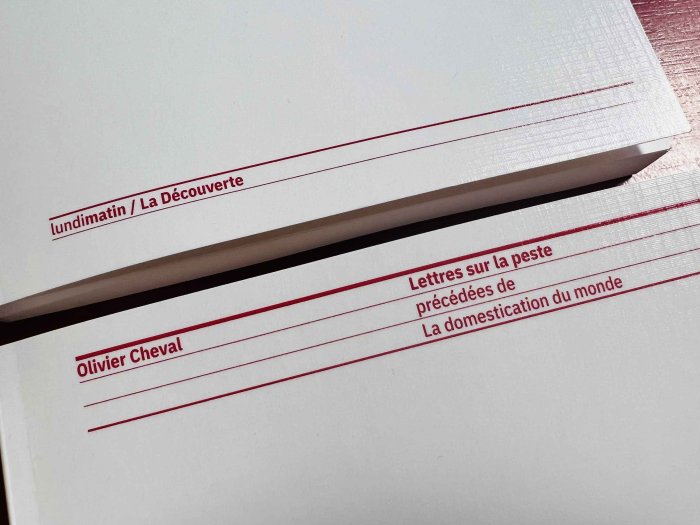
C’est l’époque où je travaillais à la ville, à deux heures de voiture-train-métro – avec les portables des autres en guise de paysage. Alors confinement, ça voulait dire soulagement. C’était vivre dans ma grotte. Le printemps poussait, les odeurs étaient charriées par la rivière, les voitures ne traversaient presque plus le hameau. Je n’avais aucun besoin de signer un papier pour m’autoriser à dériver alentour, personne n’aurait pu me serrer dans les méandres d’une forêt que je connais comme ma poche.
Ceux qui accablent ton livre penseront que je suis, moi aussi, un privilégié. Ils n’ont pas tort. L’hiver je profite d’une vallée où tout est humide et froid, où les arbres sont en cadavres et où il n’y a pas de lumière. Le reste du temps je goûte à une vie sans éclat ni carrière brillante. Tout ça pour dire que j’ai plutôt le privilège d’être paumé. J’ai l’impression que toi aussi – au moins dans le monde d’après, et que nous avons la même quête de sens : comprendre ce qui s’est passé depuis trois ans. Et en plus de parler de dérive biopolitique, nous réfléchissons ce que nous avons vécu. Les mots manquent, évidemment, puisqu’il s’agit de formuler le diffus, pas de subsumer une réalité sous les catégories disponibles – nous en sommes d’autant plus perdus. C’est pourquoi, si tu permets, il n’y aura pas de guillemets entre nous.
Pourtant, puisque tu sembles faire partie de ceux qui n’ont plus peur, j’aimerais d’abord te dire que nous n’avons pas la même façon d’accueillir le sars-cov2. Beaucoup m’avaient confié – vaccinés ou malades, vaccinés et malades, que l’expérience était « bizarre ». Ça s’est confirmé pour moi, et je n’en ai pas été rassuré. Quand je pense que c’est un peu une pochette surprise, cette maladie, avec des effets qui varient en fonction de chacun, je reste convaincu qu’il y a de quoi être inquiet. Et au lieu de vouloir dissoudre toutes les barrières pour enfin retrouver les autres, au lieu d’ouvrir des espaces clos remplis d’humains pour retrouver une certaine innocence, j’entends effectivement rester précautionneux.
En tout cas je me sens responsable des pathogènes que je trimballe, pour reprendre ta formule. Hors de question de multiplier les outils qui pourraient tout révéler (muter en police autosanitaire, vivre en pleine conscience de mes proto-affections), mais une fois au courant, je ne peux décemment pas envisager de faire comme si de rien n’était : le jour où j’ai appris que deux voisines qui se savaient malades se sont auto-attestées saines pour ne pas avoir à en assumer les conséquences – rater une partie de cartes avec leurs partenaires de quatre-vingt ans, j’ai imaginé remettre un masque pour leur dire ce que j’en pense. Bref : même si je t’accorde qu’en plus d’être paumé je suis légèrement hypocondriaque, je t’avoue que je suis resté assez fidèle à l’irruption du virus, et ne crois pas que la distance dissout tous les liens (essaie avec un ours, tu vas voir que ce n’est pas une façon de ne pas être relié).
Par contre en te lisant, même depuis là où j’en suis, l’idée ne m’est jamais venue que tu minimisais la maladie, que tu ignorais sciemment les soins différés ou les covids longs, voire que tu manquais d’empathie envers les personnes affaiblies. Jamais, car la perte existentielle que tu évoques s’ajoute pour moi aux lourdes atteintes des corps – organes, facultés, vitalité. Elle relève de la réalité sanitaire dont tes détracteurs croient être seuls à parler. Il n’y a en effet pas de santé qui ne soit celle d’une personne existante, dotée d’idées sur sa propre vie, et qui pourtant lui échappe puisque cette vie ne se réduit pas aux idées ; pas de santé qui soit pure adéquation avec une idée préexistant au corps vécu, et qui soit homogène aux machines censées égaliser les chances de survie.
Bien sûr les moyens médicaux sont très utiles, salvateurs parfois. Mais pourquoi les critiques te reprochent-ils de dire qu’il est malsain que toute inégalité soit insupportable ? J’ai pour ma part l’impression que la santé réelle ne peut être réduite aux dénominateurs communs. Ça parait évident de dire ça, mais la remarque a le mérite de faire émerger la vraie question : c’est quoi, pour eux, la santé ? Pouvoir continuer à travailler (Sarkozy) ou être apte à tomber malade et s’en relever (Canguilhem) ? Peut-être finalement qu’ils accusent ta prétendue indifférence pour masquer leur incapacité à répondre. Il me semble en tout cas que revendiquer l’égalité sanitaire parfaite au nom du bien des pauvres comporte le risque d’évacuer boiteux et bras cassés de la vie partagée (Macron n’offrait-il pas une chance pour tous avant d’évacuer jojo le gilet jaune ?).
Plus largement, contrairement à ce qu’ils affirment, j’ai trouvé que justement, toi, tu affirmes qu’il y a un événement covid. Plutôt que renforcer la polarisation qui nous plombe, et qui en l’occurrence se signale par deux façons de dire que rien n’a changé (soit le covid est derrière nous, soit les mesures résiduelles ne sont rien du tout), tu affirmes que nous sommes tous bel et bien dans le monde d’après. Quelque chose a changé dans les conditions objectives (augmentation des achats et des ventes en ligne, normalisation des visios et du télétravail, distanciation des corps et reliance par le numérique), et les dispositions intérieures ont suivi – les déchirures en sont une manifestation évidente, tu tiens à nommer les autres.
Evidemment, quand on se laisse porter par les changements, on ne les aperçoit pas. D’ailleurs on a déjà vécu certains progrès techniques sans disparaitre (les GPS et sites de rencontres n’ont pas annihilé les rencontres réelles, ni les surprises), alors on peut se dire que ce n’est pas les quelques avancées récentes qui vont transformer l’existence. On peut même oublier la tranquillité avec laquelle on y est allé, vers la vie d’après. A chaque petit pas concédé, ce n’était pas la fin du monde : après tout, une merde de plus ou de moins dans le corps, un contrôle de plus ou de moins sur les corps ; après tout, on avait d’autres chats à fouetter, un enfant à chérir, il ne fallait pas s’appesantir sur les gestes insignifiants qu’on nous imposait au nom de la plus signifiante des missions – ne pas tuer les gens. D’ailleurs les contraintes se contournaient aisément, et c’était drôle d’en parler avec le reste du peuple-pas-dupe-du-tout.
Mais tu as raison, même sans virer chaque fois à la complaisance jubilatoire ou au délire de résistance pour qui a fait mine d’obéir, la farce a engendré des effets secondaires tenaces : les deux pieds posés sur cette sédimentation, on s’est rendu amnésique. Il s’agit donc de conjurer l’oubli – l’autre nom du progrès sans retour comme tu dis. De se souvenir de l’apparition de la dernière couche de contrôle pour en témoigner auprès de ceux qui la tiendront bientôt pour naturelle. Et surtout, de raviver le souvenir où se logent des sentiments en voie d’extinction. Peut-être es-tu trop incisif quand tu pointes le laisser-aller de l’époque, mais c’est un peu la situation qui t’y pousse : on ne veut rien apercevoir de la perte parce qu’on sent qu’on y est pour quelque chose. Alors évidemment, on n’entend que ce que tu ne dis pas ; on n’entend rien à ce que tu dis parce qu’il y a plus grave dans la vie. Et on s’autorise de vilaines réactions : on te repositionne sur le champ, on rabat ton propos sur une origine prétendument bourgeoise.
Heureusement que tu as fait le choix de crier. Que tu as eu le courage de rester à la périphérie d’émotions qui te minimisent pour laisser s’exprimer ce qui te déborde. Écrire ce livre t’a peut-être un peu soulagé, mais il t’a surtout fait prendre le risque du dépassement. Et au lieu de produire de l’information sur ton propre compte, tu as fait naître une œuvre aussi fragile et vulnérable que la vie d’une personne – que le « ça tient » que la biologie ne pourra jamais expliquer, comme dit Stengers. Heureusement que tu as fait le choix de crier, sans quoi les critiques auraient réussi à faire passer ton texte pour un confortable nombrilisme plutôt qu’une solitude qui s’extime pour appeler la résonance. Elles auraient réussi à montrer qu’il faut avoir la décence de ne pas généraliser à partir de l’haïssable petit moi, convaincu tout le monde que ton livre est un piège parce qu’il exprime ce que tu ressens et oblige à te croire. Heureusement que tu as des amis à qui adresser des lettres, sans quoi les critiques auraient prouvé qu’on ne peut faire parler que les chiffres.
En te tournant vers les tiens, c’est ta réussite, tu es parvenu à mettre des mots sur ce qui s’est passé : une fine toile a été déposée sur tout ce qui bouge, sur la vie même, et nous avons perdu le monde. Pas le monde d’avant – d’avant le monde d’après, mais la préséance même du monde, comme disait Merleau-Ponty. Celle-ci n’est pas une donnée objective, mais la vérité perceptive d’un sujet situé qui se dit qu’il y a le monde et que celui-ci précède la conscience qu’il en prend. Et puisqu’elle relève de la foi perceptive, cette préséance n’est pas connaissance première mais infraconnaissance (comme le « ça tient » de la vie précède toute fonction organique). Elle est connivence silencieuse avec le monde et porte tous les énoncés formulés à son propos, en plus de nos existences.
Or en lieu et place du monde se tient désormais une toile de fond qui prétend être première de toute éternité (ce que nous éprouvions comme passé est passé). Il faut s’apercevoir du drame. Car – c’est moi qui l’écris, tu me diras si tu en es d’accord, la relation sensible à cette préséance est la source réelle des singularités : la façon dont chacun assume au regard des autres, par-delà l’ego incapable de s’autoprésenter, la relation au monde qui le précède, cette façon d’assumer ce qui le déborde fait sa présence singulière. Pas la particularité à laquelle va s’intéresser la science médicale, mais sa manière propre de se vivre en incomplétude (donc, notamment, en vulnérabilité). Et j’ajoute que ce sont les singularités qui font la profondeur de nos existences (nos amours autant que nos peines, voire nos relations thérapeutiques), et qui font la chair du monde – quand celui-ci recueille les singularités qui sont effectivement passées et qu’il reste, lui, plein de leurs absences.
Ainsi le drame, tu as raison, c’est qu’en lieu et place du monde préséant se tient aujourd’hui un flux d’informations sans profondeur, une fine couche de discours. Les amateurs de portables à la cool s’en font les relais amusés : ils font tourner les ordinateurs comme on faisait tourner les usines, ils produisent de la trace numérique et génèrent de la valeur. Résultat : ils construisent un grand machin où leur petit machin fait office de modulateur universel ; en se laissant porter, ils portent le projet cybernétique – pas grave, on ne peut pas en mourir. Rien d’étonnant alors à ce que la religion du chiffre fasse globalement oublier la relation sensible à la préséance du monde : la perception livrait celle-ci dans la foi, la perspective numérique fait apparaître le monde comme essentiellement calculable, pouvant être intégralement connu, par conséquent précédé par le nombre qui lui donne sens. Bientôt il semblera fait comme on l’explique, si ce n’est connaissable en vertu du fait qu’on l’a construit. Et le pire c’est que les critiques surenchérissent : tu as le droit à ta leçon de constructivisme (le monde n’est pas donné mais évidemment construit voyons !), ton livre est ramené à un symptôme d’ignorance. Ils prétendent même te ré-informer…
Heureusement que ton cri a de la force. Tu tiens à ce que toute chose soit reconnue dans l’éclat de sa singularité, alors tu t’appliques à dénoncer la machine à uniformiser : la multiplication des lieux faits des plaques grises qui font les dimanches éternels et qui poussent à consommer plutôt qu’à rencontrer, la capture du désir par une machine qui laisse penser que le comble du bonheur serait d’éliminer la chair comme obstacle au plaisir infini. Jolies formules. Vient pourtant aux esprits chagrins que tu es l’aristocrate de service, le philosophe-dandy qui évolue dans le monde des idées et qui va nous faire le bon vieux coup de l’être-vers-la-mort, au lieu de tenir compte des corps et des circonstances concrètes. L’argument fatal ne tarde pas : il est question de vivre ou mourir pour de vrai, là, de penser pour les pauvres, mon petit gars, pas de jouer les gros bras eugénistes prêt à défiler avec les rageux.
Et donc, pour éviter qu’ils ne le couvrent totalement, ton cri singulier, j’aimerais lui faire écho. Tout d’abord en disant qu’au nom du vice qu’est censé être l’amour propre, ils oublient l’amour de soi – l’amour à partir de soi. Ils prétendent faire ou parler pour les autres, mais portés par une énergie du fait même de s’abandonner, ils risquent de se faire relais du pouvoir tel qu’il existe aujourd’hui. Rien de mieux pour amplifier les dégâts du conformisme, colmater les brèches, accompagner le dispositif techno-sanitaire. Et s’ils t’accusent aussi de dénigrer les sciences, c’est pour mieux oublier que l’art philosophique est en réalité retour de science : il s’impose quand on est suffisamment enfoncé dans l’ailleurs pour le connaitre (par curiosité primale ou inertie culturelle, peu importe) et qu’on a découvert que la relation intime au monde préséant ne peut muter en connaissance ; il impose de faire comme toi une œuvre fragile qui « tient » sans correspondre, et qui atteste d’une transformation.
J’aimerais surtout redire ici que c’est bien à la santé que nuit l’uniformisation dont tu parles. La vaste opération de vaccination (tiens, les critiques n’en parlent pas) est par exemple en train de faire oublier le virus alors qu’il n’a pas du tout disparu et qu’il risque, ainsi sédimenté, et même s’il provoque des réactions fort diverses, de devenir un grand homogénéisateur (raison de plus pour ne pas l’accueillir à bras ouverts, tu ne trouves pas ?). En tout cas la multiplication des protocoles contribue à dissoudre les singularités vitales : pas seulement parce qu’ils s’appliquent à des personnes (en la matière, on pourra toujours prétendre qu’on va les adapter), mais parce qu’ils ont toute ignorance de la relation sensible à la préséance du monde. Parfois, j’en arrive à craindre que l’on se souvienne plus des singularités qui sortent du laboratoire que de celles où se loge le covid : dans nos fragilités, voire dans le faible que nous avons pour les gens.
Et tu n’en parles pas beaucoup mais justement, il y a de quoi en parler, des personnes qui étaient aimées et qui ont été ignorées par le système de santé – des hommages qui devaient être rendus aux morts. Bien sûr, ça ne les ramènera pas. Mais leur dignité d’être singuliers ? Et la nôtre, de dignité ? Interdire aux gens d’enterrer librement leurs proches, c’était les empêcher de se taire face à l’incompréhensible dissolution d’une singulière présence. De se rappeler de la préséance du monde, du silence au fond de nos vies. Ton cri est juste, Olivier : beaucoup refusent de voir que nous pouvons mourir plus encore, et c’est grave.
Il faut donc conjurer l’oubli, tu as raison. Pas l’oubli de l’Etre, comme ils disent pour se moquer, mais l’oubli très concret du confinement. Car effectivement, on est en passe d’oublier le vécu de l’époque : la pression et l’urgence, l’angoisse et la méfiance, les informations contradictoires et les imaginaires délirants (y compris les nôtres), le constat d’obéissance malgré la colère (rien n’était possible-tout l’était-tout le serait), l’ahurissement à la sortie et les déchirures qui ont suivi. Peut-être que l’erreur est d’avoir voulu reprendre trop vite là où on en était avant. En tout cas on a étouffé l’expression de la pluralité des expériences et toi, tu montres la voie, tu prends ce risque, tu oses parler de ton expérience et en tirer une pensée sans jouer au scientifique.
Que dis-tu en ce sens ? Que le confinement a été le premier événement cybernétique de l’histoire, l’actualisation d’un monde déjà unifié (le dehors a fermé, les décrets ont entériné la force du fait). Tu dis que le confinement était le Grand Séquestre. Là encore, j’ai entendu un écho à Merleau-Ponty : le philosophe décrivait le Grand Objet que devient le monde quand on réintroduit le subjectif d’abord exclu en en faisant un cas particulier des relations de science. Et par la suite, j’ai bien compris ton appel : puisque les séquelles de la séquestration semblent irréversibles, il convient de déserter, de vivre une vie clandestine dans la doublure du monde.
Mais à cela, plutôt que rabattre ton discours sur des données économiques et sociales, je veux répondre singulièrement – depuis ma situation de paumé qui tient aux idées. Et d’emblée, je dois t’avouer que l’idée de doublure ne me va pas tellement. D’abord parce que les imbéciles heureux de la cybernétique l’adorent : leur construction reste acceptable tant qu’elle est prétendument construite sur la base d’un monde naturel (on passe de celui-ci, même s’il y a parfois du bon, au monde du progrès, même s’il y a des ratés). Et surtout parce que certaines lectures m’ont conduit à penser qu’une telle doublure n’existe pas.
Tu le dis toi-même, non ? Le Grand Séquestre n’était pas un double, c’était le monde lui-même. Et bien Moore insiste en ce sens : plutôt que se laisser aller au dualisme qui fait la perspective capitaliste, il faut voir que le capitalisme se déploie à travers la toile de la vie, et qu’il y a double intériorité : le capitalisme dans la nature et la nature dans le capitalisme. De plus, quand Rosset s’applique comme toi à faire reconnaître la réalité des singularités, il va au bout de l’effort et invite à ne pas en être frustré, par conséquent à rejeter le double censé manquer à cette réalité : si on affirme la présence tragique des singularités contre le présentiel, il faut donc dire qu’il n’y a pas d’autre monde, et que la doublure est un mirage (mais aussi, c’est l’avantage, que ton livre n’est pas un divertissement – une façon de se soulager du réel, voire de s’en détourner).
Est-ce que je prétends qu’il faut tout accepter ? Aucunement. Comme tu dis, il faut lutter pour la représentation de la réalité, le sens de l’événement. Et je reconnais que la solitude romantique de ton cri constitue déjà une ouverture dans la connexion généralisée, qu’elle évite de la relayer. Mais je veux ajouter qu’une de tes conceptions peut participer à l’enfermement : quand tu t’en tiens à opposer la singularité des lieux aux espaces gris des dimanches éternels, tu conserves l’arrière-fond conceptuel de l’étendue-chose quantifiable – celui de Descartes et des sciences, comme liant uniforme. Or pour éviter d’en rester moi-même à la seule présence tragique, je propose plutôt de concevoir que c’est le m-onde, entendu comme mouvement, qui effectue le lien des lieux. Un mouvement est surgissement d’une forme à partir d’un fond sans être une explosion où tout s’en va : dans le geste, il y a du retenu. Ainsi, tel un geste initié par les muscles agonistes et antagonistes, le m-onde produit et retient, produit ses formes et les retient en un seul geste (il n’y a pas dualisme).
Quel est l’intérêt de cette histoire d’espace ? Celui d’aller conceptuellement contre l’unification contemporaine que tu décris. Tu dis d’ailleurs que le monde reste trop vaste pour se réduire à un seul scénario – celui du capitalisme. Et bien justement, contre l’idée qu’il y aurait un monde déjà unifié que le Grand Séquestre mondial aurait actualisé, je conçois que le monde naturel vit de se refaire sans cesse un. En conséquence de quoi, malheureusement, il faut apercevoir que nous vivons dans le même monde que les ennemis du monde – qu’il n’y a pas qu’eux qui nous l’imposent. Et c’est pourquoi la désertion n’est pas aussi simple que tu sembles le dire. Il est plutôt nécessaire de redoubler d’efforts pour lutter ; prendre le capitalisme à rebours et montrer que la doublure, c’est lui qui veut y faire croire.
Etonnamment – j’en reviens à mon expérience si tu permets, c’est le confinement qui m’a fait accéder à ces idées. Fuir de l’intérieur en espérant trouver l’amour dans le revers du monde, comme tu dis, c’est ce que j’avais fait ou cru faire pendant longtemps : à coup de logements retirés et de sommets montagnards, à coup de sport et d’enivrants. Et même si j’essayais d’échapper à l’académisme, même si la philosophie n’était pas un refuge hors du monde, je me méfiais de la politique comme débouché naturel. Né prolo, je trouvais cette tendance bourgeoise et facile : basée sur l’évidence de la correspondance entre la pensée et le monde en tant qu’il est ordonné (par les bourgeois, justement), elle conduit à n’être jamais inquiété par l’étrange rencontre de la pensée et de son autre. Mais le confinement a changé beaucoup de choses.
J’avais compris depuis quelques temps que c’était précisément une erreur bourgeoise, de croire que la pensée politique entérine le mythe de l’accord de la pensée et de son objet : la politique consiste au contraire à dissoudre le prétendu ordre préexistant, à prendre le risque du recul. Or si la sortie du confinement et mon refus d’obtempérer m’ont confirmé dans cette perspective, ils m’ont aussi fait nettement voir qu’une attaque publique contre la pensée était en cours : on veut la faire précéder le monde senti, la faire devenir information. Il y a donc urgence à la faire exister en situation pour résister aux nouvelles tentations – pour s’empêcher de n’y voir que du feu, à ces changements de la vie, se laisser porter et ne plus voir le mal nulle part (ne pas se sentir plus concerné par l’ostracisation des soignants non vaccinés que par le sort fait aux migrants délogés par les guerres qui assurent notre confort).
En un mot le confinement m’a convaincu de l’urgence de retrouver la convivialité sans laquelle l’ex-pression est difficile, et j’ai imaginé le terrain vague. C’était ma façon de lutter contre l’autisme ambiant, l’installation de la vie d’après. Or ce que ton livre m’a fait comprendre, c’est que c’est aussi une lutte contre l’oubli. Je dirais même qu’en t’écrivant, je saisis que ce que le confinement et ses suites ont révélé, c’est qu’il y avait des failles là où on croyait avoir des appuis – des amis. L’événement covid a activé les faiblesses dans les corps, les cœurs et les consciences. Et comme c’était à l’endroit de la vie et de la mort, de la santé et de l’existence, c’était très décevant de constater ces failles, alors nous avons défailli : les déchirures entre amis étaient trop douloureuses, nous avons fini par faire silence. Celui-ci nous a soulagé des conflits perpétuels, mais il a favorisé l’oubli, et peut-être nourri l’indifférence qui résulte de la perte de la pensée. Il a même été sédimenté : en lieu et place du silence du monde, il y a désormais le silence des gens informés (ou de ceux qui pensent ne pas avoir à répondre aujourd’hui de leurs erreurs d’hier – après tout, pensent-ils peut-être, ce n’est pas la fin du monde si d’autres en ont pâti ; pas de quoi avoir honte).
Ce que j’espère, donc, c’est que le terrain vague permette demain de retrouver le dialogue. Bien sûr, nous n’allons pas recoller tous les morceaux, et les motifs de désunions vont probablement se réactiver. Mais en s’appliquant à ne pas prêter à l’autre une carence pour expliquer son discours, en évitant de le rabattre sur son origine sociale (certes, chacun aura à la dépasser à même l’ex-pression), nous parviendrons peut-être à parler de nouveau de ces choses profondes (vie, mort, existence, santé). Et alors, pourvu que les esprits chagrins ne dénoncent pas encore la politique de l’entre soi au nom des collectifs plus larges, nous ouvrirons une brèche communiste, envers interdit de ce monde comme tu dis, en montrant l’exemple à partir de nos solitudes (grâce à toi, déjà, et de nouveau, je me sens moins seul).
Ce que j’espère, même, c’est que nous irons jusqu’au pardon. Non pas qu’il faille l’accorder sur tout et à tous, mais paradoxalement, à certains et sur certaines choses. Un pardon circonstancié. Juste de quoi faire en sorte que discuter ne veuille plus dire réinformer les gens, mais recommencer à refaire le monde, comme le dit si bien Edouard (un philosophe de l’amitié replié en centre-Bretagne qui s’applique à opposer un communisme sanitaire au gouvernement par la santé – c’est d’ailleurs parce qu’il se méfie beaucoup des critiques biopolitiques indifférentes aux vulnérabilités qu’il a d’abord classé ton livre parmi elles ; à tort, il le reconnait volontiers). Juste de quoi penser avec lui que l’amour ne peut désormais plus signifier accepter l’autre tel qu’il est, mais reconnaitre que l’on a tendance à vouloir le transformer et que les disputes fraternelles permettent que ce ne soit pas trop le cas.
En nous engageant sur le terrain vague, nous manifesterons en tout cas l’incomplétude liée à notre présence singulière – à la préséance du monde qui fait notre singularité. Nous soumettrons notre vulnérabilité à l’accueil de l’autre, et pourrons faire renaitre la communauté des bras cassés – au moins, des gens paumés par le confinement. Nous pourrons avouer que c’était blessant d’être en désaccord pendant si longtemps, et qu’il est certes nécessaire de dépasser la rancune pour réussir à parler de ce qui s’est passé pour chacun. Tu pourrais même accepter de penser que les propos agressifs qui te visaient sont nés au creux de situations éprouvantes, et entendre que certains regrettent sincèrement ce qu’ils ont pu écrire. En ce sens, finalement, il me reste à te remercier d’avoir sollicité des réactions aussi vives avec ton livre. Car il faut probablement en passer par là pour éviter d’oublier ce qui est passé, et qui mérite que nous nous battions.






