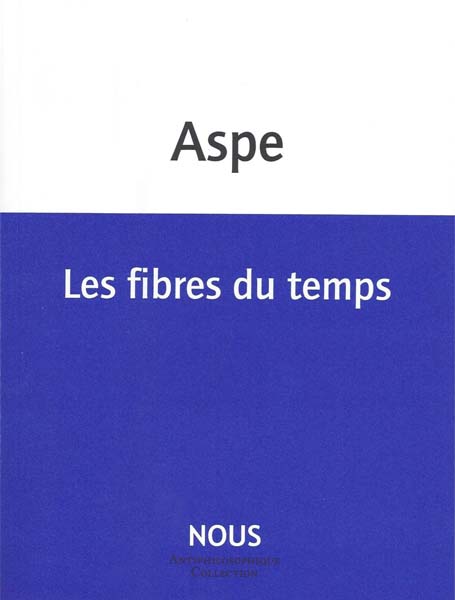Entretien réalisé par : Élise Creully, Benjamin Gizard, Romain Huët, Vivian Petit.
- On peut commencer peut-être par des éléments de présentation du livre et de comment il s’insère dans ta trajectoire intellectuelle personnelle. Par rapport à ce livre, nous pouvons déjà relever que dans les années 1990 tu étais proche du post-opéraïsme, de la revue Multitudes qui thématisait la façon dont le temps du travail s’indifférenciait progressivement du temps de la vie. Seulement, dès ta thèse, tu commences à marquer des distances vis-à-vis de ces approches du capitalisme. Au niveau de tes oeuvres qui suivent, on peut être surpris par tes références qui ne sont pas forcément celles qu’on voit le plus dans les écrits militants : Gilbert Simondon, Soren Kierkegaard, Wittgenstein… Comment reconstituerais-tu ta trajectoire qui mène à ce livre ?
- Bernard Aspe : D’abord merci pour cette discussion, parce que le problème quand on écrit ce genre de livre, c’est qu’il n’est pas évident qu’il soit lu, et encore moins qu’on puisse en parler. Je vais répondre un peu vite à ces questions de trajectoires intellectuelles pare que j’ai l’impression qu’il y a d’autres questions qui vont nous amener plus directement au contenu, aux enjeux, etc., au-delà de mon histoire à moi. Sur ce point, je n’ai pas grand chose d’intéressant à dire : c’est sûr qu’il y a eu une rencontre avec Negri puis un éloignement d’avec lui et le post-opéraïsme. Les livres que je fais en gardent toujours un peu une trace, une sorte de nécessité de s’expliquer, à la fois en assumer un héritage et s’en distancier. Pour se situer par rapport à d’autres courants. J’ai l’impression qu’il vaut mieux entrer dans le détail des questions, des thématiques.
- Comment en es-tu venu à écrire ce livre ? Quel est son lien avec tes écrits précédents ?
- Je ne sais pas comment les gens font pour écrire des livres, c’est assez mystérieux. Mais pour moi ça vient beaucoup des insatisfactions liées à ce que contenait le livre précédent, Les mots et les actes}. Je ne me relis pas beaucoup, parce que ce n’est pas très agréable de se relire, mais je voyais dans ce livre-là des faiblesses particulières qui appelaient une ré-élaboration. L’autre chose c’est que ce Les Fibres du temps s’est écrit à une période où j’étais beaucoup moins engagé dans les milieux politiques. L’écriture a commencé en 2010, au moment où je me suis éloigné de l’engagement « réel », « organisationnel ». Donc c’est un livre dont la visée est politique, mais dans son développement il ne l’est pas tant que ça et pas autant que ceux écrits avant.
- Nous souhaitons aborder la place de l’université dans la constitution des subjectivités contemporaines, dans les difficultés à faire l’épreuve du discours de vérité et de l’être ensemble. Est-ce que tu pourrais développer ce point ? Et toi dans ta pratique de recherche, comment tu te situes par rapport à la pensée universitaire ? Puisque tu te situes sur un terrain qu’elle occupe avec les sciences sociales. Et tout à l’heure tu distinguais temps commun et temps social, peut être que tu peux en dire deux mots ?
- Peut-être que ça revient à la question du discours situé. Ce que je retiens de l’analyse que Lacan fait du discours de l’université, c’est que ce discours évacue la dimension du sujet. C’est-à-dire qu’avec ce discours on propose aux étudiants une méthode avec des limites bien définies et un objet bien spécifique, une problématique elle-même tout à fait spécifiée, et qui doit pour être recevable dans les différents secteurs académiques ne pas sortir du cadre qui lui est donné, que ce soit en histoire, en archéologie ou en philosophie quand il s’agit de rester dans la tradition du commentaire des auteurs… On donne un espace de pensée tout en demandant à celui qui entre dans cet espace de remettre à plus tard le moment où il parlera en son nom. Le discours de l’université, c’est la perpétuelle remise à plus tard du moment où il faudra parler en son nom, parce qu’il faut laisser parler les documents, les auteurs qu’on commente, les enquêtes sociologiques… Le moment de parler en son nom, avec la spécificité qu’ajoute le fait même d’exister et d’en penser quelque chose, est remise à plus tard ou laissée dans les marges. J’essaie de faire en sorte, même si des amis me disent que c’est très universitaire ce que je fais, et malgré le fait que je mobilise des références (Simondon, Aristote, Wittgenstein, ou quelques autres), que ce livre présente un espace autre que ceux qui existent jusque-là, avec une façon de parler en son nom, de l’assumer. Sinon je ne vois pas l’intérêt d’écrire des livres.
- Là tu viens de parler de porter un discours en son nom et pourtant on dirait que tu évacues assez vite le fait de parler de ta trajectoire propre.
- Il y a deux choses. Le discours est situé au sens où il s’agit de parler en son nom. Comme disait Lacan, il s’agit de s’autoriser de soi-même. C’est-à-dire qu’il y a un moment où on n’est pas soutenu par des références ou des appuis pris sur les autres, et il y a quelque chose qu’on ajoute. Ce quelque chose qu’on ajoute expose, est une manière de choisir une forme d’exposition subjective. Mais le discours « situé » dont vous parlez est autre chose. Je ne suis pas sûr que ce que je fais soit un discours « situé » dans la mesure où la tradition philosophique donne une position assez bizarre, qui, si on l’assume, fait qu’on peut parler de tout. Notamment ne pas respecter le découpage des différents champs du savoir. La question n’est pas tant de croire que le discours qu’on tient est universel, mais de se dire que l’adresse est constitutivement indéterminée. C’est-à-dire que quand on écrit, il faut garder l’adresse indéterminée, au sens où ce qui est décrit et approché là est une expérience qui est en partage d’une manière extrêmement diffuse, et c’est à quoi je m’adresse en chacun, même s’il est certain que le livre ne peut pas toucher tout le monde. Ce n’est pas « situé » au sens politique, mais il y a comme je le disais un ajout subjectif. Il y a des paradigmes donnés pour expliquer le temps commun, par exemple ceux de la transmission avec l’expérience d’avoir des enfants, dans l’expérience amoureuse, l’expérience de la vie de couple, l’expérience du collectif politique, et dans ce sens là on peut dire que c’est situé, puisqu’il y a une convocation de ces expériences là ; mais en tant qu’elles ne sont pas les miennes.
- Et donc est-ce que tu pourrais parler de ton rapport aux sciences sociales ?
- Alors sciences sociales ça peut vouloir dire beaucoup de choses, parce qu’entre Georg Simmel et Pierre Bourdieu, il y a bien différentes traditions sociologiques. En tous cas si les sciences sociales c’est l’analyse des déterminations sociales en tant qu’elles produisent des comportements et qu’elles produisent la reproduction de ces comportements, alors oui il faut penser ce qui apparaît et existe et qui pourtant ne peut être pensé ou déduit de corrélations et de chaînes de causalité objectives dans les rapports sociaux. Il y a des émergences ou des ajouts, qui ne sont pas le résultat ou le fruit du développement objectif socio-économiques.
- Pour aborder le livre lui-même, est-ce que tu pourrais expliquer la logique d’ensemble, chapitre après chapitres ?
- La raison d’être de ce livre, son sujet, c’est le temps commun. Mais ce n’est pas un livre sur le temps — c’est un livre qui essaie de saisir cet objet particulier qu’est le temps commun : comment peut-il être appréhendé ? Qu’est-ce qu’il faut pour l’élaborer ? Comment peut-on le concevoir ? Et s’il y a eu cet objet, c’est aussi parce qu’il y a cette expérience -je crois- très partagée : l’impression d’une raréfaction de l’expérience d’un temps commun qui soit assez consistante, c’est-à-dire qui puisse tenir. La question du temps commun est donc la question du collectif, de la tenue, de la consistance, de la pérennité de ce qui se construit comme expérience collective. Depuis l’expérience que j’ai pu en avoir, j’ai pu voir que les collectifs politiques ne tiennent pas, ou ne tiennent pas bien. Donc l’élément de départ c’est la difficulté à faire durer l’expérience collective, la faire consister, c’est-à-dire autrement que sur un mode auquel on peut recourir mais pas sans dommages : avec des effets de « surmoi », des effets de culpabilisation, etc. Je parle d’une tenue qui soit vraiment féconde. Penser le collectif a voulu dire pour moi utiliser Simondon, qui, à ma connaissance, est le penseur qui a le plus clairement développé ce concept qui est au centre de ce livre : le concept de « transindividuel ». Il n’est pas le seul à l’utiliser, mais il est le seul à l’utiliser comme il le fait. Le transindividuel désigne l’expérience du collectif : on part d’une certaine manière des banalités d’une certaine sociologie : être plusieurs, c’est être « plus que » la somme des unités assemblées. Simondon me paraît proposer une image plus développée ce que ce « plus que » peut être. Un collectif c’est l’instauration d’un espace de résonance, un espace-temps. Le premier chapitre est sur l’espace commun, il développe l’idée d’une intériorité commune, que je reprends à P. Sloterdeijk, qui dit que le point de départ de la réflexion philosophique ne devrait pas être l’individu, le sujet, la conscience, mais un être-ensemble. La tradition part plutôt de l’être esseulé. Contre ce solipsisme de la tradition philosophique, Solterdeijk propose de partir de l’être ensemble, et de ce qu’il appelle une « intériorité commune » qui enveloppe les êtres. Le chapitre 2 est sur la question du temps commun, donc la même chose mais en développant du côté du temps. On est alors davantage dans ce que Simondon apporte sur la question de ce qui instaure un temps spécifique : un temps du collectif qui n’est pas le temps social. Une fois posé le primat de l’être-ensemble il s’agit de savoir ce qui arrive à l’un du « plus qu’un », c’est-à-dire celle ou celui qui se retrouve dans l’être-ensemble. C’est à ce moment là que je fais appelle à une dialectique, parce qu’un trait marquant de la pensée dialectique, c’est sa capacité à tenir ensemble des concepts qui sont censés s’opposer, comme « séparation »/« inséparation ». Dans un être ensemble, il y a une séparation qui demeure effective parce qu’il n’y a pas fusion entre les êtres, et dans le même temps il y a de l’inséparé qui se construit entre les êtres. C’est le chapitre 3. Dans le chapitre 4 il y a un changement d’orientation : finalement le registre des trois premiers chapitres est assez spéculatif. La pensée spéculative, c’est la pensée qui ne se préoccupe pas de la différence entre la pensée et l’existence. C’est une définition que donne Kierkegaard. Le chapitre 4 se préoccupe de cela : la pensée peut être contrainte de se pré-occuper du fait qu’elle n’est pas l’existence. Parler ou écrire, ce n’est pas la même chose qu’agir. Donc : comment faire avec ce hiatus qui structure l’expérience de l’existant ? Dans ce chapitre je reprends à Foucault la notion de « discours de vérité », parce que l’épreuve de la vérité c’est justement l’épreuve de tenir ensemble les mots et les actes, les paroles ou pensées et les manières de les exister ou de les exemplifier en actes ou dans des modes de vie. Dans la notion de discours de vérité, ce qui est intéressant c’est paradoxalement que la vérité ne se cantonne pas au discours. C’est ce qui oblige une mise en acte existentielle de ce qui est dit, pensé, etc. Avec une sorte de saut entre les deux. Le chapitre 5 porte sur la raréfaction du temps commun, ce qui correspond à la raréfaction de l’épreuve du discours de vérité entendu en ce sens, avec en particulier le rôle de l’université dans ce processus. Dans le chapitre 6, on revient à la question du temps commun sous l’angle proprement politique, où l’idée est que la politique a à la fois comme condition, comme enjeu central et comme horizon possible le temps commun.
- Dans un deuxième temps, on voulait aborder avec toi la question de l’écriture, des choix stylistiques que tu as pu retenir dans ton livre. Comme on l’a déjà rappelé tout à l’heure, c’est une lecture qui a pu être complexe pour quelques-uns d’entre nous. On a la sensation en te lisant que tu mènes un travail sur l’écriture, que tu essaies de faire surgir une écriture d’un autre ordre, avec beaucoup de métaphores, d’images, de concepts qui peuvent parfois être un peu hermétiques à la première lecture, par exemple, quand tu parles de cristallisation, de membrane polarisée, d’enveloppe chrono-topologique, de temps fibré. Ces concepts et ces métaphores ont pu appeler à certains moments un travail de traduction, d’interprétation de notre part, pour comprendre le sens que tu leur attribues. Est-ce que solliciter un effort d’interprétation de ton lecteur est un parti-pris volontaire de ta part pour nous inviter en quelque sorte à nous approprier ta pensée, est-ce que c’est quelque chose que tu objectives ? Ou bien finalement, est-ce que ce n’est que le fruit de nos expériences de lecture singulières ?
- Est-ce que c’est volontaire ? Euh… Moi j’aimerais bien être plus clair en fait. Ça me plairait d’être plus clair. Mais bon. Il y a plusieurs choses. Il y a le parti pris de ne pas forcément expliciter les raisons d’être à proprement parler du livre. La logique que je vous ai dite, par exemple. Et donc de laisser des choses qui ne sont pas forcément explicitées comme ça. Mais non, je dirais que ça n’est quand même pas un choix au sens où moi quand je propose ce livre, je ne m’attends pas spécialement à ce qu’on me dise que c’est compliqué. Ce n’est pas quelque chose sur quoi je joue en tous cas.
- Autre question, peut-être un peu plus personnelle, sur ta conception de l’écriture. Nous trouvons que ton écriture a un caractère exploratoire, au sens où peut-être, tu essaies de contourner les limites du langage, pour figurer l’expérience de ce temps commun, ce processus aussi de subjectivation. Est-ce que tu as un idéal d’écriture ? Est-ce qu’il y a des formes d’expression que tu aimerais atteindre ?
- Euh. Un idéal d’écriture. Je ne saurais pas dire. Par exemple un nom ? Un modèle comme ça ?
- Ça peut être des auteurs que tu peux admirer, ou un langage que tu essaies de faire surgir, de t’approprier. Ou entre tes différents livres en fait. Est-ce qu’il y a des évolutions ?
- Oui ça évolue. Enfin ça évolue, je ne sais pas comment. Ce que je peux dire, c’est que dans ce livre-là il y a l’image des fibres qui n’est pas une image complètement élucidée et c’est un peu logique parce-que j’ai l’impression qu’un titre, ça doit plutôt donner une image qui reste en partie non élucidée plutôt qu’elle ne doit expliquer le contenu du livre. Il y a des choses desquelles on essaie de s’approcher qui ne peuvent effectivement ni être mises en concept ou en discours. Ce n’est peut-être pas tellement une question d’expérience ineffable. C’est la question de cette étrange expérience qui fait qu’on est là et qui fait que tout à l’heure, on va sortir, et se demander où est passé ce que l’on était une demi-heure plus tôt. Par exemple, ce sont des choses comme ça qu’il s’agit d’approcher aussi, indépendamment des enjeux politiques, etc.
- L’une des singularités de l’expression de ta pensée, de ton livre, c’est le recours à des inserts, c’est-à-dire à des commentaires de films qui sont comme des interludes dans tes chapitres, qui viennent soit des contrepoints ou des synthèses des concepts que tu développes. Est-ce que tu peux revenir sur ce choix du recours aux inserts ? Et pourquoi avoir associé le cinéma à ton travail philosophique ?
- Le recours au cinéma tient à la façon dont il a toujours accompagné pour moi le travail philosophique. Et les auteurs auxquels je m’attache, comme Rancière, ce sont aussi des gens qui ont beaucoup travaillé sur le cinéma, et donc il y a une sorte d’héritage. Mais le cinéma, c’est aussi une expérience possible du temps commun : un film peut être vu comme une enveloppe possible pour ceux qui le voient. Une enveloppe, c’est-à-dire quelque chose qui abrite un espace-temps commun. Cette enveloppe, c’est comme une proposition, c’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’il y a un film qu’un temps commun se génère automatiquement. D’une certaine façon, il faut aussi se transmettre ce qu’il y en a eu lieu, de ce moment-là, pour que vraiment le temps commun soit vraiment instauré à proprement parler. Je pense qu’une projection de film, c’est comme une proposition d’existence d’un temps commun. Donc c’est pour ça que même si le livre se présente comme une argumentation philosophique classique, il y a aussi des coupures à certains moments. Et parfois, ces coupures viennent mettre en difficulté, ce qui est dit dans l’argumentation conceptuelle, en pointant un angle mort par exemple.
- Nous voudrions revenir sur ton usage de Simondon, et sur ta manière de l’associer à ta critique de Deleuze, qui apparaît en différents points de ce livre, notamment au troisième chapitre, intitulé La division du temps. C’est une critique qui est aussi présente depuis un moment dans tes écrits, et nous voudrions te demander pourquoi Simondon te paraît plus à même que Deleuze de t’aider à penser les questions qui t’intéressent. Tu t’opposes à Deleuze sur plusieurs points, notamment sur la question de la dialectique. Deleuze critique la dialectique spéculative de Hegel, en s’attaquant à la dialectique. Il ironise par exemple régulièrement sur ceux qui ont l’impression de faire avancer la pensée en découvrant une contradiction. Et quand Deleuze loue des œuvres d’art, comme par exemple les films de Godard, c’est en disant que l’une de leurs qualités est de ne pas être dialectique, de ne pas fonctionner sur des contradictions, mais d’accueillir le multiple et la multiplicité. Toi, tu sembles plutôt critiquer la dialectique spéculative de Hegel, mais pas parce qu’elle est dialectique, plutôt parce qu’elle est spéculative. Tu dis qu’il y a besoin de la dialectique pour penser le commun. Tu fais remarquer qu’il faut toujours être au moins deux pour qu’il y ait une subjectivation, dans la mesure où pour être un sujet il faut faire l’expérience d’être plus que soi. Et tu fais remarquer qu’il y a là un dépassement dialectique, parce que même dans la rencontre de l’autre, c’est toujours par le commun que cette rencontre est possible. Est-ce que tu peux en dire plus sur ton usage de Simondon et l’écart que tu fais avec Deleuze, sur pourquoi cet écart te paraît nécessaire.
- Aujourd’hui Simondon et Deleuze sont souvent lus ensemble et en continuité, notamment aux Etats-Unis ou au Canada. Simondon est d’ailleurs beaucoup plus lu aux Etats-Unis qu’en France. Le problème est que Deleuze ne s’intéresse pas du tout à ce que signifie « être ensemble ». C’est la raison majeure de la différence. Il me semble que chez Simondon, on a une pensée de ce qu’est « être ensemble », avec ce terme de « collectif », cette consistance spécifique du collectif. Même si cette question du collectif occupe une place assez restreinte dans son œuvre, on trouve chez Simondon une investigation à propos de l’être du collectif, ce qu’il n’y a pas chez Deleuze. C’est une des différences qui à mon avis n’est pas seulement une différence d’intérêt d’objet, mais aussi une différence de méthode, une différence qui a à voir avec les aspects proprement métaphysiques, ou ontologiques, des deux pensées. Il me semble que si on entrait dans le détail on verrait que ce ne sont pas les mêmes socles, et que c’est peut-être une erreur de les lire en continuité, ou du moins c’est un parti pris qui n’a rien d’évident.
- Toujours à propos Deleuze… Tu disais qu’il s’agit peut-être de ton ouvrage le moins directement politique, cela dit il est tout de même parsemé de références aux collectifs militants et aux débats qui les agitent, probablement à la fois pour servir d’exemple et pour montrer les implications concrètes de tes considérations. Nous voudrions revenir sur les implications politiques de ta critique de Deleuze, qui peut sembler aboutir à une critique des luttes des « minorités ». Tu fais remarquer qu’à l’intérieur des mouvements de lutte il semble y avoir une évidence partagée selon laquelle on doit éviter d’écraser les multiplicités de monde, de subjectivités, de luttes, etc., ce qu’on ferait si on tentait de les intégrer dans une totalité. Malgré ce refus de la totalité, que tu vois comme une évidence partagée dans les milieux militants, et nous sommes assez d’accord avec toi là-dessus. Tu fais aussi remarquer qu’il y a cependant différentes polémiques, portées notamment par ceux que tu appelles les « adversaires actuels de Deleuze », qui affirment qu’avec son éloge du multiple, il aurait, décrit la trame subjective contemporaine, et ses impasses propres. Et là nous te citons : « L’insistance conceptuelle sur les multiplicités et la promotion des luttes minoritaires auraient même préparé le sol sur lequel s’est opérée la recomposition du capitalisme. La polémique est certainement excessive, mais elle situe bien la difficulté. » Nous nous étonnons que tu situes ici la difficulté. Il nous semble que la difficulté est moins liée à la question du multiple ou de la multiplicité que dans la capacité, ou non, à avoir une analyse et une critique des formes de la gouvernementalité et de l’économie en tant que mode de gestion. Nous considérons que le débat devrait moins porter sur le principe de la spécialisation des luttes, que sur ce qui est défendu par ces luttes, et sur leur rapport au libéralisme. C’est-à-dire que demander plus de femmes dans les CA des entreprises du CAC 40 ce n’est pas comme le féminisme tel qu’il est défendu dans des mouvements révolutionnaires, et que demander des quotas de noirs dans les publicités ou sur les couvertures de magazines au nom du « ressenti des premiers concernés » ça n’a pas grand chose à avoir avec les luttes des Black Panthers. Il nous semble aussi qu’il faut renoncer à une prétention à la totalité pour mieux comprendre les modes d’exploitation et de gestion contemporains. Par exemple, ce n’est pas tout à fait un hasard si les questions que tu te poses sur la mise au travail et le travail gratuit sont posées par des féministes depuis une quarantaine d’année, ou si les difficultés d’avoir un rapport à l’espace commun animent les préoccupations de certains collectifs antiracistes, dans leurs critiques de l’urbanisme, des contrôles policiers, etc. Il y a aussi probablement un intérêt à comprendre les divisions genrées et racistes du travail pour s’opposer à ce que tu appelles les militants du capital ou les militants de l’économie. Nous aimerions que tu en dises plus sur le rapport que tu entretiens à cette question des luttes des minorités ou de la nécessité à comprendre comment sont opérées les divisions du travail, de l’espace sur des bases de genre et de race, et enfin au débat pour savoir si toute analyse et toute parole est située, sur où tu te situes dans ces débats.
- Il y a beaucoup de choses … Le passage que vous citez est une allusion à Zizek qui fait une allusion à Deleuze, en l’accusant de donner la trame de la subjectivité contemporaine, liquide, évanescente, avec ce principe qu’il ne faut jamais trop faire consister les choses, qu’il faut toujours les laisser ouvertes au devenir, etc. Il y a toute une critique possible de Deleuze, qui n’est pas forcément honnête, parce que je ne pense pas qu’on puisse rendre sa pensée homogène à la vie liquide, décrite par exemple par Bauman, malgré les engagements plutôt malheureux de Deleuze auprès des socialistes dans les années 80. Ceci dit, je crois qu’un des problèmes de notre contemporanéité politique est l’épuisement des solutions minoritaires ou singularistes. On a beaucoup appris que la politique était située, appris à penser que comme il n’y a pas de totalité il n’y a que des singularités, des moments, des occurrences de la politique, des luttes singulières, des luttes qui ne doivent pas être reprises sous une même bannière, et qui doivent être laissées à leurs émergences et leurs singularités. Laisser à la fois à leurs singularités de contenu (la lutte des femmes n’est pas la même chose que la lutte des racisés, qui n’est pas la même chose que la lutte écologiste, etc) et à leur caractère évanescent. Il ne faudrait surtout pas les faire consister, avec la solution ancienne qui était celle du parti, entendu comme une sorte d’institution qui permet de donner une continuité à une chose qui n’est pas censée en avoir. Et j’ai l’impression qu’on vit l’épuisement de ce schème selon lequel la politique est située, est une série d’occurrence singulière, et rattachée aux luttes des minorités. Quand je dis qu’on vit l’épuisement de ce schème, c’est bien sûr une fois qu’on prend en compte l’importance qu’ont eu les luttes minoritaires pour mettre en question la vieille dialectique marxiste qui avait réponse à tout et resituait toujours à l’intérieur d’un même schème d’explications les différentes situations qui se donnaient. Donc, il y a certainement eu besoin de faire éclater ce schème à travers les luttes, les comportements et aussi les schèmes conceptuels, comme ceux de Deleuze et Guattari, qui ont tenté de donner une sorte d’espace conceptuel à ces émergences et ces luttes qui n’entraient pas dans les schèmes marxistes. Mais on vit l’épuisement de ces schèmes. Et la question est de savoir comment on ne restaure pas la vieille totalité qui explique tout, la vieille détermination objective hégélo-marxiste.
- Nous allons plus en avant dans le livre, dans les tous derniers du chapitre. Tu proposes une critique de la cause écologique telle qu’elle est portée aujourd’hui. Pour l’essentiel, tu remets en cause deux attitudes : Il ne suffit pas d’ajouter la question environnementale aux revendications classiques, Il ne suffit pas de souligner les conséquences des désastres écologiques inégalement réparties sur la planète, En d’autres termes, il ne faut plus raisonner en termes de conséquences mais prendre plutôt la mesure que le capitalisme est une force géologique à part entière. Il a non seulement réduit la vie en fermant toute contemplation – tenue pour inutile- au profit d’une vie qui doit se vouer au travail utile c’est-à-dire une vie qui exige la peine de chaque homme, en l’astreignant à s’épuiser en d’innombrables travaux. Mais ce n’est pas tout, tu insistes sur le fait que le capitalisme a produit sa propre nature, il a mis au travail la nature. Les capitalistes ont fait la moisson des forces disponibles ; ils ont absorbé, utilisé, accumulé les ressources solaires, minérales, animales et végétales. Le capitalisme tend à faire passer dans son domaine d’exploitation la totalité des forces disponibles. Et c’est précisément là que le capitalisme rencontre ses premières limites : les limites de la mise au travail de la nature laquelle est en voie d’épuisement, la planète a cessé de rayonner sa force ; la perte à sa surface est signe d’épuisement. Comme le capitalisme a imposé un certain état de la planète, la critique écologique est nécessairement anticapitaliste. Nous l’avons compris comme un appel à l’insurrection illimitée qui s’autorise d’elle-même. Il nous faut alors ouvrir un temps pour répondre au futur en tant que c’est le temps qui vient. Et comment ouvre-t-on ce temps ? Cela suppose de « s’inscrire dans un réseau formé par une pluralité d’actes », c’est-à-dire faire raisonner les actes les uns avec les autres afin qu’une temporalité commune puisse jaillir. Il nous faut donc un « accordage des temps » qui est à comprendre comme une lutte contre le temps du capitalisme. Cet accordage des temps passe par l’alliance, c’est-à-dire « la mise en relation de plusieurs contextes partagés par une unité ». Tu parles alors « d’une assemblée des luttes » pour faire exister des actions qui raisonnent les unes avec les autres et qui se définit par la pluralité des positions qui peuvent s’y exprimer ». Cet appel à « l’assemblée des luttes », je le comprends comme l’éternel appel à la « convergence des luttes » tel qu’on a l’habitude de le thématiser dans le monde militant. Mais surtout, en quoi ceci se distingue des appels répétés de Stengers et de Latour pour un immense parlement intégrant les humains et les non-humains. En gros, nous comprenons leur appel qui est essentiellement « démocratique » : pour faire face au futur, il nous faut produire collectivement des savoirs et ceci exige la participation de tous ceux qui sont concernés. En d’autres termes, il faut faire intervenir tous les concernés dans la composition des forces. Ceci pourrait alors favoriser et cultiver les habitudes démocratiques. En quoi ta proposition se distingue-t-elle de celle de Stengers ou encore de Latour ? Le terme même « d’assemblée » évoque explicitement l’idée du « processus délibératif » ? En somme, ne risque-t-on pas de tomber dans l’éternel appel à la délibération, à s’intégrer dans des processus de délibération ? Peux-tu nous en dire plus ? L’accordage des temps passerait il par la délibération entre les différents collectifs ?
- Il y a plusieurs choses. Je ne me souviens plus d’avoir utilisé le terme « d’assemblée des luttes », mais soit. Cette expression n’est pas du tout à confondre avec l’idée du modèle parlementaire que l’on retrouve chez Latour par exemple. Pour Latour, il nous faudrait élargir le modèle parlementaire en intégrant les humains et les non-humains. Or, il faut insister sur le fait que la question politique est celle de l’antagonisme. Il y a des ennemis irréductibles alors que dans le modèle parlementaire il n’y en a pas. S’il doit y avoir une « assemblée des luttes », celle-ci doit se constituer en vue de faire face à un ennemi. Elle doit réunir ceux qui ont un ennemi commun. Il se trouve que cet ennemi commun est, pour le moment, beaucoup plus fort, il a une capacité d’action incommensurable par rapport à la nôtre. Mais au lieu de « assemblée des luttes » il vaut mieux parler de « l’alliance » ; terme que j’emprunte à Olivier Feltham, qui a utilisé ce concept pour désigner ce qui permet de relier différents foyers de luttes. J’utilise aussi Simondon pour montrer que, ce qui est mis en résonnance, ce sont des actions. L’assemblée des luttes est l’assemblée de ceux qui portent un certain type d’actions, d’interventions, de critiques en acte du capitalisme et de son écologie propre. Pour le dire autrement, l’assemblée des luttes est l’appel à une composition des actions qui tente de mettre en question l’existence du capitalisme – à des échelles que l’on peut considérer pour le moment comme dérisoire quand on est déprimés ou à des échelles locales pour les plus optimistes. L’alliance a donc deux versants : le premier versant est celui de la composition. Il nous faut un « travail de composition » de notre côté, un travail de composition divisante parce qu’il ne s’agit pas d’une fusion. Ici, je ne parle pas d’individualités, mais je parle bien de type de collectifs politiques qui existent. L’alliance pose le problème suivant : comment des collectifs qui ne portent pas le même discours de vérité politique vont quand même créer un espace de résonance spécifique où ils vont pouvoir tenir ensemble en dépit de l’hétérogénéité des modes d’action, des modes de vie, et des vérités qu’ils portent. Sur le deuxième versant, il y a le travail de l’antagonisme politique. Ces deux versants doivent être liés.
- Il y a deux termes qui sont omniprésents dans le texte. Le premier est celui de la « consistance des collectifs ». Le second est celui du potentiel. En ce qui concerne la « consistance » des collectifs, on sent bien qu’il s’agit de penser une réponse à la tendance à l’évanescence, à la dispersion, à la fragilité des collectifs politiques. La consistance des collectifs renvoie à une dimension affective (rapports entretenus entre les uns et les autres, faire voisiner les vies), à la dimension intellectuelle (produire des collectifs de pensées), et à la dimension de l’action (réciprocité des actes). Peux-tu revenir sur les explications que tu donnes sur cette tendance à l’évanescence ou à la fragilité des collectifs politiques et, dans un second temps comment un collectif se donne de la « consistance » ?
- La question de la consistance est pour moi la question essentielle du livre. J’ai l’impression que notre problème, de notre côté politique – c’est-à-dire ceux qui ont pour ennemi le capitalisme dans ses formes actuelles- n’est pas seulement celui de l’incommensurabilité de nos actions et de l’échelle à laquelle on existe. Le problème est aussi de faire consister des espaces temps qui ne soient pas réduits ou repris dans ceux de notre ennemi. L’idée que l’on retrouve notamment chez Rancière, est que la politique telle qu’on peut l’expérimenter avec les limites que ça a, c’est l’instauration, dans le meilleur des cas, « d’espaces-temps autonomes » c’est-à-dire qui se donnent une logique propre, des règles propres, et une consistance propre qui n’est pas fixée par les impératifs de l’économie. Cette exigence d’un « espace-temps autonome » est de plus en plus difficile à remplir pour de multiples raisons il y a la question de la répression, du contrôle, de la paranoïa, qui peuvent se poser avec force dans certains milieux radicaux. Mais, de façon plus générale, il n’est pas facile de tenir une consistance d’un collectif sans production de surmoi. Si un groupe veut tenir, continuer à exister avec une logique propre irréductible à celle de l’ennemi, avec une pensée propre, une forme de vie en écart de celle de l’espace ennemi, les membres de ce collectif sont exposés à tout ce qui dans le monde contemporain invite à une sorte d’usure rapide des relations que l’on peut nouer et des formes d’expérience collective que l’on peut construire. On a longtemps fait la critique du schème totalisant pour affirmer l’importance de l’émergence singulière, des cas. C’est un peu la même chose ici. Contre les rigidités de la forme des partis politiques, on a fait l’éloge de l’évanescence, de l’inconsistance, du fait que le collectif est toujours une entité en devenir et qu’il y a quelque chose d’essentiel dans le fait qu’il soit toujours en devenir ; qu’il soit toujours exposé à des reconfigurations, à des remaniements, à des redéfinitions et ultimement à sa propre disparition (Oury). On a tellement fait cet éloge de tout cela que l’on a peut-être oublié de questionner ce qui pouvait donner une armature à un collectif politique. Le danger, c’est de laisser jouer les effets de surmoi qu’analysait Guattari. Les effets du surmoi, c’est le fait de produire des effets de culpabilisation au sein d’un collectif politique : « tu ne peux pas partir du collectif militant parce que c’est une faute ; toi tu es en train de trahir, de dévier, etc ». La culpabilisation fait tenir des collectifs mais au prix de les asphyxier rapidement. Or, dans mon idée, il s’agit d’essayer de faire en sorte qu’il y ait des armatures, des structures -dirait Simondon- qui soient trouvées et qui ne soient pas pour autant la résurrection des formes anciennes de partis, des formes instituées finalement. Comment le collectif se maintient sans s’instituer ? C’est une vieille question. Comment il se maintient sans s’instituer mais sans faire aussi qu’à la place de l’institution, il y ait des effets de surmoi (ou de charisme, ce qui revient au même) qui tiennent les choses. Comment le collectif peut rester ouvert au devenir et au renouvellement tout en restant structuré. Ce sont des questions qui se posent dans les milieux politiques, mais aussi dans les couples.
- Dans ton ouvrage, tu évoques la nécessité d’un « accordage des temps ». Cela te conduit à contester le temps des horloges, le temps du capitalisme. Pour toi, le temps est devenu invivable car il est décidé par le dehors. Le temps ennemi est le temps de l’horloge. C’est ce qui a permis de discipliner les êtres humains, de synchroniser les activités humaines (nécessité devant le projet de la mondialisation). Comment peut-on lutter contre le temps des horloges ? Que signifie que le temps de la vie est un enjeu de la lutte ? Quelle alternative proposes-tu à cette contestation du temps ? Nous avons compris que tu proposais « l’accordage des temps » : mais comment se fonde-t-il ? Est-il quelque chose de spontané qui se joue dans l’effervescence du moment dans l’action par exemple ? Est-ce que c’est une temporalité que nous avons à attendre, quelque chose de spontané qui arriverait ? Ou est-ce quelque chose de décidé par des collectifs qui chercheraient alors à trouver une voie pour mettre en accord les rythmes de chacun (avec le danger évidemment soit de la rigidification militaire quand il y a pression à l’action soit d’un rapport assez lâche à l’action quand on exprime une trop forte attention aux rythmes spécifiques de chacun). En bref, quel mode de liaison des temps proposes-tu ?
- Il faut se méfier de laisser trop de choses à la spontanéité. C’est un problème dans certains milieux radicaux qui accordent trop de confiance à ce qui peut émerger de soi-même en quelque sorte. J’ai l’impression qu’il y a un minimum de volontarisme à assumer. La question est de savoir quelle forme donner à ce volontarisme qui ne reconduirait pas les impasses anciennes. Je pense qu’il ne faut pas trop se confier à la spontanéité car c’est aussi une des impasses que l’on a rencontrée ces derniers temps. Donc l’accordage des temps, c’est est la question de savoir comment construire un temps commun, comment faire consister le temps du collectif, mais aussi, au-delà même du collectif, comment composer un temps entre des collectifs politiques tout à fait hétérogènes ; hétérogènes parce que leur objet est hétérogène, parce que leur mode d’action est hétérogène.
- Il y a une image forte qui traverse ton ouvrage, qui est celle de l’inversion de la flèche du temps. Tu expliques que le temps commun est un temps qui ne va pas du passé vers le futur, il est le temps qui vient du futur vers le présent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi est-ce que ça se distingue du régime d’historicité moderne, qui avance vers le progrès ?
- Le schéma du futur radieux est le schéma où le passé détermine le futur. Celui-ci est la conséquence de ce qui s’est passé. Dans ce schéma du progrès, il y a quelque chose qui va vers l’avant, de même que dans le marxisme dogmatique quelque chose doit produire la révolution, avec la même nécessité. Si on suit la chaîne des causes et des effets on arrive à une grande bascule qui ouvre nécessairement à un futur radieux parce qu’on suit la nécessité historique… L’idée de Simondon — encore une fois ce n’est pas un livre sur le temps physique ou le temps de l’univers, c’est un livre sur le temps commun — c’est que le futur ne doit pas être envisagé comme un ensemble de possibles qui s’ouvrent devant nous mais comme un champ de potentiel, c’est-à-dire comme une situation métastable : une situation qui peut basculer de telle ou telle manière, mais toujours d’une manière qui n’est pas pré-déterminée. Dans le champ de potentiel, il y a des lignes d’actualisation. Ces lignes d’actualisation ne sont pas pré-dessinées. Elles se dessinent à mesure que le futur s’expérimente. Le possible renvoie en fait à ce qui est passé. C’est un des problèmes de la subjectivation diffuse, de se rapporter au futur comme à un ensemble de possibles entre lesquels il faut choisi. Les possibles sont déjà dessinés, on a déjà une sorte de modèle. L’expérience du futur en tant que telle, qui n’est pas si fréquente, c’est celle d’un potentiel sans possible. C’est pour cela que de l’impossible peut arriver. C’est essentiel pour nous, si l’on veut avoir un minimum d’espoir. L’impossible arrive, et cet impossible a la forme d’un potentiel qui en tant que tel renvoie à ce qui n’est pas déjà défini.
- Tu dis donc qu’il faut sortir de la dictature du présent, et préserver la possibilité d’avoir un passé. Tu dis aussi qu’il faut lutter pour la possibilité d’avoir un futur. L’essentiel de tes réflexions porte d’ailleurs sur ce que l’on va faire du futur. Nous aimerions aussi que tu nous dises ce que tu penses de comment on peut se pencher sur notre présent, sur la catastrophe au présent. On sait que le discours catastrophiste concerne toujours le futur, la menace de la crise économique à venir, ou la menace de la crise écologique, et c’est souvent au nom de la prévention des risques que s’exercent les modes de gestion contemporains, avec l’idée que c’est soit l’autorité, soit le chaos, pour ne pas voir que c’est souvent les deux à la fois. Il nous semble que ces discours gouvernementaux sur la crise future qu’il faudrait éviter sont à la fois là pour justifier l’autoritarisme présent ou la dégradation présente des conditions de vie, et pour ne pas parler de la catastrophe déjà présente. Deux questions : Comment faire pour ne pas accompagner les discours catastrophistes lorsqu’on lutte pour préserver le futur ? Et comment vois-tu les possibilités de l’intervention au présent ?
- Ce sont deux choses différentes. Dans le mode de gestion de la catastrophe il y a le recours à un État, à des institutions, à une autorité administrative. Je pose quant à moi la question de l’ouverture au futur à l’intérieur d’un collectif (au sens où Simondon l’entend), ce qui n’est pas du tout contradictoire avec la critique de la gestion de la catastrophe. Simondon dit que c’est quand on remet le temps dans le bon ordre, quand on voit le futur comme un champ de potentiel qu’on entrevoit aussi un présent, et qu’on peut aussi reconvoquer le passé, que c’est à ce moment que le temps dans son intégralité, dans ses dimensions multiples, dans sa « dimensionnalité » propre, peut apparaître pour lui-même. Par exemple, ce qui est intéressant dans le mouvement pour le climat, c’est le fait d’invoquer la jeunesse pour refuser de se voir voler le futur par les autorités qui vont donner une forme à ce futur, le pré-agencer comme un ensemble de possibles à travers lesquels les « jeunes » vont devoir passer, ces possibles étant de plus en plus réduits.
- C’est en effet très ambigu. On peut dire, comme tu le dis, que les jeunes sont ceux qui se font voler une partie du futur par les gouvernants, mais on peut aussi dire que les jeunes sont ceux à qui s’adressent les gouvernants et la publicité pour culpabiliser leurs parents. Ce sont ceux à qui on dit qu’ils n’auront pas de retraite à cause de l’irresponsabilité de leurs parents, ou ceux qui doivent faire la morale à leurs parents pour qu’ils trient leurs déchets ou achètent de la lessive écologique. Ceux à qui on donne cet objectif un peu flic, celui d’être la mauvaise conscience des autres.
- Vous avez raison raison, c’est aussi ça, parfois, le recours à la jeunesse dans notre période ; il y a une ambivalence, qui, cela dit, n’efface pas l’intérêt d’un mouvement qui est promis à revenir et qui, vu l’état des choses, est appelé à ne pas s’éteindre.