Fiche de lecture. Elie Tenenbaum, Partisans et centurions. Une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle, ed. Perrin, 2018.
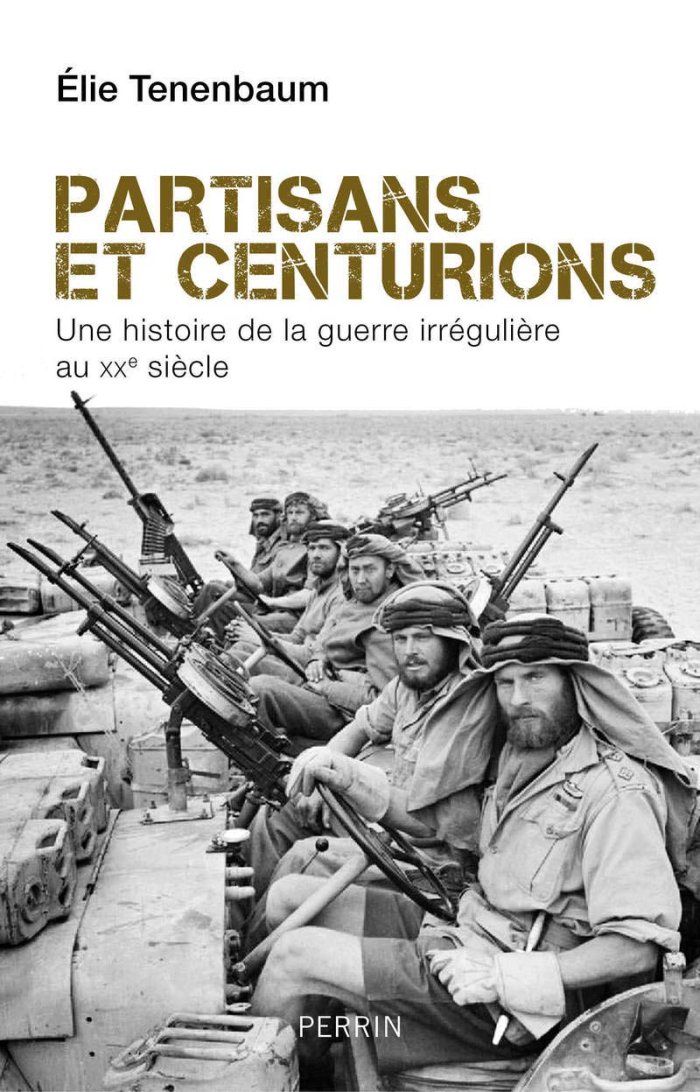
L’auteur refuse d’apporter des jugements sur l’objet de son étude, ce qui est en soi louable (étant donné que la suspension temporaire du jugement fait partie de la méthodologie historienne) mais cette absence s’étend souvent à l’analyse, si bien que son sujet semble par bien des aspects assez plat, voire immobile dans le temps. Tenenbaum rend ainsi compte de « dérives » (le terme est sien) des applications de la doctrine française en Algérie et remarque qu’elles posent de tels problèmes politiques que l’arme en devient inopérante. En l’absence de réflexion approfondie sur le cœur de la doctrine (qui mènerait d’ailleurs à éviter le terme de « dérive »), on ne comprend pas pourquoi elle est reprise par d’autres armées malgré son échec. Surtout, la même doctrine produisant des effets similaires plusieurs années plus tard dans d’autres contextes, l’absence de questionnement mène à une simple répétition de la remarque sur des « dérives » (cette fois en Amérique du sud). Or, si entre l’Algérie de la fin des années 50 et, par exemple, l’Argentine de la fin des années 70, des mêmes applications produisent les mêmes effets, cela pose de nombreuses questions qui auraient enrichies le sujet. Soit les différents théoriciens s’interrogent sur leurs échecs, auquel cas nous serions curieux de connaître la teneur de leurs débats ; soit l’absence de ce débat devrait amener l’auteur à l’expliquer.
Eli Tenenbaum ne justifie en rien les horreurs que les militaires perpétuent en application des principes des doctrines étudiées. C’est plus froid : ce n’est pas le problème abordé. Mais, précisément, ces horreurs et leurs effets font partis du problème, y compris d’un point de vue purement miliaire dans l’objectif d’écrasement de l’ennemi. Si une méthode circule malgré ses échecs politico-militaires à répétition et ses effets systématiquement terrifiants sur les populations, cela pose question sur les raisons des militaires à la reprendre et à s’interroger sur la terreur ainsi obtenue. Or, chez l’auteur, tout se passe comme si ces effets devaient être lamentés (« dérives » donc) autant de fois que la méthode est appliquée, tels des effets collatéraux indésirables, sans se demander s’ils ne sont pas intrinsèques à la méthode. Evidemment, si la question était posée, l’auteur serait bien obligé d’interroger la nature des Etats qui les appliquent, et ne pourrait plus se contenter de remarquer des problèmes à la marge pour des nations qui se revendiquent de la « démocratie libérale » (les guillemets sont miennes, elles n’apparaissent certainement pas chez Tenenbaum qui accepte l’appellation, étant entendu que l’Occident –une expression cette fois pleinement de l’auteur- défend bien ce régime politique générique). Et c’est là que le bât blesse, ces doctrines qui impliquent de vastes ingénieries sociales –soit la manipulation psychologique des populations, par la terreur ou la séduction- obligent à interroger les régimes politiques qui les utilisent car elles les redéfinissent. Voilà le champ que l’auteur évite absolument, alors même que nombre de doctrinaires militaires qu’il cite (forcément puisqu’ils sont centraux) ont, eux, bien conscience du problème et savent ne pas savoir comment le résoudre. Là où Galula et Trinquier s’en sortent avec des pirouettes intellectuelles qu’ils savent peu convaincantes et qui, en définitive, finissent toujours par affirmer un camp du bien contre l’autre, Tenenbaum évite simplement la question pour la considérer hors de la problématique de sa thèse. Cette absence d’analyse sur le contenu des doctrines en lien avec ses effets politiques laisse entendre qu’il s’agit de contenus relativement neutres, de simples techniques qui circulent d’une armée à une autre. Or, on n’utilise pas ces techniques impunément.
Faisons une petite incursion dans le dur des théories militaires en question pour mieux saisir le problème non soulevé par l’auteur.
Pour l’“école française” (une partie que je connais mieux que les autres), soit la « doctrine de guerre révolutionnaire » (DGR) [1], Tenenbaum retient centralement le concept des « hiérarchies parallèles », expression du colonel Lacheroy qui désigne l’ensemble du maillage social (associations, etc.) qui, selon lui, permet au parti insurgé de « tenir » la population. Tenenbaum oublie cependant, parmi les éléments consensuels de l’école française, le « scénario des cinq phases », présenté aussi par Lacheroy et repris par la plupart des auteurs français (Trinquier et Galula, pour ne citer que les plus lus aux Etats-Unis, intéressant donc directement la problématique –sur les circulations entre puissances occidentales- de l’ouvrage). C’est fort dommageable car ce scénario, présenté comme intangible, explique bien des choses. De quoi s’agit-il ? Avec de très légères variantes entre Lacheroy, Trinquier et Galula, la guerre révolutionnaire se déroule en cinq phases. Dans ses prémisses (première phase), elle n’est détectable que par des experts, c’est-à-dire le personnel militaire, policier, judiciaire ou politique spécialistes en guerre subversive :
« Dans une période calme, seuls les services spécialisés décèlent les signes précurseurs d’un orage et, en général, les signalent aux autorités responsables. Mais l’expérience prouve qu’elles sont rarement écoutées. » [2]
Et pour cause, cette phase se caractérise par des « agitations » qui sont en fait des manifestations normales dans n’importe quel régime libéral (essentiellement, des grèves et des manifestations). A cette phase initiale succèdent inéluctablement quatre autres pour arriver à la prise de pouvoir par le parti insurgé. Insistons, pour les militaires de la DGR, la succession des phases est inéluctable, de sorte qu’il convient –logiquement- de prévenir la guerre dès sa première phase, y compris pour des raisons humanitaires puisque les phases suivantes seront forcément plus violentes. Avec les mots de Galula :
« Il ne s’agit pas, comme pour une guerre ordinaire, de la “continuation de la politique par d’autres moyens”, car une insurrection peut naître bien avant que l’insurgé commence à avoir recours à l’usage de la force. » [3]
A partir du moment où les militaires croient savoir ce qui va se dérouler, ils entrent dans une logique préventive, si bien qu’il est toujours préférable de détruire l’adversaire avant même qu’il ait manifesté la moindre violence. Ainsi, on comprend très bien que quiconque applique cette doctrine en vient forcément à arrêter –et souvent détruire- le moindre opposant politique ou syndicaliste. Ces actions, qui se retrouvent dans toutes les latitudes et durant toute la période entreprises par l’auteur, ne peuvent être considérées comme des « dérives » qu’en faisant l’impasse sur ce point. Il ne s’agit pas là d’un point annexe d’un traité militaire mais ce qui constitue le socle commun aux auteurs les plus lus de la doctrine (d’ailleurs directement dérivé de ces fameuses « hiérarchies parallèles »). Cette expression des « cinq phases », Tenenbaum la cite une seule fois dans son ouvrage sans en expliciter le sens, si bien que cela semble une simple technique caractéristique des Français, voilà tout. Mais, avec le bref résumé que j’en ai fait, tout le monde aura compris que ces « cinq phases » implique rien moins qu’un état de guerre permanent (lui-même justifiant un Etat policier), puisque la première phase correspond à ce que nous considérons comme des activités normales dans un régime libéral. D’ailleurs, la simple reprise du vocabulaire utilisé par les théoriciens de la guerre révolutionnaire aurait peut-être permis à Tenenbaum de donner une idée de quoi parle t-on. Par exemple, une boutade de Lacheroy décrivant la cinquième phase (quand le camp révolutionnaire a construit l’intégralité de son pouvoir parallèle) :
« On peut toujours reprendre les questions en main, bien sûr, même quand on est arrivé là. Seulement, à ce moment là, il n’y peut-être pas besoin d’un Général, ni d’un Préfet, il vaut mieux un boucher. ». [4]
Rien ne fait dévier l’auteur de l’idée que les doctrines dont il étudie les circulations sont neutres. Il s’ensuit que, si elles produisent des effets indésirables, c’est le fait d’applications malencontreuses. On soulignera d’ailleurs sa propension à insister sur des « mauvais » usages des techniques occidentales par les forces de l’ordre établi de pays plus exotiques. Par exemple, il remarque que le programme de coopération des polices promue par les Etats-Unis à travers l’Académie Internationale de Police (IPA, fondée en 1963 à Washington) se traduit par un usage extensif de la torture par les policiers qui reçoivent cette instruction. Pour l’auteur, « les dérives viennent surtout de l’interprétation très élastique du terme “subversion” qui contribuera pour beaucoup à l’extension de la répression bien au-delà des strictes nécessités sécuritaires. Nombre de dictatures d’Asie et d’Amérique latine auront ainsi préalablement bénéficié de la formation et de l’assistance technique et opérationnelle des États-Unis qu’elles mettront à profit, non seulement contre des rebellions armées, mais aussi contre tout forme d’opposition ou de dissidence sociale. ». Avec le bref exposé antérieur, nous savons qu’il ne s’agit là d’aucune dérive, puisque les premiers théoriciens et promoteurs s’engagent dans cette voie que les autres ne font que suivre. Et, sans vouloir entrer dans un procès en colonialisme de l’auteur, il eut été préférable qu’il remarque que ces « dérives » suivent la même logique d’extension de la qualification de « subversif » que celles perpétrées par le FBI de monsieur Hoover et son programme COINTELPRO [5]. Ce trait d’égalité entre les flics du monde entier eut été bienvenu.
Quand l’auteur se résigne, malgré tout, à un bilan de ces doctrines militaro-sécuritaires (qu’il préfère appeler selon l’expression euphémistique de « guerres irrégulières », il est vrai commode pour désigner un ensemble assez disparate de doctrines dont il rend très bien compte les concurrences et les jonctions), cela donne un jugement mitigé qui ressasse ces décidément malheureuses « dérives » :
« Ce qui devait être le couronnement des efforts concertés de l’Occident en matière de guerre irrégulière en est donc aussi le chant du cygne, vestige encombrant d’un concept qui peine souvent à démontrer ses résultats et dont les dérives politiques et sécuritaires tendent à faire peser plus de menaces sur la démocratie libérale qu’elles ne contribuent à sa protection. »
A s’interdire une étude critique du cœur de la doctrine qui montrerait –d’ailleurs sans beaucoup d’originalité- que ses principes mènent logiquement à, entre autres, une extension infinie (c’est-à-dire jusqu’à ce qu’une autre force soit en mesure de s’y opposer) de la répression, Tenenbaum se condamne à observer des « dérives » à répétition. Cette approche n’est pas seulement politiquement exécrable, elle est aussi méthodologiquement questionnable dans la mesure où son sujet reste alors forcément plat et, en fin de compte, d’une certaine manière, intemporel (ou inamovible dans le temps). L’absence de re-problématisation au fur et à mesure des différentes périodes qu’il aborde condamne l’ouvrage à un registre des utilisations et des circulations de doctrines militaires qui semblent neutres. Cette somme est importante, elle pourrait être encore bien plus étendue, sans que son intérêt n’apparaisse clairement car les questions ne se renouvellent pas.
L’ouvrage impressionne par son érudition et l’imposant travail d’archive. Il déçoit en revanche par la limitation des questions qu’il pose et sa tiédeur à l’heure d’interroger son objet. Aussi, apparaît-il moins comme une thèse qui offre une compréhension à un phénomène politique et militaire d’une importance majeure pour le second XXe siècle, qu’un manuel à consulter pour en extraire des informations sinon dispersées ou inaccessibles. En définitive, on peut certes louer ce travail sur les circulations qui comble un vrai manque, mais à se focaliser sur les circulations, et seulement sur elles, on finit par se demander qu’est ce qui circule au juste.
Jérémy Rubenstein





