La naissance des vitrines commerciales
C’est à la fin du XVIIIe siècle que de grands vitrages commencèrent à être utilisés pour constituer des devantures et mettre en scène la marchandise dans l’espace commercial en Europe. Leur diffusion a bouleversé les pratiques de commerce de détail et le vécu de l’espace public urbain. Impliquant la maîtrise de techniques innovantes (le verre plat, les armatures métalliques, l’éclairage artificiel …), les vitrines ont joué un rôle majeur dans l’histoire du consumérisme, accompagnant le développement du shopping, du merchandising et de certaines formes de marketing. (…)
Avant les vitrines existaient plusieurs techniques d’exposition commerciales. Les marchandises étaient exposées vendues et travaillées à l’air libre, devant la boutique ou derrière les « ouvroirs », dispositifs servant à la fois de volets (lorsque la boutique est fermée) et de tables d’étalage et d’auvent (lorsqu’elle est ouverte). Cet usage de la façade ouverte sur rue était exigé par certains règlements corporatifs, qui en faisaient un gage de probité (…) L’époque du commerce sans vitrine n’était pas forcément celle de la fermeture : marchandises, boutiques, ateliers étaient souvent largement ouverts, s’installant en partie sur la voie publique. Quand les produits n’étaient pas visibles depuis l’extérieur, il fallait entrer et se les faire montrer : l’entrée n’était pas toujours libre, notamment dans les boutiques de luxe (…) C’est à la fin du XVIIIe siècle qu’apparurent de grands « vitrages » dans les galeries du Palais-Royal à Paris. Louis-Philippe II, qui régnait alors sur le palais, décida en 1780 d’en louer une partie pour rembourser des dettes (…). Dès ses débuts, la vitrine fut un « dispositif de curiosité », servant à « jouer sur la propension des personnes à se laisser surprendre, à être attirés par l’inconnu, à opter pour la nouveauté, à aimer les surprises [1] ». Bientôt surnommé le « palais marchand », le Palais-Royal attira les visiteurs de province et d’Europe, frappant leur sens visuel et marquant leur mémoire (…). L’esthétique de l’économie d’Ancien Régime, fondée sur le don ostentatoire et le gaspillage, est ainsi réinterprétée et intégrée dans une économie marchande urbaine, fondée sur le désir et l’attention. Dans les deux cas, il s’agit d’offir un spectacle en apparence gratuit, mais impliquant une contrepartie (la soumission ou l’achat). Dans les deux cas, on a un spectacle qui attire du monde, constitue un public dont la seule présence renforce sa propre attractivité. L’âge d’or de la galerie de bois, 1789-1830, est de fait une période révolutionnaire, où s’affrontent mondes aristocratique et bourgeois, où disparaissent les corporations, où se libéralise le commerce, où « les magasins ne cessent de croître et de proliférer [2] ». La vitrine apparaît ainsi comme un dispositif central dans la transition d’un modèle à l’autre, créant de nouvelles valeurs et de nouveaux « centres » (…). Comme le note Galluzzo, cette mobilisation de la foule de passants de toute classe comme flâneurs, curieux et potentiels clients, est centrale dans le développement du shopping, c’est-à-dire dans la transformation de l’achat en activité de loisir en milieu urbain. Elle a pour corrélat la transformation de toute activité de loisir (promenade, rencontre, réunion) en achat potentiel.
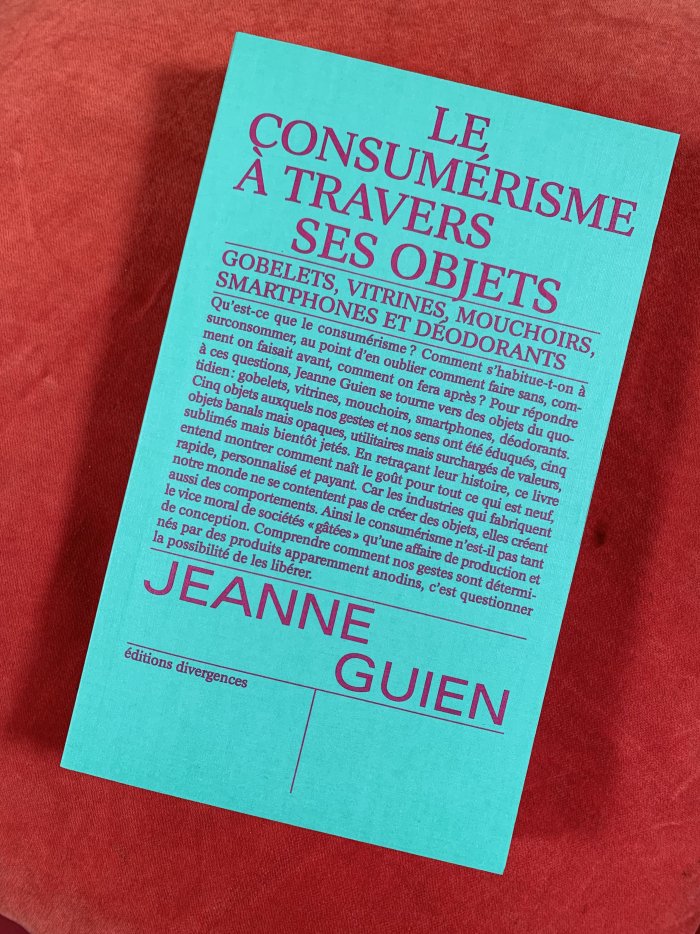
De fenêtre nécessaire à éclairer un endroit sombre, les « vitrages » et « glaces » étaient devenus des dispositifs marchands : il s’agissait toujours de capter l’attention des passants pour la focaliser sur des marchandises, en leur offrant un abri, un spectacle ou un raccourci (…). Karl Marx, en exil à Londres, décrivait en 1858 le centre-ville comme une suite de boutiques vitrée sn transformant toute promenade dans la rue en une revue des produits du commerce colonial :
Dans les rues animées de Londres, les magasins se serrent les uns contre les autres, et derrière leurs yeux de verre sans regard s’étalent toutes les richesses de l’univers, châles indiens, revolvers américains, porcelaines chinoises, corsets de Patis, fourrures de Russie et épices des Tropiques ; mais tous ces articles qui ont vu tant de pays portent au front de fatales étiquettes blanchâtres où sont gravés des chiffres arabes suivis de laconiques caractères. Telle est l’image qu’offre la marchandise en apparaissant dans la circulation [3].
A partir des années 1850, les « grands magasins » se sont multipliés en Europe, aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et dans certaines villes colonisées comme Alger, Oran, Blida, Hanoï, Saigon … Ces grands magasins firent l’objet de vastes projets architecturaux, pour les construire ou les rénover. On y retrouve l’obsession pour le verre et ses effets de sublimation (…). De ce point de vue, les grands magasins étaient les héritiers des palais, théâtres et cathédrales : ils attiraient du monde par la promesse de voir et d’être vu dans un décor prestigieux. Promettant « la liberté de regarder la marchandise sans être contrait de l’acheter », ils firent un usage très intense des vitrines, qui se diffusèrent dans tout type de commerce (…). Derrière la prétention à la dilapidation générale de la lumière, on assiste en fait une répartition classiste de l’éclairage. Dans la division du travail des grands magasins, la visibilité (et la beauté) étaient en effet réservées aux espaces de vente : les travailleurs de la logistique, de l’imprimerie, de l’échantillonnage, ou de l’étiquetage travaillaient fréquemment en sous-sol, à proximité des salles de machines (…) A l’époque même où elle promouvait le repli sur la cellule familiale et la sphère privée [4], la bourgeoisie réclamait des classes populaires une animation permanente de l’espace public. Tout en ayant l’air d’offrir aux plus modestes l’entrée gratuite dans un espace féérique digne des bals princiers les plus fermés, les grands magasins normalisèrent l’exigence d’une ville toujours active.
L’économie de la captation de l’attention visait tout particulièrement les femmes à plusieurs niveaux. D’abord, comme employées : elles étaient massivement affectées aux comptoirs des grands magasins, où leur corps devait être intégré au « poème commercial ». Les « demoiselles de magasin » étaient embauchées selon leur âge (moins de 20 ans) et leur physique, devaient porter une tenue réglementaire et se tenir debout 10 à 12 heures par jour, avec un jour de repos par semaine (…). Les vendeuses sont tenues d’assurer ce que Daniel Roche appelle « l’effet vitrine » : leur corps, « façade visible », doit représenter l’élégance vendue aux autres femmes, les clientes doivent de leur côté se faire les « vitrines » de la richesse de leur époux [5]. La clientèle ciblée était en effet principalement féminine. On le constate dans les illustrations publicitaires des grands magasins y compris lorsqu’il s’agit de magasins pour hommes. De plus, la séduction marchande était elle-même présentée comme quelque chose de féminin : alors que c’étaient principalement des hommes qui concevaient, construisaient et géraient les grands magasins et leur communication, le merchandising était présenté comme adapté à une « nature féminine » forcément portée à la séduction et au soin des apparences (…).
Bris de vitrines et techniques de lutte
Les vitrines font enfin l’objet d’une appropriation par les mouvements sociaux qui les placent au cœur de « techniques de lutte » variées (…). En 1850, à Londres, pendant la construction du Cystal Palace, un pamphlet adressé aux ouvriers portait le titre : « Jetez la première pierre sur la maison de verre ». Il invitait ces derniers à boycotter le chantier et la visite de l’exposition, qui rendait trop peu hommage au rôle des ouvriers dans l’histoire de l’industrie anglaise (…). Entre 1909 et 1912, les suffragettes anglaises pratiquèrent « l’argument de la vitre cassée » : casser les vitrines de commerces lononniennes, notamment des boutiques de luxe ou de grands magasins, pour revendiquer le droit de vote et dénoncer le mépris dans lequel était maintenu leur mouvement. C’est cependant dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec la banalisation des vitrines commerciales et la croissance urbaine, que les bris de vitrines entrèrent massivement dans le « répertoire d’actions » de l’émeute urbaine. On en constate à Casablanca en 1952, à Alger en 1960, à Harlem en 1964, à Paris en 1968 … Une interprétation instrumentale revient à dire que le bris de vitrine permet l’effraction et le pillage (…) Ce fut le cas par exemple à Douala en 2008, lors d’un mouvement social de très grande ampleur dénonçant la hausse des prix des carburants et des denrées de base. Cependant, si les médias rapportent régulièrement des récits de commerçants révoltés par le pillage de leur magasin, multiples sont aussi les récits de bris de vitrines sans pillage, ni effraction (…) Pour Philippe Braud, la « fonction performative » des bris de vitrines est politique : leur caractère spectaculaire attire l’attention sur une cause ou sur le groupe social qui la porte lequel souffre d’invisibilité [6]. On retrouve ici la sociologie de la visibilité : il s’agit de faire exister une réalité vers laquelle les différentes lumières sociales ne sont jamais tournées (…).
Si l’on prend au sérieux cette violence sélective on a deux options. Première option : c’est l’individu tenant le commerce qui est visé, en tant que personne physique ou membre d’un groupe social. C’est souvent le cas dans les attaques personnelles ou les mouvements racistes. Ainsi de la « nuit de cristal » en 1938 : à travers toute l’Allemagne, plus de 7000 commerces appartenant à des Allemands juifs furent attaqués. Les débris de leurs vitrines et fenêtres laissèrent son surnom à ce pogrom qui s’accompagna aussi de meurtres, viols, sévices, arrestations et déportations. Il s’agit dans ce cas de détruire la place de l’autre dans l’espace urbain (…). Deuxième option : c’est la marque ou l’enseigne qui est visée, comme personne morale. Ainsi certaines grandes entreprises sont-elles systématiquement ciblées par les manifestations et contre-sommets altermondialistes ou anticapitalistes (…). La vitrine est visée ici comme objet-média (porteur de signes aisément identifiables comme le logo), pour la matérialité spectaculaire de son bris (qui frappe les sens, la mémoire, l’attention) et comme dispositif marchand comme cet « opérateur de basculement » qui fait du passant un consommateur potentiel de ses produits. De la même façon qu’en cassant des machines ouvriers et ouvrières empêchant réellement (et non « symboliquement »), la mécanisation de leur travail, certains briseurs de vitrines luttent réellement contre la marchandisation de leur regard, en détruisant le spectacle des vitrines, ou en le rendant grotesque. La valeur des marchandises est atteinte par la destruction de leur écrin (…).
P.B






