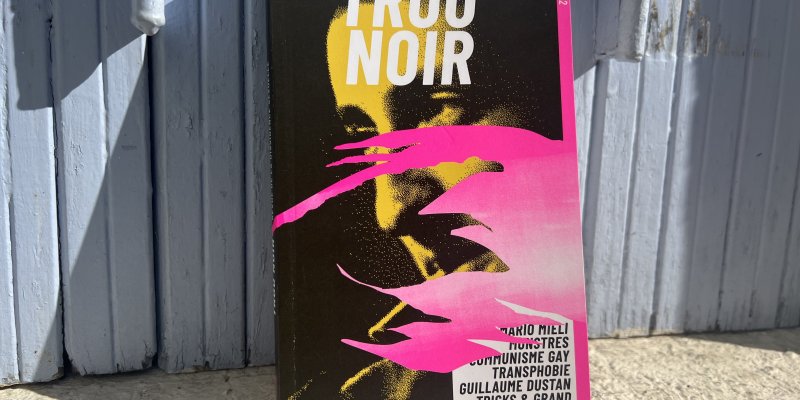- Bonjour Xavier. La mélancolie de la nasse est le récit de plusieurs manifestations qui se sont déroulées à Rennes, dont l’une, en décembre 2019, s’est finie pour un certain nombre des manifestants, dont le narrateur, à l’intérieur d’une nasse, puis en contrôle d’identité au commissariat. Tu sembles partager beaucoup avec le narrateur … Ce récit est-il autobiographique ?
- Oui ce récit est autobiographique. Mais ce que j’ai vécu dans les manifestations ces dernières années, nous sommes nombreux à l’avoir vécu… Et à partager, je crois, ce sentiment d’être aujourd’hui dans une sorte d’impasse. J’en profite aussi pour donner quelques nouvelles de cette ville de Rennes à ceux qui n’y sont pas allés récemment, voire même qui n’y sont jamais venus. Mais la situation locale ressemble, hélas, à celle de bien d’autres villes françaises.
- Tu célèbres dans ton récit les feux de joie ou le bris des vitrines des promoteurs qui saccagent la ville de Rennes, à savoir les compagnies d’assurances ou les agents immobiliers. Tu opposes la manif encadrée, réglée, où absolument tout est prévisible, à la révolte, l’émeute, en donnant notamment des exemples liés au mouvement contre la réforme des retraites de 2010, à celui contre la loi travail en 2016, ou au mouvement des Gilets Jaunes. Cependant, comme tu l’écris, le recours à la casse peut lui aussi être très prévisible et réglé …
- Je ne sais pas si je « célèbre », en tout cas je salue fraternellement ceux et celles qui sortent du rang pour casser ici une vitrine d’agence bancaire, là celle d’une d’agence immobilière. Ces destructions-là, c’est une évidence, ne sont rien en comparaison de celles qui affectent nos vies et dont sont en partie responsables ces entreprises.
À Rennes, les entreprises de l’immobilier (Giboire, Blot, etc.) s’entendent très bien avec les élus (l’actuel adjoint à l’urbanisme est un héritier falot qui ne doit son poste qu’au fait d’être le fils de son papa : Edmond Hervé, qui fut maire de Rennes, ministre, sénateur, etc.). Entreprises de l’immobilier, du BTP et élus vont main dans la main pour transformer cette ville en un espace dépolitisé, sécuritaire et lisse (les élus parlent aujourd’hui, à propos du centre-ville d’« espace apaisé » - c’est leur nouvel élément de langage. Est-ce que ça signifie que dans cet « espace apaisé », les flics de la Compagnie départementale d’intervention n’éborgneront plus personne ? Je ne sais pas).
Les conflits d’intérêts entre élus et groupes immobiliers sont, à Rennes, à peine cachés et quand l’un d’eux est trop visible, on remplace l’adjoint à l’urbanisme et c’est tout.
Briser les vitres des agences immobilières, c’est désigner l’ennemi. Et celui-ci est en train de transformer cette ville autrefois « rock » en un espace pacifié et joli qu’on pourrait qualifier de bobo et de sympa. Mais sous le sympa affiché et brandi comme un étendard, il y a l’exclusion de ceux qui n’ont pas les moyens d’être sympa et cool.
En tout cas, casser une vitrine a un sens politique évident et fort. Ce que je pointe, c’est peut-être l’aspect ritualisé. Et donc l’absence de surprise. Je m’amuse à imaginer qu’on pourrait régler sa montre, un jour de manif, sur le bris de vitrine du crédit agricole de l’avenue Janvier, comme d’autres auraient pu régler leur pendule sur le passage d’Emmanuel Kant qui effectuait chaque jour, à la même heure, la même promenade... Il n’aurait dérogé qu’à deux occasions à ce rituel : pour aller chercher un livre de Rousseau et, en 1789, à l’annonce de la Révolution française.
Le problème du rituel, c’est que nous devenons prévisibles. L’ennemi sait ce que nous allons faire, où nous allons intervenir. Je ne suis pas un spécialiste de la guerre mais il me semble que dans un combat asymétrique, pour remporter une bataille, l’effet de surprise est décisif.
- Tu décris Fabrice Le Restif, leader local de Force Ouvrière, comme un bonnet de nuit. Tu écris qu’il quitte la manifestation avant son terme, non pas par peur des débordements, mais parce qu’il aime se coucher tôt. Comment le sais-tu ?
- Je le déduis, tout simplement. Car quand je l’écoute pendant la manif, il semble très en colère. Et déterminé. Mais dès que ça chauffe un peu, dès que la manif sort des sentiers battus et que ça commence vraiment, Fabrice Le Restif a disparu. Je déduis donc qu’il a un bus à prendre... Je me souviens qu’il a donné une interview à France 3 Bretagne, pendant un mouvement social, dans le bus qui l’emmenait à la manif. Et il me semble que c’était un bus d’une ligne qui relie les communes voisines à l’hyper-centre rennais. Il n’est pas toujours facile de rentrer chez soi à l’heure quand on habite en périphérie... C’est aussi un des drames de la gentrification.
Et je voulais aussi citer M. Le Restif pour le simple et pur plaisir de faire une comparaison avec Restif de la Bretonne, dit le Hibou-Spectateur (c’est le devenir-animal avant l’heure), qui est un écrivain singulier, mystérieux, amateur de dérives nocturnes dans le Paris révolutionnaire.
- N’est-ce pas cependant une facilité que de cibler les directions syndicales comme seules responsables de l’atonie que connaît actuellement le mouvement social. On peut en effet constater d’une part que quand bien même elles désireraient, par exemple, être à l’initiative d’une grève générale, la tâche serait difficile compte tenu de la situation du salariat, de l’atomisation et du faible taux de syndicalisation, et que d’autre part, les « radicaux » sont eux aussi parfois en manque d’imagination (par exemple quand ils s’adressent aux seuls manifestants « déters », comme tu l’écris), et qu’ils font eux aussi face à des difficultés pour s’organiser de manière efficace dans la période actuelle …
- Je ne cible pas les directions syndicales comme « seules responsables de l’atonie que connaît le mouvement social ». Je me moque un peu, en passant, du représentant de FO 35, ce qui n’est pas la même chose. Et ce que tu dis de l’atomisation, du peu de syndicalisation me semble juste.
Nous sommes tous dans la même impasse. Militants syndicaux, radicaux, etc. Les frontières entre les différents mondes ne sont d’ailleurs pas toujours aussi claires que l’on voudrait bien le croire. Certains essayent d’organiser, aujourd’hui, à Rennes, la rencontre entre ces différentes composantes du mouvement social, de créer un espace où puissent être discutées des stratégies, des hypothèses politiques, etc. Cela me semble une très bonne chose.
Et si je me moque dans La mélancolie de la nasse de tel représentant syndical, de tel rituel radical, je n’oublie pas pour autant qui sont nos véritables ennemis.
Derrière les lignes de flics, il y a des donneurs et des donneuses d’ordre. Derrière les flics qui font le sale boulot, il y a des politiciens, des dirigeants d’entreprises, l’association des commerçants (aussi appelée le Carré rennais), des haut fonctionnaires bien propres sur eux. Patrick Strzoda qui a réprimé violemment, en tant que préfet, le mouvement social rennais de 2016, est aujourd’hui directeur du cabinet d’Emmanuel Macron.
Ces gens-là ont du sang sur les mains.
Il y a aussi un journal comme Ouest-France qui participe à cet endormissement général, à cet engourdissement… Ce journal a pour habitude de salir systématiquement, dans ses articles, tous ceux qui luttent et qui ne se soumettent pas à l’ordre en place.
Mais la collaboration avec les puissants est pour ce journal une vieille tradition familiale.
Toutes ces éminentes personnes savent très bien quel est leur intérêt et il est souvent, d’ailleurs, très crapuleux. Mais ils se drapent dans des grandes déclarations où il est question de « démocratie », de « liberté de la presse et du commerce », tout le charabia habituel qui ne dupe plus grand monde.
Mais ne répondre que « ACAB ! » me semble quand même un peu limité. Les donneurs d’ordre s’en arrangent facilement. Ils aimeraient bien qu’on pense que le problème se réduit à la police et au fait que ce sont des « bâtards », des gens violents et peu éduqués.
Or il y a aussi les donneurs d’ordre, et ceux-ci sont des gens bien élevés, qui aiment l’art, la culture... Non seulement ils aiment l’art et la culture mais ils les financent, ce qui est sans doute le meilleur moyen de contrôler les « mutins de panurge », pour reprendre l’expression de Philippe Muray.
- Comme nombre de manifestations rennaises, la manifestation qui fait basculer le récit ne peut pas accéder au centre ville, puis se termine dans une nasse. L’interdiction des manifestations dans le centre ville de Rennes, et le nassage des manifestants, sont désormais fréquents à Rennes. Alors qu’elle était l’une des villes motrices du mouvement contre la loi travail en 2016, tu écris que les manifestants rennais sont désormais relégués en deuxième division …
- Oui, l’interdiction des manifs dans l’hyper-centre est devenue la norme. L’une des causes est de toute évidence liée à la volonté municipale de transformer le centre-ville de Rennes et de le vider de toute conflictualité politique. Et quand les syndicats acceptent cet état de fait, se soumettent aux injonctions de la mairie et de la préfecture, organisent des manifs loin du centre-ville, comme ce fut le cas, par exemple, le 1er mai dernier, cela est très problématique. Et pour justifier ce renoncement, cette défaite, on va alors chercher les classes populaires et on affirme haut et fort que si on va manifester en périphérie, c’est pour aller au plus près de ceux qui souffrent le plus… Mais qui y croit vraiment ?
Concernant la métaphore sportive et la relégation en deuxième division, on peut dire qu’elle est la conséquence de la répression politique. Sartre dit quelque part que le foot est un sport relativement simple mais que tout est compliqué par l’équipe adverse. Il y a, en effet, un camp en face de nous. Il est organisé et stratège. Et il faut rappeler qu’à Rennes, le pouvoir a mis des moyens considérables pour liquider tout ce qui résiste et ne rentre pas dans le rang. La répression, après 2016, a frappé de plein fouet le milieu militant. Le « Vivre Ensemble » érigé en slogan municipal est aussi et peut-être d’abord une manière de conjurer le conflit politique.
- Ton récit est aussi une charge à l’encontre de la bourgeoisie rennaise, notamment les entrepreneurs culturels. Il semble que la politique menée par la municipalité du Parti Socialiste et d’Europe Écologie à Rennes prouve qu’on ne domine pas seulement une population par la répression, mais aussi en tentant de susciter l’adhésion et la participation à son propre encadrement …
- Comme je l’ai dit plus haut, j’ai l’impression qu’on reste trop concentré sur la question de la police et qu’on porte peu d’intérêt à d’autres acteurs de la domination. Ce qui me frappe aujourd’hui, c’est le rôle joué par la Kulture dans cette domination. Les artistes sont indispensables au pouvoir. Et la « gauche » (avec tous les guillemets d’usage) est sans aucun doute, dans sa manière d’enrégimenter à son service les artistes et les acteurs culturels, plus fine et plus intelligente que la droite traditionnelle. Pendant la dernière campagne municipale, la maire de Rennes, Nathalie Appéré, a répété qu’à Rennes il y avait dorénavant « un écosystème favorable aux entreprises culturelles ». La culture et l’art sont aujourd’hui des atouts dans la grande compétition des métropoles. Les bobos à l’aise financièrement, ces bobos que la ville souhaite attirer aiment l’art et la culture… Mais on peut se demander : quel art et quelle culture ? Un art et une culture totalement dépolitisés ? Un art et une culture du « Vivre ensemble » ? L’artiste en organisateur de grandes kermesses sympa où tout le monde est content et où tout le monde peut participer ? À Rennes, le monde de la culture, quand il s’agit de prendre parti, est aux abonnés absents. Et quand il prend la parole, c’est pour dire « Merci la ville de Rennes ! », qui le lui rend bien. Les militants peuvent se prendre des coups de matraque et de flashball, des jeunes gens se faire éborgner, le petit monde de la culture rennais regarde ailleurs. Tant que l’écosystème est favorable à la reproduction de son espèce et à ses « entreprises culturelles », pour ne pas dire ses petites affaires, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le plus drôle, c’est que certains de ces acteurs culturels se voient comme des artistes radicaux et subversifs… On a là une arrière-garde qui se pense toujours comme étant à la pointe. C’est le triomphe de « la subversion subventionnée » !
Maurice Druon, qui était ministre de la culture en 1973, a dit : « Les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile dans une main et un cocktail Molotov dans l’autre devront choisir. ». Voilà, ils ont choisi. C’est fait. Aujourd’hui ils ont la sébile dans une main et dans l’autre un chiffon pour cirer les pompes !
- La narration que tu fais de la manifestation et de l’émeute est celle d’une expérience sensible. Au-delà des nombreuses références à Rimbaud, tu cites aussi Le vertige de l’émeute, de Romain Huët. Tu te demandes, avec un peu d’humour, si La mélancolie de la nasse ne devrait pas en être la suite, et tu écris qu’il faudrait faire le récit de la nasse en tant que phénomène et expérience sensible. L’analyse de Romain Huët a été une inspiration pour toi ?
- Le vertige de l’émeute décrit bien cette expérience très particulière qu’est une émeute. Et il me semble que la nasse est précisément le contre-pied et parfois le contre-coup de ce vertige. Après le vertige de l’émeute, il y a parfois la retombée brutale, quand on s’aperçoit que l’on est nassé. L’émeute est le moment où tout semble possible, où la joie traverse les corps, où on a l’impression d’être comme ivre. Il y a, dans une émeute, une grande euphorie qui est très belle, même si mêlée de crainte et d’incertitude. Mais ce moment-là est du côté de la vie, de l’affirmation de la puissance. Et avec la nasse, c’est comme si tout s’arrêtait brutalement. Dès que l’on comprend que l’on est nassé, qu’il n’y pas de brèche possible dans le dispositif ennemi, que l’on n’est plus maître du temps, alors il y a comme une retombée... On n’est plus dans le mouvement, tendu vers ce qui va arriver et que l’on désire (même si l’on ne sait pas très bien ce que c’est) mais immobilisé, empêché, retenu... On n’est plus sur les cimes en proie au vertige mais tout en bas, dans une sorte de cloaque où l’on se retrouve à pisser entre deux voitures...
- Dans ton récit, l’expérience de la nasse est résumée par cet alexandrin : « Nous étions serrés les uns contre les autres. » Tu écris aussi que la nasse est une « métaphore de notre condition humaine ». Tu peux expliquer ?
- Disons que j’ai terminé ce court texte (le temps de lecture du livre est à peu de même longueur que cet article) au début du premier confinement. On l’a un peu oublié mais il y avait une lutte en cours avant le premier confinement, une lutte contre la réforme des retraites. À Rennes, dès que nous sortions dans la rue, dès que nous sortions du sentier balisé et autorisé par la préfecture, nous étions nassés. Et puis soudain, nous avons été obligés de rester chez nous… Tout s’est enchaîné. J’ai eu l’impression qu’une même logique était à l’œuvre et que les dimensions de la nasse s’étaient juste agrandies. Un peu comme si nous vivions tous dans le village baroque de la série Le Prisonnier. « Il faut faire quelque chose numéro 6 ! » Mais quoi ? Aujourd’hui numéro 6 refuserait très certainement d’être réduit à un QR Code. Nombreux sont ceux qui ont lu et relu La peste de Camus pendant le confinement. Je ne sais pas s’ils ont aussi visionné la série Le Prisonnier… Elle me semble assez visionnaire.
- Au sortir de la nasse, lorsqu’on te demande ton nom, tu déclares t’appeler « Camille Dupont », identité que plusieurs manifestants se sont attribuée dans la nasse. Suite à cela, tu es embarqué direction le commissariat. Le récit bascule alors dans l’absurde. Tel Bartleby, ton personnage déclare d’abord qu’il préférerait ne pas entrer dans le fourgon en raison de sa claustrophobie. Puis, une fois au poste de police, il répond très évasivement à chaque question, ne finit aucune de ses phrases, ne comprend aucune des demandes qui lui sont faites. Il déclare même ne pas savoir ce qu’est une manifestation, ou ne pas se souvenir de s’il est déjà passé devant un juge … Ton récit fait par exemple penser aux Les aventures du brave soldat Svejk de Jaroslav Hasek, ou à la manière dont un certain théâtre de l’absurde (par exemple celui de Vaclav Havel) a pu ridiculiser la bureaucratie et les polices politiques … Le recours à l’absurde était pour toi une façon de résister au pouvoir ? Ou de mettre en exergue l’absurdité de celui-ci ?
- Il faut raison garder. Ce court texte, ce n’est quand-même pas Le procès de Kafka ou Bartleby de Melville. Et nous ne sommes pas face aux bureaucraties des régimes politiques que tu évoques… Et c’est pour ça que je peux m’amuser, sans doute, de cette situation, dans ce commissariat de centre-ville. Dans d’autres pays (voire même dans certains quartiers), cela ne viendrait à l’idée de personne de jouer à l’idiot dans un commissariat car les risques que cela se termine très mal seraient infiniment plus grands. C’est vrai que je compare les locaux du commissariat de la Tour d’Auvergne à ceux de la Stasi, mais c’est exagéré, surtout si l’on songe aux dispositifs de surveillance qui étaient à l’œuvre en Allemagne de l’Est. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu’il n’y a pas dans ce pays la surveillance des opposants politiques et que la situation n’est pas en train d’évoluer très vite... Mais quand je « résiste », à ma manière, avec mes moyens, face à cette policière un peu âgée, je ne suis pas dans la situation de ceux et celles qui se sont opposés à des régimes bureaucratiques bien plus violents et plus répressifs… Mais c’est vrai que je fais la comparaison sur un mode comique. C’est peut-être une répétition : cela se produit d’abord sur un mode de farce, avant un mode plus tragique… À l’inverse de ce que dit Marx de la répétition historique.
- Quant le narrateur quitte le commissariat, tu écris que la policière semble soulagée. On se doute cependant que si tu avais été accusé d’un fait précis ta stratégie eût été moins payante …
- Je me suis permis d’adopter cette stratégie-là parce qu’il ne s’était, ce jour-là, précisément rien passé dans la manifestation, comme les jours précédents d’ailleurs. Du coup, qu’est-ce qu’on me reprochait ? De m’appeler Camille Dupont ? Cela ne fait pas un dossier très solide… Ce n’est pas l’affaire du siècle ! Ce texte est le récit d’une petite histoire qui m’est arrivée dans cette ville de Rennes, histoire que j’ai d’abord racontée de vive voix à mes amis et camarades, comme on fait le récit d’une manif ou d’une action, en fin de journée, dans un bar. Et puis ensuite, j’ai couché sur le papier cette histoire, pour d’autres amis... Et puis, avec les amis des éditions du Commun, on en a fait un petit livre... Cela fait beaucoup d’amis, mais il faut bien de temps en temps écrire des histoires (ou des textes théoriques) à ses amis, non ?
Bonnes feuilles
Et si j’ai aimé le bruit des coups de burin sur les distributeurs de billets, le chant des vitrines qui volent en éclats, les formes bizarres que dessinent les marteaux sur les devantures des agences immobilières, les coups de pied contre les vitres de ces entreprises qui vendent des immeubles moches de haut standing — aux noms de Riviera et de Central Park — si j’ai goûté à la poésie des débordements, aux spectacles des destructions de caméras de vidéosurveillance par des grimpeurs agiles, montant le long des gouttières ou des lampadaires pour péter ce qui transforme nos centres-villes en supermarchés sous surveillance, si j’ai de tout mon soûl applaudi à ces gestes qui nous sortaient de notre léthargie, il me semblait que j’étais devenu moins sensible, ces derniers temps, à la beauté de ces moments de grâce.
Certains de ces moments-là continuaient pourtant de vivre en moi leur existence autonome. Il m’arrivait, dans des sommeils agités, d’en rêver la nuit. L’un d’eux m’avait particulièrement marqué… Lors d’une manif sauvage et nocturne du printemps 2016, une Porsche avait été incendiée sur le parking situé sur les quais, en face de l’ancien cinéma Gaumont. Il me semblait n’avoir jamais vu de ma vie plus beau feu de camp. Est-ce que tout ce qui nous entravait ne pourrait pas ainsi partir en fumée et disparaître dans le néant pour toujours ? Alors que la manifestation avançait vite, je m’étais arrêté quelques secondes, ému, pour regarder la Porsche en train de cramer. C’était un sacrifice fait à la lune qui, cette nuit-là, si je me souviens bien, était pleine, lumineuse, là-haut dans un ciel sans nuage. Cette nuit magique ne pouvait être qu’une nuit de pleine lune. Alors que j’étais arrêté devant la Porsche en flammes, comme subjugué, hypnotisé, captif émeutier, un ami m’avait tiré par la manche pour que nous hâtions notre pas et rejoignions le reste de la manifestation qui se dirigeait vers le local du Parti socialiste. Il n’y avait pas une seconde à perdre. Les flics, bizarrement absents, pouvaient débarquer à tout moment. Mais nous étions vifs, rapides, comme ivres de ces semaines incandescentes de lutte intense. Nous n’avions pas besoin de Faucon Millenium pour filer à toute vitesse dans la nuit car nous flottions déjà au-dessus du sol. L’espace et le temps n’étaient plus pour nous des conditions de possibilité de nos courses enfiévrées. Rennes est magique. Quelqu’un l’avait tagué sur un mur. En quelques mots bien choisis, une main anonyme avait résumé notre état d’esprit.
Et puis, au fi l du temps, c’est comme si nous avions été réduits à quelques rituels dévitalisés que nous devions faire, par devoir, parce qu’il fallait bien manifester, parce qu’il fallait bien essayer de résister à l’ennemi qui gagnait partout du terrain et triomphait ici d’être parvenu à transformer la ville en un espace aseptisé, sécuritaire et lisse. J’étais fatigué et déprimé. Il me semblait que seuls nos ennemis pouvaient encore nous surprendre par leur volonté décuplée de nettoyer cette ville que nous avions tant aimée, de liquider tout ce qui ne rentrait pas dans le rang, tout ce qui ne se soumettait pas. Et pour ce faire, la Municipalité avait des réserves inépuisables. Elle avait, à son service, les forces de police, toujours fidèles au poste. Elle avait, à son service, des communicants qui masquaient sous des slogans débiles des réalités crues. Elle avait, à son service, des artistes domestiqués pour témoigner des largesses que leur accordait le pouvoir en échange de toutes 12 les compromissions, de toutes les danses du ventre devant les décideurs politiques. Ces apparatchiks ternes ne régnaient encore que parce que nous étions assoupis, somnambules, déambulants approbatifs, disant oui à tout ce qu’il y avait de plus niais et de plus faisandé ici-bas et qui trônait majestueusement à l’Hôtel de ville.
Un soir, des années plus tôt, les portes de la Mairie avaient presque cédé sous les coups des assaillants. L’Hôtel de Ville avait failli être envahi. Ce n’était pas un soir de printemps mais une nuit froide de l’hiver 20⒑ L’intrusion n’avait été empêchée que par l’intervention de quelques bacqueux, télescopique en main. Le matin même, il avait neigé. Je m’en souviens bien. J’étais au commissariat, avec des camarades, la main droite menottée au banc. Dehors, il neigeait. On pouvait voir, par la fenêtre du comico, la neige tomber à gros flocons. C’était très beau. Nous avions été délogés, quelques heures plus tôt, au petit matin, du squat ouvert pour organiser la lutte contre la réforme des retraites. Des flics casqués, matraque et bouclier en main, nous avaient fait monter dans des camions. Nous avions traversé la ville bouclés dans une de ces cellules individuelles de fourgon de police. Je n’avais encore jamais été enfermé dans un espace aussi exigu, aussi 13 fr oid et métallique. Malgré l’inconfort de la situation, je pouvais repenser à toutes ces journées merveilleuses que nous venions de vivre comme on traverse un rêve. Peu importe ce qui allait se passer par la suite, je savais que nos ennemis ne pourraient jamais nous enlever le souvenir de ce que nous avions vécu. Ils pouvaient, s’ils le voulaient, nous encager, nous étions vivants, plus vivants que jamais. Les feux de la révolte brûlaient dans la ville comme si cinq-mille chimpanzés avaient dynamité leur zoo. Mais ces feux qui à l’époque illuminaient nos nuits n’avaient-ils pas été depuis lors éteints au karcher ? Ainsi donc la pacification triompherait et elle aurait ce goût de cyanure… Du possible, du possible, sinon j’étouffe ! De l’imprévu, de l’imprévu, sinon je meurs !