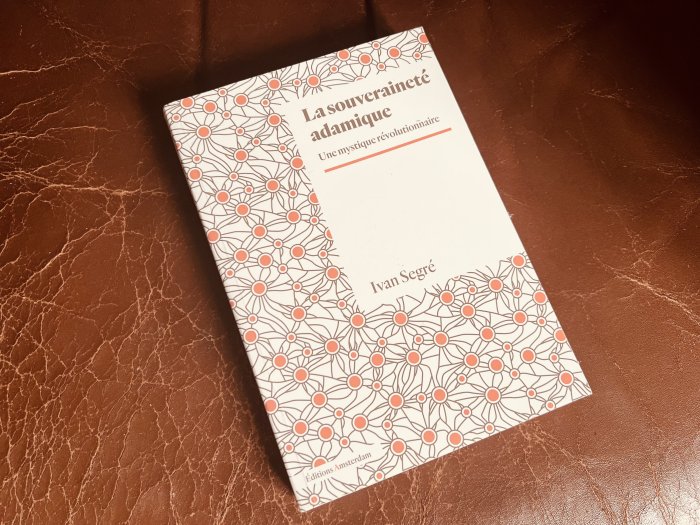- Julien Chanet : Commençons par le commencement, qu’est-ce qu’une anthropogonie, concept que vous mobilisez, et qu’est-ce qui fait, selon vous, que le texte de la Genèse est un texte bien plus subversif que nombres de lectures laissent à penser ?
- Ivan Segré : Une cosmogonie est un récit de la création du monde, ou du cosmos ; une anthropogonie est un récit de la création de l’humain, ou de l’anthropos. Ce que je montre dans les premiers chapitres de La Souveraineté adamique, c’est qu’en partant des mythologies du Proche-Orient antique, on s’aperçoit que l’anthropogonie hébraïque est d’abord une critique de l’anthropogonie babylonienne. Dans la tradition babylonienne, l’humain est créé afin de produire la subsistance des dieux ; dans la tradition monothéiste, dont les écrits sont postérieurs d’un millénaire et empruntent délibérément aux mythes babyloniens, l’humain est créé afin d’entrer en relation avec l’unique dieu créateur, afin de le sortir de sa solitude, en quelque sorte. C’est ce fil directeur que je m’évertue à dérouler, et dont j’explore en effet la dimension subversive, puisqu’elle saute aux yeux une fois mis en évidence ce point de départ.
- Vous relevez dans l’introduction que Marcel Gauchet, après bien d’autres, identifie une logique impériale dans le monothéisme hébraïque. Au contraire, selon vous, l’argument de la « fable hébraïque » est celui d’une libération, ou d’une « inservitude volontaire, d’une indocilité réfléchie » (dans les pas de Foucault). Vous soulignez cependant que la Bible, en vouant l’humain à prolonger le geste créateur du dieu, appelle à transformer le monde, et vous posez cette question : « comment prétendre transformer vraiment le monde, c’est-à-dire y graver l’empreinte de la forme humaine, sans être soi-même couronné de cette empreinte ? » Or, comment répondre à cette question en s’appuyant sur une « mystique révolutionnaire », ainsi que vous semblez le proposer ? Et comment s’assurer que la transformation du monde ne nous précipite pas toujours plus vers l’abîme (écologique, sociale, relationnelle, etc.) et l’hubris ?
- Par « mystique révolutionnaire », il faut entendre l’idée que la vocation de l’humain est d’entrer en relation avec le dieu, c’est-à-dire, en termes plus immédiatement accessibles, avec son prochain, et qu’en ce sens la relation éthique couronne la création du monde. Dans cette perspective, on posera que la dévastation, qu’elle soit écologique ou sociale, repose toujours, en dernière analyse, sur une perversion de cette vocation initiale. Et la forme originaire de cette perversion, c’est une humanité créée afin de produire la subsistance des dieux, c’est-à-dire une humanité soumise à la jouissance des dieux. Il est ainsi évident, à mes yeux, que « l’hubris » dont vous parlez, avec ses conséquences sociales et écologiques, procède non de la relation éthique, mais de la jouissance insatiable des dieux.
- Je poursuis cette question : il y a dans votre démarche analytique des textes une validation de l’approche cartésienne consistant à « se rendre comme maître et possesseur de la nature ». Vous avez récemment déclaré à propos de l’antispécisme, courant de pensée qui égalise les règnes humain et animal : « quiconque remet en question cette différence [entre l’humain et l’animal], je dirais, est à mes yeux très suspect. ». Pouvez-vous préciser ? Qu’est-ce qui est pour vous au fondement de la différence entre l’humain et l’animal et qui vous parait intangible ?
- Je cite dans l’introduction du livre un propos extrait d’une lettre d’Engels, dont on trouve le pendant dans l’Idéologie allemande, qui explique que la différence « capitale » entre l’homme et l’animal c’est que le premier produit ses conditions d’existence tandis que le second collecte sa subsistance. Et je m’inscris en faux contre cette affirmation, puisqu’il est évident que la différence entre l’humain et l’animal c’est l’émergence du langage articulé. L’être humain parle, l’animal, lui, ressent, s’exprime, etc., mais il ne parle pas. L’antispécisme, en ce sens, est le symptôme d’un mutisme essentiel.
- Peut-on faire un rapprochement avec le propos suivant de Jean Bottero ? : « ce que nous sommes aujourd’hui, il n’y a pas 10 000 ans que nous avons commencé de l’être. La première fois que l’homme a accédé à la pleine et haute civilisation et que, délaissant l’incertitude de l’existence au jour le jour, l’isolement des petits groupes, l’impuissance devant les éléments, et cette sorte d’animalité prolongée, il en est arrivé à l’organisation sociale et politique, au sens du devoir et du droit, à la domination de la nature, à la production calculée des biens utiles, à la mise en ordre intelligente des choses, c’est entre 4000 et 3000 avant notre ère, dans la Mésopotamie méridionale […] » (Naissance de Dieu).
- Le propos de Bottero que vous citez s’inscrit dans le droit de fil de celui d’Engels ; il considère que la rupture avec l’animalité se situe dans la révolution sociale apparue au néolithique, à l’aube de l’Histoire avec un grand H. Il faut donc réaffirmer que la différence essentielle réside dans l’émergence de la parole, que c’est à ce moment que nous avons commencé d’être ce que nous sommes, nous, humains. Reste qu’Engels, comme Bottéro, ont raison de pointer qu’avec la société de production, l’urbanisation, l’Etat, la hiérarchisation sociale, etc., une autre histoire commence, et toute la question, à mon sens, est d’œuvrer à ce que les développements de cette histoire néolithique procèdent de l’émergence de la parole et non de sa dénégation. Et c’est de ce biais que nous retrouvons donc Marx et Engels, car leur égalitarisme, au fond, vient de l’idée que chaque être humain est fondamentalement l’égal d’un autre en ce qu’ils sont tous deux des corps parlants, et que leur socialité doit en témoigner. La sauvagerie capitaliste, en regard, c’est un univers animal, celui de la concurrence impitoyable, de la lutte pour la survie.
- JC : Revenons maintenant sur les interprétations conservatrices du texte biblique. Je pense notamment à celle, canonique, de Leo Strauss, situant « Athènes » du côté de la rationalité critique, et « Jérusalem » du côté de la pieuse obéissance. En quoi votre lecture de la Bible, radicalement opposée à celle de Strauss, serait-elle plus légitime ? Est-ce qu’il en va ici de ce que vous appelez une « décision herméneutique » ?
- Strauss reprend à son compte une dichotomie qui ne vient pas de la Bible mais de l’histoire occidentale, puisque de fait, il n’est littéralement pas question d’Athènes dans la Bible hébraïque. Et si l’on s’en tient au corpus rabbinique le plus antique, le Talmud et le Midrash, Athènes n’y représente pas une forme de rationalité critique par différence ou opposition à une pieuse obéissance mais une forme d’impérialisme, ce qui correspond du reste à une réalité historique puisqu’Athènes apparaît dans l’histoire juive sous la forme d’Alexandre et des généraux grecs qui se partagent à sa mort ses conquêtes militaires. La lecture de Strauss a en fait pour point d’appui une certaine interprétation du judaïsme médiéval, et notamment de Maïmonide : il y a d’un côté l’approche grecque d’un cosmos éternel, de l’autre l’approche biblique d’une création du monde. Mon propre geste interprétatif ou herméneutique consiste à revenir à la Bible, où il n’est pas question d’opposer l’éternité grecque du monde à la création biblique du monde, mais d’opposer l’anthropogonie babylonienne à l’anthropogonie hébraïque. En ce sens, tandis que Strauss se focalise sur une certaine interprétation du judaïsme médiéval, je reviens à la Bible, puis de là je poursuis avec le Talmud, enfin avec la cabale médiévale, dont je m’emploie à montrer qu’elle prend son inspiration dans la Bible. Autrement dit, tandis que Strauss ignore l’argument initial de l’anthropogonie hébraïque, j’en fais pour ma part le fil directeur d’une analyse de certains écrits bibliques, talmudiques, midrashiques et cabalistiques.
- Afin de mettre au jour la dimension révolutionnaire de la Bible hébraïque, vous critiquez la critique biblique, celle portée par Römer ou Assman notamment. En quoi la critique biblique, comme domaine de recherche à l’intersection de l’archéologie, de l’histoire, de l’herméneutique, est-elle selon vous le relais d’une doctrine finalement conservatrice, ce qui semble paradoxal si l’on songe que la critique biblique a pour origine des penseurs comme Spinoza ?
- Dans La Souveraineté adamique, je pars des acquis de la critique biblique en termes d’approche philologique et méthodologique, mais je conteste en revanche ses interprétations. Car il y a d’une part les faits, d’autre part les interprétations. En termes de faits, il y a par exemple les proximités, parfois les correspondances littérales entre le texte biblique et tels écrits babyloniens qui précèdent l’écriture de la Bible, proximités qui vérifient donc la thèse d’un emprunt des scribes hébreux aux écrits babyloniens. En termes d’interprétation, il y a la question de savoir si les scribes hébreux sont idéologiquement soumis aux représentations mythologiques des babyloniens, ou si au contraire ils élaborent une critique de cette mythologie. Et ma thèse est que l’anthropogonie hébraïque est précisément une critique révolutionnaire de l’anthropogonie impériale des Babyloniens. Car suivant la Bible, j’y insiste, l’humain n’est pas créé pour produire la subsistance des dieux. Et c’est la portée révolutionnaire de l’anthropogonie hébraïque qui, selon moi, non seulement est restée inaperçue de la critique biblique depuis Spinoza, mais qui en outre a été occultée, voire refoulée par la critique biblique, laquelle ne veut voir dans la Bible qu’une compilation de mythes plus ou moins archaïques et tribaux. Et la raison de cet aveuglement est profonde. À mon sens, elle relève de l’idée que la lumière procède du christianisme d’une part, de la civilisation gréco-romaine d’autre part, le judaïsme étant une chose sinon obscure, du moins dépassée ou caduque. Je prétends qu’au contraire la pensée des antiques scribes hébreux est toujours contemporaine, à condition de savoir les lire.
- Il ne serait donc pas exagéré de dire que cette contemporanéité, ou cette modernité du judaïsme, qui est au cœur d’une partie de votre travail, est actuellement au mieux nié, au pire brocardé, y compris par ceux qui s’attachent à construire une société humaine libéré du joug impérial, que l’on peut comprendre ici en un sens très large : le combat contre la domination de l’homme sur l’homme. Les difficultés pour vous semblent nombreuses, entre les athéismes matérialistes rétifs à toutes références mystiques ou religieuses, l’ombrage de la philosophie grecque sur la pensée juive, les reliquats d’antijudaïsme chrétien et autre, l’hermétisme des sciences humaines … Voyez-vous néanmoins des ouvertures ?
- C’est une question à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Ce que je peux dire, c’est que mon parcours témoigne des nombreuses difficultés que vous évoquez, notamment mon parcours universitaire… Mais je me suis déjà exprimé à ce sujet, notamment dans LM, donc je ne vais pas y revenir ici. Disons simplement que dans la société dans laquelle nous vivons, les obstacles sont nombreux pour un esprit libre, et a fortiori quand il s’agit d’un esprit qui puise sa liberté dans la tradition juive.
- Revenons à votre livre. Vous montrez qu’au fond le récit polythéiste de la création de l’humain se perpétue depuis l’antique Babylone jusqu’aux « dieux » du capitalisme contemporain. Vous en tirez l’idée d’une analogie entre la critique qu’élaborent « les antiques scribes hébreux » et celle qu’élaborent des figures plus contemporaines telles que Marx, Engels ou Clastres. Pour faire vivre cet enseignement adamique de la relation éthique, peut-on dire que votre cœur balance entre les traditions communistes et anarchistes ?
- A vrai dire, j’essaie de déplier des enseignements fondamentaux de la tradition juive, mais en effet ma lecture est influencée sur un versant par les textes de Marx et Engels, sur un autre par des écrits davantage anarchisants, tels ceux de Clastres ou du comité invisible. Plutôt que mon cœur balance entre les uns et les autres, je dirai que j’emprunte ici et là de manière à éclairer les enjeux conceptuels contemporains des écrits de la tradition juive.
- Cette riche tradition vous mène, dans cet ouvrage, à aborder des usages de la numérologie hébraïque, la guematria (l’art de convertir les lettres en nombres et vice versa). Et vous soutenez que les décryptages cabalistiques relèvent de la pensée conceptuelle. Que dire à une personne dotée d’un esprit moderne, un esprit éduqué pour résister aux fallaces, qui, ouvrant un livre sur la kabbale, se dirait que cela n’a ni queue ni tête ?
- Eh bien je lui conseillerais, pour commencer, de lire mon livre !