- Alizé LJ : Dans ton livre L’invention de la mort : Essai sur le décès humain et les origines de la religion (Mexico : UNAM, 2021), tu montres que beaucoup d’animaux non humains possèdent une certaine conscience de la mort. Les individus des espèces sociales sont capables de se reconnaitre en l’autre et de se sentir affectés (négativement ou positivement). Tu expliques que ces comportements sont modelés par les relations sociales. Cependant, nous sommes la seule espèce qui ait développée des attitudes non seulement intentionnelles mais également systématiques autour du traitement funéraire du corps des défunts. Cela serait-il du à notre capacité à nous raconter des histoires par le langage ou par sa représentation – à notre intelligence narrative, le mythos des Grecs ?
- Roberto Martínez González : Je pense que ce que tu exposes est très juste. Dans une large mesure, l’apparition des langages structurés, comme celui que possède notre espèce, change tout. Évidemment, les animaux non humains possèdent une certaine forme de langage et on peut supposer, selon l’information que l’on peut obtenir à partir des restes paléontologiques, que les hominidés antérieurs à notre espèce étaient également dotés d’un certain langage. La grande différence, c’est que les langages articulés que l’on possède impliquent une certaine notion de temporalité, parce que le fait de ne pas pouvoir prononcer des mots de manière simultanée génère nécessairement un ordre. Donc effectivement, cela nous conduit à une certaine narrativité dans laquelle les choses s’ordonnent dans le temps. Et évidemment, le fait de pouvoir agencer dans le temps l’existence d’une société, c’est-à-dire de pouvoir placer les choses sur un axe temporel, nous amène à la production d’histoires et de mythes, qui sont un peu la même chose.
Mais la langue n’est pas le seul langage que nous possédions. En réalité, nous utilisons plusieurs langages de manière simultanée. Et si on veut remonter jusqu’à la Préhistoire, ou du moins au Pléistocène et au-delà, il est intéressant de noter que les premières preuves de langages que nous possédions, qui sont des langages picturaux, n’ont pas ce caractère narratif. Ça ne veut pas dire que des narrations n’aient pas existé mais les représentations que l’on possède dans ces expressions picturales sont, dans leur grande majorité, statiques et elles ne représentent pas des scènes. Elles fonctionnent plutôt selon un principe d’accumulation de l’information, comme s’il s’agissait d’exprimer beaucoup de sentiments de manière simultanée dans un espace donné plutôt que de raconter quelque chose en particulier. Il semble que la distribution dans l’espace soit plus importante que la succession dans le temps dans l’art rupestre pléistocène. Si on prend l’exemple de l’art rupestre de Chauvet, on peut noter qu’au cours d’une temporalité de plusieurs millénaires, des choses très similaires ont été peintes, comme si le temps ne s’était pas écoulé et qu’il s’agissait d’une accumulation dans l’espace plutôt que dans le temps.
À ce sujet, ce que disaient Deleuze et Guattari me parait intéressant ; que les nomades n’ont pas d’histoire, qu’ils ne possède qu’une géographie. Il semblerait que certains changements sociaux soient nécessaires pour que la permanence dans le temps ne prenne un sens, pour qu’on accorde plus d’importance au temps qu’à l’espace. Et je crois que ça a quelque chose à voir avec la territorialisation. Autrement dit, les sociétés qui sont plus mobiles ont une manière distincte de concevoir l’espace, pas vraiment comme des démarcations totalement définies mais comme des territoires qui se superposent les uns aux autres. Et en ce sens, l’espace est beaucoup plus important, parce que chaque point qui le constitue est doté d’une signification ; un lieu est l’endroit au sein duquel se font certaines choses dans un temps déterminé. Mais on parle ici de temps cyclique, pas de temps cumulatif proprement dit, c’est-à-dire pas exactement d’une construction de l’historicité.
Suivant cette perspective, je crois que le propre de notre espèce est de nous raconter des histoires mais le sens narratif est peut-être quelque chose qui est propre à certaines manières d’être en société. Il y a des sociétés qui existent aujourd’hui encore qui ont très peu de mythes comme, par exemple, certaines sociétés d’Asie, ou certains bouddhismes, au sein desquels vivre dans l’ici et maintenant a plus d’importance que de construire des récits à propos d’autres temps.
Donc je crois que dire des choses est bien le propre de notre espèce mais raconter des histoires est quelque chose qui est peut-être propre à un certain type de société. Le devenir historico-culturel est celui qui produit cette nécessité de narrer des histoires. Du moins c’est ce que je pense. Et c’est évidemment lié à certaines manières de penser la vie et la mort. Disons qu’il est difficile de concevoir que la narration d’histoires puisse avoir une importance quand la préoccupation est de se maintenir dans l’ici et maintenant. C’est quelque chose qui acquière de l’importance quand la notion de temps cumulatif apparait. C’est un peu comme la différence qu’établissait Lévi-Strauss entre les sociétés froides et les sociétés chaudes. Les sociétés chaudes sont celles qui sont guidées par le changement ; elles ont un intérêt à se présenter ou à se penser elles-mêmes comme étant en transformation permanente. Au contraire, les sociétés froides sont celles qui ont un intérêt à se penser comme immuables, où il n’existe rien de plus que, éventuellement, le temps de la création et le présent.
- Tu m’as fait penser à James C. Scott qui explique que « toute histoire et généalogie représente un positionnement stratégique vis-à-vis d’autres groupes » [1]. Les Lao, qui refusent la possibilité d’être liés à un récit sur leur passé, possèdent ainsi une marge de manœuvre illimitée et peuvent être plus autonomes dans la construction de leur identité.
Au Pléistocène apparaissent en même temps dans le registre archéologique les représentations picturales et les premières conduites rituelles, en l’occurrence les pratiques funéraires. Si elles sont des langages, elles sont donc des manières d’entrer en relation avec les membres de notre propre espèce et elle traduisent à la fois la manière d’être en relation avec notre milieu. Il me semble que la religion, ou la philosophie, représentent également des manières d’être en lien. Tu écris d’ailleurs « ce qui parait avoir été le détonateur de la religiosité n’a pas été la découverte de la mort, en tant que phénomène naturel, mais l’invention des morts, en tant qu’entités persistantes et liées à l’identité du groupe (p. 28) et tu définis la religion ici comme « un système de pratiques et de croyances qui permettent aux membres d’une société d’agir de manière symbolique sur leur environnement social et naturel » (p. 17).
- Je suis complètement d’accord avec James C. Scott. Je suis convaincu que, effectivement, toute narration est un positionnement face à une certaine altérité. La narration se construit par rapport à autrui. La religion a à voir avec ça. La racine de religion est religare et renvoie à la construction de liens avec un environnement donné et un collectif donné, et à la différentiation vis-à-vis d’un autre. Ceci fait peut-être écho, justement, à ces sociétés qui semblent avoir peu de narrations, peu de mythes, qui préfèrent ne pas se situer de manière si déterminée dans le temps, et pour lesquelles la place dans l’espace est plus importante.
Ce que tu dis est juste ; il est intéressant de noter que les manifestations mortuaires et l’art apparaissent de manière simultanée en contexte archéologique. Ce qu’on peut cependant remarquer c’est que, bien qu’elles soient simultanées, elles ne coexistent pas nécessairement. Il y a donc des lieux dans lesquels apparaissent des styles artistiques bien définis mais où on n’identifie pas de dépôts funéraires clairs. Au contraire, il existe des zones dans lesquelles il se passe un peu l’inverse : il n’y a presque pas d’art rupestre, ou bien il n’y a pas de style vraiment identifiable, mais on trouve d’importantes concentrations de morts.
Je crois qu’au final l’art comme les dépôts funéraires ont une caractéristique commune qui est qu’ils constituent tous deux des marques dans l’espace. En fin de compte, ils représentent chacun des manières de construire des paysages à partir des espaces occupés, de leur donner une identité différente de celle qu’ils possédaient à l’origine, ou bien de la renforcer, ou de la reconstruire. En ce sens, je crois qu’ils sont intéressants parce que, dans les deux cas, ils génèrent une historicité. Dans la mesure où l’on reconnait qu’une manifestation est le produit d’une action qui s’est réalisée dans le passé, ça donne une profondeur temporelle à l’existence d’un groupe donné. L’art et les pratiques funéraires rendent donc compte d’un certain aspect de la vie sociale.
- Cela signifie-t-il que ce que tu appelles la « socialisation des morts » est quelque chose d’exclusivement humain, voire même ce qui nous rend humains ? Ou bien ce processus est-il toujours lié à un certain type de société, peut-être celles qui voient le temps comme une succession, étant donné que la succession implique les idées d’origine et de fin ? Et ceci pourrait-il expliquer la raison pour laquelle l’adoption de conduites rituelles n’est pas graduelle au cours de l’histoire humaine, ni automatique – je veux dire par là que ce n’est pas le fait de naître humain qui le permet, en tout cas pas nécessairement, mais que ça dépend plutôt d’une certaine conception de l’existence.
- Je crois qu’au final ce qui nous rend humains, ce qui nous distingue des animaux non humains, c’est le fait de recourir à la mort pour construire des aspects identitaires. En ce sens, il est tout aussi humain de rejeter les morts, de les extraire hors de notre identité comme s’il s’agissait de quelque chose qui perturbait la construction de notre image en tant que société, que de les recycler et de construire des temporalités cycliques au sein desquelles on s’efforce de répéter que nous sommes les mêmes que nos ancêtres, de la même manière qu’il est tout aussi humain de les maintenir au sein de la société et, disons, d’en faire des participants permanents de la vie sociale. Tout ça représente, à mon avis, des formes d’existence sociale différentes. Ce que ces pratiques ont en commun, d’une certaine manière, c’est que l’on utilise les morts pour la construction identitaire, et ça, les animaux non humains ne le font pas. Pour leur part, ils maintiennent une petite socialisation avec les morts, que démontrent des attitudes comme celles de « deuil » – il s’agit de réponses qui peuvent durer quelques minutes, des heures ou plusieurs jours. Mais il n’existe aucune stratégie qui résulterait d’un véritable cheminement faisant usage de ces morts pour construire leur identité. Je crois que c’est ce qui constitue la différence : les animaux non humains dans la nature tendent à vivre dans un présent permanent parce que les morts ne font plus partie de leur société. Chez les humains, il existe des sociétés qui décident de vivre dans ce présent permanent mais, pour vivre dans ce présent permanent, il faut qu’il y ait une gestion des morts qui les installe à la marge de la société.
- Les sociétés organisées sous la forme d’États industriels ont donc besoin de la non-existence de leurs morts pour exister, ou pour construire leur identité. Tu écris « nos données suggèrent que lorsque les liens entre les personnes et les collectifs sont faibles ou fluides, une société ne requière tout simplement pas l’existence de ses morts pour exister. » Si on prenait ta proposition à l’envers, pourrait-on dire que le soin envers les morts est l’un des éléments qui permet la cohésion sociale ? Par opposition avec l’orientation présentiste moderne, pourrait-on considérer que le soin apporté aux morts est corrélatif d’une importance plus grande accordée au passé ?
- Je crois que ce que tu dis est tout à fait exact. C’est l’idée que je tente de défendre dans mon livre. Effectivement, la société moderne, urbaine, capitaliste nécessite ne pas avoir de morts pour exister de cette manière. Je crois qu’il y a cette idée, prégnante, de vivre dans un présent éternel et que les morts la perturbe. Les seuls morts qu’on honore sont des morts abstraits que personne n’a connu – je pense ici aux héros nationaux. On s’obstine comme beaucoup d’autres sociétés de cueilleurs à n’avoir que deux temps : le temps mythique de la création et le temps actuel, ou du moins celui que nous considérons comme relever de l’actualité. Une autre de nos caractéristiques est que nous avons perdu la possibilité de marquer le territoire de manière plus significative. Évidement, nous avons des limites nationales bien définies et autres mais dans quelle mesure le territoire est-il doté de sens pour les personnes et pour les groupes sociaux au-delà de cette notion très abstraite de nation ?
En réalité, en tant qu’individus, nous possédons peu de possibilités de marquer le territoire, de construire du sens à partir de celui-ci. Il y a des éléments comme le graffiti par exemple qui constituent des marques dans le territoire mais, en général, il s’agit de groupes qui se maintiennent dans l’anonymat et qui ne peuvent se reconnaître qu’entre eux. De plus, une bonne partie de leur production est clandestine. Nous formons des sociétés au sein desquelles nous sommes faiblement unis et donc nous produisons des marques dans le territoire qui sont peu significatives. C’est également vrai pour les cimetières. Dans le passé, on trouvait les cimetières au centre des villes – ce que Philippe Ariès a dit à de nombreuses reprises. Par contraste, les cimetières contemporains se trouvent à l’extérieur et plus ils sont récents moins ils sont porteurs de sens. Autrement dit, ils se résument de plus en plus à un alignement de pierres tombales lisses qui ne signifient pas grand chose. Et, en plus, ils sont peu visités. En fin de compte, ce sont des espaces très marginaux.
Il semblerait que tout ce qui a du sens pour les groupes au sein desquels les gens se connaissent réellement tende à se dissiper. À la place, on trouve les symboles actuels qui, en réalité, ne recouvrent aucun sens en dehors du niveau très abstrait qu’incarne par exemple les monuments historiques. Combien de Français se sentent-ils émotionnellement touchés par des choses comme la prise de la Bastille et combien de Mexicains se sentent-ils émotionnellement concernés par des choses comme la guerre d’Indépendance ? Il s’agit d’événements très éloignés dans le temps et qui renvoient plus à des temporalités mythiques qu’à un temps vécu. Et effectivement, c’est bien là la stratégie : ne plus penser à nos morts et ne plus être en relation avec eux pour laisser la place à des morts totalement abstraits avec lesquels personne n’est réellement lié.
- Par ailleurs, il est intéressant d’observer comment cette volonté de rester dans un présent éternel et l’absence apparente de religion laisse place à une volonté de devenir physiquement immortels. C’est le chemin logique. Et, en fait, ce n’est pas tant qu’il y ait une absence réelle de religion mais plutôt que la pensée scientiste n’est plus comprise comme une croyance, bien que je pense de mon côté qu’elle en soit bien une – au sens où il s’agit d’une certaine manière, d’une manière toute aussi ritualisée, d’être en relation avec ce qui nous entoure.
Et lorsque la vie n’est pas comprise comme un devenir ancêtre, ou une manière de relier notre propre existence à tous les liens et à toute la mort (devenir compost) qui nous a permis d’exister, se développe un désir d’aller sur Mars. Le rejet du corps mortel-terrestre laisse place à un désir de le marStyriser.
- Je suis complètement d’accord avec toi.
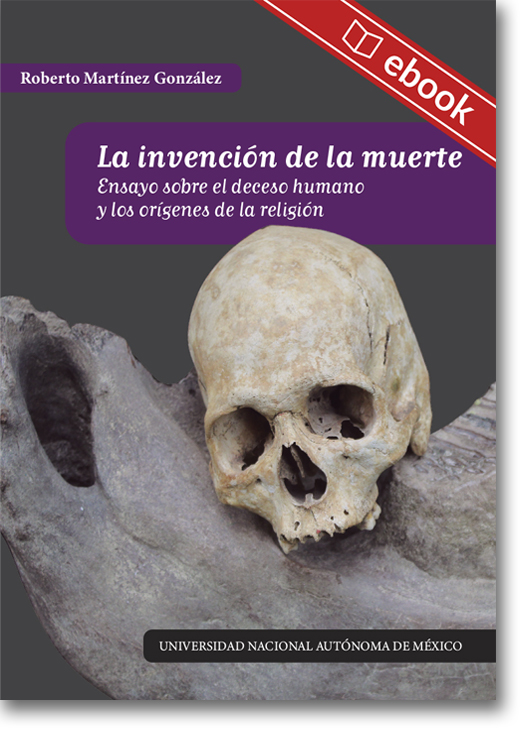
Illustration : Banksy, “Cave Painting Removal” (Leake Street Tunnel, Londres, 2008)






