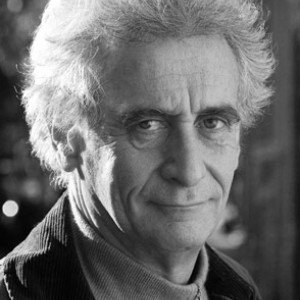Que ce soit dans Lumières d’exil, qui raconte Germaine Krull (1897-1987), photographe révolutionnaire, ou dans Sylvia Pankhurst, sur la peintre révolutionnaire (1882-1960) critiquée par Lénine pour son gauchisme, elle fait sentir sans cesse le lien intime qu’elle noue avec sa personnage tout en recourant au stratagème qui est à la base de tout l’art du roman : se mettre à la place de l’autre. Avec son Kate Millet, pour une révolution queer et pacifiste(Libertalia), elle porte cet art-là à des intensités qui brouillent définitivement les frontières : si c’est bien une « biographie romancée », la part de roman (et même de romance) que comporte cette narration ultradocumentée ne fait qu’y apporter un surcroit de vérité. Les documents, comme l’atteste la bibliographie finale, ce sont des interviewes, des ouvrages nombreux, mais aussi principalement les livres de Kate Millet elle-même, qu’elle évoque sans pouvoir les citer car, comme Dumas nous l’apprend au détour d’un paragraphe : « citer abondamment une autrice américaine dont les livres ne sont pas encore dans le domaine public, comme je l’avais fait dans un premier jet, coûte un paquet de dollars ». Mais ainsi qu’on pourra le vérifier à la lecture, cette contrainte est créatrice.

En nous racontant la vie et l’oeuvre de Kate Millet, romancière, essayiste, cinéaste, plasticienne et l’une des mères fondatrices de la deuxième vague féministe mondiale, Dumas nous la rend si profondément proche qu’on a le sentiment d’avoir affaire à une camarade. De la vie de cette rejetone d’une bourgeoisie américaine confite en conformisme, on ressent le déchirement qui l’accompagnera jusqu’à la fin, entre son attachement à une famille cultivée et aimante, et l’insurmontable esprit patriarcal - en l’occurrence principalement porté par des femmes qui rejettent ce ludion lubrique « lesbienne, sculptrice inconnue, virée de la fac, autrice de livres pleins de scènes de cul, et dingue » au point de réussir à la faire interner plusieurs fois, et jusqu’en Irlande où elle était allée porter sa solidarité aux femmes de la prison d’Armagh. Car si Millet nous est si proche, c’est aussi par son refus de se cantonner à un seul combat, et son rejet de toute forme d’assignation, y compris celle que voudraient lui imposer certaines sœurs féministes, à elle qui aime les femmes mais vivra une grande partie de sa vie avec un homme, un artiste japonais bien-aimé. Il n’est sans doute pas indifférent que les deux fois où on l’a mise de force en h.p., ce fut quand elle défendit de manière que certains trouvèrent sans doute trop exaltée des détenus, l’un de Trinidad et Tobago promis à la pendaison, les autres, femmes irlandaises contraintes à couvrir en forme de protestation les murs de leurs cellules du sang de leurs menstrues.
Lire ce livre, c’est aussi revivre les années 70, une époque née avec tant de groupes aux noms réjouissants : New York Radical Women, Youth International Party, White Panther Party, Radical Lesbians, et notre préféré, Women’s International Conspiracy from Hell (Conspiration internationale des femmes venues de l’enfer) : WITCH (sorcière). C’est revivre le 8 mars 79 en Iran, au lendemain de la révolution populaire qui avait renversé le Shah, quand le voile noir de l’intégrisme n’était pas encore définitivement tombé sur les femme et qu’elles avaient pu encore partir à quelques milliers, en manif sauvage pour exiger leurs droits, avec parmi elles Millet qui se ferait expulser. C’est revivre à New York ou Poughkeepsie l’exaltation de ces femmes et de ces hommes qui, pour fabriquer leurs œuvres d’art aussi bien que pour bâtir un domaine d’accueil pour femmes artistes sciaient, coupaient, collaient, peignaient – on scie et on colle beaucoup dans ce récit. C’est revivre le moment où Millet découvre le réel complexe de la vie des prostituées et le retranscrit sans moralisme, en restituant la langue dans laquelle il est raconté.
Revivre tout cela, en fait, dans l’époque si sombre que nous traversons, c’est revivre.
S.Q.
Extraits
Puis, après Oxford et Greensboro, Kate Millett est de nouveau sans argent à New York. Sa mère l’aide. Elle enseigne dans une école maternelle, part au Japon, enseigne dans une fac japonaise, rentre, se retrouve dans la mouise. Travaille comme employée au classement chez Olsen. Au mois d’août, Fumio Yoshimura peint des Pères Noël qu’on prépare déjà en prévision des fêtes. Pour un dollar soixante-quinze de l’heure. Il travaille dans les sweatshops où l’on fabrique des décors de vitrines. Parce qu’il est ce que la famille de Kate Millett appelait un « jap » avant de le connaître, donc un non-Blanc, il est exploité comme le sont la plupart du temps ceux qui viennent d’ailleurs. Et cela aussi la met en rage.
Puis Millett se voit proposer un poste au Barnard College, l’une des Seven Sisters affiliée à Columbia. Après les réunions de professeurs, elle retrouve quelques collègues au West End Bar. Elles boivent. Laissent tomber les masques de jeunes enseignantes devant se tirer dans les pattes pour réussir, défont leurs cheveux attachés, déboutonnent le col de leur chemisier. Cessent de rivaliser afin d’occuper une place plus intéressante et mieux payée. Trouvent parfois une réelle complicité et décident alors de finir la soirée ensemble à la Bowery.Y rejoignent Fumio. Ils sont quatre ou cinq dans le loft, elles boivent encore avec lui, ils parlent, ils rient, partagent entre eux une moitié de poulet. Et parfois elles préfèrent Chinatown. Devant une soupe aux raviolis échangent leurs rêves et se défoulent de leur peur de l’avenir. Dans l’atmosphère chaleureuse de l’alcool, se sentent de plus en plus proches les unes des autres, embarquées dans la même galère. Mais le chacun pour soi revient dès le lendemain en salle des professeurs.
Pour pouvoir continuer à enseigner en fac, Kate Millett doit maintenant passer une thèse. Tout en commençant ses recherches, elle continue à créer des sculptures. Elle utilise toujours des objets trouvés dans la rue, mais travaille de plus en plus les matériaux elle-même. Découpe et taille. Creuse désormais dans son travail artistique la notion de couple à travers la métaphore de l’espace domestique et plus précisément de son ameublement. Et elle s’amuse. Elle installe l’une à côté de l’autre et dos tourné, c’est-à-dire regardant dans des directions opposées, deux silhouettes identiques et sans sexe défini dont elle a sculpté la tête et les jambes dans le bois et recouvert le torse et les cuisses de toile à matelas évoquant l’idée de lit. Elle intitule cet assemblage Love Seat. Siège d’amour. Ce qu’on appelle en français une causeuse. Dos tourné, chacun regardant dans une direction opposée, façon étrange de se parler ou de s’aimer. On peut se parler et s’aimer tant qu’on veut, on peut finir par se ressembler à force de vivre ensemble, la solitude n’en reste pas moins constitutive de notre être. Kate, dit Eleanor Pam, a toujours été d’une grande solitude intérieure.
Même quand les fêtes se succédaient. Dans l’atelier elle continue cependant de s’amuser. La notion de jeu est chez elle fondamentale. Au point que même en rédigeant une thèse de plus de quatre cents pages une fois imprimée, elle s’amusera, choisira les mots et sculptera les phrases avec humour, puis assemblera paragraphes, chapitres et parties comme si elle avait à la main des ciseaux à bois, de la colle et des clous.
Elle est dans l’atelier. Elle scie de l’aggloméré. Dans deux des panneaux sciés, découpe une ouverture. Construit deux boîtes avec les morceaux sciés. Construit deux petits tiroirs. Accole les deux boîtes. Place les tiroirs dans les ouvertures. Peint des carrés bleus et des carrés blancs autour des tiroirs. Remplit les tiroirs de billes bleues et de billes blanches. Pose sur le dessus du meuble un porte-chapeau en bois surmonté d’une marotte de modiste en forme de tête. Y creuse et y peint deux yeux bleus. Les billes évoquent l’enfance et le jeu. Elles évoquent aussi la folie. En français, on perd la boule. En anglais, on perd ses billes. Et des yeux vous surveillent.
Elle est dans l’atelier, elle découpe et elle taille. Elle est à son bureau, elle lit, elle prend des notes, dresse une bibliographie. Elle a un poste à Barnard, elle milite, elle vit avec Fumio Yoshimura, ils ont des amis, ils sortent avec ou sans eux, dînent avec ou sans eux dans le loft de la Bowery, parlent, boivent, ils sont heureux, elle paraît apaisée. Sa famille a accepté Fumio. Qu’il soit un amant et non un mari n’est pas grave, enfin Kate aime un homme, tout le monde est rassuré. Et tous mettent leur racisme en veilleuse. Mother Millett adore Fumio. Et lui l’a adoptée immédiatement, il se conduit envers elle en digne fils japonais, l’aide le matin à préparer le petit- déjeuner, lui masse les pieds le soir. Quand ils sont à Saint Paul, Fumio s’initie aux traditions familiales, bourbon, pêche sous la glace et jus d’orange le matin.
La souffrance indéfinie qu’Eleanor Pam sentait autrefois chez son amie continuellement sous- jacente, comme si elle avait porté sa peau sens dessus dessous, semble avoir disparu. Semble. Paraît. Donne l’impression de. Elle est mariée, elle aime son mari, elle enseigne à l’université, elle ne couche plus avec des femmes. Mais les matins de congé Kate Millett reste au lit. Elle rêve. Se permet de fantasmer à propos d’une élève, sachant que jamais elle ne passera à l’acte et soupçonnant en même temps ce refoulement de ne servir à rien, voire de lui nuire, de brûler une énergie qui dans l’atelier serait mieux utilisée.
En 1966, Kate Millett lit dans un magazine un article qui va changer ce sur quoi elle écrit, ce dont elle parle dans ses sculptures, ce contre quoi elle se bat. Elle lit, et tout au fond d’elle, quelque chose coince, cogne, grince, se déchire. Quelque chose qui n’a apparemment rien à voir avec sa vie personnelle. Qui vient de l’extérieur, de ce qu’une autre a vécu. Une autre qu’elle ne connaît pas. De ce que d’autres ont fait. D’autres qu’elle ne connaît pas.
Le 26 octobre 1965 à Indianapolis, en Indiana, le corps décharné d’une jeune fille de seize ans nommée Sylvia Likens a été découvert dans une chambre située à l’arrière de la maison de Gertrude Baniszewski, dans NewYork Street. Son cadavre était couvert d’ecchymoses. Les mots « Je suis une prostituée et fière de l’être » étaient gravés sur son abdomen. Ses parents l’avaient mise en pension avec sa sœur cadette Jenny Likens chez Gertrude Baniszewski au mois de juillet. Les sévices infligés à Sylvia tout l’été sont devenus de plus en plus violents, allant jusqu’à faire d’elle pendant les dernières semaines de sa vie une prisonnière, enfermée dans la cave de Gertrude Baniszewski.
Kate Millett lit cet article un an après les faits. Lors du procès. Celui de Gertrude Baniszewski, de deux de ses enfants et de deux jeunes garçons du quartier. Tous accusés de meurtre. Gertrude Baniszewski de meurtre au premier degré, avec tortures et intention de donner la mort, les autres de meurtre au deuxième degré, coups et blessures ayant entraîné la mort. Une bande d’adolescents emportés par leurs pulsions sadiques sous la hou- lette d’une adulte à qui son avocat trouve pour seule excuse un léger dérangement là-haut, dit-il en se tapotant le front.
Le travail à venir de Kate Millett découle en majeure partie de la lecture de cet article, de ce que symbolise pour elle l’horrible fait-divers. Et ce que symbolise pour elle l’horrible fait-divers a à voir avec sa vie personnelle. Avec ce qu’elle appelle le cauchemar de grandir fille, de devenir femme.
(…)
À l’automne, Carol Hanisch, Shulamith Firestone, Robin Morgan et Pam Allen créent les New York Radical Women que rejoint Kate Millett. Toutes ont participé d’une manière ou d’une autre aux mouvements pour les droits civiques, pour la liberté de parole, contre la guerre du Vietnam. Et toutes en ont assez de jouer les subalternes. Mais les revendications de NOW leur paraissent trop limitées, elles s’en démarquent à la fois par leur ton et leurs propositions. « Nous définissons les intérêts des femmes comme ceux de la plus pauvre d’entre elles, la plus insultée, la plus méprisée, la plus maltraitée... Elle est nous toutes : laide, bête (étonnamment idiote, grosse conne), mégère, harpie, putain, machine à baiser et procréer, mère de nous tous. Tant qu’elle ne sera pas libre, aucune d’entre nous ne le sera », écrivent-elles dans leur déclaration de principes.
(…)
New York City, 220 East 60th Street, 15 octobre 1968. Quelques membres de NOW se réunissent pour essayer de résoudre le problème des dissensions intérieures. Betty Friedan déclare : Je veux placer les femmes dans des positions de pouvoir. Ti-Grace Atkinson, qui milite à NOW depuis février 1967, pense plutôt qu’il faut détruire les positions de pou- voir. Pour elle, la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes exige que l’on combatte contre tous les rapports de pouvoir, hommes/femmes, hommes/hommes, femmes/femmes, Blancs/Noirs, riches/pauvres. Les deux positions sont irrécon- ciliables. Présidente de la section new-yorkaise, Ti-Grace Atkinson démissionne. Je me rends compte, écrit-elle, qu’en occupant ce poste, je parti- cipe à l’oppression. On ne peut pas détruire l’oppression en occupant la place de l’oppresseur.
(…)
Et avoir dit oui, je suis lesbienne, elle que la notion d’identité sexuelle désempare, et qui, peut-être parce qu’elle est écrivaine et attachée aux mots, se demande pourquoi il en existe tant, lesbienne, homo, queer, gouine, gousse, goudou, pour catégoriser les unes et si peu pour les autres, les « normales », les hétéros, lui vaut d’être rejetée, par une grande partie des féministes, mais aussi par sa famille.
(…)
La conversation prend un tour étrange. Il s’agit de livres à écrire à propos de politique. Et plus exactement à propos de ce que vivent les gens qui veulent réaliser le changement. Millett soutient qu’il faut le raconter. Raconter les luttes telles qu’on les connaît de l’intérieur, afin de contrebalancer les discours restrictifs et fabriqués des médias. C’est en fait un des projets de livre auxquels elle a renoncé, d’abord par peur d’affronter ce qui a été si douloureux pour elle, puis par dégoût de ce qui lui a été imposé. Mais elle n’évoque pas ce projet devant ses amis, elle parle à mots couverts. Midge MacKenzie hoche la tête. Ses cheveux orange balayent ses épaules. Elle hausse les sourcils, lève ses yeux verts au ciel, agite une main couverte de bagues, ses bracelets tintent. Elle interrompt Millett. Vouloir avoir une démarche politique et dire la vérité lui semble contradictoire, c’est le moins qu’on puisse dire. La politique, voyons, repose sur les croyances fabriquées par le pouvoir et les médias qui les servent. Millett voit derrière le sarcasme de son amie un défi à relever. Avec le film elle a achevé quelque chose. Il lui reste à honorer le contrat signé chez Doubleday. Un livre à écrire. Sur la vérité de ce que vivent celles et ceux qui veulent le changement. Ce qui sera forcément sa vérité. La vérité d’elle-même parmi les autres. Un travail long et difficile l’obligeant à tout dire.
(…)
Parallèle au mouvement d’art féministe se développe alors en Californie un mouvement d’art ethnique, dont la Chicana Judith Baca est une des représentant les plus connues, pour ses immenses œuvres murales, telles que Uprising of the Mujeres qui met en scène, dit-elle, de féroces Indiennes. Les deux mouvements sont différents, mais il existe un parallèle incontestable entre eux : la lutte contre la domination. Le Centre de ressources de l’art public et social, raconte Judith Baca, menait son travail sur l’ethnicité dans un autre quartier que celui du Woman’s Building. Nous faisions des allers-retours entre les deux, cela nous enrichissait toutes. Nous nous respections mutuellement. Car comme l’a dit ensuite Gloria Steinem, si le féminisme est qualifié de blanc, ce n’est pas du féminisme. Ou bien le féminisme inclut toutes les femmes ou bien ce n’est pas du féminisme. Les Africaines-Américaines ont participé en masse à l’invention du féminisme et en le qualifiant de blanc on efface des centaines et des centaines de gens dont nous avons tant appris. Il est impérieux de démontrer la fausseté d’un argument souvent utilisé pour décrédibiliser les féministes accusées de toutes appartenir à la classe moyenne blanche, une expression reprise à l’envi par les médias de l’époque (et certains universitaires actuels qui se basent sur les articles de presse). Et à Houston en 1977, la Conférence nationale des femmes rassemble deux mille déléguées américaines et dix-huit mille observatrices et observateurs venus d’Amérique et d’ailleurs. C’est l’occasion pour les représentantes des minorités américaines – Asiatiques, Hispaniques (en majorité Chicanas et Portoricaines), Africaines-Américaines, Amérindiennes et Alaskiennes autochtones – de se rencontrer et de mettre au point un programme commun.