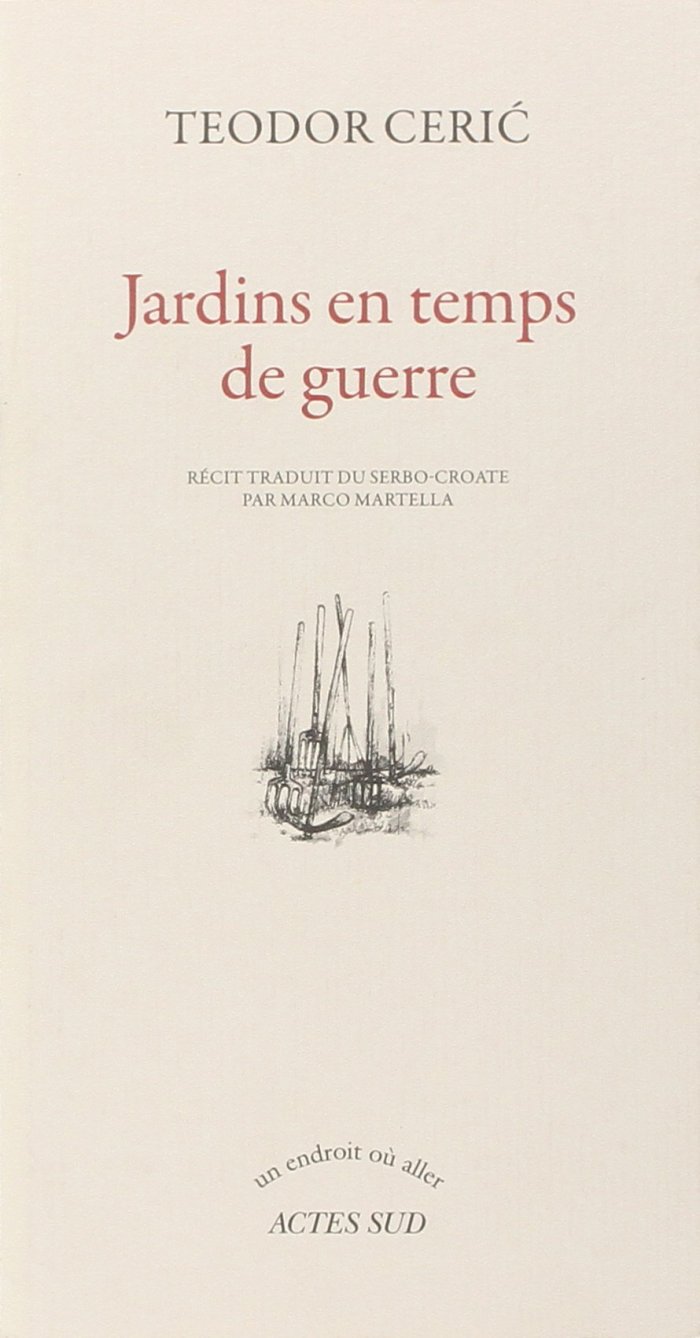
Teodor Cerić incarne à la perfection et en toute discrétion l’une des figures les plus improbables qui soient de l’auteur et du poète : quittant en 1992 Sarajevo assiégée, sous les feux de l’artillerie, il arpente l’Europe en réfugié presque vagabond, de petit boulot en petit boulot, dont émerge sous l’effet du hasard celui de jardinier. Rentré à Sarajevo en 1998 après la « paix de Dayton », il s’installe dans une modeste maison à quelques dizaines de kilomètres de la métropole bosnienne, où il – littéralement – cultive son jardin, publiant un unique recueil remarqué en 2003 pour retomber aussitôt dans un mutisme volontaire, silence dont il n’émerge que le temps de quelques articles poétiques pour la confidentielle revue Jardins, dirigée par Marco Martella aux éditions du Sandre. C’est celui-ci, par ailleurs traducteur du serbo-croate, qui, convainquant l’auteur de fournir quelques tenons et mortaises, a provoqué l’assemblage que vous pouvez lire depuis 2014 sous le titre « Jardins en temps de guerre », dans la belle collection Un endroit où aller d’Actes Sud.
Ainsi, un matin de printemps, je me décidai. Je me rendis à Victoria Station et pris un train pour le Kent. Qu’allais-je trouver là-bas ? Et qu’était devenu ce jardin maintenant que son jardinier avait disparu ? Un simple lieu de mémoire ? Un monument funéraire ?
Ah non, Prospect Cottage était tout sauf cela.
Le jardin débordait de vie, et la mort y était partout présente.
En 130 pages placées sous le signe, en exergue, de Derek Jarman, le célèbre cinéaste britannique qui passa les huit dernières années de sa vie, aux prises avec le VIH qui devait l’emporter en 1994, à construire de toutes pièces un singulier jardin dans la rocaille, Teodor Cerić évoque ainsi pour nous, en sus de l’emblème qu’est de facto Prospect Cottage, la grotte crétoise devenue forêt dédiée aux nymphes du musicien grec protestataire Anatólios Smith, réputé être revenu « plus ou moins fou » des séances de torture de la dictature des colonels, le secret jardin romain, et même tarpéien, de Monte Caprino, et son évolution hygiéniste et ambiguë, le jardin pavillonnaire de Samuel Beckett, à Ussy-sur-Marne, au fin fond du « 77 », le parc de Painshill, dans le Surrey, avec la curieuse histoire de Tom Page, « ermite officiel » du parc (ce fut un temps à la mode en Angleterre, au XVIIIe siècle, pour les riches propriétaires de parc, que d’y installer un vrai)faux ermite à demeure) recruté par le créateur et propriétaire du parc, Charles Hamilton, grand ami du poète Alexander Pope, le très parisien jardin des Tuileries lui-même, mais appréhendé par sa face cachée, celle de ses employés prenant leurs ordres pour la journée dans le froid matinal, et enfin le très privé et très secret jardin d’Odile, à Graz, en Autriche, enfermé dans le petit puits intérieur de lumière chiche d’un immeuble bourgeois par ailleurs anodin.

- Prospect Cottage
De l’engrais fut apporté dans le jardin. Les plantes, y compris les sauvageonnes, que Jarman aimait autant sinon plus que les horticoles raffinées dont les pépinières anglaises regorgent, commencèrent à croître. Au bout de quelques mois, le petit jardin se remplit d’une étonnante variété d’herbacées et d’arbustes : lavandes, santolines, monnaie-du-pape, ajoncs, sedums, cistes, églantiers et rosiers rugueux, coquelicots, valérianes, sauges… Le tout, à profusion. C’étaient essentiellement des végétaux de terrain sec, adaptés à ce coin de l’Angleterre où il pleut beaucoup plus rarement que dans le reste du pays. Des plantes tenaces, capables également de faire face aux tempêtes de Dungeness.
Ce jardin était fait pour résister.
Même la lectrice ou le lecteur qui, comme moi, ne serait pas particulièrement amatrice ou amateur de botanique et de jardins ne pourra s’empêcher d’être saisi par l’art profond du récit, sous son apparence si anodine, mis en œuvre ici par Teodor Cerić. Comme si un ami, certes infiniment plus « calé » que vous-même en matière de noms des plantes et des fleurs, ou de qualités géologiques des sols, vous prenait doucement par la main et vous entraînait dans une pensive promenade, paisible et dénuée de toute urgence, pour simplement partager avec vous ce que lui fait tel ou tel jardin, ce qui se met alors à bouillonner, philosophiquement, poétiquement et même peut-être politiquement, au contact de ces micro-paysages où se conjuguent hasard et nécessité, dessein mûri et survenance aléatoire, histoire et géographie des intimités partageables.

- Maison de Samuel Beckett à Ussy-sur-Marne
Il y a quelques jours, j’ai reçu une invitation au vernissage d’une grande exposition sur la nature urbaine, appelée « La Ville fertile » à Paris. L’image du carton d’invitation, très élaborée, montre une ville moderne, avec ses gratte-ciel et ses grands boulevards plantés d’arbres, entourée d’un paysage sauvage de montagnes, de lacs et de forêts. La ville elle-même est traversée, en son centre, par une sorte de grand parc débordant d’arbres et irrigué par des cours d’eau bucoliques. Le message contenu dans l’image est clair. Voilà une utopie pour le vingt et unième siècle : la nature, qu’à l’heure actuelle on réintroduit dans l’espace urbain, s’apprête à sauver la ville moderne, devenue stérile. Les « espaces verts » – jardins, parcs urbains et périurbains, corridors écologiques, friches jardinées, coulées vertes – sont déjà en train de faire renaître la vie dans les lieux artificiels de notre quotidienneté. Élus, urbanistes et paysagistes de renommée internationale, dont les agences se trouvent à Londres, Berlin ou Sydney, vont bientôt nous aider à sortir définitivement de cette impasse de la modernité.
N’ayant pas l’intention de me rendre à Paris pour voir l’exposition, j’ai jeté le carton d’invitation à la poubelle. Cependant, l’image radieuse de la ville qui débordait de végétation, touchante dans sa naïveté, n’a pas quitté mon esprit. Sans m’en apercevoir, je me suis mis à repenser à une ville en particulier, la dernière où j’ai séjourné lors de mon long périple de jeunesse à travers l’Europe. Une ville de province, assez modeste, mais une vraie ville tout de même, avec un centre vibrant d’activité, quelques monuments aux héros de son histoire, une banlieue toute grise s’estompant doucement dans la campagne. Et j’ai repensé à un jardin aussi, minuscule, caché au cœur de cette ville, tellement bien caché que personne n’était au courant de son existence silencieuse.
Pendant que je me laissais aller aux souvenirs, j’avoue avoir eu, soudain, un doute. Et si, me suis-je dit, les commissaires de l’exposition parisienne avaient raison ? Si un jardin, même minuscule, même caché à la vue du monde, pouvait sauver une ville tout entière ?

- Jardin du Tiers-Paysage (Toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire)
On songera sans doute aux si déroutants jardins de ferraille du « Crépuscules » de Joël Casséus (où il est aussi question d’ailleurs, de réfugiés fuyant la guerre), à l’exceptionnelle « Musique du garrot et de la ferraille » de l’étonnant duo belge Jardin d’Usure, avec leur refus patent de domestication du chaos, aux pouvoirs curatifs ambigus des « Jardins statuaires » de Jacques Abeille, ou de ceux s’étendant « Sur les falaises de marbre » d’Ernst Jünger (dont le « Journal 1939-1940 » s’intitule, certainement sans hasard, « Jardins et routes »), voire aux désaffections ferroviaires du « Passerage des décombres » d’Antonin Crenn : on aura bien le sentiment, tout au long de cette brève lecture, de s’approcher sereinement, discrètement, comme mine de rien, d’un secret camouflé, dissimulé en plein jour, celui d’une résonance intime restant à jamais mystérieuse, peut-être.
Ce que je peux vous dire sur mon jardin, c’est qu’il n’a rien d’extraordinaire, surtout pour vous qui êtes habitué aux jardins de France, dont je connais bien le raffinement. À l’intérieur de ses murs, il y a des arbres, de l’herbe qui, en ce moment, par-delà la fenêtre de mon bureau, se meut à peine dans la brise du soir d’été, des fleurs, des crapauds qui, tout à l’heure, se mettront à coasser tous ensemble, faisant trembler la maison, réveillant dans ma poitrine un bonheur mais aussi un sentiment étrange, comme un trouble, auxquels je ne m’habitue toujours pas.






