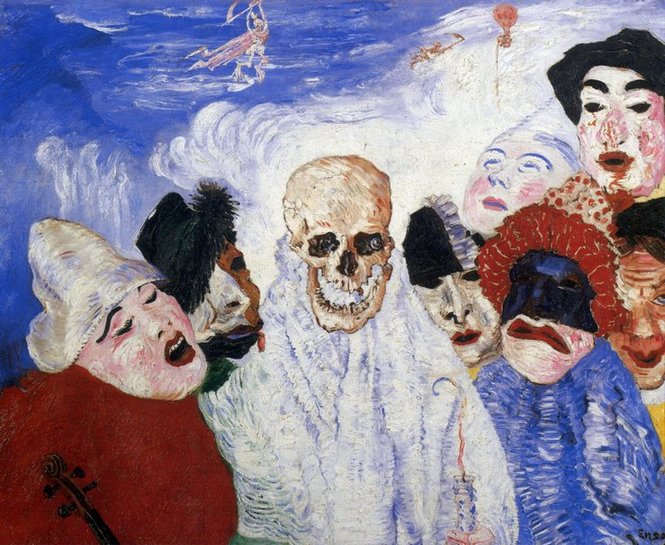[Cet article est d’abord paru chez nos confères de Grozeile.co .]
J’ai horreur du temps perdu à porter un fardeau
Avant d’atteindre ce fameux repos qu’on va m’accorder
Casey, « Rêves illimités »
Il n’y aura pas de retraite
Que penser de l’idée même de « retraite », quand on nous rappelle quotidiennement que le monde dans lequel nous vivons est en train de s’effondrer ? Qui peut prétendre aujourd’hui se projeter dans l’avenir à plus de dix ans, quand chaque rapport du GIEC, chaque alerte des scientifiques, chaque nouvelle d’incendie, de sécheresse, d’inondation ou d’insurrection liée au prix du carburant nous promet des années difficiles et des bouleversements sociaux plus réguliers ?
Toutes les promesses de retraite se heurtent à l’incrédulité des jeunes que nous sommes [1]. Pour notre génération, une certitude : la retraite ne viendra jamais. Car ce monde ne nous permettra pas de nous mettre en retrait. Il suffit de regarder le Chili, l’Iran, Hong-Kong, l’Algérie ou la France en décembre 2018 pour s’en convaincre. La fin du monde est peut-être toujours plus facile à imaginer que la fin du capitalisme, mais le capitalisme se délabre à vue d’œil, et avec lui, la promesse d’une vieillesse pensionnée.

L’histoire qu’on nous a toujours racontée sur les retraites commence à la sortie de la seconde guerre mondiale avec l’instauration d’une « une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours » [2]. Pendant les « Trente Glorieuses », la croissance économique et une démographie porteuse assurent aux retraités un revenu proche de leur revenu d’activité. Mais à partir de 1991 : patatras ! Le « Livre blanc sur les retraites » de Michel Rocard hurle à la dégradation de l’équilibre financier du système de retraites, dans un contexte où la croissance ralentit fortement, et où la population vieillit.
A partir de là, fini le discours sur la solidarité avec les personnes âgées : il ne s’agit plus que de diminuer le poids des retraites dans le PIB. Ce qu’on appelle hypocritement « réforme des retraites » n’est qu’un levier parmi d’autres pour faire des économies budgétaires, afin de compenser le ralentissement de la croissance. Comme on fait des économies sur tout ce qui est peu rentable et coûte cher, surtout quand on y intègre (un peu) le facteur humain. Ainsi l’école, les hôpitaux, les transports publics, l’agriculture, et, bien sûr, l’écologie.
Mais il y a un hic de plus avec cette réforme des retraites [3] : c’est un néant sur la question écologique. Le rapport [4] de Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, évite soigneusement d’en parler, alors même que les personnes âgées, par exemple, sont les plus vulnérables lors des vagues caniculaires.
Si les détails de la réforme Delevoye ne sont pas encore fixés, on en sait déjà assez pour comprendre que cette réforme des retraites, comme toutes les autres, est en contradiction absolue avec les évidences écologiques. Non pas tant en raison de son contenu que de ses présupposés. Le rapport Delevoye se fonde sur des prédictions decroissance économique d’au moins 1% par an (p. 116) : ce qui signifie notre mort écologique [5]. Car qui dit croissance dit production croissante de gaz à effets de serre, extractivisme, déforestation, et dévastation des écosystèmes [6].
Mais s’il n’y a plus de croissance, moins d’argent sera produit et redistribué. Alors, il est absolument évident que le système à point de Delevoye ne suffira pas à garantir le minimum vital. En cherchant à toute force à éviter la « faillite » économique du système français de retraites (p. 5), la réforme Delevoye ne voit pas que sa faillite politique et écologique est programmée. La conclusion est simple : ou bien l’on revoit radicalement les bases du partage entre les générations, ou bien l’on continue de courir au suicide collectif.
Pour l’essentiel, la critique des mesures préconisées par Delevoye a été faite, nous n’y reviendrons pas [7] ; il suffit de lire l’excellente BD d’Emma. La modification de l’ « âge à taux plein » et le passage à une « retraite par points » incitent globalement les gens à travailler plus longtemps. Donc à voir leur retraite se réduire comme peau de chagrin, puisqu’il y a tendanciellement de moins en moins de travail [8](robotisation, automatisation, délocalisation, suppressions de poste dans le public, qui augmentent le chômage structurel en Europe [9]). Les emplois restants sont de plus en plus précaires, et les seniors ont en outre de plus grande difficulté à en trouver.

Et puis, quel sens cela pourrait-il avoir, de travailler plus, quand les gains de productivité obtenus depuis deux siècles auraient déjà dû nous libérer du travail ? On relèvera l’absurdité qu’il y a à pousser encore les gens à « travailler plus longtemps » (Edouard Philippe [10]) quand tous les rapports scientifiques indiquent qu’il faut au contraire diminuer la production et travailler moins pour préserver nos milieux de vie. Un rapport du think tank Autonomy indique récemment qu’ « au rythme actuel des émissions carbone » il faudrait que nous travaillions environ « 9 heures par semaine pour maintenir le pays sous le seuil critique des 2°C de réchauffement climatique » [11]. C’est la direction inverse, écologiquement insoutenable, que prend la réforme des retraites. On nous propose de réformer les retraites tout en sapant les conditions de toute retraite vivable.
Dans quel monde prétend-on se retirer ?
Dans la situation qui est la nôtre, les impératifs de budget sont très secondaires. Nous devons prendre du surplomb : toute réforme politique contient un choix de vie. Le choix de vie contenu dans la réforme Delevoye est insupportable : il consiste à ajouter à l’effondrement écologique en cours un effondrement de ce qui reste des solidarités (certes imparfaites car pensées sur des bases obsolètes) du XXe siècle. Le rapport Delevoye nous recommande en somme de partager la pénurie. Une pénurie organisée, puisque de l’autre côté de la barricade, les riches n’ont jamais été aussi riches. Au moment où nous avons le plus besoin d’entraide, de solidarité, le gouvernement propose l’individualisme et le sauve-qui-peut au nom d’économies budgétaires insensées.
Voilà en gros à quoi le monde doit ressembler dans la tête d’un Delevoye : se faire soigner par une infirmière de 62 ans, transporter par un cheminot de 65 ans, sauver d’un incendie par un pompier de 64 ans, éduquer par une prof de 69 ans, mais tabasser par un CRS de 34 ans car les flics doivent bénéficier des seuls régimes spéciaux que ce monde-là connaisse encore [12]. Pendant ce temps, le monde entier cramera parce que des businessmen de 74 ans exploiteront à fond tout ce qu’il reste de ressources naturelles, pendant qu’il sera encore temps. Pour nous, les jeunes, qui naviguons à vue dans l’uberisation et le précariat, on servira le mythe de la croissance verte et de l’économie de plateforme. Plus d’applis, plus de vidéos, plus de data, plus de serveurs, plus de trottinettes, plus de startups de recyclage et de compteurs Linky, qui ne serviront qu’à alimenter le contrôle et la surveillance, et à « flexibiliser » les marchés en rendant le travail plus précaire.
Reste que ceux qui contestent la réforme des retraites – la plupart des centrales syndicales et la gauche – ont du mal à imaginer un monde différent. Ils discutent finalement dans un cadre économico-budgétaire très semblable à celui du gouvernement [13]. Tous ou presque cherchent à « adapter » le système actuel [14] bien peu à revoir ses fondements. Nous devons refuser les règles du jeu de la contestation traditionnelle.
S’il faut faire le deuil de notre système de retraites, c’est pour mieux imaginer comment se réapproprier et partager les richesses. Des richesses qui ne sont pas qu’économiques. Notre système actuel de retraite se contente de verser une pension aux vieux passé un certain âge, comme pour les récompenser de nous foutre la paix. Mais il y a mille manières de prendre soin des personnes âgées, et toutes ne passent pas par l’argent. Nous devons réapprendre à établir des solidarités non-économiques avec nos aïeux, qui effectuent déjà tout un tas de tâches non-rémunérées permettant le bon fonctionnement de l’économie (à travers leurs engagements bénévoles ou la garde des enfants notamment). Les formes historiques du soin aux personnes âgées sont foisonnantes selon les époques et la géographies : elles ne demandent qu’à être étudiées, discutées, et améliorées [15]. Plus la grève sera longue et peuplée, plus nous aurons le loisir d’y réfléchir sérieusement et démocratiquement.
En grève jusqu’à la retraite
La bataille sur la réforme des retraites qui commence le 5 décembre est un enjeu majeur pour les écologistes français. Il y a une écologie résignée, voire nihiliste, qui peut se laisser aller à penser que cette réforme ne nous concerne pas. Que nous allons de toute façon à la catastrophe. Qu’il y aura trop de vieux dans les années qui viennent, que de toute façon ils se « gavent trop », qu’il faut bien qu’on fasse décroître les revenus. Certains vont jusqu’à penser que des retraités plus pauvres consommeront moins, et qu’au fond, ça ne ferait pas de mal à notre empreinte carbone si une bonne partie de cette classe d’âge qui pollue tant mourrait prématurément [16].
Une écologie conséquente ne considère pas la démographie ou la vieillesse comme un problème, quand c’est l’organisation capitaliste de la vie qui rend ce monde invivable et injuste. Le monde n’a jamais été aussi « riche » d’argent, de ressources, d’énergie qu’aujourd’hui : c’est leur répartition qui est monstrueusement inéquitable. Il y a largement de quoi permettre des conditions de vie décentes et écologiques pour tous avant de devoir songer à réduire la population ou le montant des retraites.

La bataille des retraites est donc l’occasion de démontrer que social et populaire ne sont pas que des mots-clé à coller hypocritement à côté d’ « écologie » pour se dédouaner de toute solidarité réelle. C’est l’occasion d’entrer en discussion avec les bases syndicales qui sont les seules à même de faire décroître réellement notre mode de production, puisqu’elles ont cet avantage sur les écolos qu’elles connaissent leur outil de production et savent comment le transformer. C’est l’occasion pour l’écologie de poser à nouveaux frais la question de la vieillesse, de l’entraide, du soin, qui sont les conditions mêmes d’un monde habitable. Bref, l’occasion d’amorcer un authentique processus révolutionnaire.
Nous, improbables retraités de 2060, avons des parents et des grands parents, des vieux amis, que leur travail use et ennuie depuis des décennies. Nous connaissons la fatigue imprimée sur leurs visages, et dans leurs corps. Eux se battront pour ne pas avoir à trimer plus : la lutte pour leur retraite est une question de survie et de dignité. Nous serons donc à leur côtés. Toutes les joyeusetés de cette réforme sont matière à produire un conflit social puissant, à même de stopper le rythme infernal de réforme plus obscènes les unes que les autres, qui n’ont pour but que de nous soumettre à des boulots absurdes.
Au contraire, il nous faut dégager les conditions d’un temps libre de masse, créatif et non dévastateur, comme celui d’un grand nombre d’activités écologiques : artisanat, permaculture, zad, écoconstruction, cantines, assos de quartier, maisons des femmes, cours de langue, transmissions de savoir-faire, réparations… Tout un tissu de solidarité et d’entraide qui sera nécessaire pour les temps difficiles qui arrivent, et qui n’aura que faire des objectifs de croissance ou des équilibres budgétaires.
Une vue à long terme ne doit donc pas s’arrêter au simple retrait de la réforme des retraites. On ne reviendra pas au système de protection sociale de 1945 ni à un contexte de croissance économique soutenue. Il faut dire au revoir aux retraites telles qu’on les a connues ces 75 dernières années, celles de la socialisation des solidarités sous contrôle de l’Etat. Mais dire goodbye aux retraites, ce n’est pas accepter une régression des solidarités. C’est rompre avec l’idée d’une vie de travail souvent absurde et harassante que viendrait couronner, à la fin, la « retraite ». C’est étendre l’idée de retraite ou de grève à la vie entière, puisque nous aurons à travailler moins et à prendre soin les uns des autres.
Il suffit de s’engouffrer dans la voie suggérée par les gilets jaunes. Organisons des Assemblées dans tout le pays pour discuter de l’avenir, et prendre nous-mêmes les mesures qui s’imposent. Réquisitionnons les bâtiments, les médias, la nourriture, les richesses et tous les moyens qui seront nécessaires pour faire durer la grève jusqu’à ce que d’autres formes de solidarité vieillesse ait été établies, jusqu’à ce que les émissions de gaz à effet de serre aient été drastiquement diminuées, jusqu’à ce qu’on puisse garantir aux jeunes et aux vieux un avenir digne d’être vécu.