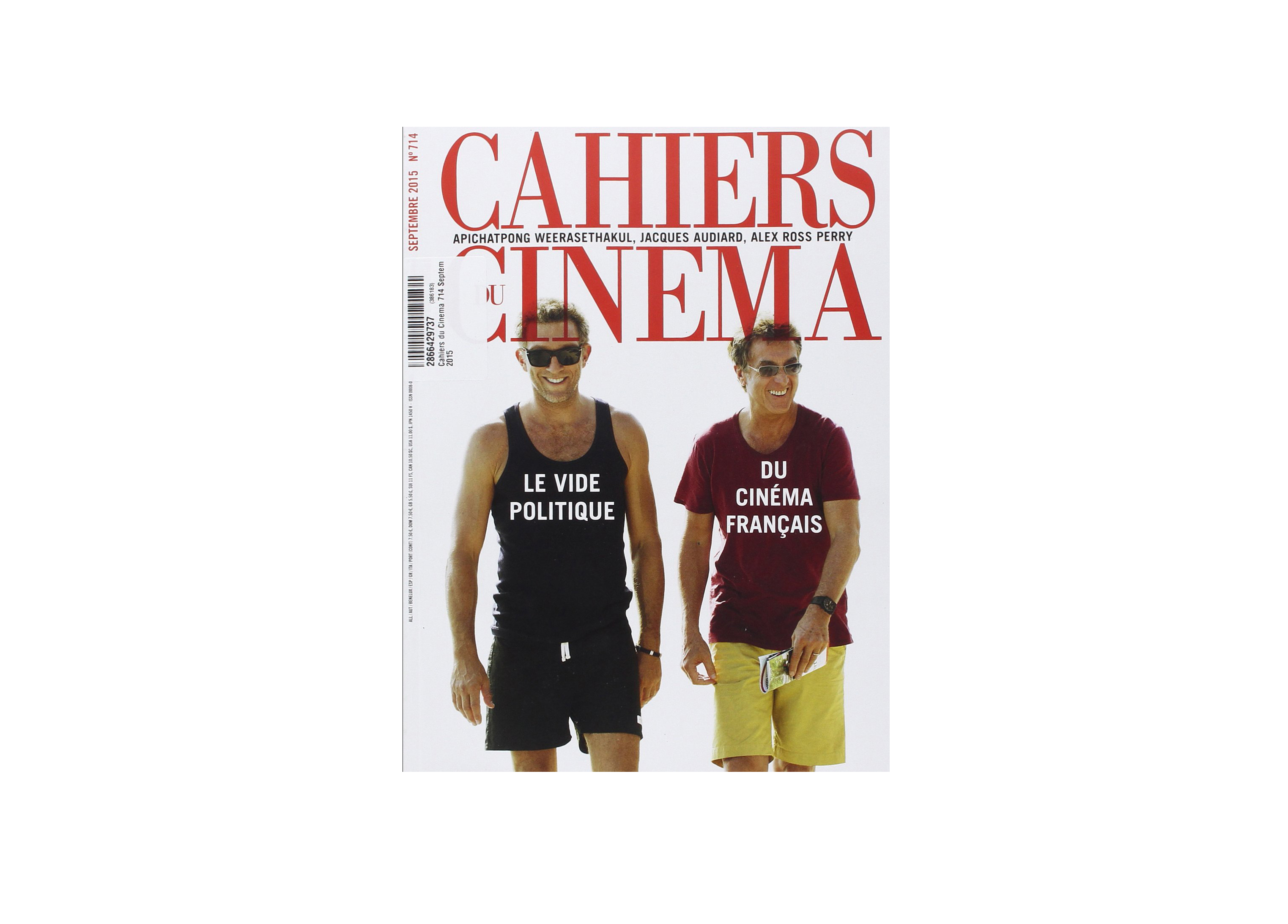J’arrive par la ligne 6 du métro, en aérien. Petit coup d’œil vers la tour Eiffel, à quelques centaines de mètres sur ma droite quand je passe sur le pont Bir Hakeim. Je descends à Passy. C’est les vacances scolaires, les rues du XVIe arrondissement de la capitale sont plutôt vides. Outre les éboueurs, les gardiennes d’immeuble (des femmes, bien sûr) ou les travailleurs du bâtiment, il n’y a pas grand monde. La plupart des riverains se sont échappés pour rallier leur demeure provinciale. Je longe une série d’immeubles haussmanniens avec vue sur la Seine, un épais tapis rouge débute au rez-de-chaussée, des petites piaules tout en haut, et entre les deux des grandes fenêtres. C’est tout propre, rien ne dépasse, rien ne se passe. J’ai toujours la même remarque en tête : ce quartier est d’un ennui total. Pas de charme, pas d’élégance, ça transpire juste l’argent. J’aperçois la Maison de la radio (et de la musique, depuis peu) au bout de la rue. Je ne suis pas en avance, j’accélère le pas. Je me rends dans les bureaux de France Inter pour effectuer un énième « remplacement ».
Toujours des galères pour franchir la sécurité. Portiques façon aéroport, plusieurs gardes sont armés. J’explique ma situation. Mon badge n’est pas à jour car je ne suis que de passage, je fais des remplacements. Oui on est au courant de mon arrivée. D’accord d’accord, ce sont les consignes, quelqu’un va venir me chercher. L’ascenseur nous emmène directement au 5e étage. On pénètre dans la machine. Tous les couloirs sont exactement les mêmes, elliptiques, ça ne s’arrête jamais. Les postes de travail sont regroupés par émission. En face de la direction, « Le 6/9h30 » aussi appelé « La matinale », toujours en bazar, des livres s’entassent jusqu’au plafond. Au-dessus, « C’est encore nous », Charline Vanhoenacker et son équipe s’affairent derrière une baie vitrée saturée d’affiches humoristiques. Au fond du couloir, après « Le 18/20 » où un silence concentré domine autour de Fabienne Sintes, on aperçoit la case attribuée à « La terre au carré », décorée de quelques plantes.
1. Appréhender les règles du jeu
Comme des engrenages, les bureaux en série, identiques, structurent le vaste mécanisme de la première radio de France. C’est impressionnant, très peu de gens se parlent mais tout se déroule sans accroc. Un fois installé derrière l’ordinateur, le travail peut commencer. En fait non, j’avais oublié : je dois d’abord réactiver ma session et mon adresse mail professionnelle. J’oublie toujours qui je dois appeler. L’assistance informatique ? Je n’ai pas le droit de faire la démarche moi-même, il faut que je passe par mon responsable. Excuse-moi, peux-tu envoyer une demande pour ma session ? Ça râle. Ah bon, c’est à moi de m’occuper de ça ? Tu devrais appeler Christophe, il va t’aiguiller, ou peut-être Eric ? Allez, c’est reparti. La porte C, c’est où déjà ? Punaise, il y a des travaux ici, j’avais oublié. Demi-tour. Un bureau pour les crayons, un autre pour les bouteilles d’eau, c’est au rez-de-chaussée pour obtenir son badge et au 10e étage pour l’activer. Dans ce labyrinthe administratif, je me fais comme à chaque fois renvoyer d’un endroit à l’autre comme une balle de ping-pong. Après plusieurs coups de fil et une bonne petite randonnée « indoor », victoire, je réinitialise mon mot de passe et me voilà pris dans le tourbillon.
Mes tâches sont plutôt claires, je commence à bien les connaître après tout ce temps. Tantôt nommé « attaché de production », « collaborateur » ou « programmateur », je suis chargé de structurer les sujets des émissions, de dégager des axes de réflexion, et surtout de trouver les personnes pertinentes pour en parler. Je suis mobilisé en remplacement sur les tranches dites « actu », c’est-à-dire le matin (entre 6h et 9h30), le midi (entre 13h et 14h) et le soir (entre 18h et 20h). Mes choix et propositions se confrontent à la direction de la rédaction (dernière décisionnaire sur les thématiques à évoquer), et la production (la voix qui occupe l’antenne). Les autres émissions, appelées « programmes », se réfèrent à une autre hiérarchie. Ma marge de manœuvre dépend donc des contextes et des personnes. Parfois, je peux me sentir à l’initiative du début à la fin, d’autres fois je dois « faire le boulot » car « l’actualité le réclame » (prosopopée classique des conférences de rédaction, j’y reviendrai).
Les émissions ne pourraient avoir lieu sans les attachés de production. C’est une position de pivot primordiale. Ceux que l’on désigne oralement comme les « atta pro » anticipent et font face aux imprévus, doivent être force de proposition et sont les garants du bon déroulement de l’antenne. Si cela se passe mal, c’est sur eux que ça retombera. Peu importe que les effectifs n’aient cessé d’être réduits et que le temps imparti pour la préparation de chaque émission soit de plus en plus court. Après tout, les « voix » de l’antenne ne sont que des « bouffeurs de micro » (citation d’une discussion avec un célèbre animateur de France Inter) et la direction a d’autres chats à fouetter. De la définition de la thématique abordée jusqu’à l’accompagnement des invités pour les installer en plateau, ce sont les atta pro qui sont aux manettes. Archétype de l’ère néolibérale, ce métier est un interstice pour lequel l’importance est inversement proportionnelle à la reconnaissance.
Cette position symbolique est aussi, et peut-être surtout, formelle. Certains collègues sont toujours employés à travers des contrats hebdomadaires, alors même qu’ils occupent le même poste à temps plein depuis plusieurs années. C’est à la frontière du légal, mais soit. Les fameux CDD-U (Contrats à durée déterminée d’usage), sont reconductibles à l’infini sans délai de carence et sans indemnité de fin de contrat. Censée être juridiquement destinée à des emplois pour lesquels le CDI est inadapté, dans l’hôtellerie-restauration ou dans l’événementiel notamment, cette forme de contrat est mobilisée sans distinction pour faire fonctionner les médias. Le jour où les salaires sont versés est toujours une tragi-comédie. Combien ce mois-ci ? Quatorze fiches de payes différentes, dont deux qui indiquent 0 euro et une qui indique un chiffre négatif. Bravo, nouveau record ! Tu vas bien t’amuser à faire comprendre ça à Pôle Emploi maintenant. Indispensables au monde médiatique, les attachés de production y occupent le haut du tableau de la précarité.
2. Hiérarchiser l’information
Tous ces remplacements ont fait suite à un stage : les couloirs de la Maison de la Radio (et de la musique, depuis peu) sont arpentés par des dizaines de jeunes étudiants en quête de validation de leur module « expérience professionnelle ». Bien que ce soit contraire à la loi, les stagiaires dans les émissions de radio du service public occupent souvent un poste bien précis. Chargés de la documentation et de l’écriture des résumés qui accompagnent les podcasts des émissions sur le site internet, la charge de travail équivaut à un salarié temps plein. Jusqu’à encore peu, les stagiaires n’étaient pas rémunérés (leur convention s’arrêtant après 1 mois et 30 jours) mais récompensés par un chèque de quelques centaines d’euros à la fin de leur mission.
Quand on me propose d’occuper pour la première fois un « vrai » poste sur la grille d’été, pas de formation ou de réunion un peu officielle. Je n’ai que des bribes de trucs et astuces, ultra- lacunaires, transmises pendant le stage. Je suis le binôme d’un atta pro plus aguerri et je programme l’émission quotidienne « Le téléphone sonne » en direct de 19h à 20h. Quatre invités par jour, 5 sujets par semaine. Je ne suis pas journaliste et n’ai aucune formation en ce sens. C’est un peu impressionnant. Début de syndrome de l’imposteur, en quoi suis-je légitime à définir les sujets à évoquer et l’angle pour les traiter de manière intéressante ? Comment vais-je réussir à trouver des bons invités à chaque fois ? La panique s’estompe rapidement, je comprends vite que mes mains ne sont pas aussi libres que ça : l’actu, l’actu, l’actu, là est le combustible du moteur.
Sur ma session professionnelle, je peux accéder à un fil regroupant les dépêches de l’AFP et de Reuters. Dans cet espace se mêlent les derniers chiffres du CAC 40, une disparition inquiétante dans le Doubs, les dernières déclarations de Bruno Le Maire, ou encore une énième manœuvre militaire chinoise au large de Taïwan. Cela ne s’arrête jamais et peut avoir un effet hypnotique façon Tik Tok. Cette seule lecture n’est pas suffisante pour sentir le « pouls de l’actualité ». Avec l’objectif de trouver des sujets, j’épluche tous les matins les quotidiens nationaux (France Inter n’a pas de codes pour accéder à la presse quotidienne régionale). C’est à partir des autres qu’on se calibre. Un chiffre, une phrase, une personnalité fait la une du Monde ? On en a pas encore parlé chez nous ? Ça pourrait être notre sujet de mardi. Et ainsi de suite, de jour en jour, en plus des « marronniers » répétés chaque année, on arrive à « trouver » des choses à dire.
Si l’envie me prend de proposer un sujet que les autres médias n’ont pas déjà digéré, je vais devoir le défendre. En général, la direction de la rédaction, tout comme la production, demandera quelle est « l’accroche d’actualité ». Pour obtenir le droit d’en parler, il sera impératif de réussir à trouver un prétexte, aussi inconsistant soit-il. Les petites phrases des responsables politiques sont très efficaces, les études à la méthodologie douteuse produites par les think tanks aussi. Tout cela est limité par les capacités de compréhension des interlocuteurs décisionnaires, tous âgés de plus de 40 ans. Je nous revois expliquer pendant plusieurs minutes, avec mon collègue atta pro, ce qu’était la « souveraineté numérique » et pourquoi il était important d’en parler. Pour cette fois, nous avons réussi notre coup. L’émission a été faite. À l’inverse, pour la guerre civile éthiopienne, événement majeur du XXIe siècle ayant entraîné plusieurs centaines de milliers de morts, je n’ai essuyé que des refus d’incompréhension. Personne n’en parle, donc ce n’est pas assez « fort ». D’accord.
3. Inviter des gens respectables
Une fois les sujets déterminés et arrêtés, je dois remplir le plateau « d’experts ». Première contrainte, la disponibilité. La Maison de la Radio se trouve à Paris. Les émissions sont programmées quelques jours en avance dans le meilleur des cas, mais ça peut parfois être du matin pour le soir. Soit on habite à Paris et on peut être là rapidement, soit on habite loin, on est prévenu à l’avance et donc on s’organise pour venir mais ça sera à ses propres frais. J’ai le droit de commander des taxis pour les gens d’Île-de-France, mais France Inter ne rembourse jamais les déplacements plus longs en train, et les invités ne sont bien sûr pas rémunérés pour leur participation à une émission. Pour venir depuis une « ville moyenne », il faut avoir une maison d’édition ayant prévu un budget promo, ou pouvoir être capable d’investir de sa poche. Ça filtre déjà beaucoup.
Ensuite, la voix. Parler dans un micro est un exercice particulier. Certaines personnes sont considérées comme des « bons clients », s’expriment de manière intelligible, connaissent les règles et savent rebondir, tandis que pour d’autres, ça ne fonctionne pas. Le format des émissions réclame des interventions concises, courtes, avec un début et une fin. « Ici, on est pas chez les violets » m’a- t-on plusieurs fois répété, manière d’exprimer que les auditeurs de France Inter ont une capacité d’écoute plus inconsistante que ceux de France Culture (ce sont eux « les violets », en référence à la couleur du logo). Si vous voulez être le plus précis possible dans vos explications et donc que vous avez besoin de temps pour choisir vos mots, développer votre propos, vous ne serez pas invité. Même chose si votre éloquence ne respecte pas les règles canoniques de l’expression dominante (bourgeoise). Ici, il faut avancer au galop et la forme est priorisée sur le fond.
En tant qu’atta pro, je suis chargé d’organiser la couverture quotidienne de sujets aussi divers que la fréquentation des campings du sud de la France, l’explosion dans le port de Beyrouth, l’alliance politique de coulisse entre macronistes et républicains. À chaque fois, je dois réussir à mettre rapidement la main sur les « références » liées aux sujets évoqués, comprenez des gens déjà connus des médias, qui se sont déjà exprimés, et ainsi considérés comme des personnalités « respectables », avec un « statut ». C’est ce qui est attendu par la direction. Ce sont des patrons de fédération, des chargés d’étude, des universitaires qui ont compris le jeu. Évidemment, uniquement des gens ayant acquis ou fait perdurer une condition sociale en haut de l’échelle. « Ma femme de ménage ne représente personne » aimait me marteler une présentatrice de la station pour appuyer sur ce principe. Ici, c’est France Inter, les autres médias nous écoutent. Les interventions de personnalités « paillettes » (jargon interne), c’est-à-dire avec une grosse notoriété, pourront être reprises dans des dépêches AFP ou sur les réseaux sociaux. Ça fait partie des grands objectifs du schmilblick.
Le temps imparti pour choisir les invités, vérifier s’ils peuvent être là et s’ils parlent bien, faire valider par la direction, les contacter puis attendre leur réponse, est court. Je dois aller vite, et aller vite veut dire aller simple, et aller simple veut souvent dire aller comme d’habitude. La première étape est toujours la même : sonder son répertoire de contacts téléphoniques. France Inter a ses « tauliers » de première ligne pour chaque thématique. Ce sont les invités, interchangeables, qu’on désigne par le pronom « un » suivi de leur nom de famille. Le sujet est très large ? J’ai des sociologues passe-partout (« un Viard, un Wieviorka »). Besoin de « sentir l’opinion publique » ? J’ai des politologues capables de lâcher des chiffres car ça fait bien à l’antenne (« un Dabi, un Fourquet »). On veut prendre « un peu de hauteur » ? Psychiatres ou autres philosophes branchés développement personnel, (« un André, un Comte-Sponville, un Lenoir ») on a aussi. Souvent des hommes dont l’égo est assez gonflé pour se sentir à l’aise à parler de tout et de rien. Peu importe les termes précis du sujet, tant que ça les touche plus ou moins directement, ils seront ravis et disponibles pour venir. Ça fonctionne un peu comme les éditorialistes des chaînes d’info en continu mais avec un peu plus de consistance intellectuelle. Bien pratiques pour combler un plateau composé de spécialistes plus « techniques », ils sont comme des piliers de comptoir pour lesquels le studio remplace le bistrot.
4. Usiner le réel
Précaire, responsable de beaucoup avec peu de moyens, l’attaché de production ne peut pas faire de vagues. Ce n’est pas une injonction hiérarchique qui l’impose, mais la structuration même de son poste. Si l’atta pro veux continuer à mener une vie un minimum épanouie, c’est à dire qui ne se limite pas à son travail, il doit se ménager. Une émission à peine terminée, il faudra passer à la
suivante. Ça ne peut pas être toujours des révolutions. Pour réussir à durer dans ce métier et être rappelé par les ressources humaines, pourquoi pas jusqu’à obtenir un poste fixe (toujours avec des CDD-U à la semaine, ne rêvez pas), il faut coûter peu de temps : débiter des thématiques et des plateaux rapidement en ayant compris les attentes de la direction. Si vous vous faites retoquer trop d’invités et de sujets (« un peu trop engagé », « pas assez gros », « trop France Culture »), vous ne réussirez pas à tout boucler et vous embêterez la direction pour qui vous êtes un simple dossier parmi d’autres. Il faut tenir le rythme de la chaîne de production ou vous en serez écarté. Des centaines de personnes attendent derrière vous.
Pour être efficace, il incombe de comprendre une chose : la mission n’est pas de rendre compte du réel mais de l’actualité. Cette variation est bien plus qu’une finesse sémantique. Ce n’est pas vis-à-vis du réel, passé présent comme futur, que le travail d’attaché de production se construit. Lorsque vous choisissez les sujets à aborder et les invités avec lesquels en parler, c’est à partir de « l’actu » que vous devez raisonner, c’est-à-dire à partir d’une hiérarchisation informationnelle produite et alimentée par les médias eux-mêmes de manière réticulaire. L’attaché de production est un des outils à travers lesquels le « traitement de l’actualité » s’émancipe des autres sphères du monde social. Cela devient un marché à part entière, au même titre que les autres. Vous ne vendez pas des planches de bois ou des voitures électriques, mais de l’actu, et c’est à partir de ça que le travail s’organise. L’objectif du média devient dès lors d’entretenir une certaine position sur le marché de l’information, et pour les gros mastodontes comme France Inter, cela est synonyme de jouer sur les mêmes plates-bandes que les autres. C’est pour cette raison que très souvent, la direction explique en conférence de rédaction que « l’actualité l’impose » (à l’image des fameuses « humeurs du marché » décrites par les économistes de plateaux), sans que cette réification grotesque, véritable renversement de l’acte journalistique, ne provoque la simple interrogation de qui que ce soit. L’existence d’une ligne éditoriale explicite, autour de laquelle les discussions peuvent s’agréger, est dissoute dans la dynamique incessante de l’actu.
L’attaché de production appréhende et respecte les règles sans qu’on ait besoin de les lui expliciter. Il n’a pas le temps de faire autrement. La définition des sujets, tout comme le choix des invités, s’établit dans un rapport constant aux autres médias. Si plusieurs médias font quelque chose, il faudra le faire aussi. La concurrence régit la stratégie à adopter. Pour France Inter, l’objectif est de se maintenir en tant que première radio de France. Cela se traduit par l’entretien d’une position présentée comme médiane, « il faut parler au plus grand nombre », qui se trouve être, dans les faits, une non-position, ou plutôt une anti-position. La station organise le défilé des « experts » déjà reconnus, des responsables politiques et syndicaux établis, des gros chefs d’entreprise, des artistes dont l’image est gérée par des batteries d’agents et autres attachés de presse. Les plus puissants sont considérés comme les plus représentatifs. Eux, ils ont réussi, ils savent de quoi ils parlent. Elle est là, la vraie-fausse ligne éditoriale : une acceptation sans concession de l’ordre existant, conceptualisée comme la meilleure manière d’atteindre un public le plus large possible.
L’anti-position mène à l’avènement de l’anti-réel. Une déclaration abjecte d’un ministre macroniste le weekend ? Il sera invité le lundi dans la matinale (à l’initiative de France Inter ou du ministre lui-même d’ailleurs, les demandes vont dans les deux sens). On vous expliquera que c’est d’abord à lui de s’expliquer, il représente la nation, « il doit rendre des comptes », et surtout ça fera des dépêches. C’est le meilleur moyen pour que tous les autres médias vous écoutent et vous reprennent (ça veut dire ça « être au cœur de l’actu »). S’ensuit 20 minutes de tapis rouge pour un individu qui enchaîne les mensonges sans être ni rectifié ni bousculé par les journalistes intervieweurs. Sa légitimité à s’exprimer ne découle pas du fond de ses propos, mais bien de sa position sociale. Les ministres sont des gens sérieux et, pour cette raison, des acteurs primordiaux de la structuration de « l’actualité ». Des éléments de langage du pouvoir s’immiscent ainsi petit à petit dans le travail journalistique jusqu’à créer une anti-réalité dont le fondement n’est même plus interrogé. Les policiers ne sont pas violents, les « blacks blocs » sont des « casseurs » dépolitisés, une réforme légale est une réforme légitime, la lutte contre le dérèglement climatique est compatible avec le capitalisme, et ainsi de suite. Bien que certaines personnalités sérieuses invitées sur la station tentent ensuite de rétablir un semblant de vérité, c’est trop tard. La thématique, le ton de l’émission, les questions, les autres intervenants, tout est désormais calibré vis-à-vis de cette « actu ». Si vous osez pointer frontalement la supercherie, vous serez écarté (« trop de » quelque chose). L’anti-réel émerge de la machine, purgé de toute remise en cause des hiérarchies en place, comme un tampon de validation de la fin de l’Histoire.
5. Face à la rationalité néolibérale, saboter la machine ?
L’attaché de production est un des points d’ancrage de la néolibéralisation du travail journalistique. C’est notamment autour de lui que sont observables les conséquences de la généralisation de la « gouvernance » [1] dans les structures médiatiques : précarisation accrue du poste de travail concomitante à une sur-responsabilisation, passage d’une injonction de type haut/bas autour d’un ligne éditoriale claire à des mécanismes indirects de « conduite des conduites », émergence du « traitement de l’actualité » comme un marché autonomisé des autres sphères de la vie sociale, généralisation de la promotion des « bonnes pratiques » basée sur un « benchmarking » censé accroître « la compétitivité ». L’expérience sensible du métier d’atta pro est paradigmatique en ce sens.
Au début, on se demande comment il est possible que tant de liberté soit laissée à un jeune étudiant de M2 en sciences sociales pour construire les émissions de la première radio de France. Au milieu, on n’a même plus le temps d’y penser, il faut enchaîner. À la fin, une fois qu’on a réussi à sortir du tourbillon, on se rend compte que cette fameuse « liberté » n’en était en fait pas une : la seule solution existante pour honorer les missions qui sont les vôtres est d’appréhender et respecter la dynamique globale de la station, dont vous devenez dès lors un des multiples maillons. Une belle gouvernance, sans vague, sans conflit, bien huilée.
Comme pour les autres activités subventionnées car dites « d’intérêt public » (poste, transports, éducation etc), la généralisation du néolibéralisme dans les médias accompagne une dépréciation qualitative. En plus de conditions de travail internes de plus en plus fragiles, la rigueur du rapport au réel ne constitue plus la tâche première du travail journalistique. Pour se maintenir sur le marché de l’info, d’autres priorités sont à mettre en avant. Ce renversement a des répercussions sur le plan politique : la densité de la mission de formation d’un « citoyen éclairé » par la mise à disposition d’une information vérifiée s’étiole, la fonction de contre-pouvoir exercée par la critique des éléments de langage du pouvoir est de plus en plus lacunaire. La polarisation du travail autour du traitement de « l’actualité », et non plus de la réalité, nourrit la dynamique contre-démocratique inhérente au néolibéralisme. Le bal des experts en lien avec la volonté de rester compétitif encadre la disparition d’une relation cohérente (donc agonistique) au réel, centrée sur les luttes, les oppositions, les dominations, auxquelles la démocratie est censée par définition apporter une réponse sans cesse renouvelée. Comme le montre l’exemple médiatique, la généralisation de la rationalité néolibérale ne fait pas que fragiliser les piliers essentiels d’un partage démocratique du pouvoir : il participe à faire disparaître, à travers la transfiguration de ce qui compose l’essence du réel, l’existence même d’un idéal centré sur l’intégration constante et sans bornes du plus grand nombre dans les affaires de la cité.
Une fois qu’on se rend compte de tout ça, on fait quoi ? On reste ou « on se casse » ? Évaluons la première possibilité : continuer à faire l’atta pro pour France Inter. Déjà, ça rapporte un peu d’argent, argument à prendre en compte. Ensuite c’est sympa pour l’égo quand vous rentrez dans le village de 1500 habitants où vous avez grandi et que les potes de votre mère institutrice soulignent, impressionnées, qu’elles ont entendu votre prénom sur France Inter. Que ça doit être bien de travailler là-bas... oui oui, c’est super (haha) ! Si cette valorisation symbolique liée au fait que vous côtoyez le « show biz » n’est pas suffisante à vous faire rester, il faudra se poser la question fatidique : à quel point la machine est-elle sabotable ? C’est-à-dire, à quel point, dans votre position d’atta pro, vous êtes en capacité de court-circuiter (au moins un petit peu) la rationalisation néolibérale du travail journalistique ?
Dans les couloirs de France Inter, en lien avec une certaine éthique du service public assez largement partagée (les médias privés paient beaucoup plus, donc si vous restez à Radio France, c’est que vous accordez de l’intérêt à des choses extra-économiques), vous trouverez des « camarades » comme vous insatisfaits des évolutions de l’antenne. Des journalistes, d’autres atta pro, des réalisateurs, certains techniciens, beaucoup comprennent que la pente n’est pas souhaitable et s’organisent pour lutter contre. Ces « résistances », elles s’expriment par des petites phrases en conférence de rédaction, par des combats pour le maintien des quelques programmes de grande qualité proposés par la station (il y en a, vraiment), par des refus de faire encore une fois les choses « comme d’habitude », par des grèves contre l’énième réduction des effectifs. Des arguments existent pour rester.
A ce stade de la réflexion, il vous faudra prendre en compte deux observations, plus décourageantes cette fois. Premièrement, à France Inter comme sans doute ailleurs (à vérifier), les attachés de production, contrairement aux collègues journalistes et techniciens, ne sont pas organisés collectivement. C’est le néant. La nature même du poste, ultra précaire et interstitielle (nous ne sommes ni vraiment journaliste, ni vraiment autre chose), entrave les quelques volontés de mise en commun des initiatives de lutte. Ancrage du néolibéralisme, vous disais-je.
Deuxièmement, la rationalisation néolibérale se diffuse d’abord pour les heures de grande écoute, « La matinale » en tête de file. Dans la mesure où ce processus est lié à la volonté de France Inter (comme la plupart des autres gros médias) de « parler au plus grand nombre », c’est en toute logique dans les tranches principales d’information qu’il est le plus abouti et le plus verrouillé. Si vous avez comme objectif de torpiller la machine en son cœur, c’est dans ces espaces qu’il faudra réussir à pénétrer. Et là, le bât blesse. En trois ans de remplacements réguliers, je n’ai à titre personnel jamais été mobilisé sur la programmation de la matinale de la semaine. La directrice des ressources humaines sait pertinemment que je n’ai pas le profil adéquat pour répondre avec le dévouement nécessaire aux attentes de madame Salamé et monsieur Demorand (les attas pro de la matinale ont en effet comme principale caractéristique de ne jamais remettre en cause la pertinence de ce qu’ils produisent). La tranche principale de France Inter est une mécanique cadenassée, sur-contrôlée par la direction et encadrée avec poigne (pour ne pas dire autoritarisme) par la cheffe de la matinale chargée d’orienter tout ce beau monde dans la seule et unique direction possible. Pour un petit atta pro dénué de toute organisation collective, ça fait beaucoup à saboter.
6. Épilogue. Prométhée est dans la contre-allée
Si vous choisissez de rester, vous serez sans doute petit à petit écarté des tranches principales pour travailler sur des émissions moins importantes, traitant d’une actualité plus « froide », plus « magazine » (et par conséquent moins néolibéralisée). La pertinence d’un supposé court-circuitage de la dynamique de ces contenus n’est dès lors pas évidente. Surtout, vous deviendrez potentiellement à vos dépends coopérateur de l’avancée néolibérale dans la station : certains programmes réputés « de gauche » sont instrumentalisés par la direction pour faire passer la pilule. France Inter se droitise considérablement ? Comment pouvez-vous dire une telle chose alors qu’une bande de wokes fait des blagues tous les après-midi entre 17h et 18h ? [2] Évidemment. Entre la complicité et la complaisance, la fuite vous semblera l’option la plus tenable sur le plan moral. Votre mère ne comprendra sans doute pas, certains de vos amis non plus, mais peu importe. Claquer la porte apparaîtra comme la seule possibilité.
Officiellement sorti de la machine, vous serez désormais en capacité d’observer la globalité du paysage. Quelques chiffres, comme un boomerang, retiendront votre attention : la moyenne d’âge des gens qui écoutent France Inter est de 55 ans, les audiences radio ne cessent de chuter depuis plusieurs dizaines d’années, de moins en moins de personnes regardent la télévision. Bien plus que depuis l’intérieur grâce à des têtes brûlées éclairées, la dynamique de la lutte contre la rationalisation économique du travail journalistique vient de l’extérieur. Malgré la robustesse de la promotion de l’anti-réel, beaucoup sont parvenus à s’extirper du dispositif. Les expériences sensibles de la quotidienneté néolibérale marquées par la fragilisation, la déconsidération, la prédation, l’humiliation, la répression, la destruction, mettent en lumière la caducité grandissante de la production médiatique « grand public ». Quelque part, si le néolibéralisme porte en son cœur la négation de l’idéal démocratique, il est aussi une négation de lui-même. D’une manière ou d’une autre, la machine est vouée à s’autodétruire. Pour les petites et moyennes structures médiatiques périphériques engagées contre le néolibéralisme (et donc, par définition, classées à gauche [3]), ce constat oblige. Concentrées à rendre compte avec rigueur et consistance des affres agonistiques de notre contemporanéité, la responsabilité du rétablissement d’une relation saine au réel leur revient. Le besoin ne fait que de s’accroître et les idéaux seront réactivés dans son sillage. Prométhée est dans la contre-allée.
Maxime Cochelin