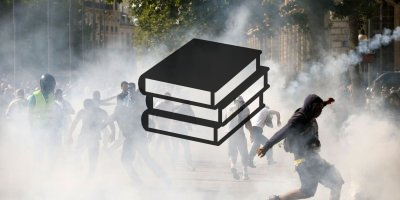Après bientôt deux mois de guerre en Ukraine, on a peut-être tendance à oublier les guerres quasi permanentes que mène l’Occident dans les pays du Sud. Je ne prétends en aucune façon minorer la violence déchaînée par le régime russe contre ses voisins. Cependant, comme nous l’a rappelé un texte signé de la Cantine syrienne de Montreuil [3], il ne faudrait pas « faire des pays occidentaux l’axe du bien ». « Rappelons, s’il le faut, poursuivent-ielles, que l’Occident a lui-même basé sa puissance (et continue de le faire) sur le colonialisme, l’impérialisme, l’oppression et la spoliation des richesses de centaines de peuples dans le monde entier. » C’est bien de cela que parle Mathias Delori dans ce livre. Plus précisément, il propose une « théorie de la violence libérale ». Qu’est-ce à dire ? Il s’agit de « la guerre contre le “terrorisme” engagée en 2001 par les États-Unis, avec le soutien de leurs alliés ». « On a pris une mitrailleuse pour tirer sur un moustique », selon un ancien responsable des services extérieurs français cité dès le début de l’introduction. Le même ajoutait dans la foulée que « si l’on avait évidemment raté le moustique, on avait fait, au passage, beaucoup de dégâts ». En effet, confirme Delori, « le “terrorisme” a causé la mort d’environ 4 000 civils en Europe et en Amérique du Nord depuis 2001, attentats du 11 septembre compris ». Or, « d’après des estimations prudentes, la barre des 4 000 victimes civiles (afghanes) fut atteinte après seulement trois mois de guerre en Afghanistan ». On sait que cette guerre a duré vingt ans, durant lesquels d’autres conflits ont été déclenchés contre de soi-disant « terroristes » et/ou États « complices de », etc. : Afghanistan, Irak, Mali, Syrie, sans parler des frappes aériennes (de drones) au Pakistan, au Yemen, en Somalie… Pour rester un instant dans les statistiques, on peut lire ceci dans la conclusion de Ce que vaut une vie : « Le réseau diplomatique Geneva Declaration a conduit une étude sur les “violences armées” entre 2000 et 2007. Le terrorisme n’était la cause que de 2% des 400 000 victimes civiles causées par ce type de violence. Ce chiffre s’explique facilement : les États, libéraux ou non, tuent beaucoup plus de personnes innocentes que les organisations terroristes. » Et pour terminer cette séquence d’arithmétique macabre, on ajoutera, toujours d’après Delori (dans sa conclusion, cette fois), que « les féminicides ont fait environ dix fois plus de morts » que le terrorisme en vingt ans (2001-2021) dans l’espace euro-atlantique [4].
On pourrait se demander pourquoi la guerre n’a pas été déclarée aux assassins de femmes, et comparer les montants des investissements consentis par les États dits libéraux dans la lutte contre les féminicides avec ceux de leurs interventions militaires à l’étranger… Mais le propos de Mathias Delori n’est pas exactement celui-ci. Il est plutôt d’explorer les mécanismes, les rouages de cette « violence libérale », les mythes qui la justifient et l’entretiennent, et les discours que tiennent ceux-là même qui l’administrent. Et cela concerne pas mal de monde. Peut-être, comme moi, avez-vous sursauté en entendant ces dernières semaines à la radio ce genre de phrase : « Poutine envahit l’Ukraine », « Poutine a fait ci, Poutine a fait ça ». Bien sûr, je ne veux pas minimiser sa responsabilité, mais il me semble tout de même que c’est parler trop vite et trop simple : même si cela ne m’enchante guère, je dois bien admettre que toute une armée lui obéit et que « son » opinion publique a minima, le laisse faire – sachant la censure, la répression impitoyable et tout le reste, mais.
Par « chez nous » (Europe-États-Unis) c’est pareil : il y a bien un appareil militaire et policier qui applique les décisions des chefs d’États à travers le monde entier. Et là, j’en vois qui se récrient : mais ce n’est pas pareil, nous somme civilisés, nous ! Et il est vrai que si « notre » discours est probablement plus policé (à nos propres oreilles, du moins – il faudrait demander aux « autres » ce qu’ielles en pensent, enfin, avant qu’ielles soient victimes « collatérales » d’un bombardement aérien par drone ou avion de chasse [5] ou qu’ielles soient noyée·e·s en Méditerranée [6]…), il n’en recouvre pas moins des choses pas jolies jolies…
Mathias Delori a enquêté sur les agissements (plus exactement sur la manière dont ils les justifient et dont ils sont légitimés par le discours dominant) de deux groupes de personnes bien différentes – en tout cas dans nos imaginaires : ceux qui conduisent des « interrogatoires renforcés » (à Guantánamo, Abu Ghraib et autres lieux de détention secrets de la CIA) sur des prisonniers suspects de terrorisme et ceux qui bombardent ces mêmes suspects (avant qu’ils soient arrêtés) depuis leur avion de chasse. Il a pu s’entretenir avec un certain nombre de pilotes français de bombardiers. Par contre, concernant les « interrogateurs » (on pourrait dire les tortionnaires, mais ils ont tendance à réfuter l’appellation, allez savoir pourquoi), il a dû se contenter de la littérature normative produite par l’administration américaine (ce que l’on peut ou ne peut pas faire en interrogeant un prisonnier) et quelques autres sources « indirectes ». Les uns sont très loin de leurs cibles – à plusieurs dizaines de kilomètres s’ils larguent leurs bombes depuis un avion, voire à des milliers s’ils pilotent un drone armé depuis le désert du Nevada [7]. Les autres sont tout près du prisonnier qu’ils ou elles [8] interrogent. Mais les un·e·s et les autres disposent du même répertoire moral et politique afin de justifier ce qu’ils font, à leurs propres yeux comme à ceux des autres. Il s’agit des déclinaisons de ce que Mathias Delori identifie comme les trois grands principes de la violence libérale.
1. La violence libérale est non intentionnelle et doit le rester. Plus exactement : on n’exerce pas la violence “pour le plaisir”, par sadisme en quelque sorte. En ce qui concerne les « interrogatoires renforcés », il s’agit d’obtenir des informations, des renseignements sur l’ennemi. On ne torture pas un prisonnier pour lui faire mal, mais on lui impose un certain niveau de stress, de pression, afin de le faire craquer psychologiquement et de le faire parler. Il y a eu, semble-t-il, pas mal de débats, principalement entre militaires et agents des services secrets états-uniens, les premiers protestant contre le principe des interrogatoires de plus en plus « renforcés », les seconds, au contraire, s’y livrant d’autant plus qu’ils étaient couverts par le secret de centres de détention sans aucune existence légale et discrètement dispersés à travers le monde. Chez les aviateurs, la non-intentionnalité s’exprime plutôt dans le cadre d’une certaine bureaucratisation, à travers toute une chaîne hiérarchique et une série de procédures d’engagement que Mathias Delori détaille dans son livre. Elle est également facilitée par une euphémisation du langage (comme, dans le cas précédent, « interrogatoire renforcé » pour « torture »). « [Les aviateurs] ne “tuent” pas d’autres êtres humains. Ils “bombent” (du néologisme “bomber”) des objectifs, “neutralisent” des ennemis, “traitent” des cibles et “délivrent des armements”. » Chez les uns comme chez les autres, il s’agit de concilier « humanité » et « efficacité ». Ce qui, finalement, n’est pas très éloigné du langage d’un ministre de l’Intérieur (« d’ici », comme La Provence est d’ici, voir note 5) justifiant les yeux crevés et les mains arrachées par les « forces de l’ordre » [9].
2. La violence libérale doit être maîtrisée. Ou proportionnée. En ce qui concerne les interrogatoires renforcés, les manuels précisent par exemple qu’ils doivent s’arrêter avant de (risquer de) provoquer la mort du prisonnier. Hum… Voilà qui peut donner prétexte à interprétation. Et qui a donné prétexte à interprétation : ainsi par exemple un interrogateur en Afghanistan a-t-il soutenu que les conventions de Genève [qui protègent en principe les prisonniers de guerre] n’interdisent pas d’infliger des souffrances aux prisonniers. Mieux (enfin, mieux pour lui, devrais-je dire, et pire aux oreilles de toute personne sensée) : il prétendait que le thème central de ces conventions serait que l’on « ne peut jamais traiter un prisonnier plus mal qu’on ne traite ses propres hommes ». C’est pourquoi, selon lui, on pouvait trouver une marge de manœuvre dans ces textes, qu’il définissait ainsi : « Ce serait de la triche si l’on interrogeait le prisonnier à plusieurs. Mais pourquoi ne pas adopter la règle selon laquelle les interrogatoires peuvent se poursuivre tant que l’interrogateur peut les supporter ? » (Je souligne. No comment.)
Mais du côté des aviateurs, ce n’est pas beaucoup mieux. Ici, la maîtrise de la violence, ou sa proportionnalité, se mesure à la « valeur » de la cible. Cette « valeur » détermine à son tour une « valeur seuil des victimes non combattantes » – soit des victimes « collatérales ». Ainsi, une cible de grande valeur augmente cette « valeur seuil » : lors de la guerre en Irak, elle était de trente pour ce type de cible : « En d’autres termes, écrit Delori, les aviateurs états-uniens qui avaient identifié une telle cible pouvaient ouvrir le feu si leur estimation du nombre de dégâts collatéraux était comprise entre zéro et vingt-neuf. » Il faut ajouter ici que les avions postmodernes embarquent des logiciels qui permettent ces évaluations… Le pilote entre différentes données, environnement (urbain ou pas), nombre d’habitants dans la zone, type et puissance de la bombe ou du missile, distance et angle de tir, etc. et la machine l’informe du nombre probable de victimes de son tir. Ce genre de dispositif fait partie de ce que Delori appelle les « technologies morales de la guerre aérienne », qui permettent à leurs utilisateurs (les pilotes) de tenir à distance, en quelque sorte leurs propres responsabilités.
3. La violence libérale doit être légale, soit encadrée par des textes législatifs et/ou réglementaires. Il faut lire à ce propos comment l’administration américaine a rédigé les manuels de torture… en prenant soin tout d’abord de l’« expatrier », en premier lieu à Guantánamo, ce qui a permis d’autoriser des procédures qui auraient été interdites sur le territoire des États-Unis. Et lorsque Guantánamo ne suffisait pas, il y avait encore les prisons secrètes de la CIA ailleurs dans le monde. Je n’ai ni le goût ni l’envie de détailler ici les prescriptions officielles en matière d’interrogatoires renforcés. Vous les découvrirez en lisant Delori, c’est l’horreur [10].
Quant aux pilotes, leur respect de la légalité n’a d’équivalent que leur inconscience des conséquences potentielles de leurs actes (ou peut-être, plus exactement, leur « indifférence » à ces conséquences, l’un d’eux utilisant précisément ce terme) – actes, il est vrai, quelque peu « désincarnés » : appuyer sur un bouton qui déclenche un tir vers une cible très distante… de plus, ils doivent toujours demander l’autorisation de le faire et ne disposent finalement que de peu de capacité d’initiative personnelle. Par contre, ils ont déclaré à Thomas Delori que s’ils recevaient l’ordre de lâcher une bombe thermonucléaire au-dessus d’une ville, ils le feraient sans état d’âme [11]. Ils servent un pays (la France) dont le Président, qui a le pouvoir de donner de tels ordres, est démocratiquement élu, donc, ils ne voient pas de problème à les exécuter.
Il y aurait encore pas mal de choses à dire sur ce livre très instructif. Je voudrais seulement dire encore un mot de sa conclusion qui m’a beaucoup touché. Il s’agit de la toute dernière section, intitulée « Resignifications poétiques ». « Des détenus de Guantánamo, écrit Delori, ont commencé à écrire des poèmes dès leur arrivée au camp, en 2001-2002. Quand le ministère de la Défense a eu vent de cette histoire, il a fait interdire ces textes au motif qu’ils représentaient “un risque pour la sécurité nationale en raison de leur contenu et format”. La direction du camp a ensuite procédé à la destruction des poèmes. Par exemple, les 25 000 vers rédigés par Shaik Abduraheen Muslim Dost furent intégralement confisqués et détruits par les gardiens. Pour s’assurer que de nouveaux poèmes ne verraient pas le jour, la direction du camp a ensuite ordonné la fouille de toutes les cellules. Tous les objets pouvant servir de support à l’écriture de poèmes (stylos, feuilles de papier) furent confisqués ou détruits. Les détenus ont alors commencé à utiliser de nouveaux supports, comme des gobelets en plastique, pour écrire leurs poèmes. Ils sont parvenus à en faire sortir une vingtaine. La direction du camp a riposté en distribuant des gobelets n’absorbant plus l’encre des stylos. »
Pourquoi cet acharnement contre les poèmes des détenus ? Voici l’explication qu’en donne Delori, non sans avoir consacré quelques paragraphes à cette notion de « re-signification » [12]. Ce sont les dernières lignes de son livre et ce seront aussi les dernières de cette recension, bien insuffisante, je le crains, pour rendre compte de sa richesse de contenu. Une seule solution : lisez-le !
« La poésie n’est pas le seul médium de resignification, mais elle possède un pouvoir particulier. Ce pouvoir découle du fait qu’elle est le langage où l’énonciation de la subjectivité du locuteur est la plus importante. Si l’orientalisme et le discours techno-stratégique constituent les victimes de la guerre contre le terrorisme en purs objets du discours, la poésie de résistance à la guerre contre le terrorisme les resubjective de manière radicale. Cette resubjectivation fait des victimes de cette guerre l’équivalent des victimes du terrorisme : des vies dignes de chagrin. »
franz himmelbauer (17 avril 2022)