Ici se pose la question de la réappropriation de la violence, dont les démocraties biopolitiques nous ont, avec toutes les expressions intenses de la vie, si parfaitement dépossédés. » (Tiqqun, « Introduction à la guerre civile »)
En trois décennies elle [la social-démocratie] a réussi à presque effacer le nom d’un Blanqui, dont la voix d’airain avait ébranlé le XIXe siècle. » (Walter Benjamin, « Thèses sur le concept d’histoire »
La question de l’usage de la violence au sein des différentes révoltes qui ont émergé depuis 2010 et 2011 est centrale dans les discussions politiques. Que ce soit en France, où Macron et son gouvernement parlent de « Black block violent » pour disqualifier les manifestations de Gilets jaunes, ou à Hong Kong où le Parti Communiste Chinois qualifie les manifestants « d’acteurs criminels, violents et impudents », les actes de révolte n’épousent pas les lignes politiques traditionnelles [1]. Les États refusent de leur côté d’employer le terme de « violence » quand ils usent de coercition : la « violence » est commise par des « criminels » ou des « coupables », jamais par eux-mêmes. L’État dissimule son propre usage de la violence derrière une rhétorique législative.
Lors des blocages de Buenos Aires en 2003, le président Nestor Kirchner déclarait : « Voter est la seule manière concrète et légitime de vivre ensemble dans un pays et une démocratie moderne et progressiste [2]. » Cette déclaration résume la conception commune de la politique comme dialogue et débat, aboutissant à glisser un bulletin dans l’urne lors des élections. Bien sûr, la plupart des sociologues et des historiens sont d’accord pour dire que la politique comprend aussi les grèves et les manifestations, les blocages et les piquets. Mais d’aucuns pensent encore pouvoir exclure du champ politique les événements violents comme les sabotages ou les émeutes. Lors des émeutes de Londres en 2011, plusieurs critiques de gauche ont déploré le manque de vue politique dont faisaient preuve les émeutiers ; selon eux, le pillage et l’émeute étaient l’expression de la disparition de la politique. David Harvey écrivait dédaigneusement que le capitalisme devrait passer en procès pour ses crimes mais que « c’est ce que ces stupides émeutiers ne peuvent ni voir ni exiger [3]. »

Dans le texte qui suit, je vais traiter de deux ouvrages, Rassemblement. Pluralité, performativité et politique de Judith Butler et Il n’y a pas de Révolution malheureuse / Le Communisme de la destitution de Marcello Tari. Tous deux analysent les nouveaux mouvements de révolte qui sont apparus depuis la crise financière de 2008 : les révoltes arabes, les émeutes en Grèce entre 2008 et 2011, Occupy aux États-Unis, les Indignés espagnols, les émeutes de Londres en 2011, le mouvement contre l’augmentation des prix du bus au Brésil, les grèves des étudiants chiliens, le mouvement démocratique à Hong Kong et la vague d’émeutes et de manifestations en France de Nuit Debout aux Gilets jaunes. Les deux livres ont le mérite d’élargir la manière dont on entend la politique afin d’y inclure les actes souvent considérés comme non-politiques. Je vais me concentrer sur la question de la violence et, en suivant Tari, j’avancerai qu’il est important de se débarrasser de toute idée « démocrate » de révoltes non-violentes.
Dans son livre de 2015, Rassemblement. Pluralité, performativité et politique, Judith Butler propose une analyse du mouvement d’occupation des places de 2011, qui comprend la réappropriation collective de places et d’espaces publics à Tahir au Caire, du Parc Gezi à Istanbul, du Park central à Hong Kong et du Zucotti Park à New-York [4]. L’explosion des occupations a peut-être duré un an ou deux – de nombreux commentateurs l’ont noté lors de la sortie du livre de Butler en novembre 2015 – mais il nous faut aussi regarder les événements en cours à Hong Kong, où des millions de gens manifestent à la fois contre le gouvernement local et le Parti Communiste Chinois, et Paris, où le mouvement des Gilets Jaunes a fait suite à Nuit Debout, afin de rejeter tout déni ou toute lamentation dépressive sur la disparition du dit mouvement d’occupation des places. Les gens sont toujours en train de descendre dans la rue, d’occuper des espaces publics et de montrer leur mécontentement contre le système établi.

Bien qu’il faille faire preuve de prudence envers tout lien de causalité stricte de type socio-économique entre crise et révolte, il est évident que cette nouvelle vague de protestation est liée à la crise financière et à un développement économique à plus long terme. La crise financière de 2007 et 2008 a révélé les conséquences brutales de l’atterrissage du capitalisme mondial après un long crash de quarante ans, au cours duquel les 1% ont amassé de la richesse tout en faisant des économies sur la reproduction sociale. La crise était déjà là, mais l’explosion des bulles financières a montré l’énormité des problèmes que cachaient les économies capitalistes occidentales depuis quatre décennies [5]. Rien n’indique que nous n’allons pas voir se développer de nouvelles manifestations et de nouvelles occupations dans les années à venir.
Le livre de Butler est une contribution à l’analyse de l’émergence du nouveau mouvement de révolte et son mode d’action de prédilection, l’occupation. Butter analyse ce qu’elle appelle une provisoire « théorie des assemblées », et affirme que la pratique plurielle des assemblées fait émerger les expressions de la volonté populaire hors des institutions du système politique et conteste réellement la revendication du pouvoir à être démocratique. Butler montre comment, « par l’assemblée », les occupations de places revendiquent l’espace public contre les stratégies de privatisation qui le dépolitisent. La dépolitisation est donc combattue « par le mouvement des corps, l’assemblée, l’action et la résistance », ce que Butler propose d’appeler « la souveraineté populaire » ou le « nous, le peuple ». Butler utilise ainsi sa propre théorie de la performativité pour montrer comment les assemblées réalisent une forme particulière de « nous, le peuple », « suspendant le pouvoir établi », protestant contre leur condition précaire et proclamant que la masse rassemblée fait partie du peuple ou est, tout simplement, le peuple. Le peuple en assemblée agit collectivement afin de défier la domination.
Non-violence
Tout au long de son analyse, Butler s’efforce de décrire les manifestations mais aussi d’autres actions de protestation comme « non-violentes ». Les occupations de place de 2011 sont caractérisées par la non-violence, écrit Butler. Et en effet, passant de l’analyse empirique à la théorie, elle suggère que les « assemblées […] ne peuvent réussir que si elles souscrivent au principe de la non-violence [6] ». L’analyse de Butler est surprenante dans la mesure où beaucoup d’occupations, si ce n’est toutes les occupations se caractérisaient pas des actions de violence physique puissantes où les manifestants se battaient contre la police et cherchaient à s’emparer de places et des lieux stratégiques de la ville. Cela est apparu le plus clairement peut-être en Égypte et en Tunisie. À Tahir et dans d’autres villes d’Égypte, par exemple, les manifestants ne se sont pas seulement battus avec la police et les forces de sécurité de Moubarak – en jetant des pierres et des cocktails Molotov et en utilisant comme béliers contre les officiers de lignes de police de grands véhicules improvisés – mais ils ont aussi mis le feu à un grand nombre de commissariats et de parlements.
Décrire ces actions comme non-violentes est problématique : l’énorme foule de la place Tahir au centre du Caire s’est rassemblée, a cuisiné, a discuté et a dormi sur les lieux mais elle a aussi barricadé la place, combattu la police et détruit le mobilier urbain et les bâtiments officiels. Bien sûr, les manifestants n’avaient pas à leur disposition le même équipement que la police et les forces de sécurité de Moubarak, mais ils utilisaient au mieux ce qu’ils avaient sous la main et au-delà de toute considération de violence et de non-violence. Comme le réalisateur égyptien Philip Rizk l’a déclaré : « Malgré la glorification de la non-violence de la révolution des dix-huit jours, la violence a joué son rôle dans cette révolution depuis le jet de la première pierre le 25 janvier 2011 – suivi trois jours plus tard par l’incendie des commissariats le vendredi de la rage – jusqu’à aujourd’hui (avril 2013 [7]). »
L’étrange appropriation des manifestations violentes par Butler sous la coupe de la non-violence fait des occupations de place des « luttes démocratiques ». Mais comme l’écrit Risk, il n’était pas question de démocratie, contrairement à ce qu’affirme Butler : la foule des manifestants qui occupaient la place Tahir contestait non seulement la dictature locale de Moubarak mais aussi le modèle néo-colonial tout entier, où « les pouvoirs étrangers maintiennent leurs intérêts économiques dans un pays en s’associant avec l’élite locale, maîtres du jeu par procuration ». En d’autres termes, il ne s’agissait pas seulement d’une révolte « politique », d’une revendication à la démocratie, mais aussi d’une attaque avant tout révolutionnaire contre la réalité socio-économique du néo-colonialisme. En analysant l’occupation de la place Tahir comme un problème de souveraineté politique et de démocratie, et en décrivant l’occupation comme non-violente, Butler finit par souscrire à la réception occidentale dominante du dit « printemps arabe », selon laquelle les manifestations voulaient une « transition démocratique » et des « réformes politiques [8] ». Blanchir les manifestants et les présenter, contrairement à toute évidence, comme des démocrates non-violents, constitue une tentative désespérée, et d’un orientalisme tardif, de transformer le renversement des régimes pro-Occident en victoires pour l’Ouest et ses « valeurs démocratiques ».
La description des manifestants comme non-violents risque aussi de faire le jeu des pouvoirs locaux. Comme Abdel-Rahman Hussein l’écrit dans « La Révolution égyptienne était-elle vraiment non-violente ? », au cours des manifestations, les autorités égyptiennes décrivaient tout acte de violence non-étatique comme de la brutalité commanditée ou de la petite criminalité et essayait de contenir et de faire échouer les manifestations en réprimant les éléments radicaux tout en donnant satisfaction à des revendications plus modestes [9]. En limitant le combat révolutionnaire anticolonial à une question de démocratie, Butler tend dangereusement à copier l’idéologie occidentale du changement de régime limité ou de la « transition démocratique ».
L’idéologie démocrate de la non-violence
Décrire les événements du Caire comme non-violents soulève des questions sur le cadre d’analyse politique et théorique de Butler. Comme l’a affirmé Joshua Clover, entre autres, Butler semble bloquée par sa compréhension quasi-arendtienne et idéalisée de la démocratie, selon laquelle la démocratie est la pierre de touche de toute résistance politique [10].
La démocratie fonctionne comme l’antagonisme positif aux régimes politique ordinaires dépolitisés. Laissant les revendications révolutionnaires de côté, Butler reste clairement au sein du régime idéologique ordinaire, ce qu’on peut appeler le « démocratisme », pour qui la démocratie est une « valeur transcendante », comme l’avance Clover, monopolisant le terrain politique et le vidant de ses spécificités historiques. L’appel à une autre forme de démocratie est problématique et ne permet que de consolider le système politique en place. La démocratie a saturé tout horizon politique. Comme le dit Mario Tronti : « La démocratie politique est réalisée [11] ». Et cette « démocratie réellement existante » est le triomphe de l’économie où démocratie signifie identification entre homo democraticus et homo economicus. Il n’y a aucune prise en compte de la dimension historique ni de l’économie politique dans l’analyse de Butler, au point qu’on aboutit à un agencement politique tout à fait abstrait où la démocratie est un invariant historique, et où les corps performatifs des places qui contestent le fonctionnement du système l’interpellent et lui demandent plus de démocratie ou une vraie démocratie. Aujourd’hui, plus que jamais, la démocratie fonctionne comme une représentation dominante au sens de Debord, une idée à travers laquelle la société capitaliste s’imagine elle-même [12]. Cependant, il est problématique de faire référence à la démocratie comme à quelque chose d’intrinsèquement bon – marqué par différents régimes et des variantes locales, mais essentiellement au-dessus de la critique.
La tentative de retravailler le privilège qu’Arendt donne au discours pour y inclure le corps, reproduit une distinction entre besoins et actes politiques. Comme si la lutte politique était "seulement culturelle" et se composait de corps en mouvement et d’actes de parole. Les actions publiques d’auto-constitution sont bien sûr très importantes dans toute lutte politique – les gens dormant à Tahir et ainsi remettant en cause les autorités – mais restreindre la résistance politique à de tels actes performatifs tend non seulement à laisser de côté les conditions matérielles des manifestants mais aussi à reproduire l’opposition entre les bons manifestants, non-violents, et les bandits, violents, autant qu’a négliger les changements structuraux à une vaste échelle liés à la loi générale de l’accumulation capitaliste analysée par Marx dans le Capital et, depuis, par des générations de marxistes.
L’analyse de Butler du nouveau cycle de manifestations soulève la question de la violence mais la referme rapidement. Si nous voulons comprendre cette nouvelle vague de manifestations, nous devons repenser la notion de violence au-delà de l’opposition entre violence et non-violence, et critiquer l’attachement à une conception transcendante de la démocratie. Comme l’ont montré, entre autres Karl Korsch, philosophe allemand conseilliste et Angelo Tasca, l’historien italien co-fondateur du Parti Communiste Italien, les démocraties nationales modernes sont tout à fait capables d’un tournant totalitaire en cas de crise et d’agitation sociale. Ce fut le cas en Europe dans l’entre-deux-guerres, quand les démocraties nationales en Italie et en Allemagne ont réprimé les mouvements révolutionnaires et ont opté pour un serrage de vis totalitaire pour sauvegarder le capital [13]. En temps de crise, les régimes démocratiques ont très souvent choisi l’ordre et le contrôle – lire la préservation de la propriété privée – afin d’empêcher toute contestation sérieuse de l’ordre dominant. L’arrivée au pouvoir de Trump, Salvini et d’autres politiciens tout aussi stupides témoigne de la plasticité totalitaire de la démocratie. Celle-ci constitue rarement un garde-fou contre l’exploitation capitaliste ou ce que nous pourrions appeler, en suivant Zizek, la violence structurelle ; en fait, elle a été elle-même un moyen très efficace d’organiser la force de travail en incluant ou en excluant la force de travail surnuméraire [14]. Le politique est économique, comme Marx l’a montré dans le Capital, toute transaction économique est basée sur une violence structurelle : « Entre deux droits égaux, qui décide ? La force ». Tout acte d’échange est un résidu de la violence originaire que Marx a appelé « l’accumulation primitive ».
La manière dont les corps humains peuvent être des sources de résistance permanentes et irrépressibles, qu’analyse Butler, est une contribution très importante à l’analyse de la subversion des actions soit-disants non-politiques, mais Butler reste attachée à l’idée libérale de la politique (démocratie et non-violence) et finit donc, paradoxalement, par restreindre le mouvement d’expansion de la politique qu’elle-même proposait. Parce qu’elle ne s’intéresse pas à la question de l’économie, elle ne s’intéresse, en définitive, qu’à la manière dont le système est géré, et non à un changement du système lui-même. Sa critique politique demeure limitée et décrit un capitalisme contrôlé démocratiquement, non l’abolition de la production de marchandises. La position révolutionnaire consiste à tenter de rendre l’État complètement inutile en détruisant l’économie.
Destituer l’État
Pour se faire une meilleure idée du rôle de la violence dans les nouveaux mouvements de révolte, nous pouvons nous tourner vers le dernier ouvrage du philosophe italien Marcello Tari, Il n’y a pas de Révolution malheureuse / Le Communisme de la destitution. En combinant l’analyse de Giorgio Agamben des relations entre la souveraineté et la forme-de-vie et les compte-rendus du comité invisible du flux et reflux des insurrections, Tari se propose d’analyser le nouveau cycle de révolte comme des révoltes destituantes, c’est-à-dire des révoltes qui n’ont aucun but directement politique ni aucun programme à réaliser [15]. Ces nouvelles révoltes sont caractérisées par un refus de la politique, un abandon du système politique établi. Il est question de destituer le pouvoir, de le changer ou de le suspendre, non de le remplacer par un nouveau gouvernement.
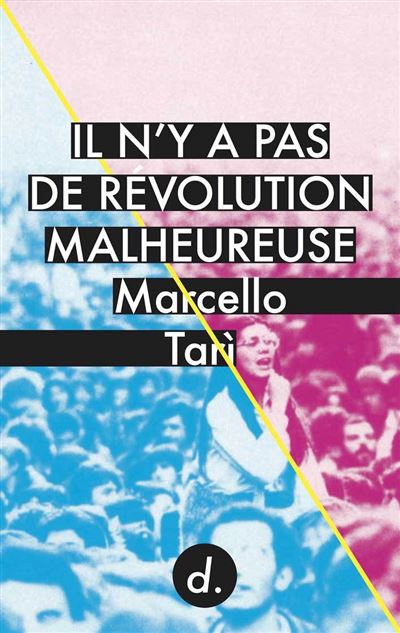
L’analyse de Tari début par la révolte des piqueteros en Argentine en 2001, où les gens sont descendus dans la rue en réponse à l’effondrement économique du pays. Les manifestants bloquaient les commerces et l’exercice du pouvoir gouvernemental en empêchant le mouvement et la circulation des marchandises, en bloquant les accès aux voies de circulation. Les Piqueteros s’organisaient en dehors des syndicats traditionnels et des partis politiques. Les manifestants s’opposaient explicitement à toute entrée dans la sphère politique publique établie et appelaient à la fin de la politique plutôt qu’à un nouveau gouvernement et à une nouvelle police.
Le slogan le plus populaire au sein du soulèvement : Que se vayan todos ! Que no se quede ninguno solo ! (Qu’ils s’en aillent tous ! Que personne ne reste !) fut ensuite repris dans la plupart des mouvements d’occupation de places en 2011 en Afrique du Nord et dans le Sud de l’Europe. Tari montre l’importance de la deuxième moitié du slogan, souvent ignorée : il ne s’agit pas de remplacer un gouvernement, un leader politique par un autre. Ce slogan exprimait l’exaspération des manifestants non seulement contre un gouvernement ou certains problèmes concrets tels que la corruption généralisée, mais contre la structure du gouvernement toute entière et la politique telle qu’elle s’est instituée dans les sociétés capitalistes modernes. Comme Tari le montre, le slogan fait preuve d’une simplicité presque naïve, mais aussi d’une critique révolutionnaire radicale : « tous les dirigeants, tous les patrons, tous les menteurs, tous les politiciens, tous les lâches, tous les dirigeants, tous les corrompus et les corrupteurs, tous doivent partir. Fichez le camp - vous ne serez ni fusillés, ni guillotinés, partez, maintenant. Voici de la violence désistante... ».
Selon Tari, les différentes révoltes qui ont eu lieu dans le monde au sein d’un mouvement éparpillé et discontinu, depuis le mouvement des piqueteros de 2001 jusqu’aux révoltes arabes en Égypte et en Tunisie et au-delà, témoignaient toutes de ce désir de destitution : Dégage !, comme criaient les révolutionnaires tunisiens contre Ben Ali. Les Indignés en Espagne, le mouvement Occupy et les mouvements, en France en 2016 et en 2018-19 se caractérisaient tous par ce geste anti-politique qui refusait de se contenter de réformes limitées d’un système à bout de souffle. « Le monde ou rien », comme l’écrivaient les manifestants à Paris en 2016.
Dans les différents slogans, apparaît ce que Tari appelle « un désir de destitution », c’est-à-dire d’une rupture révolutionnaire avec la société existante dans sa totalité. « Que personne ne reste ! » criaient les manifestants en Argentine en 2001 . Le système démocratique en place avec ses élections, ses règles, ses médias, ses partis doit partir. C’est un vase creux, un spectacle où les partis s’affrontent pour gérer un système qui est devenu automatique à un point tel que savoir qui va gagner les élections n’importe plus. La politique s’est mêlée au marché. Contrairement à l’analyse de Butler, la démocratie aujourd’hui est avant tout une idéologie qui produit des sujets consommateurs qui votent, un système sans dehors où on ne peut apparaître que comme votant et comme consommateur. La démocratie cache son vraie travail : la production de votants qui croient qu’ils décident encore.
Contre les rituels et les institutions de la démocratie réelle, ses négociations et ses élections, les mouvements de révolte ont mis en avant la communauté anonyme de la rue. Un spectre hante le parlement évacué. Quand les gens sont dans la rue, occupent les places, le gouvernement ne gouverne pas. Comme l’avance Tari : « le problème révolutionnaire est ainsi d’empêcher cette puissance d’être capturée dans une forme de gouvernement. ». Ne jamais entrer dans les structures institutionnelles mais les rejeter.

Bien que ces révoltes n’aient pas encore pris la forme d’un mouvement révolutionnaire international comme l’offensive prolétarienne de 1917 à 1921, Tari y voit le retour d’un communisme révolutionnaire. Ou, plus précisément, une reformulation du communisme où la révolution cède la place à la destitution : le communisme de la destitution. La révolution n’est plus un problème de réalisation d’un programme politique – pendant longtemps, au XXè siècle, le programme des léninistes et des socialistes était la socialisation des moyens de production – de réalisation de quelque chose comme si cela n’existait pas déjà : le communisme comme aboutissement d’une révolution politique. Le communisme destituant abandonne l’idée de réalisation d’un idéal par une action et, ainsi, il n’y a pas de programme à mettre en pratique. Il n’est plus question de proposer une série d’actions ou d’institutions qui suivent ou confirment un programme communiste. Selon Tari, qui suit sur ce point Agamben, la révolution consiste à désœuvrer le pouvoir, à rendre impossible le fonctionnement de la politique, la reproduction de ses lois. Ces nouvelles révoltes destituantes ne transgressent pas seulement les lois, ne s’opposent pas seulement à l’État, elles se retirent de l’État et des lois. Il n’est pas question de critiquer ou de détruire les lois existantes pour établir une nouvelle loi. Le projet est une opération plus complexe où la loi est suspendue, rendue irréelle. Par suite, il devient impossible de suivre les lois (autant que de les briser).
L’anarchie réelle
Suivant la lecture de Walter Benjamin proposée par Giorgio Agamben, Tari affirme qu’il n’est pas question d’éviter la violence ou d’essayer de s’opposer à un système anti-démocratique avec des corps assemblés non-violents pour réaliser une vraie démocratie, comme l’affirme Butler ; il est question d’abandonner le pouvoir tout entier, de briser le lien entre loi et violence. Comme Benjamin le montrait déjà en 1921, dans son texte énigmatique et très commenté, « Pour une critique de la violence », la police et la politique sont mêlés dans l’État moderne capitaliste. La violence de la police témoigne d’une collusion entre la constitution de l’État et le pouvoir établi, de l’anarchie immanente à l’État. La répression violente de la révolution allemande de 1921 mise en œuvre par le président social-démocrate Friedrich Ebert a montré la dimension anarchique et violente de la politique. Elle a montré que la loi peut se suspendre elle-même en faveur d’un état d’urgence où il est possible d’assassiner des révolutionnaires ou de tirer sur des manifestants [16]. Dans son texte, Benjamin argumente en faveur de la destitution – Entsetzung en allemand – de la loi et de l’État, c’est-à-dire le désœuvrement (ent) de l’institué (- setzen). L’État, Gewalt comme gouvernement, doit être démis ou destitué.
Benjamin et Tari tentent de penser une violence différente, tout à fait en dehors ou au-delà de la loi. L’opposition entre la violence et la non-violence est ainsi remplacée par l’idée d’une violence non-juridique, d’une violence révolutionnaire qui brise la dialectique d’une « violence fondatrice du droit ou préservant le droit », qui délaisse l’encadrement étatique de la violence au profit d’une pure violence qui ne trouve pas ses causes en dehors d’elle-même, soulignant l’encadrement juridique des droits par le Droit. Contre la pseudo-anarchie de l’État, où l’état d’exception est toujours présupposé et reproduit (dans un mouvement d’« exclusion inclusive », comme l’appelle Agamben) Benjamin essaie de situer un véritable état d’exception en dehors de la loi. Comme l’écrit Thanos Zartaloudis, Benjamin veut briser « le continuum de la dialectique de la violence au sein de l’encadrement juridique de l’action des êtres humains », en dé-juridisant « le plan éthique de l’existence [17] ». La révolution consiste en un abandon de la juridiction étatique imposée à la vie. La pure violence est rupture avec l’ordre. Une destitution de l’État et de l’histoire. La fin de la gouvernance.
Tari tente de penser la révolution d’une manière nouvelle à partir des mouvements de révolte contemporains. Les nouvelles révoltes ne visent aucune réforme économique ou juridique. Elles suspendent la politique classique et proposent une temporalité différente. Il n’y a pas de but politique futur, les révoltes « bloquent le fonctionnement normal de la société », ils rendent la société ingouvernable en se lançant dans un processus matériel immédiat de transformation de la vie telle qu’elle est vécue dans la ville capitaliste. Le défi est objectif : l’ancien vocabulaire révolutionnaire n’est plus disponible désormais et les révoltés doivent expérimenter et réinventer la révolution. Le mouvement ouvrier en Occident et son projet politique se sont révélés compatibles avec le mode de production capitaliste. Le communisme doit donc être extrait des ruines du socialisme réel, de l’État planificateur de l’après-guerre et de tous les groupes gauchistes continuant à organiser le passé, qui entravent concrètement tout réel mouvement de lutte.
À rebours des tentatives démocrates de Butler de différencier la violence illégitime de la non-violence légitime, Tari s’efforce de mettre en avant le geste radical présent dans ces révoltes – un geste qui ne peut être contenu au sein de la démocratie réelle mais attaque ce modèle même et ses bases politico-économiques. Nous sommes confrontés à l’émergence d’un récent fascisme de gouvernement, et cela n’a aucun sens d’essayer de sauver l’ordre politique démocratique en place, comme le propose Butler. Cette analyse rapide masque la possibilité « totalitaire » inhérente aux démocraties nationales, le fait que leur fonction est de réguler la force de travail, d’absorber ou d’exclure le travail des migrants ou de quiconque se trouve éjecté de ce modèle. Nous sommes déjà « en guerre » contre l’État.

La contre-révolution
Depuis 2009-2011, nous avons vu arriver un régime anti-terroriste élaboré qui se propose de prévenir l’émergence d’alternatives à l’ordre existant. La guerre au terrorisme et l’État d’urgence étaient en fait déjà en place, comme le montrait la répression du G8 de Gênes en juillet 2001, où la police italienne a tué un manifestant de 23 ans et a frappé plusieurs centaines de manifestants et de journalistes. Rétrospectivement, l’écrasement de la place Tiananmen en 1989 apparaît comme le début de l’organisation d’une nouvelle époque de contre-révolution. Le capital fait de son mieux pour empêcher toute négation révolutionnaire, en contrôlant les migrants et en étouffant les révoltes.






