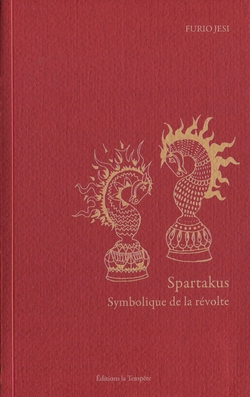
- Spartakus, Symbolique de la révolte de Furio Jesi vient de paraître aux éditions la tempête.
- Lundimatin : Furio Jesi est peu lu et peu connu en France. Comment expliquez-vous un tel silence autour de cet auteur ? Et comment préféreriez-vous le présenter ?
- Andrea Cavalletti : Ce silence est déjà en soi éloquent : il en dit long sur la grande édition, sur ses patrons et ses courtisans. Mais heureusement il existe les éditeurs indépendants, intelligents et courageux. Jesi a été un grand savant, un enfant prodige (il a fait ses débuts d’égyptologue à quinze ans à peine) qui a refusé l’école, qui n’a pas fréquenté l’université et qui, nommé professeur par « réputation », a enseigné seulement dans les dernières années parce que ses métiers de traducteurs et d’essayiste ne parvenaient plus à subvenir à ses besoins. Il a été très engagé politiquement, sur des positions d’extrême-gauche. Il venait d’une famille juive, et pendant la Guerre des Six jours il a tenu une position nette et dure contre la « mythologie technicisée » (c’est-à-dire l’usage de raisons religieuses à des fins politiques) de l’État d’Israël. En plus d’être égyptologue, Jesi a été surtout un mythologue, inspiré de Karl Kerényi dont il se considérait l’élève, mais aussi un germaniste et un philosophe ; et il fut en même temps, pour utiliser une formule de Walter Benjamin, un « Autor als Produzent » (« l’auteur comme producteur »), qui connaissait très bien et combattait les mécanismes de l’industrie culturelle et qui écrivait ses propres essais selon une technique originale de composition. Jesi a disparu à seulement 39 ans mais il a énormément écrit, publiant 20 ouvrages, et laissant quelques inédits d’importance, dont Spartakus. Et c’est vraiment dans le sous-titre de ce livre, « Symbolique de la révolte », qu’il a exprimé le problème qui lui tenait peut-être le plus à cœur : celui des survivances contemporaines, mystérieuses et déformées, des anciennes mythologies, du rapport entre la force du mythe et l’action politique.
- LM : Vous avez découvert et publié Spartakus plus de vingt ans après la mort de son auteur. Pourriez-vous retracer pour nous l’histoire de ce manuscrit ?
- AC : Jesi a disparu en 1980 et quasiment vingt ans après, en effet, j’ai retrouvé l’enveloppe de Spartakus parmi les papiers conservés par sa femme Marta. Comme dans le cas d’un autre inédit, Bachofen (2006), j’ai découvert les premières traces de son existence dans les lettres que Jesi écrivait régulièrement aux amis savants avec lesquels il était en rapport. Spartakus a été remis à la maison d’édition (Silvia), dans une version définitive, fin 1969. Toutefois, à cause des problèmes économiques de l’éditeur, la sortie a été repoussée sine die. Ce n’est que plusieurs années après que Jesi est parvenu à récupérer la seule copie intégrale du texte dactylographié. À ce stade, cependant, il était en mesure de reprendre le thème central (ainsi que quelques pages) de Spartakus dans un autre de ses chefs-d’œuvre, l’essai Lettura del “Bateau ivre” di Rimbaud (Lecture du Bateau ivre de Rimbaud, 1972), où il expérimente le modèle de la « machine mythologique », qui représente sans doute une de ses plus grandes contributions méthodologiques. Il s’agit d’un modèle cognitif qui est en même temps un modèle autocritique, adressé à la position du mythologue même. D’un côté, donc, Spartakus avait non seulement perdu de son actualité, mais également conditionné ce tournant théorique important ; de l’autre côté, la « machine mythologique » imposait à présent des développements nouveaux. Il faut se souvenir, à ce propos, que Jesi cite au début du livre une phrase de Carl Justi : « l’homme vit ou devrait d’abord vivre avec les morts, puis avec les vivants et enfin avec lui-même. » Si le travail précédent, Germania segreta [Allemagne secrète] (publié par Silva en 1967), correspondait au premier moment, et Spartakus à la rencontre avec les vivants, avec l’élaboration de la « machine mythologique » Jesi était désormais en prise avec lui-même. Ceci pourrait expliquer pourquoi le livre est resté longtemps inédit. Mais ce qui compte, pour parler comme Benjamin, est le "maintenant de sa connaissabilité".
- LM : Spartakus a été écrit juste après les barricades de Mai 68. Quel a été l’impact de cet événement sur la théorie de Jesi et sur sa lecture de la révolte spartakiste ?
- AC : En effet, Spartakus naît en partie d’un voyage à Paris que Jesi avait entrepris avec un ami, et de la déception tirée de cette expérience. En ce sens, il ne serait pas faux de dire qu’il ne s’agit pas seulement d’un livre sur la révolte, mais aussi sur son échec, c’est-à-dire sur les mécanisme capables d’empêcher qu’une révolte devienne une révolution. Ces mécanismes, pour Jesi, ne sont pas uniquement d’ordre économique, mais aussi pour ainsi dire superstructurels, ou mythologiques. La lutte contre ces mécanismes coïncide ainsi avec l’activité du savant. C’est pourquoi Spartakus n’est pas une « histoire » des événements de janvier 1919 (qui pourrait même prétendre nous enseigner quelque chose sur 68), mais une tentative pour vivre la révolte, et pour « expérimenter » depuis l’intérieur du phénomène insurrectionnel – en dépit des mécanismes de domination qui conduisent à sa fin, à la mort et au sacrifice. Spartakus est une œuvre de « dé-mythification » ou de « destruction » des mythologies du pouvoir, qui sont justement des mythologies de mort ; et c’est là que réside, je dirais, son inspiration profondément anarchiste. Naturellement, je ne fais pas allusion à une foi ou à un militantisme, mais à une idée de la mythologie qu’on pourrait définir comme une an-archéologie. Soucieux de faire obstacle à toute prétention originaire du mythe, à toute idée du mythe « marquée par un “Ur-”, un “Arche-” », qui fonde et maintient un certain état des choses, Jesi clôt ce livre, dédié en grande partie à Rosa Luxembourg et à Karl Liebknecht, avec le nom de Bakounine, et avec la citation assez explicite d’un fameux passage d’État et anarchie sur la révolte comme destruction salutaire et féconde, à travers laquelle peuvent naître des mondes nouveaux.
- LM : Nous avons vécu ces derniers mois, en France, une période intense de révolte contre la « Loi travail ». À Paris, le mouvement a pris en grande partie la forme d’importantes – et vigoureuses – manifestations de rue : quel est le rôle de la rue dans le conception de la révolte portée par Jesi ?
- AC : Un des plus beaux passages de Spartakus, que Jesi reprendra dans la Lecture du “Bateau ivre”, dit : « c’est seulement à l’heure de la révolte qu’on appréhende vraiment la ville comme sa ville : elle est en même temps sa propre ville et celle des « autres » ; parce qu’elle est champ de bataille choisi par soi et par la collectivité ; parce qu’elle est un espace circonscrit dans lequel le temps historique est suspendu et dans lequel chaque acte vaut pour lui-même, dans ses conséquences absolument immédiates. On s’approprie davantage une ville en la fuyant ou en s’y exposant qu’en jouant, enfant, dans ses rues ou qu’en s’y promenant plus tard avec une fille. À l’heure de la révolte on n’est plus seul dans la ville. »
Le thème de la ville est très présent d’autre part dans le livre précédent, Germania segreta, mais il s’agissait encore seulement de la ville du pouvoir, de la ville des morts, extérieure et menaçante, avec ses ombres expressionnistes très marquées. Parallèlement à Spartakus, Jesi écrira ensuite un roman, intitulé L’ultima notte [La dernière nuit]. C’est un roman fantastique, empreint d’humour, peuplé de vampires, mais de vampires qui s’insurgent, se rebellent contre l’oppression des hommes. Et c’est de cette matière romanesque et parodique que surgit la Turin de la contestation et des luttes ouvrières de la fin des années 60 :
de nombreuses personnes en fuite affluèrent dans la rue de façon désordonnée ; certaines poursuivirent leurs courses, d’autres s’arrêtèrent… et commencèrent à rassembler des pierres et à abattre des palissades pour se faire des bâtons. Un grondement cadencé s’approchait rapidement depuis le fond de la rue, et semblait même provenir du ciel obscur... »
La connaissance de la ville dans l’instant de la révolte coïncide pour Jesi avec le réveil collectif, c’est-à-dire avec l’expérience d’un « mythe véridique ». Si donc les mythifications et les manipulations bourgeoises maintiennent les hommes dans un état de solitude et d’engourdissement, la révolte est un instant de vérité, de « fulgurance de connaissance ». C’est là pour Jesi le rôle des émeutes et des barricades. La révolte reste toutefois un événement instantané : dans sa gestation même, des éléments ambigus ou bien des manipulations sont susceptibles d’agir, qui l’exposent à une fin tragique.
- LM : Un des buts de Spartakus est de « démythifier » les figures des héros révolutionnaires qui sont morts en combattant. Dans quelle mesure est-ce là une des tâches majeures que se fixe Jesi ?
- AC : Jesi identifie justement le mythe du sacrifice et la mythification du héro comme un de ces éléments ambigus, ou mieux comme un résidu capable de miner depuis l’intérieur la dynamique de la révolte. Si le sacrifice sanglant (de Rosa Luxembourg et de tant de ses camarades) met fin à l’insurrection et réactive le « temps normal » de la société bourgeoise, la mythification des héros morts pour la cause (dans les célébrations du parti mais aussi dans le théâtre expressionniste) appartient à ce « temps normal » et le maintient, en liant pour toujours révolte et sacrifice. Jesi accomplit par conséquent une expérience de « dé-mythification », et son modèle est Trommeln in der Nacht (Tambours dans la nuit) de Brecht, qui est justement la parodie du héro et, dans le même temps, du personnage du héro dans le théâtre expressionniste. Jesi, j’insiste, vise à une connaissance interne de la révolte, qui permette de la répéter, de la revivre, c’est-à-dire de la réactiver là même où le sacrifice (ou bien la mythologie du sacrifice) semble y mettre fin. Pour cela, il entreprend une critique de la représentation spartakiste de l’ennemi. Les rebelles, nous fait-il remarquer, avaient raison de voir dans le patron l’ennemi vrai, mais ils se trompaient en le représentant et en le voyant comme quelqu’un de monstrueux et d’inhumain. Ils appliquaient alors à l’ennemi de classe le même masque qui avait été fabriqué et appliqué par le capitalisme à un autre ennemi, celui-là non véridique, combattu dans les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Et cette représentation de l’ennemi-monstre, produite par le pouvoir, avait une véritable incidence sur le comportement des rebelles, et obtenait le même résultat obtenu à la guerre : en combattant un monstre, les spartakistes devaient se comporter de manière humaine, loyale, et devaient démontrer leur propre humanité face à un adversaire déloyal, vil, qui allait se comporter de manière inhumaine ; ils devaient donc (comme le firent effectivement Luxembourg et Liebknecht), au lieu de fuir, rester à Berlin aux côtés des camarades désormais battus, et se sacrifier pour être vraiment humains. Le « monstre », dit Jesi, « se révélait vraiment dépositaire d’une puissance tandis que ses adversaires sentaient la nécessité de lui opposer la puissance de la vertu héroïque ». Réagissant à cette mythologie tragique, Brecht avait esquissé le personnage comique d’Andreas Kragler, capable de ne pas se sacrifier en tournant le dos au dernier moment à la révolte. L’expérience théorique de Jesi, son interprétation géniale de Brecht, vise à tourner le dos au sacrifice et non à la révolte.
- LM : Un des gestes théoriques de Jesi dans ce livre est de distinguer la révolte de la révolution ; la première étant une suspension du cours du temps, et la seconde une inscription, dans le cours du temps, d’une stratégie consciente. Si Rosa Luxembourg a péri entre les mains des Freikorps, c’est, selon lui, de ne pas avoir pris en compte l’importance de cette distinction : qu’est-ce que cela signifie ?
- AC : Oui, Jesi affirme que Rosa Luxembourg voyait aussi l’insurrection, et son échec, dans une optique stratégique, comme une étape dans le long processus révolutionnaire. Ce qui signifie comprendre cet échec et le sacrifice d’un point de vue « plus élevé », mais aussi, dans la même optique, les accepter, rester sans défense face à ce qu’ils ont de fascinant. La distinction entre révolution (comme ensemble de changements dans le temps historique) et la révolte (comme suspension du temps historique) est à l’inverse cohérente avec l’entreprise de dé-mythification. Et à l’enquête sur la structure économique (dans laquelle Rosa Luxembourg excellait) elle privilégie l’étude des mythologies et des symbolisme, des matériaux poétiques et littéraires. En cela Spartakus, comme Jesi l’écrivit à un ami, « ressemble davantage à Finnegan’s Wake qu’à L’Accumulation du capital » – c’est un monologue à la fois vertigineux et cohérent, un montage serré de motifs apparemment plus lointains, où la reconstitution des événements s’accompagne d’analyses des œuvres de Mann, Theodor Storm, Brecht et Dostoïevski. Le niveau théorique est pour Jesi absolument inséparable du niveau politique. D’autre part, sur un plan proprement politique et théorique à la fois, sa rupture avec Karl Kerényi s’était consommée en mars 1968. « Les temps doivent être particulièrement sombre », écrivait alors Jesi dans sa dernière lettre à celui qui avait été pour lui un « maître depuis l’adolescence » : « Je doute, qui plus est, qu’ils s’éclairciront sans préalablement s’assombrir davantage – c’est-à-dire, sans qu’ils n’atteignent préalablement un point de crise. Cette crise se déploiera probablement dans la rue et l’on s’y battra avec des armes ... »
- LM : Beaucoup considèrent aujourd’hui que le temps des révolutions est terminé, et que nous vivrions désormais dans un temps de révoltes. Qu’est-ce que Jesi aurait pu penser d’une telle affirmation, d’après vous ?
- AC : Jesi utilisait parfois l’expression de « sociologisme vulgaire ». Ceci dit, d’un côté, il nous a rappelé que du point de vue du pouvoir il vaut mieux que la tension se décharge en une révolte, avant de mûrir en tension révolutionnaire, et que les révoltes ne sont pas étrangères à la « manipulation du temps ». D’un autre côté, il nous a appris que la dé-mythification, dans la révolte même, peut répondre à cela. Pensons par exemple au problème et au rôle de la violence de rue : comme l’a écrit Jesi dans un article politique en novembre 1969, (« I vandali e lo stato » – « Les vandales et l’État »), au-delà de son efficace immédiate, « l’affrontement violent… a au moins l’avantage de démythifier les symboles de la manifestation bien ordonnée et du cortège bien ordonné, qui sont des occasions de complaisance et d’auto-illusion, où on se trompe et où on se réjouit à peu de frais d’une force en réalité modeste ». Il est évident que Jesi refuserait comme tout aussi illusoire une complaisance de sens opposé. Le problème n’est toutefois pas la violence en soi, mais bien sa mythification, c’est-à-dire la mythologie de la violence comme principe, comme prétention fondatrice – ou constituante. Rappelant en cela Benjamin, que Jesi aimait beaucoup, la dé-mythification est une forme de Ent-setzung, de destitution.








